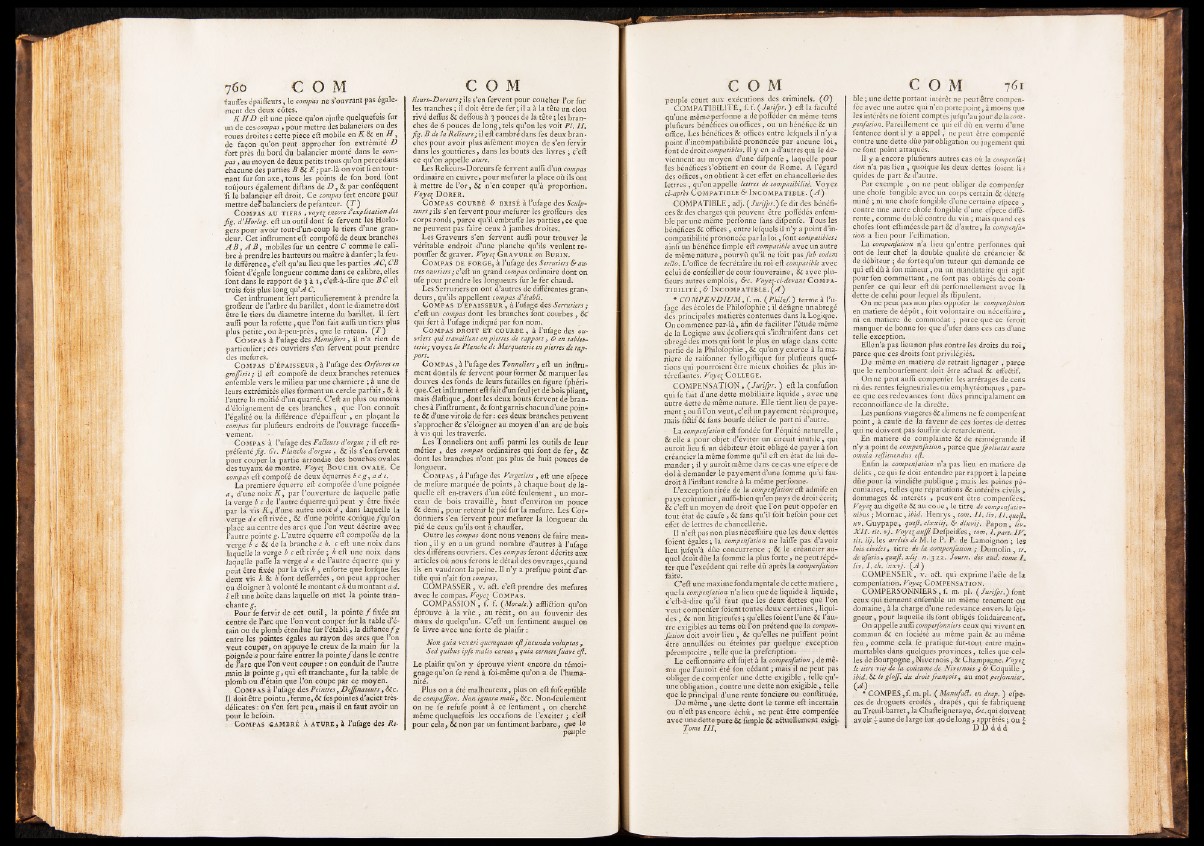
“fauffes épaiffeurs, le compas ne s’ouvrant pas également
des deux côtes.
K H D eft une piece qu’on ajufte quelquefois fur
un de ces compas, pour mettre des balanciers ou des
roues droites : cette piece eft mobile en K 8c en H ,
de façon qu’on peut approcher fon extrémité D
-fort près du bord du balancier monté dans le compas
, au moyen de deux petits trous qu’on perce dans
chacune des parties B 8c E ; par-là on voit li en tour-
■ nant fur fon axeg tous les points de fon bord font
toujours également diftans de D , & par confequent
"fi le balancier eft droit. Ce compas fert encore pour
mettre des balanciers de pefanteur. (T1)
COMPAS au tiers ,voye{ encore l'explication des
fig. d'Horlog. eft un outil dont fe fervent les Horlogers
pour avoir tout-d’un-coup le tiers d’une grandeur.
Cet inftrument eft compofé de deux branches
A B , A B , mobiles fur un centre C comme le calibre
à prendre les hauteurs ou maître à danfer ; la feule
différence, c’eft qu’au lieu que les parties AC, CB
foient d’égale longueur comme dans ce calibre, elles
font dans le rapport de 3 à 1, c’eft-à-dire que B C eft
trois fois plus long qu’^f C
Cet inftrument fert particulièrement à prendre la
groffeur de l’arbre du barillet, dont le diamètre doit
être le tiers du diamètre interne du barillet. Il fert
aufli pour la rofette, que l’on ,fait aufli un tiers plus
plus petite, ou à-peu-près, que le rateau. ÇT)
COMPAS à l’ul'age des Mentùjiers , il n’a rien de
particulier ; ces ouvriers s’en fervent pour prendre
des mefures.
C ompas d’épaisseur , à l’ufage des Orfèvres en
grofferie; il eft compofé de deux branches retenues
enfemble vers le milieu par une charnière ; à une de
leurs extrémités elles forment un cercle parfait, & à
l’autre la moitié d’un quarré. C ’eft au plus ou moins
d ’éloignement de ces branches , que l’on connoît
l ’égalité ou la différence d’épaiffeur , en plaçant le
compas far plûfieurs endroits de l’ouvrage fuccefli-
vement. -
C ompas à l’ufage des Facteurs d ’orgue ; il eft re-
préfenté fig. Ci. Planche d orgue, 8c ils s’en fervent
pour couper la partie arrondie des bouches ovales
des tuyaux de montre. Voyeç Bo u ch e o va le. Ce
compas eft compofé de deux équerres b c g , ad e.
La première équerre eft compofée d’une poignée
a , d’une noix K , par l ’ouverture de laquelle paffe
la verge b c de l’autre équerre qui peut y être fixée
par la vis K , d’une autre noix d , dans laquelle la
verge de eft r iv é e , 8c d’une pointe .conique/qu’on
place au centre des arcs, que Ton veut décrire avec
l’autre pointe g. L ’autre équerre eft compofée de la
verge b c Ce de la branche c h. c eft une noix dans
laquelle la verge b c eft rivée ; h eft une noix dans
laquelle paffe la verge d e de l’autre équerre qui y
peut être fixée par la v is h , enforte que lorfque les
deux vis A & A font defferrées , on peut approcher
ou éloigner à volonté le montant c A du montant a d.
i eft une boîte dans laquelle on met la pointe tranchante
g.
Pour fe fervir de cet outil, la pointe ƒ fixée au
centre de l’arc que l’on veut couper fur la table d’étain
ou de plomb étendue fur l’établi, la diftance f g
entre les pointes égales au rayon des arcs que l’on
veu t couper, on appuyé le creux de la main fur la
poignée d pour faire entrer la pointe ƒ dans le centre
de l ’arc que l’on veut couper : on conduit de l’autre
main la pointe g , qui eft tranchante, fur la table de
plomb ou d’étain que l’on coupe par ce moyen.
C ompas à l’ufage des Peintres, Deffinateurs, &c.
Il doit être pointu,ferme,& fespointes d’acier très-
délicates : on s’en fert peu, mais il en faut avoir un
pour le befoin.
C ompas c am b ré à ature , à l’ufage des Relieurs
Doreurs; ils s’en fervent pour coucher l’or fur
les tranches ; il doit être de fer ; il a à la tête un clou
rivé deffus 8c deffous à 3 pouces de la tête ; les branches
de 6 pouces de long, tels qu’on les voit PI. II.
fig. B de la Relieure; il eft cambré dans fes deux branches
pour avoir plus aifément moyen de s’en fervir
dans les gouttières, dans les bouts des livres ; c’eft
ce qu’on appelle ature.
Les Relieurs-Doreurs fe fervent aufli d’un compas
ordinaire en cuivre, pour mefurer la place où ils ont
à mettre de l’o r , 8c n’en couper qu’à proportion*
Voyet^ D orer.
C ompas courbé & brisé à l’ufage des Sculp*
teurs; ils s’en fervent pour mefurer les groffeurs des
corps ronds, parce qu’il embraffe les parties, ce que
ne peuvent pas faire ceux à jambes droites.
Les Graveurs s’en fervent aufli pour trouver le
véritable endroit d’une planche qu’ils veulent repouffer
& graver. Voye^ G ravure ou Burin.
C ompas de forge, à l’ufage des Serruriers & autres
ouvriers; c’eft un grand compas ordinaire dont on
ufe pour prendre les longueurs fur le fer chaud.
Les Serruriers en ont d’autres de différentes gran*;
deurs, qu’ils appellent compas d'établi.
C om pas d’épaisseur , à l’ufage des Serruriers $
c’eft un compas dont les branches font courbes , 8c
qui fert à l’ufage indiqué par fon nom.
C ompas d r o it et courbe , à l’ufage des ouvriers
qui travaillent en pierres de rapport, & en tabletterie;
voyez la Planche de Marqueterie en pierres de rapport.
.
C ompas , à l’ufage des Tonneliers , eft un inftrument
dont ils fe fervent pour former & marquer les
douves des fonds de leurs futailles en figure fphéri-
que.Cet inftrument eft fait d’un feul jet de bois pliant,
mais élaftique, dont les deux bouts fervent de branches
à l’inftrument, & font garnis chacun d’une pointe
& d’une virole de fer : ces deux branches peuvent
s’approcher 8c s’éloigner au moyen d’un arc de bois
à vis qui les traverfe.
Les Tonneliers ont aufli parmi les outils de leur
métier , des compas ordinaires qui font de fe r , &
dont les branches n’ont pas plus de huit pouces de
longueur.
C om p a s , à l’ufage des Vtrgetiers , eft une efpece
de meflire marquée de points, à chaque bout de laquelle
eft en-travers d’un côté feulement, un morceau
de bois travaillé, haut d’environ un pouce
& demi, pour retenir le pié fur la mefure. Les Cordonniers
s’en fervent pour mefurer la longueur du
pié de ceux qu’ils ont à chauffer.
Outre les compas dont nous venons de faire mention
, il y en a un grand nombre d’autres à l’ufagé
des différens ouvriers. Ces compas feront décrits aux
articles où nôus ferons le détail des ouvrages, quand
ils en vaudront la peine. Il n’y a prefque point d’ar-
tifte qui n’ait fon compas.
COMPASSER, v . a£l. c’eft prendre des mefures
avec le compas. Voyeç C om p a s .
COMPASSION, f. f. (Morale.) affli&ion qu’on
éprouve à la vue , au réc it, ou au fouvenir des
maux de quelqu’un. C ’eft un fentiment auquel on
fe livre avec une forte de plaifir :
Non quia vexari quemquam efi jucunda voluptas ,
Sed quibus ipfie malis careas, quia cernere fuave eft.
Le plaifir qu’on y éprouve vient encore du témoignage
qu’on fe rend à foi-même qu’on a de l’humanité.
Plus on a été malheureux, plus on eft fufceptible
de compajjion. Nonignara mali, & c . Non-feulemènt
on ne fe refufe point à ce fentiment, on cherche
même quelquefois les occafions de l’exciter ; c’eft
pour cela, 8c non par un fentiment barbare, que le
C O M
peuple court aux exécutions des criminels. (O)
COMPATIBILITÉ, f. f. ( Jurifpr. ) eft la faculté
qu’une mêmeperfonne a depofféder en même tems
plufieurs bénéfices ou offices, ou un bénéfice 8c un
office. Les bénéfices & offices entre lefquels il n ’y a
point d’incompatibilité prononcée par aucune lo i ,
font de droit compatibles. Il y en a d’autres qui le deviennent
au moyen d’une difpenfe, laquelle pour
les bénéfices s’obtient en cour de Rome. A l’égard
des offices, on obtient à cet effet en chancellerie des
lettres , qu’on appelle lettres de compatibilité. Voyez
ci-après C om pat ib le & INCOMPATIBLE. ÇA)
COMPATIBLE, adj. ( Jurifpr.') fe dit des bénéfices
& des charges qui peuvent être poffédés enfemble
par une même perfonne fans difpenfe. Tous les
bénéfices 8c offices, entre lefquels il n’y a point d’incompatibilité
prononcée par la lo i , font compatibles :
ainfi un bénéfice fimple eft compatible avec un autre
de même nature, pourvu qu’il ne foit pas fub eodem
téclo. L’office de fecrétaire du roi eft compatible avec
celui de confeiller de cour fouveraine, 8c avec plufieurs
autres emplois, &c. Voyeç-ci-devant C ompat
ib il i t é ,# In c om p a t ib l e . ÇA)
* COMPENDIUM, f. m. ÇPhilof.) terme à l’ufage
des écoles de Philofophié ; il défigne un abrégé
des principales matierès contenues dans la Logique.
On commence par-là, afin de faciliter l’étude même
de la Logique aux écoliers qui s’inftruifent dans cet
abrégé des mots qui font le plus en ufage dans cette
partie de la Philofophié , 8c qu’on y exerce à la maniéré
de raifonner fyllogiftiqué fur plufieurs quef-
tions qui pourroient être mieux choifies 8c plus in-
téreffantes. Voye^ C o lleg e.
COMPENSATION, ( Jurifpr. ) eft la confufion
qui fe fait d’une dette mobiliaire liquide, avec une
autre dette de même nature. Elle tient lieu de payement
; ou fi l’on veu t, c’eft un payement réciproque,
mais fiftif 8c fans bourfe délier de part ni d’autre.
La compenfation eft fondée fur l’équité naturelle ,
& elle a pour objet d’éviter, un circuit inutile, qui
auroit lieu fi un débiteur étoit obligé de payer à fon
créancier la même fomme qu’il eft en état de lui demander
; il y auroit même dans ce cas une efpece de
dol à demander le payement d’une fomme qu’il fau-
droit à l’inftant rendre à la même perfonne.
L’exception tirée de la compenfation eft. admifeen
pays coutumier, aufli-bien qu’en pays de droit écrit;
& c’eft un moyen de droit que l’on peut oppofer en
tout état de caufe, 8c fans qu’il foit befoin pour cet
effet de lettres de chancellerie.
Il n’eft pas non plus néceffaire que les deux dettes
foient égales ; la compenfation ne laiffe pas d’avoir
lieu jufqu’à due concurrence ; & le créancier auquel
étoit dûe la fomme la plus forte, ne peut répéter
que l’excédent qui refte dû après la compenfation
faite. ’
C ’eft une maxime fondamçntale de cette matière,
que la compenfation n’a lieu que de liquide à liquide ;
c’eft-à-dire qu’il faut que les deux dettes que l’on
veut compenfer foient toutes deux certaines, liquides
, 8c non litigieufes ; qu’elles foient l’une 8c l’autre
exigibles au tems où l’on prétend que la compenfation
doit avoir lieu , 8c qu’elles ne püiffent point
être annullées ou éteintes par quelque exception
péremptoire , telle que la prefeription. -
Le cefîionnaire eft fujet à la compenfation, de même
que l’auroit été fon cédant ;mais il ne peut pas
obliger de compenfer une dette exigible , telle qu’une
obligation, contre une dette non exigible, telle
que le principal d’une rente foncière ou conftituée.
De m ême, une dette dont le terme eft incertain
ou n’ eft pas encore échû, ne peut être compenfée
avec une-dette pure 8c fimple 8c a&uellement exigi-
Tome I I I ,
C O M 761
ble ; une dette portant intérêt ne peut être compenfée
avec une autre qui n’en porte point, à moins que
les intérêts ne foient comptés jufqu’au jour de la com •
penfation. Pareillement ce qui eft dû en vertu d’une
fentence dont il y a appel, ne peut être compenfé
contre une dette dûe par obligation ou jugement qui
ne font point attaqués.
Il y a encore plufieurs autres cas où la compenfa j
tion n’a pas lieu , quoique les deux dettes foient li j
quides de part & d’autre.
Par exemple , on ne peut obliger de compenfer
une chofe 'fongible avec un corps certain 8c déter*
miné ; ni une chofe fongible d’une certaine efpece ,
Contre une autre chofe fongible d’une efpece différente
, comme du blé contre du vin ; mais quand ces
chofes font eftimées de part & d’autre, la compenfation
a lieu pour l’eftimation.
La compenfation n’a lieu qu’entre perfonnes qui
ont de leur chef la double qualité de créancier 8c.
de débiteur ; de forte qu’un tuteur qui demande ce
qui eft dû à fon mineur, ou un mandataire qui agit
pour fon commettant, ne font pas obligés de compenfer
ce qui leur eft dû perfonnellement avec la
dette de celui pour lequel ils ftipulent.
. On ne peut pas non plus oppofer la compenfation
en matière de dépôt, foit volontaire ou néceffaire ,
ni en matière de commodat ; parce que ce feroit
manquer de bonne foi que d’üfer dans ces cas d’une
telle exception.
Elle n’a pas lieu non plus contre les droits du ro i,
parce que ces droits font privilégiés.
D e même en matière de retrait lignager , parce
que le rembourfement doit être aûuel 8c effectif.
On ne petit aufli compenfer les arrérages de cens
ni des rentes feigneuriales ou emphytéotiques , parce
que ces redevances font dûes principalament en
reconnoiffance de la direâe.
Les penfions viagères 8c alimens ne fe compenfent
point, à caufe de la faveur de ces fortes de dettes
qui:ne doivent pas fouffrir de retardement.
En matière de complainte 8c de réintégrande il
n’y a point de compenfation, parce que fpoliatus ante
omnia rejlituendus eji.
Enfin la compensation n’a pas lieu en matière de
délits , ce qui fe doit entendre par rapport à la peine
due pour la vindiâe publique ; mais les peines pécuniaires,
telles que réparations & intérêts civils ,
dommages 8c intérêts , peuvent être compenfées.
Voye^ au digefte 8c au code, le titre de compenfatio-
nibus ; M ornac, ibid. Henrys , tom. I I . liv. II. quefi.
xv. Guypape, quefi. clxxiij, & dlxvij.. Papon, liv.
X I I . tit. vj. Voyt^ auffi Defpeiffes, tom. 1.part. IV .
tit. iij. les arrêtés de M. le P. P. de Lamoignon ; les
lois civiles, titre de la compenfation ; Dumolin , tr.
de ufuris., queeft. x lij. 7z. _3.22.. Journ. dés aud. tome I .
liv. I . ch. Ixxvj. ÇA )
. COMPENSER, v . a6t. qui exprime l’afte de la
compenfation. Voye^ C ompensation.
COMPERSONNIERS, f. m. pi. Ç Jurifpr.) font
ceux qui tiennent enfemble un même tenement ou
domaine, à la charge d’une redevance envers le fei-
gneur, pour laquelle ils font obligés folidairement.
On appelle aufli comperfonnitrs ceux qui vivent en
commun 8c en fociété au même pain 8c au même
feu , comme cela fe pratique fur-tout entré main-
mortables dans quelques provinces, telles que celles
de Bourgogne, N ivemois, & Champagne. Voye^
le titre viij de la coutume de Nivernois ,• & Coquille ,
ibid. & le gloff. du droit françois, au mot perfonnier,
mm*
COMPES, f. m. pl. ÇManufacl. en drap. ) efpe-
ces de droguets croifés , drapés, qui fe fabriquent
auTreuil-barret, la Chafteigneraye, &c:qui doivent
avoir £ aune de large fur 40 de long, apprêtés ; ou |
DDd d d