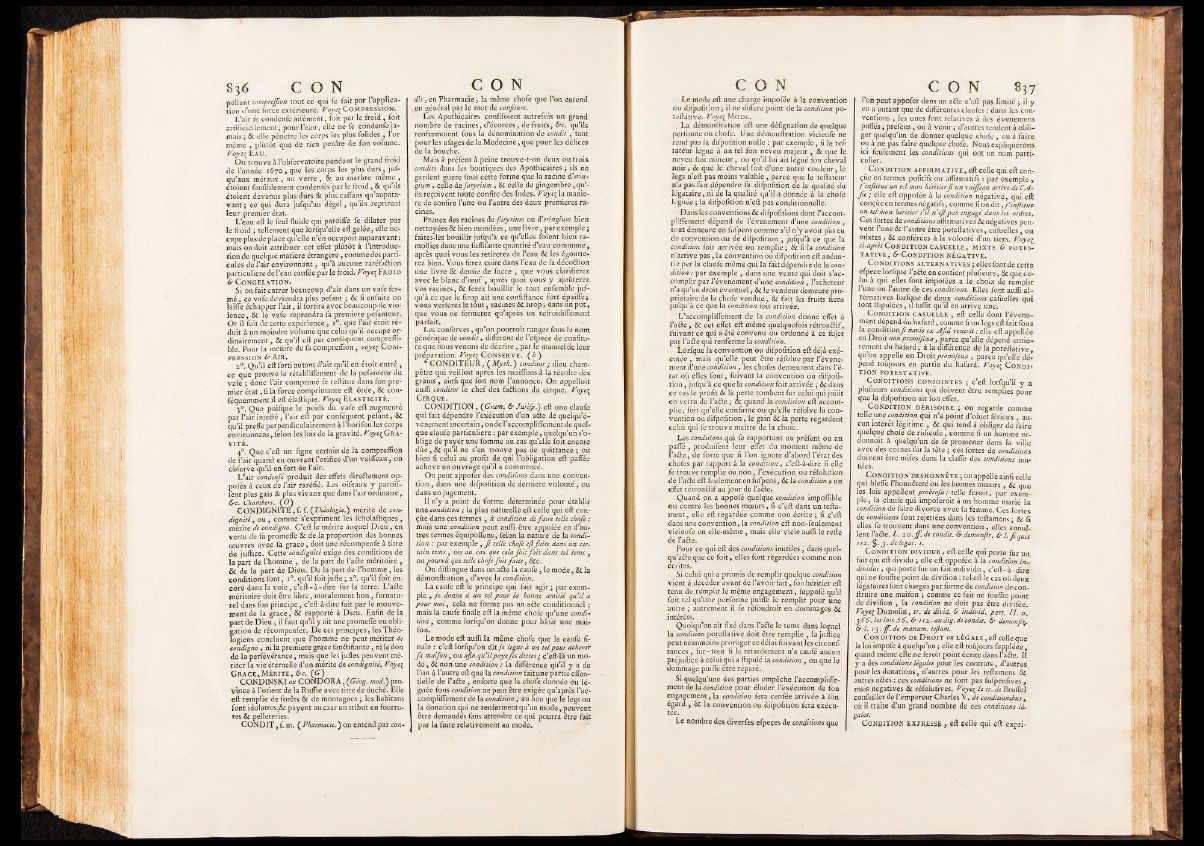
pellant compreffion tout ce qui fe fait par l’application
d’une force extérieure. Voye^ Compression.
L’air fe condenfe aifément, foit par le froid , foit
artificiellement; pour l’eau, elle ne fe condenfe jamais
; & elle pénétré les corps les plus folides , 1 or
même , plutôt que de rien perdre de fon volume.
Eau.
On trouva à l’obfervatoire pendant le grand froid
de l’année 1670, que les corps les plus durs, jusqu'aux
métaux , au v e r re , & au marbre meme ,
etoient fenfiblement condenfés par le froid, & qu’ils
étoient devenus plus durs & plus caffans qu’aupara-
vant ; ce qui dura jufqu’au dégel, qu’ils reprirent
leur premier état.
L’eau eft le feul fluide qui paroiffe fe dilater par
le froid ; tellement que lorfqu’elle eft gelée, elle oc-
cupe plus de place qu’elle n’en occupoit auparavant :
mais on doit attribuer cet effet plutôt à l’introduction
de quelque matière étrangère, comme des particules
de l’air environnant, qu’à aucune raréfaâion
particulière de l’eau caufée par le froid. V?ye{ Froid
& C ongélation.
Si on fait entrer beaucoup d’air dans un vafe fermé
, ce vafe deviendra plus pefant ; & fi enfuite on
laiffe échapper l’air, il fortira avec beaucoup de violence
, &: le vafe reprendra fa première pefanteur.
Or il fuit de cette expérience, i° . que l’air étoit réduit
à un moindre volume que celui qu’il occupe ordinairement
, & qu’il eft par confequent comprefli-
ble. Pour la roefure de fa compreflion, voye^ C ompression
& Air.
2°. Qu’il eft forti autant d’air qu’il en étoit entré ,
ce que prouve le rétabliffement de la pefanteür du
vafe ; donc l’air comprimé fe reftitue dans fon premier
é ta t, fi la force comprimante eft ôtée, & eon-
féquemment il eft élaftique. Voye% Elasticité.
3°. Que puifque le poids du vafe eft augmenté
par l’air in jeâ é, l’air eft par conféquent pefant, &
qu’il preffe perpendiculairement à l’horifon les corps
environnans, félon les lois de la gravité. V Grav
it é .
40. Que c’eft un figne certain de la compreflion
de l’air quand en ouvrant l’orifice d’un vaiffeau, on
obferve qu’il en fort de l’air.
L/àir condenfe produit des effets direâement op-
pofés à ceux de l’air raréfié. Les oifeaux y paroif-
fent plus gais & plus vivans que dans l’air ordinaire,
&c. Chambers. (O )
CONDIGNITÉ, f. f. ( Théologie.) mérite de condignité
, ou , comme s’expriment les fcholaftiques ,
mérite de condigno. C ’eft le mérite auquel D ie u , en
vertu de fa promeffe & 'de la proportion des bonnes
oeuvres avec fa grâce, doit une récompenfe à titre
de juftice. Cette condignité exige des conditions de
la part de l’homme , de la part de l’a â e méritoire,
& de la part de Dieu. De la part de l’homme, les
conditions font, i° . qu’il foit jufte ; 20. qu’il foit encore
dans là v o ie , c’eft-à-dire fur la terre. L’aâe
méritoire doit être libre, moralement b on, furnatu-
rel dans fon principe, c’eft-à-dire fait par le mouvement
de la grâce, & rapporté à Dieu. Enfin de la
part de D ieu , il faut qu’il y ait une promeffe ou obligation
de rçcompenfer. De ces principes, les Théologiens
concluent que l’homme ne peut mériter de
condigno , ni la première grâce fanâifiante, ni le don
de la persévérance, mais que les juftes peuvent mériter
la v ie éternelle d’un mérite de condignité. V?ye{
Grâce,M érite, &c. (G)
CONDINSKI ou ÇONDORA, (Géog. mod.) province
à l’orient de la Ruflie avec titre de duché. Elle
eft remplie de forêts & de montagnes ; les habitans
font idolâtres,& payent au czar un tribut en fourrures
&c pelleteries.
CONDIT, f. m. {Pharmacie,} on entend par condit,
en Pharmacie, la même chofe que l’on entend
en général par le mot de confiture.
Les Apothicaires confifoient autrefois un grand
nombre de racines, d’écorces, de fruits, &c. qu’ils
renfermoient fous la dénomination de condit, tant
pour les ufages de la Medecine, que pour les délices
de la bouche.
Mais à préfent à peine trouve-t-on deux ou trois
condits dans les boutiques des Apothicaires ; ils ne
gardent guere fous cette forme que la racine tferin-
giurn, celle de fatyrium, & celle de gingembre, qu’ils
reçoivent toute confite des Indes. Voye^ la maniéré
de confire l’une ou l’autre des deux premières racines.
Prenez des racines de fatyrium ou â’eringium bien
nettoyées & bien mondées, une livre, par exemple ;
faites-les bouillir jufqu’à ce qu’elles Soient bien ramollies
dans une fuffilante quantité d’eau commune,
après quoi vous les retirerez de l’eau & les égoutterez
bien. Vous ferez cuire dans l’eau de la décoâion
une livre & demie de fucre , que vous clarifierez
avec le blanc d’oeuf , après quoi vous y ajouterez
vos racines, & ferez bouillir le tout enfemble jufqu’à
ce que le firop ait une confiftance fort épaiffe ;
vous yerferez le tout, racines & firop, dans un pot,
que vous ne fermerez qu’après un refroidiffement
parfait.
Les conferves, qu’on pourroit ranger fous le nom
générique de condit, different de l’efpece de confiture
que nous venons de décrire, par le manuel de leur
préparation. Voye1 C onserve, {b )
* CONDITEUR, (Mytk. ) conditor ; dieu champêtre
qui veilloit après les moiffons à la récolte des
grains, ainfi que fon nom l’annonce. On appelloit
aufli conditor le chef des faâions du cirque. Voyez
Cirque.
CONDITION, (Gram. & Jurifp.) eft une claufe
qui fait dépendre l’exécution d’un a été de quelqu’é-
venement incertain, ou de l’accompliffement de quelque
claufe particulière : par exemple, quelqu’un s’oblige
de payer une fomme au cas qu’elle foit encore
due, & qu’il ne s’en trouve pas de quittance ; ou
bien fi celui au profit de qui l’obligation eft paffée
achevé un ouvrage qu’il a commencé.
On peut appofer des conditions dans une convention
, dans une difpofition de dernière volonté, ou
dans un jugement.
Il n’y a point de •tforme déterminée pour établir
une condition ; la plus naturelle eft celle qui eft conçue
dans ces termes , à condition de faire telle chofe ;
mais une condition peut aufli être appofée en d’autres
termes équipollens, félon la nature de la condition
: par exemple, f i telle chofe efi faite dans un certain
tems , ou au cas que cela foit fait dans tel tems ,
ou pourvu que telle chofe foit faite, &c.
On diftingue dans un aâe la caufe, le mode, & la
démonftration, d’avec la condition.
La caufe eft le principe qui fait agir ; par exemple
, je donne à un tel pour la bonne, amitié qu'il a
pour moi, cela ne forme pas un a été conditionnel ;
mais la caufe finale eft la même chofe qu’une condition
, comme lorfqu’on donne pour bâtir une mai?
fon. Le mode eft aufli la même chofe que la caufe finale
: c’eft lorfqu’on dit je légué à un tel pour achever
fa maifon, ou afin qu'il payefesdettes ; c’eft-là un mode
, & non une condition : la différence qu’il y a dé
l’un à l’autre eft que la condition fait une partie effen-
tielle de l’aéte , enforte que la chofe donnée ou léguée
fous condition ne peut être exigée qu’après l’ac-
compliffement de la condition ; au lieu que le legs ou
la donation qui ne renferment qu’un mode, peuvent
être demandés fans attendre ce qui pourra être fait
par la fuite relativement au mode.
Le mode eft une charge impofée à la convention
ou difpofition ; il ne différé point de la condition po-
teftative. Voye^ Mode.
La démonftration eft une défignation de quelque
perfonne ou chofe. Une démonftration vicieufe ne
rend pas la difpofition nulle : par exemple, fi le tef-
tateur légué à un tel fon neveu majeur , & que le
neveu foit mineur, ou qu’il lui ait légué fon cheval
noir > & que le cheval foit d’une autre couleur, le
legs n’eft pas moins valable , parce que le teftateur
n’a pas fait dépendre fa difpofition de la qualité du
légataire, ni de la qualité qu’il a donnée à la chofe
léguée ; la difpofition n’eft pas conditionnelle.
Dans les conventions & difpofitions dont l’accom-
pîiffement dépend de l’évenement d’une condition ,
tout demeure eh fufpens comme s’il n’y avoit pas eu
de convention ou de difpofition , jufqu’à ce que la
condition foit arrivée ou remplie ; & fi la condition
n’arrive pas, la convention ou difpofition eft anéantie
per la claufe même qui la fait dépendre de la condition
: par exemple , dans une vente qui doit s’accomplir
par l’évenement d’une condition, l’acheteur
n’a qu’un droit éventuel-, & le vendeur demeure propriétaire
de la chofe vendue, & fait les fruits liens
jufqu’à ce que la condition foit arrivée.
L ’accompliffement de la condition donne effet à
l’a â e , & cet effet eft même quelquefois rétroaâif,
fuivant ce qui a été convenu ou ordonné à ce fujer
par l’aâe qui renferme la condition.
Lorfque la convention ou difpofition eft déjà exécutée
, mais qu’elle peut être réfolue par l’évenement
d’une condition, les chofes demeurent dans l’état
ôii elles font, fuivant la convention ou difpofition
, jufqu’à ce que la condition foit arrivée ; & dans
ce cas le profit & la perte tombent fur celui qui joiiit
en vertu de l’aâe ; & quand la condition eft accomplie,
foit qu’elle confirme ou qu’elle réfolve la convention
ou difpofition, le gain & la perte regardent
celui qüi fe trouve maître de la choie.
Les conditions qui fe rapportent au préfent ou au
paffé , produifent leur effet du moment même de
l ’a â e , de forte que fi l’on ignore d’abord l’état 'des
chofes par rapport à la condition, c’eft-à-dire fi elle
fe trouve remplie ou non, l’exécution ou réfolution
de l’aâe eft feulement en fufpens, & la condition a un
effet rétroaâif au jour de l’aâe.
Quand on a appofé quelque condition impoflible
ou contre les bonnes moeurs, fi c’eft dans un tefta-
ment, elle eft regardée comme non écrite ; fi c’eft
dans une convention, la condition eft non-feulement
vicieufe en elle-même, mais elle vicie aufli le refte
de l’aâe.
Pour ce qui eft des conditions inutiles, dans quel-
qu’aâe que ce foit, elles font regardées comme non |
écrites.
Si celui qui a promis de remplir quelque condition
vient à décéder avant de l’avoir fait, fon héritier eft
tenu de remplir le même engagement, fuppofé qu’il
foit tel qu’une perfonne puiffe le remplir pour une
autre ; autrement il fe réfoudroit en dommages &
intérêts.
Quoiqu’on ait fixé dans l’aâe le tems dans lequel
la condition poteftative doit être remplie , la juftice
peut néanmoins proroger ce délai fuivant les circonf-
tances , fur-tout fi le retardement n’a caufé aucun
préjudice à celui qui a ftipulé la condition, ou que le
dommage puiffe être réparé.
Si quelqu’une des parties empêche l’accompliffement
de la condition pour éluder l’exécution de fon
engagement, la condition fera cenfée arrivée à fon
egard , & la convention ou difpofition fera exécutée
.L
e nombre des diverfes efpeces de conditions que
l’on peut appofer dans un aâe n’eft pas limité ; il y
en a autant que de différentes claufes : dans les conventions
, les unes font relatives à des évenemens
paffés, préfens, ou à venir ; d’autres tendent à obliger
quelqu’un de donner quelque chofe , ou à faire
ou à ne pas faire quelque choie. Nous expliquerons
ici feulement les conditions qui ont un nom particulier.
a C o nd ition a f f irm a t iv e , eft celle qui eft conçue
en termes pofitifs ou affirmatifs : par exemple ,
) infiitue un tel mon héritierfi un vaiffeau arrive de l'A -
fie ; elle eft oppofée à la condition négative, qui eft
conçue en termes négatifs, comme fi on d i t infiitue
un tel mon héritier s'il n efi pas engagé dans les ordres.
Ces fortes de conditions affirmatives & négatives peuvent
l’une & l’autre être poteftatives, cafuelles, ou
mixtes, & conférées à la volonté d’un tiers. Voyez
ci-après C o nd ition CASUELLE, MIXTE & POTESTATIVE,
& C o nd ition n é g a t iv e .
C o n d i t i o n s a l t e r n a t i v e s ; elles font de cette
efpece lorfque l’aâe en contient plufieurs, & que celui
à qui elles font impofées a le choix de remplir
l’une ou l’autre de ces conditions. Elles font aufli alternatives
lorfque de deux conditions cafuelles qui
font ftipulées, il fuffit qu’il en arrive une.
C o n d i t i o n c a s u e l l e , eft celle dont l’évenement
dépend du hafard, comme fi un legs eft fait fous
la conditionf i navis ex Afiâ venerit : elle eft appellée
en D roit non promifeua , parce qu’elle dépend entièrement
du hafard; à la différence de la poteftative,
qu’on appelle en Droit promifeua , parce qu’elle dépend
toûjours en partie du hafard. Voye{ C o n d i t
i o n p o t e s t a t i v e .
C o n d i t i o n s c o n j o i n t e s ; c’eft lorfqu’il y a
plufieurs conditions qui doivent être remplies pour
que la difpofition ait fon effet.
C o n d it ion d ér iso ir e .; on regarde comme
telle une condition qui n’a point d’objet férieux aucun
intérêt légitime , & qui tend à obliger de faire
quelque chofe de ridicule, comme fi un homme or-
donnoit à quelqu’un de fe promener dans la ville
avec des cornes fur la tête ; ces fortes de conditions
doivent être mifes dans la claffe des conditions inutiles.
C o nd ition déshonnête ; on appelle ainfi celle
qui bleffe l’honnêteté ou les bonnes moeurs , & que
les lois appellent probrofa : telle feroit, par exemple
, la claufe qui impoferoit à un homme marié la
condition de faire divorce avec fa femme. Ces fortes
de conditions font rejettées dans les teftamens • & fi
elles fe trouvent dans une convention , elles annul-
lent l’aâe. L. zo .ff. de condit. & demonfir. & l.fiquis
u z . § . 3 . de légat. 1.
C ondition dividue , eft celle qui porte fur un
fait qui eft dividu ; elle eft oppofée à la condition in-
dividue, qui porte fur un fait individu, c’eft-à-dire
qui ne fouffre point de divifion : tel eft le cas où deux
légataires font chargés par forme de condition de con-
ftruire une maifon ; comme ce fait ne fouffre point
de divifion , la 'condition né doit pas être divifée.
Voye^ Dumolin, tr. de divid. & individ. part. II. n.
$8 6. les lois 56. & n z . au dig. de condit. & demonfir^
& l. 13. ff. de manum. tefiam.
C o n d it ion de D ro it ou l é g a l e , eft celle que
la loi impofe à quelqu’un ; elle eft toûjours fuppléée ,
quand même elle ne feroit point écrite dans l’aâe. Il
y a des conditions légales pour les contrats, ^d’autres
pour les donations, -d’autres pour les teftamens &
autres aâes : ces conditions ne font pas fufpenfives ,
mais négatives & réfolutives. Voye^ le tr. de Bruffel
confeiller de l’empereur Charles V . de conditionïbus,
où il traite d’un grand nombre de ces conditions IL
gales.
C ondition expresse , eft celle qui eft expri