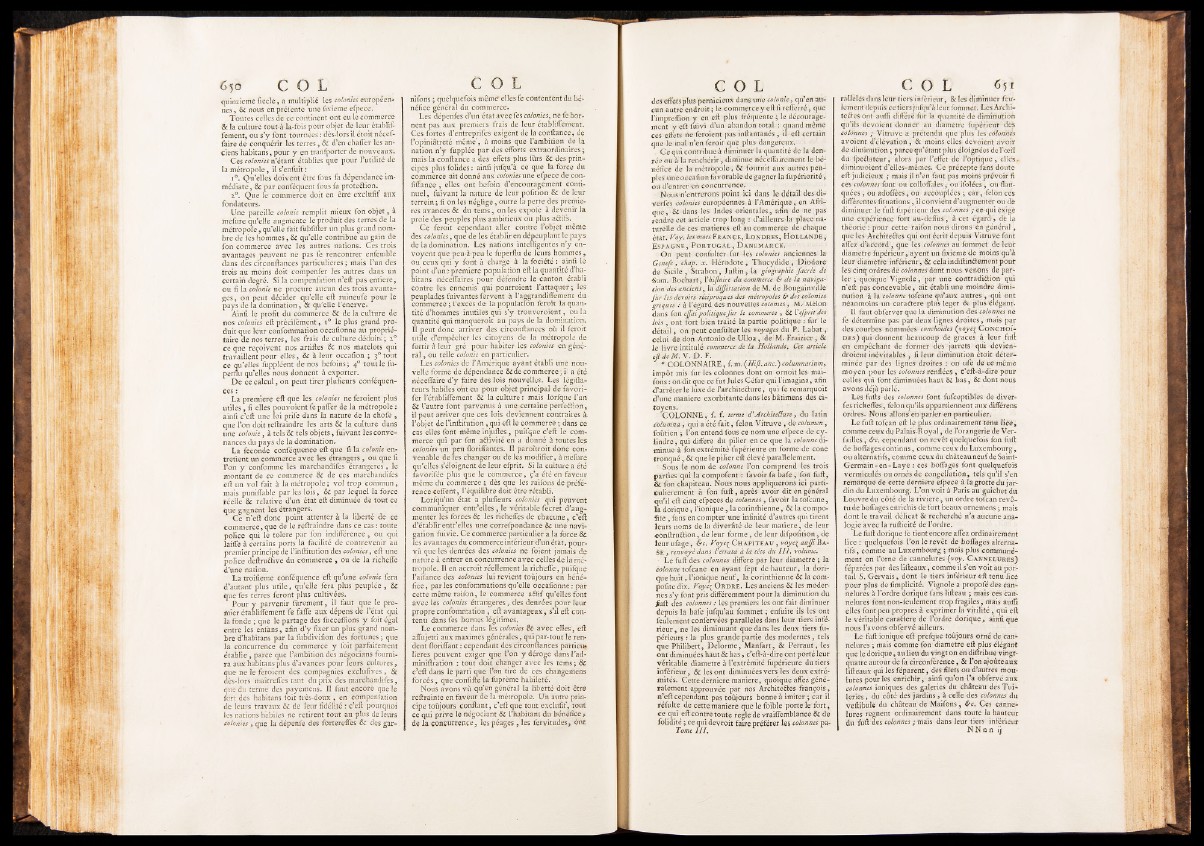
quinzième fiecle, a multiplié les colonies européennes
, & nous en présente line fixieme efpece.
Toutes celles de ce continent ont eu le commerce
& la culture tout-à la-fois pour objet de leur établif-
fement, ou s’y font tournées : dès-lors il étoit nécef-
faire de conquérir les terres, & d’en chaffer les anciens
habitans, pour y en tranfporter de nouveaux.
Ces colonies n’étant établies que pour l’utilité de
la métropole, il s’enfuit :
i ° . Qu’elles doivent être fous fa dépendance immédiate,
& par conféquent fous fa proteftion.
20. Que le commerce doit en être exclufif aux
fondateurs.
Une pareille colonie remplit mieux fon o b je t, à
mefure qu’elle augmente le produit dès terres de la
métropole, qu’elle fait fubfifter un plus grand nombre
de fes hommes, & qu’elle contribue au gain de
fon commerce avec les autres nations. Ces trois
avantages peuvent ne pas fe rencontrer enfemble
dans des circonftances particulières ; mais l’un des
trois au moins doit compenfer les autres dans un
certain degré. Si la compenfation n’eft pas entière,
ou fi la colonie ne procure aucun des trois avantag
e s , on peut décider qu’elle eft ruineufe pour le
pays de la domination, & qu’elle l’énerve.
Ainfi le profit du commerce ÔC de la culture de
nos colonies eft précifément, i ° le plus grand produit
que leur confommation occafionne au propriétaire
de nos terres, les frais de culture déduits ; 2 °
ce que reçoivent nos artiftes & nos matelots qui
travaillent pour e lle s, & à leur occafion ; 30 tout
c e qu’elles luppléent de nos befoins ; 40 tout le fu-
perflu qu’elles nous donnent à exporter.
D e ce c alcul, on peut tirer plufieurs conféquen-
Ces ;
La première eft que les colonies ne feroient plus
u tile s, fi elles pouvoient fe paffer de la métropole :
ainfi c’eft une loi prife dans la nature de la ehofe ,
que l’on doit reftraindre les arts & la culture dans
une colonie, à tels & tels o b je ts, fuivant les convenances
du pays de la domination.
La fécondé conféquence eft que fi la colonie entretient
un commerce avec les étrangers , ou que fi
l’cJn y confomme les marcha ndifes étrangères, le
montant de ce commerce & de ces marchandifes
eft un vol fait à la métropole ; vol trop commun,
mais puniffable par les lo is , & par lequel la force
réelle & relative d’un état eft diminuée de tout ce
que gagnent les étrangers.
C e n’eft donc point attenter à la liberté de ce
commerce, que de le reftraindre dans ce cas : toute
police qui le toléré par fon indifférence, ou qui
laiffe à certains ports la facilité de contrevenir ait
premier principe de l’inftitution des colonies, eft une
police deftruftive du commerce , ou de la richeffe
d’une nation.
L a troifieme conféquence eft qu’une colonie fera
d’autant plus u tile, qu’elle fera plus peuplée , &
que fes terres feront plus cultivées.
Pour y-parvenir fûrement, il faut que le premier
établiffement fe faffe aux dépens de l’état qui
la fonde ; que le partage des fucceffions y foit égal
entre les enfans, afin d’y fixer un plus grand nombre
d’habitans par la fubdivifion des fortunes ; que
la concurrence du commerce y foit parfaitement
établie , parce que l’ambition des négocians fournira
aux habitans plus d’avances pour leurs cultures,
que ne le feroient des compagnies exclufives , &
dès-lors maîtreffes tant du prix des marchandifes ,
que du terme des payemens. Il faut encore que le
fort des habitans foit très-doux , en compenfation
de leurs travaux & de leur fidélité : c’eft pourquoi
les nations habiles ne retirent tout au plus de leurs
colonies, que la dépenfe des forterefles & des garnifons
; quelquefois même? elles fe contentent du bé*
néfice général du commerce.
Les dépenfes d’un état avec fes colonies, ne fe bornent
pas aux premiers frais de leur établiffement.
Ces fortes d’entreprifes exigent de la confiance, de
l’opiniâtreté même', à moins que l’ambition de la
nation n’y fupplée par des efforts extraordinaires ;
mais la confiance a des effets plus fûrs & des principes
plus folides : ainfi jufqu’à ce que la force du
commerce ait donné aux colonies une efpece de conf
ia n c e , elles ont befoin d’encouragement continuel,
fuivant la nature de leur pofition & de leur
terrein; fi on les néglige, outre la perte des premières
avances & du tems, on les expofe à devenir la
proie des peuples plus ambitieux ou plus aftifs.
Ce feroit cependant aller contre l’objet même
des colonies, que de les établir en dépeuplant le pays
de la domination. Les nations intelligentes n’y en-
voyent que peu-à-peu le fuperflu de leurs hommes,
ou ceux qui y font à charge à la fociété : ainfi le
point d’une première population eft la quantité d’habitans
néceffaires pour défendre le canton établi
Contre les ennemis qui pourroient l’attaquer; les
peuplades fuivantes fervent à l’aggrandiffement du
commerce ; l’excès de la population feroit la quantité
d’hommes inutiles qui s’y trouveroiènt, ou la
quantité qui manqueroit au pays de la domination.
Il peut donc arriver des circonftances où il feroit
utile d’empêcher les citoyens de la métropole de
fortir à leur gré pour habiter les colonies en général
, ou telle colonie en particulier.
Les colonies de l’Amérique ayant établi une nouvelle
forme de dépendance & d ecommerce; il a été
néceffaire d’y faire des lois nouvelles. Les légifla-
teurs habiles ont eu pour objet principal de favori-
fer l’établiffement & la culture : mais lorfque l’un
& l’autre font parvenus à une certaine perfeétion,
il peut arriver que ces lois deviennent contraires à
l’objet de l’inftitution, qui eft le commerce ; dans ce
cas elles font même injuftes, puifque c’eft le commerce
qui par fon activité en a donné à toutes le.s
colonies un peu floriffantes. Il paroîtroit donc convenable
de les changer ou de les modifier, à mefure
qu’elles s’éloignent de leur efprit. Si la culture a été
favorifée plus que le commerce, c’a été en faveur
même du commerce ; dès que les raifons de préférence
ceffent, l’équilibre doit être rétabli.
Lorfqu’un état a plufieurs colonies qui peuvent
communiquer entr’elles , le véritable fecret d’aug *
menter les forces & les richeffes de chacune, c’eft
d’établir entr’elles une correfpondance & une navigation
fuivie. C e commerce particulier a la force &
les avantages du commerce intérieur d’un état, pour*
vû que les denrées des colonies ne foient jamais de
nature à entrer en concurrence avec celles de la métropole.
Il en accroît réellement la richefle, puifque
l’ailance des colonies lui revient toujours en bénéfice
, par les confommations qu’elle occafionne : par
cette même raifon, le commerce aélif qu’elles font
avec les colonies étrangères, des denrées pour leur
propre confommation , eft avantageux, s’il eft contenu
dans fes bornes légitimes.
Le commerce dans les colonies &- avec elles, eft
affujetti aux maximes générales, qui par-tout le rendent
floriffant : cependant des circonftances particu»
lieres peuvent exiger que l’on y déroge dans l ’ad-
miniftration : tout doit changer avec les tems ; &
c’eft dans le parti que l’on tire de ces changemens
fo r c é s , que confifte la fuprème habileté.
Nous avons vu qu’en général la liberté doit être
reftrâinte en faveur de la métropole. Un autre principe
toujours confiant, c’eft que tout exclufif, tout
ce qui prive le négociant & l’habitant du bénéfice,
de la concurrence, les péages , les feryitudes, ont
des effets plus pernicieux dans une-colonie 9 qu’ efl aucun
autre endroit ; le commerce y eft fi refferré, que
Timpreffion y en eft plus fréquente ; le découragement
y eft fuivi d’un abandon total : quand même
ces e.flets ne1 feroient pas inftantânés, il eft certain
que le mal n’en feroit que plus dangereux.
Ge qui contribue à diminuer la quantité de la denrée
Oit à la renchérir , diminue néceffairement le-bénéfice
de lu métropole, & fournit aux autres peuples
unooGcafion favorable de gagner la fupériorité,
ou d’entrer- en concurrence.
N ou s!n?entrerons point ici dans le détail'des di-
verfes colonies européennes; à l’Amérique-, en Afriq
u e , & dans les Indes' o rientales, afin de -ne paS
rendre c-et article trop1 long .• d’ailleurs la' place-naturelle
de ces matières eft au commerce de chaque
état. Voy. lés'tnotsFrance, Londres, Hollande,
Espagne , Portugal-, DanemarcKv • ■
: On peut confulter fur le s colonies anciennes la
Genefe, chdp. x. Hérodote, Thucydide , Diodore
de Sicile , Strabon, Juftin, la géographie facrèé de
Sam. Bochart , Yhifoire du commerce & de la. navigation
des anciens, là dijfertation de M. de Bougainville
fur les devoirs réciproques des métropoles & des colonies
greques : à l’égard des nouvelles colonies, M.- Melon
dans fon ejfai politique fur le commerce , & Y efprit'des
lois, ont fort bien traité la partie politique : fur le
détail- 4 ort peut confulter les voyages du P. L a b a t ,
celui de don Antonio de U llo a , d e ; M. Fraizier, &
le livre intitulé commerce de la. Hollande, Cet article
efl de M. V. D . F.
* COLONNAIRE, f. m. (Hifl. anc.) columnarium,
impôt mis fur les colonnes dont on ornoitles mai-
fôns : on dit que ce fut Jules Çéfar qui l’imagina, afin
d ’arrêter le luxe de l’archite&ure, qui fe remarquoit
d ’une maniéré exorbitante dans les bâtimens des citoyens.
CO LO N N E , f. f. terme d'Architecture, du latin
columna , qui a été f a it , félon Vitruve , de columen,
foûtien ; l’on entend fous ce nom une efpece de cy lindre,
qui différé du pilier en ce que la colonne diminue
à fon extrémité fupérieure en forme de cône
tronqué, & que le pilier eft élevé parallèlement.
| Sous le nom de colonne l’on comprend les trois
parties qui la compofent : favoir fa bafe , 'fon fuft,
& fon chapiteau. Nous nous appliquerons ici particulièrement
à fon fuft , après avoir dit en général
qu’il eft cinq efpeces de colonnes, favoir la tôfcane,
l à dorique, l’ionique, la corinthienne, & la compo-
lite , fans en compter une infinité d’autres qui tirent
leurs noms de la diverfité de leur matière, de leur
■ conftruûion, de leur forme, de leur difpofition, de
leur u fage, &c. Voye1 C h a p it ea u , voye^ auJJiYdk.-
ÔE , renvoyé dans Cerrata à la tête du III. volûme.
L e fuft des colonnes différé par leur diamètre ; la
colonne tofcane en ayant fept de hauteur, la dorique
huit, l’ionique neuf, la corinthienne & la com-
pofite dix. Voye^ Ordre. Les anciens & les modernes
s’y font pris différemment pour la diminution du
jfùft des colonnes : les premiers les ont fait diminuer
depuis la bâfe jufqu’au fommet ; enfuite ils les ont
feulement confervées parallèles dans leur tiers inférieu
r, ne les diminuant que dans les deux tiers fu-
périeurs : la plus grande partie des modernes, tels
que Philibert, Delorme, Manfart, & Perraut, les
ont diminuées haut & b a s , c’ eft-à-dire ont porté leur
véritable diamètre à l’extrémité fupérieure du tiers
inférieur, & les ont diminuées vers les deux extrémités.
Cette derniere maniéré, quoique affez généralement
approuvée par nos Archite&es françois,
n’eft cependant pas toûjours bonne à imiter ; car il
réfulte de cette maniéré que le foible porté le fo rt,
ce qui eft contre toute réglé de vraiffemblance & de
folidité ; ce qui deyroit faire préférer les colonnes pa-
Tome I I I .
ràllelès dans leur tiers inférieur, & les diminuer feu-
lementdepuls ce tiers jufqu’à leur fommet. Lès Àrchi-
teâes-ont aufti différé fur la quantité de diminution
qu’ils dévoient donner au diamètre fupërieur des
coldnnes ; Vitruve a prétendu que plus les côlonnes
avoient d’élévation, & moins elles de voient avoir
de diminution ; parce qu’étant plus éloignées deToeîl
du fpeflateur, alors par l’effet-de l’optique, elles.
diminuoient d’ellès-mêmes. Ce précepte fans doute
eft judicieux ; mais il n’en faut pas moins prévoir fi
cè's colonnes Yont ou eolloffales;, ou ifolées, ou flanquées
, où adoffées, ou accouplées ; c a r , -felbn ces
différentes'fituatiüns , il conviéht d’augmenter ou de
diminuer le fuft fupérieur des colonnes ; ce-qui exigé
une expérience fort au-deffus, à cet égard > de la
théorie : pour cette irâifon nous dirons ért; général ,
que les Aréhiteftes qui ont écrit depuis Vitruve font
affez d’hbcôlrd:, que les coldnnes au fommet de leur
diamètre fupérieur, ayent un fixieme de moins qu’à
leur diamètre inférieur , & cela indiftinéleriient pour
les cinq ordres dè’ colonnes dont nous- venons de par*-
1er ; quoique Vignole, par une cohtrâdiôion qui
n’eft pas concevable, ait établi une moindre diminution
à la colonne tofcarte qu’aux autres , qui ont
néarimoins un caraftére plus leger & plus élégant.
Il faut obferver que la diminution des colonnes ne
fe détermine pas par deux lignes droites, mais par
des courbes nommées conchoMes (voye{ C onchoï-
des) qui donnent beaucoup de grâces à leur fuft
en empêchant de former des jarrets qvti devien-
droient inévitables , fi leur- diminution é'tbit déterminée
par des lignes droites : on ufë de ce même
moyen pour les colonnes renflées , c’eft-à-dire pour
celles qui font diminuées haut & bas, & dont nous
avons déjà parlé.
Les fuft s des colonnes font fufceptibles de diver-
fes richeffes, félon qu’ils appartiennent aux différens
ordres. Nous allbns en parler en particulier.
Le fuft tofçan eft le plus ordinairement tenu lice,
comme ceux du P alais-Royal, de l’orangerie de Ver-
failles U &c. -cependant on revêt quelquefois fon fuft
de boffages continus, comme ceux du Luxembourg,
ou alternatifs, comme ceux du château neuf de Saint-
G e rm ain-en -L ay e : ces boffages font quelquefois
vermiculés ou ornés de congellation, tels qu’il s’en
remarque de cette derniere efpece à la grotte du jardin
du Luxembourg. L ’on voit à Paris au guichet dù
Louvre du côté de la riviere, un ordre toïcan revêtu
de boffages enrichis de fort beaux ornemens ; mais
dont le travail délicat & recherché n’a aucune analogie
avec la rufticité de l’ordre.
L e fuft dorique fe tient encore affez ordinairement
lice : quelquefois l’on le revêt de boffages alternatifs
, comme au Luxembourg ; mais plus communément
on l’orne de cannelürés-(vqy. C annelures)
féparées par des lifteaux, comme il s’en v oit àù poti*
tail S. G e rv a is, dont le tiers inférieur eft tenu licé
pour plus de fimplicité. Vignole a propofé dés c an nelures
à l ’ordre dorique fans lifteau ; mais ces cannelures
font, non-feulement trop fragiles, mais auffi
elles font peu propres à exprimer la virilité, qui eft
le véritable caraftere de l’Ordre dorique , ainfi que
nous l’avons obfervé ailleurs.
Le fuft ionique eft prefqùe toûjours orné de cannelures
; mais comme fon diamètre eft plus élégant
que le dorique, au lieu du vingt on en diftribue vingt-
quatre autour de fa circonférence, & l’on ajoute aux
lifteaux qui les féparent, des filets ou d?autres moulures
pour les enrichir, ainfi qu’on l’a obfervé aux
colonnes ioniques des galeries du château des T u ileries
, du côté des jardins, à celle des colonnes du
veftibtde du château de Maifons, &c. Ces cannelures
régnent ordinairement dans toute la hauteur
du fuft des colonnes ; mais dans leur tiers inférieur
N N n n ij