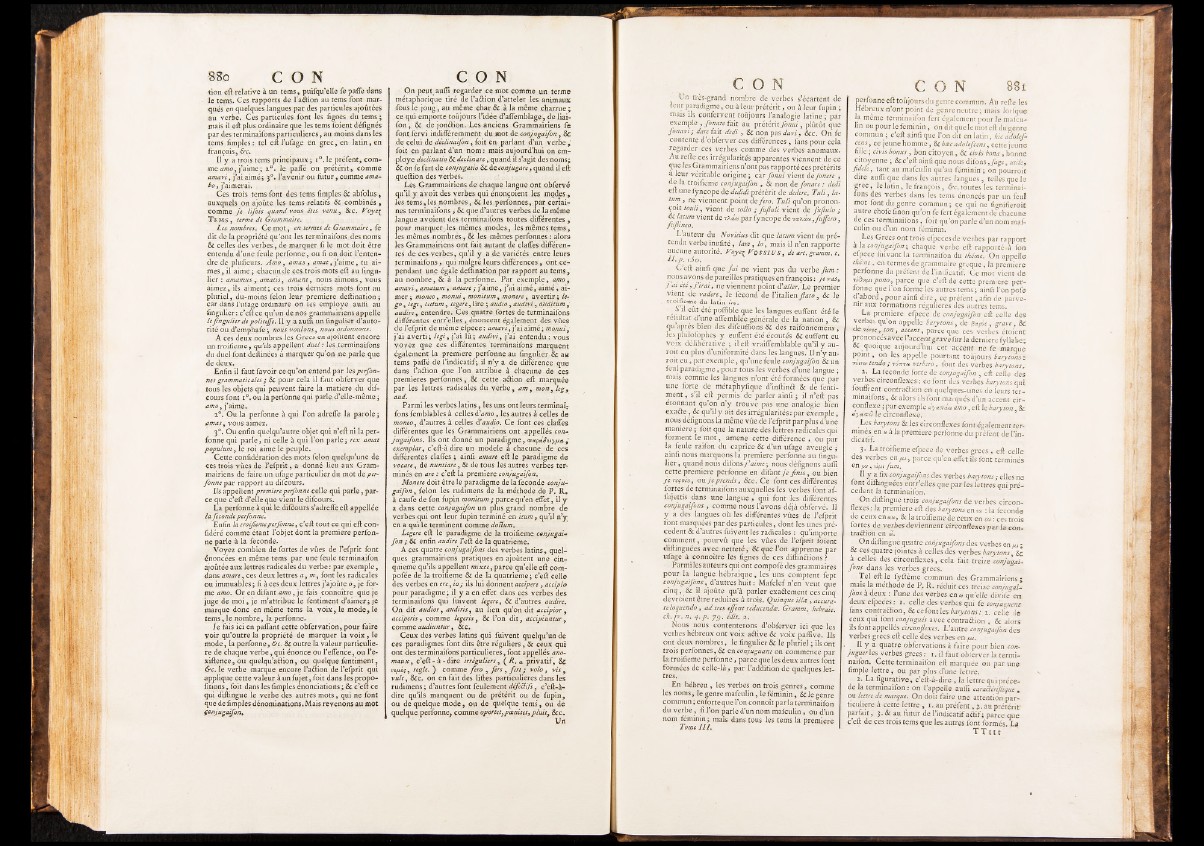
»8o C O N
tion eft relative à un tems, puifqu’elle fe paffe dans
le tems. Ces rapports de l'adion au tems font marqués
en quelques langues par des particules ajoutées
au verbe. Ces particules font les lignes du tems ;
mais il eft plus ordinaire que les tems foient délignés
par des terminaifons particulières, au moins dans les
tems limples : tel eft l’ufage -en grec, en latin, en
françois, &c,
II y a trois tems principaux ; i° . le préfent, comme
amo, j’aime; 2°. le paffé ou prétérit, comme
amavi, j’ai aimé ; 30. l’avenir ou futur, comme ama-
bo, j’aimerai» v
Ces trois tems font des tems limples & abfolus,
auxquels on ajoûte les-teins relatifs & combinés ,
comme je lijbis quand vous ■ êtes venu, &c. Voye{
T é MS , terme de Grammaire,
Les nombres. Ce m ot, en termes de Grammaire, fe
dit de la propriété qu’ont les terminaifons des noms
& celles des verbes , de marquer li le mot doit être
entendu d’une feule perfonne, ou fi on^doit l’entendre
de plulieurs. Amo, amas, amat,j’aime, tu aimes,
il aime ; chacun de ces, trois mots eft au fingu-
lier : amamus amans, amant, nous aimons, yous
aimez, ils aiment; ces trois derniers .mots font au
pluriel, du-moins félon leur première deftination ;
car dans l’ufage ordinaire on les employé . aufli au
fingulier: c’eft ce qu’un de nos grammairiens appelle
lefingulier de politejfe. Il y aauffi un fingulier d’autorité
ou d’emphafe ; nous voulons, nous ordonnons.
A ces deux nombres les Grecs en ajoutent encore
un troifieme, qu’ils appellent duel : ies terminail'ons
du duel font deltinées à marquer qu’on ne, parle que
de deux.
Enfin il faut favoir ce qu’on entend par lesperfon-
nts grammaticales ; & pour cela il faut obferver que
tous les objets qui peuvent faire la matière du discours
font i°. ou la perfonne qui parler d’elle-même ;
amo, j’aime.
20. Ou la perfonne à qui l’on adreffe la parole ;
amas, vous aimez.
30. Ou enfin quelqu’autre objet qui n’eft ni la perfonne
qui parle, ni celle à qui l’on parle ; rex amat
populum, le roi aime le peuple.
Cette confidération des mots félon quelqu’une de
ces trois vues de l’efprit-, a donné lieu aux Grammairiens
de faire un ufage particulier du mot de perfonne
par rapport au difcours.
Ils appellent première perfonne celle qui parle, parce
que c’eft d’elle que vient le difcours.
La perfonne à qui le difêours s’adreffe eft appellée
la fécondé perfonne.
Enfin la troifiemeperfonne, c’eft tout ce qui eft con-
fidéré comme étant l’objet dont la première perfonne
parle à la fécondé.
Voyez combien de fortes de vues de l’efprit font
énoncées en même tems par une feule terminaifon
ajoutée aux lettres radicales du verbe: par exemple,
dans amure, ces deux lettres a , m, font les radicales
ou immuables; fi à ces deux lettres j’ajoûte o, je forme
amo. Or en difant amo, je fais connoître que je
juge de moi, je m’attribue le fentiment d’aimer; je
marque donc en même tems la vo ix , le mode, le
tems, le nombre, la perfonne.
Je fais ici en paffant cette obfervation, pour faire
yoir qu’outre la propriété de marquer la v o ix , le
mode, la perfonne, &c. & outre la valeur particulière
de chaque verbe, qui énonce ou l’effence, ou l’e-
xiftence, ou quelqu’aCtion, ou quelque fentiment,
&c. le verbe marque encore l’aCtion de l’efprit qui
applique cette valeur à unfujet, foit dans les propo-
litions, foit dans les limples énonciations ; & c’eft ce
qui diftingue le verbe des autres mots, qui ne font
que de limples dénominations. Mais revenons au mot
fonjugaifon.
C O N
On peut( aulli regarder ce mot comme un terme
métaphorique tiré de l’aftion d’atteler les animaux
fous le joug, au même char & à la même charrue ;
ce qui emporte toujours l’idée d’alfemblage, de liai-
fon , & de jonClion. Les anciens Grammairiens fe
fojit fervi indifféremment du mot de conjugaifon, &
de celui de déclinaifon, foit enparlant d’un verbe,’
foit en parlant d’un nom : mais aujourd’hui on employé
declinatio&c declinare, quand il s’agit des noms;
& on fe fèr,t de conjugatio & de conjugare , quand il eft
queftion des verbes.
Les Grammairiens; de chaque langue ont obfervé
qu’il y avoit des verbes qui énonçoient les, modes ,
les-tems;,les nombres, &c les,perfonnes, par certaines
terminaifons, & que d’autres verbes de la même
langue avoient des terminaifons toutes différentes ,
pour marquer; les mêmçs modes, les mêmes tems,
les mêmes nombres j & les mêmes perfonnes : alors
les Grammairiens ont fait autant de claffes différentes
de ces verbes, qu’il y a de variétés entre leurs
terminaifons, qui malgré leurs différences, ont cependant
une égale deftination par rapport au tems ,
au nombre, & à la perfonne. Par exemple, amo ,
amavi, amatum , amare; j’aime, j’ai aimé, a imé, aimer
; moneo, monui, monitum, monere, avertir ; le-
go, legi, leclum , legere, lire ; audio, audivi , auditum ,
audire, entendre. Ces quatre, fortes de terminaifons
différentes entr’elles , énoncent également des vûes
de l’efprit de même efpece : amavi, j’ai aimé; monui,
j’ai averti; legi, j’ai lû ; audivi, j ’ai entendu; vous
voyez que ces différentes terminaifons marquent
également la première perfonne au fingulier & au
tems,pafle d ç l’indicatif; il n’y a de différence que
dans l’aCtion que l’on attribue à chacune de ces
premières perfonnes ; & cette, aCtion eft marquée
par les lettres radicales du verbe, am, mon, leg,
aud.
Parmi les verbes latins, les uns ont leurs terminai?
fons femblables à celles dé amo, les autres à celles de
moneo, d’autres à celles d’audio. Ce font c es claffes
différentes que les Grammairiens ont appelles con-
jugaifons. Ils ont donné un paradigme, asa.pd.S'ttypa ,'
exemplar, c’eft-à dire un modèle à chacune de ces
différentes claffes ; ainfi amare eft le paradigme de
vocare, de nuntiare, & de tous les autres verbes terminés
en are : c’eft la première conjugaifon.
Monere doit être le paradigme de la fécondé conjugaifon
, félon les rudimens de la méthode de P. R.
à caufe de fon fupin monitum; parce qu’en effet, il y
a dans cette conjugaifon un plus grand nombre de
verbes qui ont leur fupin terminé en itum, qu’il n’y
en a qui le terminent comme doctum.
Legere eft le paradigme de la troifieme conjugaifon
; & enfin audire l’eft de la quatrième.
A ces quatre conjugaifons des verbes latins, quelques
grammairiens pratiques en ajoutent une cinquième
qu’ils appellent mixte, parce qu’elle eft com-
pofée de la troifieme & de la quatrième; c’eft celle
des verbes en ere, io ; ils lui donnent accipere, accipio
pour paradigme ; il y a en effet dans ces verbes des
terminaifons qui fui vent legere, &c d’autres audire.
On dit audior, audiris, au lieu qu’on dit accipior ,
acciperis, comme legeris, & l’on dit, accipiuntur ,
comme audiuntur, &c.
Ceux des verbes latins qui fuivent quelqu’un de
ces paradigmes font dits être réguliers, & ceux qui
ont des terminaifons particulières, font appellés anomaux,
c’e f t-à -d ire irréguliers, (R . & privatif, &c
vo/xôç, réglé. ) comme fero , fers , fert ; volo , vis ,
vult, &c. on en fait des liftes particulières dans les
rudimens ; d’autres font feulement défectifs, c’eft-à-
dire qu’ils manquent ou de prétérit ou de fupin,
ou de quelque mode, pu de quelque tems, ou de
quelque perfonne, comme oportet,potnitet3 pluit, & c .
Un
C O N
Un tïè's-grand nombre de verbes s’écartent de
leur paradigme, ou à leur prétérit, ou à leur fupin ;
mais ils confervent toujours l’analogie latine ; par
exemple , fonare fait au prétérit fonui, plutôt que
fonavi; dure fait dedi, & non pas davi, & c . On fe
contente d’obferver ces différences , fans pour cela
regarder ces verbes comme des verbes anomaux.
Au refte ces irrégularités apparentes viennent de ce
que les Grammairiens ri’ont pas rapporté ces prétérits
a leur véritable origine ; car fonui vient de fonere ,
de la troifieme conjugaifon , & non de fonare : dedi
eft une fyncope de dedidi prétérit de dedere. Tuli, latum.
, ne viennent point de fero. Tuli qu’on pronon-
çoit touli, vient de tollo ; fufu li vient de fuflulo ;
& latum vient de tXeta par fyncope de retxda ,fuffero,
fujiineo.
L’auteur du Novitius dit que latum vient du prétendu
verbe inufité, lare , lo, mais il n’en rapporte
aucune autorité. Voye^ V o s s l u s , de art. gramm. t.
II. p. /;3, '
C ’eft ainfi que fui ne vient pas du verbe fum :
n°us avons de pareilles pratiques en françois : je vas,
j ai ete, j ’irai, ne viennent point dû aller. Le premier
vient de vadere, le fécond de l’italien fiato, & le
troifieme du latin ire.
' S il eut été poffible que les langues euffent été le
relultat d’une affemblee générale, de la nation , &
qu’après bien des difcuflions & des raifonnemens,
les philofophes y euffent été écoutés & euffent eu
voix délibérative ; il eft vraiffemblable qu’il y au-
roit eu plus d’uniformité dans les langues. Il n’y au-
roit e u , par exemple, qu’une feule conjugaifon & un
feul paradigme, pour tous les verbes d’une langue ;
mais comme les langues n’ont été formées que par
une forte de métaphyfique d’inftinft & de fentiment
, s’il eft permis de parler ainfi ; il n’eft pas
étonnant qu’on n’y trouve pas une analogie bien
exatte, & qu’il y ait des irrégularités : par exemple,
nous défignons la même vûe de l’efprit par plus d’une
maniéré ; foit que la nature des lettres radicales qui
forment le mot, amene cette différence ou par
la feule raifon du caprice & d’un ufage aveugle ;
ainfi nous marquons la première perfonne au fingulier
, quand nous difons j ’aime ; nous défignons aufli
cette première perfonne en difant je finis, ou bien
je reçois, ou je prends, & c . Ce font ces différentes
fortes de terminaifons auxquelles les verbes font af-
fujettis dans une langue , qui font les différentes
conjugaifons , comme nous l’avons déjà obfervé. Il
y a des langues où les différentes vûes de l’efprit
font marquées par des particiiles, dont les unes précèdent
& d’autres fuivent les r a d ic a le sq u ’importe
comment, pourvu que les vues de l’efprit loient
diftinguées avec netteté, & que l’on apprenne par
ufage à connoître les lignes de ces diftinétions ?
Parmi les auteurs qui ont compofé des grammaires
pour la langue hébraïque, les uns comptent fept
conjugaifons, d’autres huit: Mafclef n’en veut que
cinq, & il ajoûte qu’à parler exa&ement ces cinq
devroient être réduites à trois. Quinque ilia , accura-
te loquendo, ad très ejfcnt reducendce. Gramm. hebràic.
ch. jv. n. 4. p . yc). édit. 2.
Nous nous contenterons d’obferver ici que les
verbes hébreux ont voix aâ ive & voix palfive. Ils
ont deux nombres, le fingulier & le pluriel ; ils ont
trois perfonnes, & en conjuguant on commence par
la troifieme perfonne, parce que les deux autres font
formées de celle-là, par l’addition de quelques lettres.
En hébreu , les verbes on trois genres, comme
les noms, le genre mafculin, le féminin, & le genre
commun ; enforteque l’on connoît parla terminaifon
du v erbe, fi l’on parle d’un nom mafculin , ou d’un
nom féminin ; mais dans tous les tems la première
Tome III.
C O N 881
perfonne eft toujours du genre comnUin. Aü refte les
Hebreux n ont point de genre neutre ; mais lorfque
la même terminaifon fert également pour le mafculin
ou pour le féminin, on dit quele mot eft du genre
commun ; c’eft ainfi que l’on dit en latin, hic adolefi-
cens, ce jeune homme, &lioecadolefcens, cette jeune
fille ; civis bonus, bon citoyen, & civis bona, bonne
citoyenne ; & c’eft ainfi que nous difons ,fage, utile,
fidele, tant au mafculin qu’au féminin*; on pourroit
dire aufli que dans les autres langues , telles que le
'grec, le latin, le françois, &c. toutes les terminaifons
des verbes dans les tems énoncés par un feul
mot font du genre commun ; ce qui ne fignifieroit
autre chofe finon qu’on fe fert également de chacune
de ces terminaifons, foit qu’on parle d’un nom mafculin
ou d’un nom féminin.
Les Grecs ont trois efpecesde verbes par rapport
à la conjugaifon-, chaque verbe eft rapporté.à fon
efpece fuivant la terminaifon du thème. On appelle
thème, en termes de grammaire greque, la première
perfonne du prefent de l’indicatif. Ce mot vient de
TÎd-np.1 pono, parce que c’eft de cette première perfonne
que l’on forme les autres tems ; ainfi l’on pofe
d abord, pour ainfi dire, ce préfent, afin de parvenir
aux formations régulières des autres tems.
La première elpece d & conjugaifon eft celle des
verbes qu’on appelle barytons, de liapvç , grave, ôc
de Tovoe ,-ton , accent , parce que ces verbes étoient
prononces avecTaccemgrave fur laderniere fyllabe;
& quoique aujourd’hui cet accent ne fe marque
point, on les appelle pourtant toujours barytons t
rtira tendo; tutttu verbero., font des verbes barytons,
2. La féconde forte de conjugaifon , eft celle des
verbes circonflexes : ce font des verbes barytons qui
fouffrent contraction en quelques-unes, de leurs terminaifons,
& alors ilsifont marqués d’un accent circonflexe
; par exemple dyanda amo, eft le baryton, &
«yatsco le circonflexe.
Les barytons & les circonflexes font également terminés
en « à la première perfonne du préfent de l’indicatif.
3 . La troifieme efpece de verbes grecs , eft celle
des verbes en pu, parce qu’en effet ils font terminés
en p.i, ù/j.1 fum.
Il y a fix conjugaifons des verbes barytons ; elles ne
font diftinguées entr’elles que par les lettres qui precedent
la terminaifon.
On diftingue trois conjugaifons de verbes circonflexes
: la première eft des barytons en : la fécondé
de ceux en a.u>, & la troifieme de ceux en cm : ces trois
fortes de verbes deviennent circonflexes par la contraction
en m.
On diftingue quatre conjugaifons des verbes en pu ;
& ces quatre jointes à celles des verbes barytons, &
à celles des circonflexes, cela fait treize conjugaifons
dans les verbes grecs.
Tel eft le fyfteme commun des Grammairiens ;
mais la méthode de P. R. réduit ces treize conjugaifons
deux : l’une des verbes :en m qu’elle divife en
deux efpeces : 1. celle des verbes qui fe conjuguent
fans contraction, & ce font les barytons: 2. celie de
ceux qui font conjugués avec contraction , & alors
ils font appellés circonflexes. L’autre conjugaifon des
verbes grecs eft celle des verbes en.pu.
Il y a quatre obfervations à faire pour bien conjuguer
les verbes grecs : 1. il faut obferver la terminaifon.
Cette terminaifon eft marquée ou par une
fimple lettre, ou par plus d’une lettre.
2. La figurative, c’eft-à-dire , la lettre qui précédé
la terminaifon : on l’appelle aufli caraciériftique ,
ou lettre de marque. On doit faire une attention particuliere
à cette lettre , 1. au préfent, ?.. au prétérit'
parfait, 3. & au futur de l’indicatif aClif; parce que
c’eft de ces trois tems que les autres font formés. L»
T T t t t
j j l