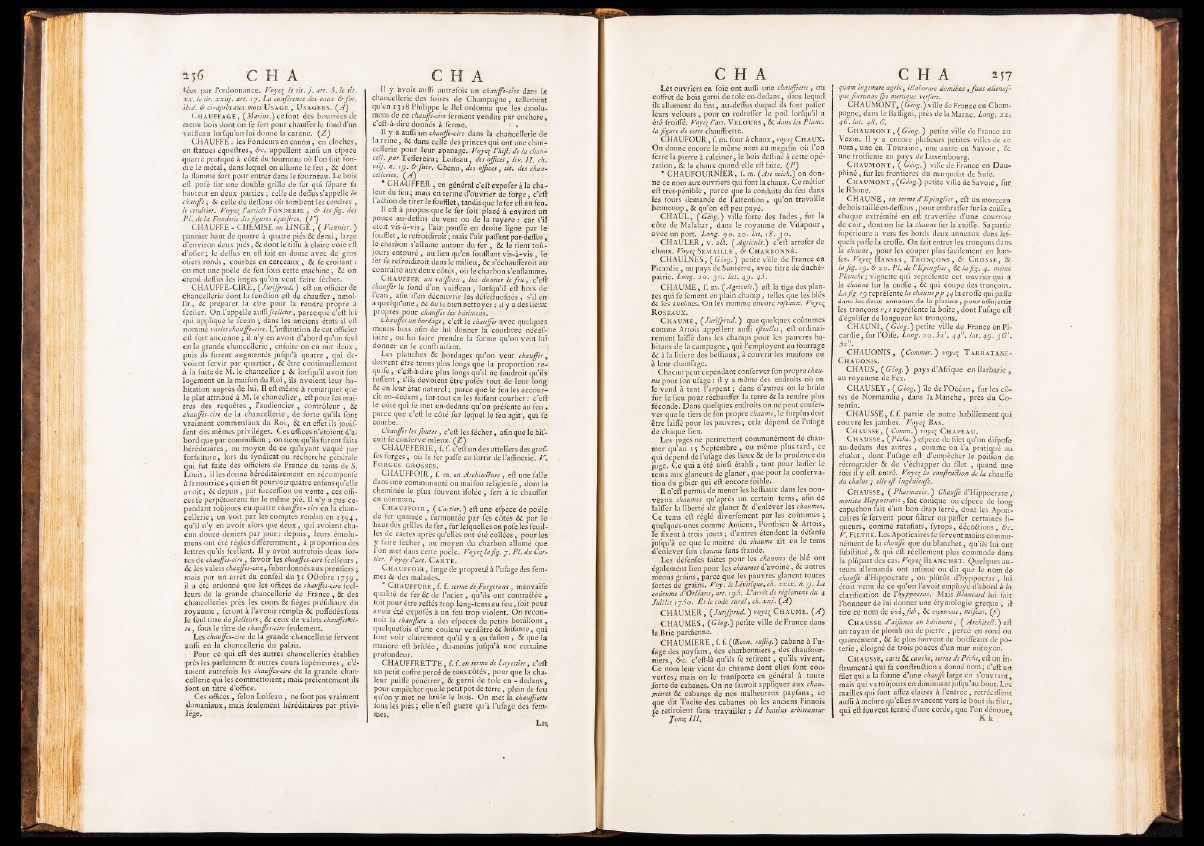
tées par l’ordonnance. Voyez /« /«. y. <iw. 5. le tit.
x x . le tir. xxiij. art. i j . La conférence des eaux & for-,
ibid. & ci-aprés aux mots USAGE , USAGEkS. {A )
C h a u f f a g e , {Marine.^) ce font des bour'réesde
menu bois dont on fe fert pour chaufferie fond-d’un
vaiffeau lorfqu’onlui donne la-caréné, {Z )
CHAUFFE : les Fondeurs en canon , en cloches,
en ftatues équeftres, &c. appellent ainfi un efpace
quarré pratiqué à côté du fourneau où l’on fait fondre
le métal, dans lequel on allume le feu , & dont
la flamme fort pour entrer dans le fourneau. Le bois
■ eft pofé fur une double.■ grille de fer qui fépare fa
hauteur en deux parties ; celle de deffus s’appelle U
chauffe ; & celle de deffousfoù tombent les cendrés ,
le cendrier. Vqye^l'article Fonderie , & les fig, dis
P I. de la Fonderie des figures équeffres. {V)
CHAUFFE - CHEMISE o« LINGE, ( Vannier. )
pannier haut de quatre à quatre piés & demi, large
d ’environ deux piés, 8c dont letiffu à claire voie eft
«1’ofier; le deffus en eft fait en dôme avec de gros
ofiers ronds, courbés en cerceaux , & fe croifânt :
on met une.poêle de feu fous cette machine, 8c on
étend deffus les linges qu’on veut faire fécher.
CHAUFFE-CIRE, ( Jurifprud. ) eft un officier de
chancellerie dont la fonâion eft de chauffer , amollir.,
8c préparer la cire pour la rendre propre à
fceller. On l’appelle auffifcelleur, parce que c’eft lui
qui applique le fceau ; dans les anciens états il eft
nommé varlet chauffe-cire. L’inftitution de cet officier
eft fort ancienne ; il n’y en avoit d’abord qu’un feul
en la grande chancellerie, enfuite on en mit deux,
puis ils furent augmentés jufqu’à quatre , qui dévoient
fervir par quartier, 8c être continuellement
à la fuite de M. le chancelier ; & lorfqu’il avoit fon
logement en la maifon du R o i, ils avoient leur habitation
auprès de lui. Il eft même à remarquer que
le plat attribué à M. le chancelier, eft pour les maîtres
des requêtes, l’audiencier, contrôleur , &
chauffes-cire de la chancellerie, de forte qu’ils font
vraiment commenfaux du Ro i, 8c en effet ils joùif-
fent des mêmes privilèges. Ces offices n’étoient d’abord
que par commiflion ; on tient qu’ils furent faits
héréditaires, au moyen de ce qu’ayant vaqué par
forfaiture, lors du fyndicat ou recherche générale
qui fut faite des officiers de France du tems de S.
Louis , il les donna héréditairement en récompenfe
à fa nourrice > qui en fit pourvoir quatre enfans qu’elle
avoit ; 8c depuis, par fucceffion ou vente , ces offices
fe perpétuèrent fur le même pié. Il n’y a pas cependant
toujours eu quatre chauffes-cire en la chancellerie
; on voit par les comptes rendus en 1394 ,
qu’il n’y en avoit alors que deux, qui avoient chacun
douze deniers par jour : depuis, leurs émolu-
mens ont été réglés différemment, à proportion des
lettres qu’ils fcellent. Il y avoit autrefois deux fortes
de chauffes-cire, favoir les chauffes-cire fcelleurs ,
8c les valets chauffes-cire, fubordonnés aux premiers ;
mais par un arrêt du confeil du 31 Oftobre 1739 ,
il a été ordonné que les offices de chauffes-cire fcelleurs
de la grande chancellerie de France, & des
chancelleries près les cours 8c fiéges préfidiaux du
royaume, feront à l’avenir remplis 8c poffédésfous
le feul titre de fcelleurs, 8c ceux de valets chauffes*ci-
re, fous le titre de chauffes-cire feulement.
Les chauffes-cire de la grande chancellerie fervent
auffi en la chancellerie du palais.
Pour ce qui eft des autres chancelleries établies
près les parlemens & autres cours fupérieures, c’é-
toient autrefois les chauffes-cire de la grande chancellerie
qui les commettoient ; mais préfentement ils
-font en titre d’office.
; Ces offices, félon Loifeau, ne font pas vraiment
domaniaux, mais feulement héréditaires par privi-
lége.
Il ÿ avoit auffi autrefois un chauffe-cire dàns la
chancellerie des foires de Champagne, tellement
qu en 131-8 Philippe le Bel ordonna que les émo'lu-
mens de ce. chàuffe-cire feroient vendus par enchère,
c’eft-à-dire donnés à ferme, ï •
Il y-a auffi un chauffe-cire dans la chancellerie de
la reine, 8c dans celle des princes qui ont une'chàn^
cellerie pour leur apanage. Voye^ l'hifi; de la chan-
cejl. par Teffereau ; Loifeau, des offices, liv. I I . ch*
viij. n. ig . & fuiv. Chenu-, des offices, tit. des chancelleries,
( J ) r , }. f :.
* CHAUFFER, en général c’eft expofer à la cha-
leur du feu ; mais en terme d’ouvrier de fofge -, c’eft
1 action de tirer le fbufflet', tandis que lé fer eft âli feu.
Il eft à propos que le fer foit’ placé à envirori un
pouce au-defliis du vent où de la tuyere : car s’il-
étoit v-is-à-vis ,' l’airj pouffé en droite ligné par le
foufflet, le refroidiroit ; mais l’air paffant par-deffus,
le charbon s’allume autour du fer , 8c le tient toû-
jours entouré , au lieu qu’en fouillant vis-à-vis , lé
fer fe refroidiroit dans le milieu, 8c s’échaufferait au
contraire aux deux côtés, où le charbon s’enflamme.
CHAUFFER unvaiffeau , lui donner le feu t i c ’eft
chauffer le fond d’un vaiffeau, lorfqu’il eft hors de •
le a u , afin d’en découvrir les défeûuofités, s’il en'
a quelqu’une, 8c de le bien nettoyer : il y a des lieux
propres- pour chauffer les bâtimens.
Chauffer unbordage , c’eft le chauffer avec quelques
menus bois afin de lui donner là courbure .nécef-
faire, ou lui faire prendre la forme qu’on veut lui
donner en le conftruifant.
Les planches 8c bordages qit’on Veut chauffer ÿ
doivent etre tenus plus longs que la proportion ré-'
quife, c’eft-à-dire plus longs qu’il ne faudroit qu’ils
fuflent, s’ils dévoient être pofés tout de leur long
8c en leur état naturel ; parce que le feu les accour-
cit en-dedans, fur-tout en les faifant courber: c’eft
le côte qui fe met en-dedans qu’on préfente au feu ,
parce que c’eft le côté fur lequel lé-feu agit, qui fe
courbe.
Chauffer les foutes f c’eft les fécher, afin que le bif-
cuit fe conferve mieux. ,(Z)
CHAUFFERIE, f, f. c’eft un des atteliers des greffes
forges, où le fer paffe au fortir de raffinerie. V,
Forges grosses.
CHAUFFOIR, f. m. en Architecture , eftunefalle
dans une communauté ou maifon religieufe, dont la
cheminée le plus fouvent ifolée , fert à fe chauffer
en commun,
C hauffoir , ( Cartier. ) eft une efpece de poêle
de fer quarrée, furmontée par fes côtés 8c par le
haut des grilles de fer, fur lefquelles on pofe les feuilles
de cartes après qu’elles ont été collées, pour les
y faire fecher, au moyen du charbon allumé que
l’on met dans cette poêle. Voye^lafig. y . PI. du Cartier.
Voyey l'art. C a r t e .
C hauffoir , linge de propreté à l’ufage des femmes
8c des malades.
C hauffure, f. f. terme de Forgerons, mauvaife
qualité de fer 8c de l’acier , qu’ils ont contractée ,
foit pour être reftés trop long-tems au feu , foit pour
avoir été expofés à un feu trop violent. On recon-
noît la chauffure à des efpeces de petits bouillons ,
quelquefois d’une couleur verdâtre 8c luifante, qui
font voir clairement qu’il y a eu fufion , 8c que la
matière eft brûlée, du-moins jufqu’à une certaine
profondeur.
CHAUFFRETTE, f. f. en terme de Layettier, c’eft
un petit coffre percé de tous côtés, pour que la chaleur
puiffe pénétrer, 8c garni de tôle en - dedans ,
pour empêcher que le petit pot de terre, plein de feu
qu’on y met ne brûle le bois. On met la chauffrette
lous les piés y elle n’ eft guère qu’à l’ufage des femmes.
Le«
Lès ouvriers en foie ont auffi une chauffrette, OU
coffret de bois garni de tôle en-dedans, dans lequel
ils allument du feu , au-deffus duquel ils font paffer
leurs velours , pour en redreffer le poil lorfqu’il a
été froiffé. Voyez l'art. VELOURS, 8c dans les Plane.
la figure de cette chauffrette.
CHAUFOUR, f. m. four à chaux, voyez C h a u x .
On donne encore le même nom au magafin où l’on
ferre la pierre à calciner, le bois deftine à cette operation,
8c la chaux quand elle eft faite. {P)
* CHAUFOURNIER, f. m. {Art méch.) on donne
ce nom aux ouvriers qui font la chaux. Ce métier
eft très-pénible, parce que la conduite du feu dans
les fours demande de l’attention, qu’on travaille
beaucoup, 8c qu’on eft peu payé.
CHAUL, ( Géog. ) ville forte des Indes , fur la
côte de Malabar, dans le royaume de Vifapour,
avec un port. Long. g o . 20. lat. 18. g o .
CHAULER, v . a&. {Agricult.) c’eft arroferde
chaux. Voyez Semaille , 6* C harbonné.
CH AULNES, ( Géog. ) petite ville de France en
Picardie, au pays de Santerre, avec titre de duche-
pairie. Long. 2.0. go. lat. 4g. 4S.
CHAUME, f. m. {Agricult.') eft la tige des plantes
qui fe fement en plain champ, telles que les.blés
8c les avoines. On les nomme encore rofeaux. Voyez
R oseaux.
C h a um e , ( Jurifprud. ) que quelques coûtumes
comme Artois appellent auffi ejleulles, eft ordinairement
laiffé dans les champs pour les pauvres ha-
bitans de la campagne, qui l’employent au fourrage
8c àlalitiere des beftiaux, à couvrir les maifons ou
à leur chauffage.
Chacun peut cependant conferver fon propre chaume
pour fon ufage : il y a même des endroits où on
le vend à tant l’arpent ; dans d’autres on le brûle
fur le lieu pour réchauffer la terre 8c la rendre plus
féconde. Dans quelques endroits on ne peut conferver
que le tiers de fon propre chaume, le furplus doit
être laiffé pour.les pauvres; cela dépend d e l’ufage
de chaque lieu.
Les juges ne permettent communément de chau-
mer qu’au 15 Septembre , ou meme plus tard, ce
qui dépend de l’ufage des lieux 8c de la prudence du
juge. Ce qui a été ainfi établi, tant pour laiflèr le
tems aux glaneurs de glaner, que pour la conferva-
tion'du gibier qui eft encore foible»
Il n’eft permis de mener les beftiaux dans les nouveaux
chaumes qu’apres un certain tems, afin de
laiffer la liberté de glaner 8c d’enlever les chaumes.
Ce tems eft réglé diverfement par les coûtumes ;
quelques-unes comme Amiens, Ponthieu 8c Artois,
le fixent à trois jours ; d’autres étendent la défenfe
jufqu’à ce que le maître du chaume ait eu le tems
d’enlever fon chaunie fans fraude.
' Les défenfes faites pour les chaumes dé blé ont
également lieu pour les chaumes d’avoine, 8c autres
menus grains, parce que les pauvres glanent toutes
fortes de grains. Voy. leLèvitiquey ch. xxix. n .g .L a
coutume d'Orléans, art. ig5. L'arrêt de réglement du 4
Juillet lySo. Et le code rural, ch.xxj. {A)
CHAUMER, {Jurifprud. ) voye^ C haume. {A)
CHAUMES, {Géog.) petite ville de France dans
la Brie parifienne.
CHAUMIERE, f. f. {(Econ. rufiiq.) cabane à l’u-
fagedes payfans, des charbonniers, des chaufourniers
, &c. c ’eft-là qu’ils fe retirent, qu’ils vivent.
C e nom leur vient du chaume dont elles font couvertes;
mais on le tranfporte en général à toute
forte de cabanes. On ne fauroit appliquer aux chaumières
8c cabanes de nos malheureux payfans, ce
que dit Tacite des cabanes où les anciens Finnois
le retiroient fans travailler : Id beatius arbitrantur
Jotn$ IIIi
qnam i/igemere agrist illaborare domibüs ,fuas alienaf-
que fortunas fpe metuque verfare.
CHAUMONT, {Géog.) ville de France en Champagne,
dans le Baffigni, près de la Marne. Long. 22.
4(3. lat. 48. (T.
C haum ont , ( Géog. ) petite ville de France au
Vexin. Il y a encore plufieurs petites villes de ce
nom, une en Touraine, une autre en Savoie, 8c
une troifieme au pays de Luxembourg.
C h a um o n t , ( Géog.) ville de France en Dauphiné
, fur les frontières du marquifat de Sufe.
C h a um o n t , {Géog.) petite ville de Savoie, fur,
le Rhône.
CH AUNE, en terme cT Epinglier, eft un morceau
de bois taillé en-deffous, pour embraffer fur la cuiffe ;
chaque extrémité en eft traverfée d’une courroie
de cuir, dont on lie la chaune fur la cuiffe. Sa partie
fupérieure a vers fes bords deux anneaux dans lef-
quels paffe la croffe. On fait entrer les tronçons dans
la chaune, pour les couper plus facilement en han-
fes. Voye{ Hanses , T ronçons , & C r o s se , &
la fig. ig. & 20. PI. de CEpinglier, 8c la fig. 4. même.
Planche; vignette qui repréfente cet ouvrier qui a
la chaune fur la cuiffe , 8c qui coupe des tronçons.
La fig. rg repréfente la chaune pp ; ÿ la croffe qui paffe
dans les deux anneaux de la platine, pour affujettir
les tronçons r; s repréfente la boîte, dont l’ufage eft
d’égalifer de longueur les tronçons.
CHAUNI, { Géog.) petite ville de France en Picardie
, fur l’Oife. Long. 20.62'. 44". lat. 4g. g 6 '. mm
CHAÜONIS , ( Commer. ) voye^ T arratane-
C hauo nis.
CHAUS, ( Géog. ) pays d’Afrique en Barbarie
au royaume de Fez.
CHAUSEY, ( Géog. ) île de l’Océan, fur les côtes
de Normandie, dans la Manche, près du Cotentin.
CHAUSSE, f. f. partie de notre habillement qui
couvre les jambes. Voye[ Bas.
C hausse, (Comm.) voyez C hapeau .
C h a u s s e , {Pêche.) efpece de filet qu’on difpofe
au-dedans des autres , comme on l’ a pratiqué au
chalut, dont l’ufage eft d’empêcher le poiffon de
rétrograder 8c de s’échapper du filet , quand une
fois il y eft entré. Voyez la conftruclion de la chauffe
du chalus ; elle ejl ingénieufe.-
C hausse, {Pharmacie.) Chauffe d’Hippocrate,•
monica Hippocratis , fac Conique ou efpece de long
capuchon fait d’un bon drap ferré, dont les Apoti-
caires fe fervent pour filtrer ou paffer certaines liqueurs,
comme ratafiats, fyrops, décoftions , &cj
V. Filtre. Les Apoticaires fè fervent moins communément
de la chauffe que du blanchet, qu’ils lui ont
fubftitué, 8c qui eft réellement plus commode dans
la plûpart des cas. Voyez Bl an ch e t . Quelques auteurs
allemands ont infinué ou dit que le nom de
chauffe d’Hippocrate, ou plûtôt d’hyppocras, lui
étoit venu de ce qu’on l ’avoit employé d’abord à la
clarification de Yhyppocras. Mais Blancard lui fait
l’honneur de lui donner une étymologie greque ; il
tire ce nom de ù-mo,fubf & r.spetmiju/f mifeeo. {b)
C hausse d'aifance eh bâtiment, { Architecl. ) eft
un tuyau de plomb ou de pierre., percé en rond ou
quarrément, & le plus fouvent de boiffeaux de poterie
, éloigné de' trois pouces d’un mur mitoyen.
CHAUSSE, carte & çauche, terme de Pêche, eft un infiniment
à qui fa conftruûion a donné nom ; c’eft uit
filet qui a la forme d’une chauffe large en s’ouvrant,
mais qui vatoûjours en diminuant jufqu’au bout. Les
mailles qui font affez claires à l’entrée, retréciffent
auffi à mefure qu’elles avancent vers le bout du filet,
qui çft fouyent fermé d’une corde, que l’on dénoue,
9ÜH V L . *