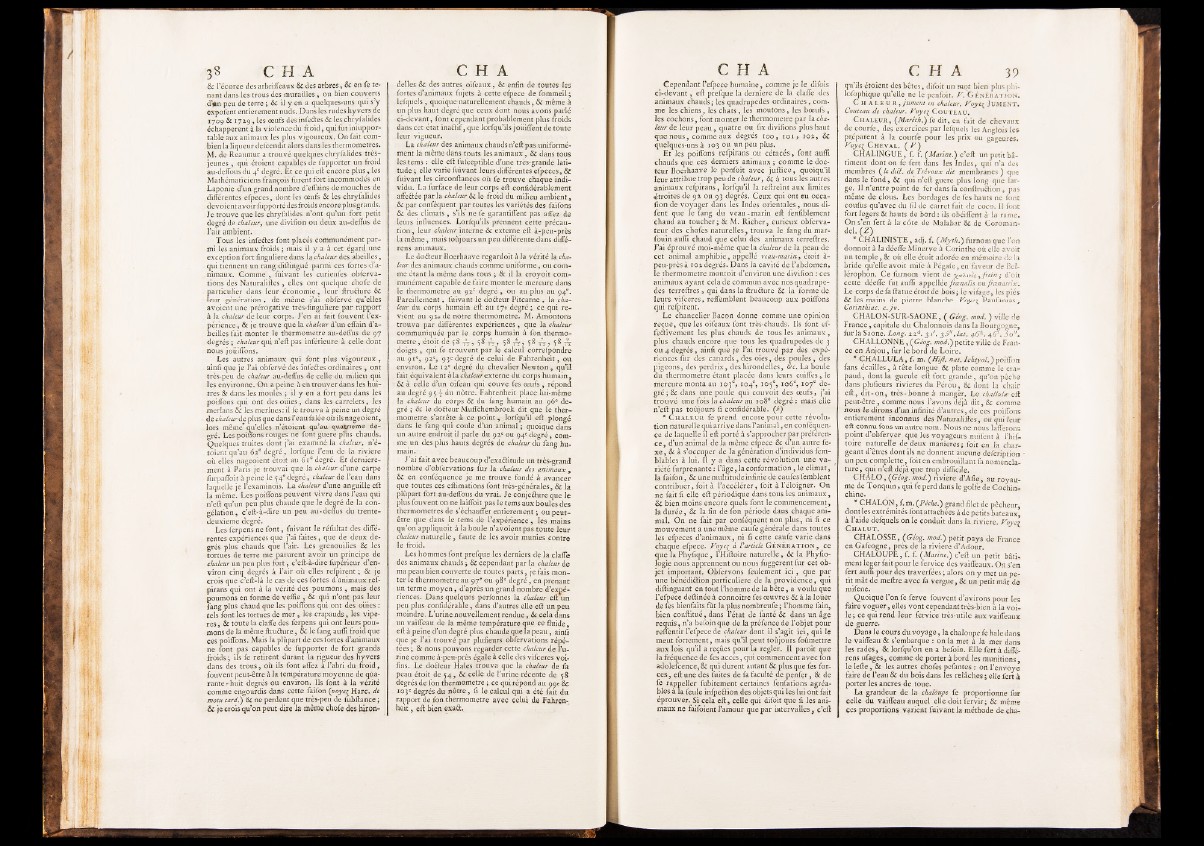
& l’écorce des arbriffeaux & des arbres, & en fe tenant
dans les trous des murailles , ou bien couverts
d’fin peu de terre ; & il y en a quelques-uns qui s’y
expofent entièrement nuds. Dans les rudes hy vers de
1709 & 17 19 , les oeufs dès infefres & les chryfalides
échappèrent à la violence du froid, qui fut infuppor-
table aux animaux les plus vigoureux. On fait combien
la liqueur defcendit alors dans les thermomètres.
M. de Reaumur a trouvé quelques chryfalides très-
jeunes , qui étoient capables de fupporter un froid
au-deffous du 4e degré. Et ce qui eft encore plus, les
Mathématiciens françois" furent fort incommodés en
Laponie d’un grand nombre d’effains de mouches de
différentes efpeces, dont les oeufs & les chryfalides
dévoient avoir fupporté des froids encore plus grands.
Je trouve que les chryfalides n’ont qu’un fort petit
degré de chaleur, une divifion ou deux au-deffus de
l’air ambient.
Tous les'infeâes font placés communément parmi
les animaux froids ; mais il y a à cet égard une
exception fort finguliere dans la chaleur des abeilles,
qui tiennent un rang diftingué parmi ces fortes d’animaux.
Comme , fuivant les curieufes obferva-
tions des Naturalises, elles ont quelque chofe de
particulier dans leur économie, leur ftruâure &
leur génération , de même j’ai obfervé qu’elles
avoient une prérogative très-finguliere par rapport
à la chaleur de leur corps. J’èn ai fait fouvent l’expérience
, & je trouve que la chaleur d’un effain d’abeilles
fait monter le thermomètre au-deffus de 97
degrés ; chaleur qui n’eft pas inférieure à celle dont
nous joiiiffons.
Les autres animaux qui font plus vigoureux:,
ainfi que je l’ai obfervé des infefres ordinaires , ont
très-peu de chaleur.au-deffus de celle du milieu qui
les environne. On a peine à en trouver dans les huîtres
& dans les moules ; il y en a fort peu dans les
poiffons qui ont des oiiies, dans les carrelets, les
merlans & les merluesiil fe trouva à peine un degré
de chaleur de plus que dans l’eau falée où ils nageoient,
lors même* qu’elles n’étoient qu’au quatrième degré.
Les poiffons rouges ne font guere plus chauds.
Quelques truites dont j’ai examiné la chaleur, n’étoient
qu’au 62e degré, lorfque l’eau de la riviere
où elles nageoient étoit au 61e degré. Et dernièrement
à Paris je trouvai que la chaleur d’une carpe
furpaffoit à peine le 54e degré, chaleur de l’eau dans
laquelle je l’examinois. La chaleur d’une anguille eft
la même. Les poiffons peuvent vivre dans l ’eau qui
n’efl: qu’un peu plus chaude que le degré de la congélation,
c’eft-à-dire un peu au-deffus du trente-
deuxieme degré.
Les ferpens ne font, fuivant le réfultat des différentes
expériences que j’ai faites, que de deux degrés
plus chauds que l’air. Les grenouilles & les
tortues de terre me parurent avoir un principe de
chaleur un peu plus fort, c’eft-à-dire fupérieur d’environ
cinq degrés à l’air où elles refpirent ; & je
crois que c’eft-là le cas de ces fortes d’animaux ref-
pirans qui ont à la vérité des poumons, mais des
poumons en forme de v e f f e , & qui n’ont pas leur
fang plus chaud que les poiffons qui ont des oiiies :
tels font les tortues de mer, les crapauds, les vipères
, & toute la claffe des ferpens qui ont leurs poumons
de la même ftru&ure, & le fang aufli froid que
ces poiffons. Mais la plupart de ces fortes d’animaux
ne font pas capables de fupporter de fort grands
froids ; ils fe retirent durant la rigueur des hy vers
dans des trous, où ils font affez à l’abri du froid,
fouvent peut-être à la température moyenne de quarante
.-huit degrés ou environ. Ils font à la vérité
comme engourdis dans cette faifon ([voyeç Harc. de
motu card.) & ne perdent que très-peu de fubftance ;
& je crois qu’on peut dire la même chofe des hirondéliés
& des autres oifeaux, & enfin de toutes les
fortes d’animaux fujets à cette efpece de fommeil ;
lelquels, quoique naturellement chauds, & même à
un plus haut degré que ceux dont nous avons parlé
ci-devant, font cependant probablement plus froids
dans cet état inaftif, que lorfqu’ils joiiiffent de toute
leur vigueur.
La chaleur des animaux chauds n’eft pas .uniformément
la même dans touts les animaux, & dans tous
les tems : elle eft fufceptible d’une très-grande latitude
; elle varie fuivant leurs différentes efpeces, &
fuivant les circonftances où fe trouve chaque individu.
La furface de leur corps eft confidérablement
affeftée par la chaleur & le froid du milieu ambient,
& par conféquent par toutes les variétés, des faifons
& des climats, s’ils ne fe garantiffent pas affez de
leurs influences. Lorfqu’ils prennent cette précaut
io n , leur chaleur interne &. externe eft à-peu-près
la même, mais toûjours un peu différente dans diffé-
rens animaux.
Le dofreur Boerhaave regardoit à la vérité la cha-
.leur des animaux chauds comme uniforme, ou comme
étant la mêm,e dans tous ; & il la croyoit communément
capable de faire monter le mercure dans
le thermomètre au 92e degré , ou au plus au 94®.
Pareillement, fuivant le dofteur Pitcarne , la chaleur
A\\ corps humain eft au 17e degré; ce qui revient
au 92e de notre thermomètre. M. Amontons
trouva, par différentes expériences , que la chaleur
communiquée par le corps humain à fon thermomètre,
étoit de.58 tV , 58 7 â , 58 , 58 ~ i , 58
doigts , qui fe trouvent par le calcul correfpondre
au 91e, 9:2e, 93e degré de celui de Fahrenheit, ou
environ. Le 12e degré du chevalier Newton, qu’il
fait équivalent à la chaleur externe du corps humain,
1 & à celle d’un oifeau qui couve fes oeufs , répond
au degré 95 -j- du nôtre. Fahrenheit place lui-même
la chaleur du corps & du fang humain au 96e degré
; 8c le doéteur Muffchembroek dit que le thermomètre
s’arrête à ce point, lorfqu’il eft plongé
dans le fang qui coule d’un animal ; quoique dans
un autre endroit il parle du 92e ou 94e degré, comme
un des plus hauts degrés de chaleur du fang humain.
J’ai fait avec beaucoup d’exa&itude un très-grand
nombre d’obfervations fur la chaleur des animaux,
8c en conféquence je me trouve fondé à avancer
que toutes ces eftimations font très-générales, & la
plûpart fort au-deffous du vrai. Je conje&ure que le
plus fouvent on ne laiffoit pas le tems aux boules des
thermomètres de s’échauffer entièrement ; ou peut-
être que dans le tems de l’expérience, les mains
qu’on appliquoit à la boule n’avoient pas toute leur
chaleur naturelle, faute de les avoir munies contre
le froid.
Les hommes font prefque les derniers de la claffe
des animaux chauds ; & cependant par la chaleur de
ma peau bien couverte de toutes parts, je fais monter
le thermomètre au 97e ou 98e degré, en prenant
un terme moyen, d’après un grand nombre d’expériences.
Dans quelques perfonnes la chaleur eft un
peu plus confidérable, dans d’autres elle eft un peu
moindre. L ’urine nouvellement rendue, & cela dans
un vaiffeau de la même température que ce fluide ,
eft à peine d’un degré plus chaude que la peau, ainfi
que je l’ai trouvé par plufieurs obfervations répétées
; & nous pouvons regarder cette chaleur de l’urine
comme à-peu-près égale à celle des vifceres voi-
fins. Le doûeur Haies trouva que la chaleur de fa
peau étoit de 54, & celle de l’urine récente de 58
degrés de fon thermomètre ; ce qui répond au 99e &
103e degrés du nôtre, fi le calcul qui a été fait du
rapport de fon thermomètre avec celui de Fahrenheit
, eft bien exafr..
Cependant l’efpece humaine, comme je le difois
ci-devant, eft prefque la derniere de la claffe des
animaux chauds; les quadrupèdes ordinaires, comme
les chiens, les chats, les moutons, les boeufs ,
les cochons, font monter le thermomètre par la chaleur
de leur peau, quatre ou fix divifions plus haut
que nous, comme aux degrés 100, 101 > 102, 8c
quelques-uns à 103 ou un peu plus.
Et les poiffons refpirans ou cétacés, font aufli
chauds que ces derniers animaux ; comme le docteur
Boerhaave le penfoit avec juftice, quoiqu’il
leur attribue trop peu de chaleur, 8c à tous les autres
animaux refpirans, lorfqu’il la reftreint aux limites
•étroites de 92 ou 93 degrés. Ceux qui ont eu occa-
fion de voyager dans les Indes orientales, nous di-
fent que le fang du veau-marin eft fenfiblement
chaud au toucher; & M. Richer, curieux obferva-
teur des chofes naturelles, trouva le fangdumar-
fouin aufli chaud que celui des animaux terreftres.
J’ai éprouvé moi-même que la chaleur de la peau de
cet animal amphibie, appellé veau-marin, étoit à-
peu-près à 102 degrés. Dans la cavité de l’abdomen,
le thermomètre montoit d’environ une divifion : ces
animaux ayant cela de commun avec nos quadrupèdes
terreftres, qui dans la ftruâure 8c la forme de
leurs vifceres, reffemblent beaucoup aux poiffons
qui refpirent.
Le chancelier Bacon donne comme une opinion
reçue, que les oifeaux font très-chauds. Ils font effectivement
les plus chauds de tous les animaux,
plus chauds encore que tous les quadrupèdes de 3
ou 4 degrés, ainfi que je l’ai trouvé par des expériences
fur des canards, des oies, des poules, des
pigeons, des perdrix, des hirondelles, &c. La boule
du thermomètre étant placée dans leurs cuiffes, le
mercure monta au 103e, 104e, 105e, 106e, 107e degré
; 8c dans une poule qui couvoit des oeufs, j’ai
trouvé une fois la chaleur au 1088 degré : mais elle
n’eft pas toûjours fi confidérable. (b)
* C haleur fe prend encore pour cette révolution
naturelle qui arrive dans l’animal, en conféquence
de laquelle il eft porté à s’approcher par préférence
, d’un animal de la même efpece 8c d’un autre fe-
x e , & à s’occuper de la génération d’individus fem-
blables à lui. Il y a dans cette révolution une va-:
riété furprenante : l’âge, la conformation , le climat,
la faifon, 8c une multitude infinie de caufes femblent
contribuer, foit à l’accélérer, foit à l’éloigner. On
ne fait fi elle eft périodique dans tous les animaux,
& bien moins encore quels font le commencement,
la durée, & la fin de Ion période dans chaque animal.
On ne fait par conféquent non plus, ni fi ce
mouvement a une même caufe générale dans toutes
les efpeces d’animaux, ni fi cette caufe varie dans
chaque efpece. Voye^ à Varticle G én éra tio n , ce
que la Phyfïque, l’Hiftoire naturelle, & la Phyfio-
logie nous apprennent ou nous fuggerent fur cet objet
important. Obfervons feulement i c i , que par
une bénédiction particulière de la providence, qui
diftinguant en tout l’homme de la bête, a voulu que
l’éfpece deftinée à connoître fes oeuvres & à la loiier
de fes bienfaits fût la plus nombreufe ; l’homme fain,
bien conftitué, dans l’état de fanté 8c dans un âge
requis, n’a befoinque de la préfence de l’objet pour
reffentir l’efpece de chaleur dont il s’agit ic i, qui le
meut fortement, mais qu’il peut toûjours foûmettre
aux lois qu’il a reçûes pour la regler. Il paroît que
la fréquence de tes accès, qui commencent avec fon
adoleicence, & qui durent autant & plus que fes forces
, eft une des fuites de fa faculté de penfçr, & de
fe rappeller fubitement certaines fenfations agréables
à la feule infpeétion des objets qui les lui ont fait
éprouver. Si cela eft, celle qui difoit que fi les animaux
ne faifoient l’amour que par intervalles, ç’eft
qu’ils étoient des bêtes, difoit un mot bien plus phi-
lofophique qu’elle ne le penfoit. ^ .'G én ér a t io n .
CH A L E U R , jument en chaleur. Voye{ J UMENT.
Couteau de chaleur. Voye^ C o ut eau .
C haleur, ([Maréch.) fe dit, en fait de chevaux
de courfe, des exercices par lefquels les Anglois les
préparent à la courfe pour les prix ou gageures.
Voye[ C heval. ( V )
CHALINGUE, f. f. (Marine.) c’eft un petit bâtiment
dont on fe fert dans les Indes, qui n’a des
membres ( le dicl. de Trévoux dit membranes ) que
d^ns le fond, 8c qui n’eft guere plus long que large.
Il n’entre point de fer dans fa conftrufrion, pas
même de clous. Les bordages de fes hauts ne font
coufus qu’avec du fil de carret fait de coco. Il font
fort légers & hauts de bord : ils obéiffent à la rame.
On s’en fert à la côte de Malabar 8c de Coromandel.
(Z )
* CHALINISTE, adj. f. {Myth.) furnom que l’on,
donnoit à la déeffe Minerve à Corinthe où elle avoir
un temple, & où elle étoit adorée en mémoire de la
bride qu’elle avoit mife à Pégafe, en faveur de Bel-
Iérophon. Ce furnom vient de >oc, frein ; d’où
cette déeffe fut aufli appellée froenalis ou frcenatrix.
Le corps de fa ftatue étoit de bois ; le vifage, les pies
8c les mains de pierre blanche. Voye£ Paufanias,
Corinthiac. c .jv .
CHALON-SUR-SAONE, ( Géog. mod. ) ville de
France, capitale du Chalonnois dans la Bourgogne,
fur la Saône. Long. 22A 3 /'. $5" , lat. 46^ 4C . i o w*
CHALLONNE, {Géog. mod.) petite v ille de France
en Anjou, fur le bord de Loire.
* CHALLULA, f. m. ([Hijl. nat. Ichtyol. ) poiffon
fans écailles, à tête longue 8c plate comme le crapaud,
dont la gueule eft fort grande, qu’on pêche
dans plufieurs rivières du Pérou, 8c dont la chair
e f t, d it-on , très-bonne à manger. Le challula■ eft
peut-être, comme nous l’avons déjà dit, 8c comme
nous le dirons d’un infinité d’autres, de ces poiffons
entièrement inconnus des Naturaliftes, ou qui leur
eft connu fous un autre nom. Nous ne nous lafferons
point d’obferver que les voyageurs nuifent à l’hif-
toire naturelle de deux maniérés; foit en la chargeant
d’êtres dont ils ne donnent aucune defeription
un peu complette, foit en embrouillant fa nomenclature
, qui n’eft: déjà que trop difficile.
CH ALO, {Géog. mod.') riviere d’A fie, au royaume
de Tonquin, qui fe perd dans le golfe de Cochin-
chine.
* CHALON, f. m. {Pêche.) grand filet de pêcheur,
dont les extrémités font attachées à de petits bateaux
à l’aide defquels on le conduit dans la.riviere. Voyez
C h a lu t .
CHALOSSE, {Géog. mod.) petit pays de France
en Gafcogne, près de là riviere d’Adour.
CHALOUPE, f. f. {Marine.) fc’eft un petit bâtiment
leger fait pour le 1er vice des vaiffeaux. On s’en
fert aufli pour des traverfées ; alors on y met un petit
mât de meftre avec fa vergue, 8c un petit mât de
mifene.
Quoique l’on fe ferve fouvent d’avirons pour les
faire voguer, elles vont cependant très-bien à la voile
; ce qui rend leur fervice très-utile aux vaiffeaux
de guerre.
Dans le cours du voyage, la chaloupe fe haie dans
le vaiffeau & s’embarque : on la met à la mer dans
les rades, & Iorfqu’on en a befoin. Elle fert à diffé-
rens ufages, comme de porter à bord les munitions ,
le lefte, & les autres chofes pefantes : on l’envoye
faire de l’eau & du bois dans les relâches ; elle fert à
porter les ancres de toue.
La grandeur de la chaloupe fe proportionne fur
celle du vaiffeau auquel elle doit fervir; & même
çes proportions varient fuivant la méthode de cha