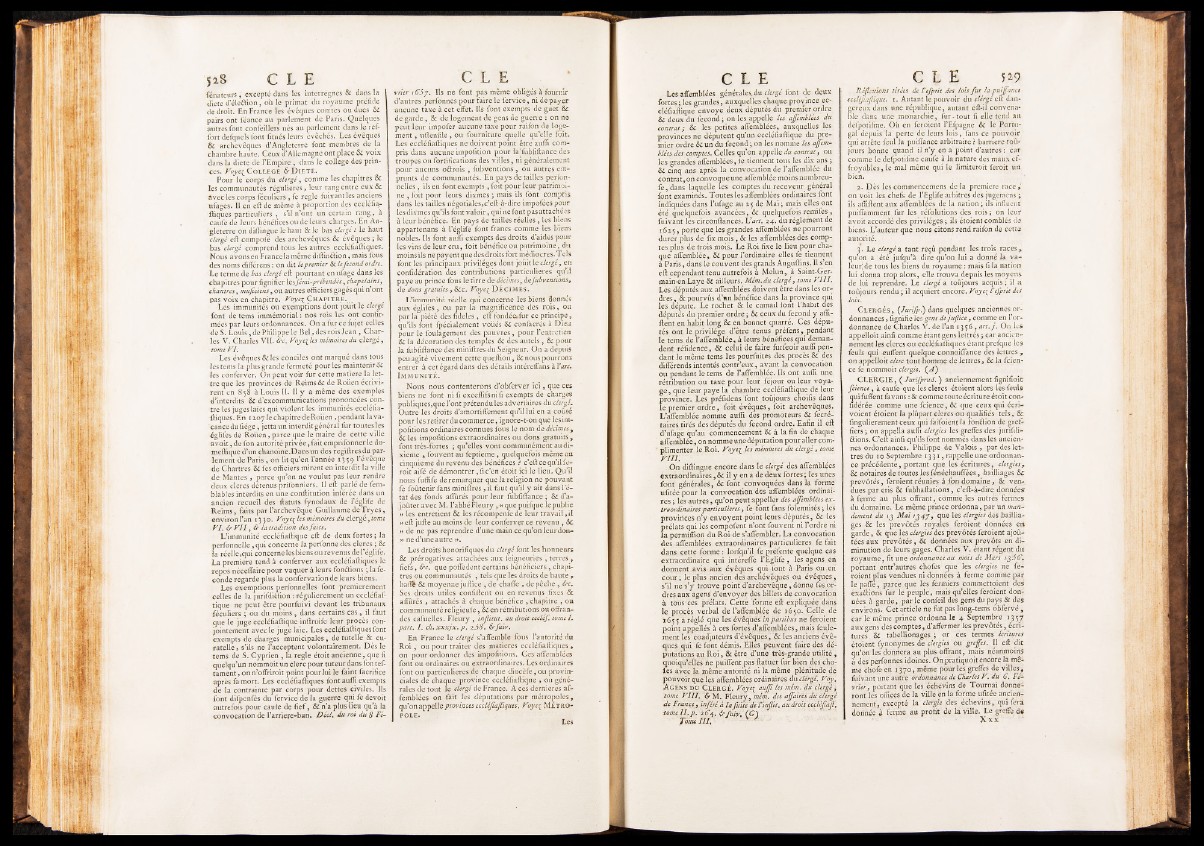
fénateurs excepté dans les interrègnes & dans la
diete d’éle&ion, où le primat du royaume préfide
de droit. En France les évêques comtes ou ducs 8c
pairs ont féance au parlement de Paris. Quelques
autres font confeillers nés au parlement dans le ref-
fort defquels font litués leurs évêchés. Les eveques
& archevêques d’Angleterre font membres de la
chambre haute. Ceux d’Allemagne ont place 8c voix
dans la diete de l’Empire , dans le college des princes.
Foyc^ C ollege & D iet e.
Pour le corps du clergé, comme les chapitres &
les communautés régulières, leur rang entre eu x&
âvec les corps léculiers , fe réglé fuivantles anciens
ufages. Il en eft de même à proportion des ecclefia.-
ftiques particuliers , s’il n’ont un certain rang, à
caufe de leurs bénéfices ou de leurs charges. En Angleterre
on diftingue le haut & le bas clergé : le haut
clergé eft compolé des archevêques 8c évêques ; le
bas clergé comprend tous les autres eccléfiaftiques.
Nous avons en Francelamême diftinâion, mais fous
des noms différens : on dit le premier Hile fécond ordre.
Le terme de bas clergé eft pourtant enufage dans les
chapitres pour fignifier lesJ'émi-prébendés, chapelains,
chantres, muficiens, ou autres officiers gages qui n’ont
pas voix en chapitre. Voye^ C h a p itr e .
Les immunités ou exemptions dont jouit le clergé
font de tems immémorial : nos rois les ont confirmées
par leurs ordonnances. On a fur ce fujet celles
de S. Louis , de Philippe le Bel, des rois Jean , Charles
V. Charles VII. &c. Voyelles mémoires du clergé,
- tome V I.
Les évêques & les conciles ont marqué dans tous
les tems la plus grande fermeté pour les maintenir &
les conferver. On peut voir fur cette matière la lettre
que les provinces de Reims &: de Roiien écrivirent
en 858 à Louis II. Il y a même des exemples
d’interdits & d’excommunications prononcées contre
les juges laïcs qui violent les immunités eccléfiaftiques.
En 1207 le chapitre de Roiien , pendant la vacance
du fiége, jettaun interdit général fur toutes les
églifes de Roiieh> parce que le maire de cette ville
avoit, de fon autorité privée, fait emprifonner le do-
meftique d’un chanoine.Dans un des regiftresdu parlement
de Paris, on lit qu’en l’année 13 59 l’évêque
de Chartres & fes officiers mirent en interdit la ville
de Mantes , parce qu’on ne voulut pas leur rendre
deux clercs détenus prifonniers. Il eft parlé de fem-
blables interdits en une conftitution inférée dans un
ancien recueil des ftatuts fynodaux de l’églife de
Reims, faits par l’archevêque Guillaume deTryes,
environ l’an 1330. Voye[ les mémoires du clergé, tome
VI, & V I I , & la tradition des faits.
L’immunité eccléfiaftique eft de deux fortes ; la
perfonnelle, qui concerne la perfonne des clercs ; 8c
la réelle,qui concerne les biens ou revenus de l’églife.
La première tend à conferver aux eccléfiaftiques le
repos néceffaire pour vaquer à leurs fondions ; la fécondé
regarde plus la confervation de leurs biens.
Les exemptions perfonnelles font premièrement
celles de la jurifdiétion : régulièrement un eccléfiaftique
ne peut être pourfuivi devant les tribunaux
féculiers ; ou du moins , dans certains cas , il faut
que le juge eccléfiaftique inftruife leur procès conjointement
avec le juge laïc. Les eccléfiaftiques font
exempts de charges municipales, de tutelle & curatelle
, s’ils ne l’acceptent volontairement. Dès le
tems de S. Cyprien , la réglé étoit ancienne , que fi
quelqu’un nommoit un clerc pour tuteur dans fon tef-
tament, on n’offriroit point pourlui le faiiit facrifice
après fa mort. Les eccléfiaftiques font auffi exempts
de la contrainte par corps pour dettes civiles. Ils
font difpenfés du fervice de la guerre qui fe devoit
autrefois pour caufe de fie f, & n’a plus lieu qu’à la
convocation de l’arriere-ban. Décl, du roi du S Février
iS5y. Ils ne font pas même obligés à fournir
d’autres perfonnes pour faire le fervice, ni de payer
aucune taxe à cet effet. Ils font exempts de guet 8c
de garde, & de logement de gens de guerre : on ne
peut leur impofer aucune taxe pour raifon de logement
, uftenfile, ou fourniture quelle qu’elle foit.
Les eccléfiaftiques ne doivent point être auffi compris
dans aucune impofition pour la 'fubfiftance des
troupes ou fortifications des villes, ni généralement
pour aucuns oétrois , fubventions , ou autres emprunts
de communautés. En pays de tailles perfonnelles
, ils en font exempts , foit pour leur patrimoine
, foit pour leurs dixmes ; mais ils font compris
dans les tailles négotiales,c’eft-à-dire impofées pour
les dixmes qu’ils font valoir, qui ne font pas attachées
à leur bénéfice. En pays de tailles réelles, les biens
appartenans à l’églife font francs comme les biens
nobles. Ils font auffi exempts des droits d’aides pour
les vins de leur cru, foit bénéfice ou patrimoine, du
moins ils ne payent que des droits fort médiocres. Tels
font les principaux privilèges dont jouit le clergé, en
confidération des contributions particulières qu’il
paye au prince fous letirre de décimes, defubventions,
de dons gratuits , & c . Voye%_ DÉCIMES.
L’immunité réelle qui concerne les biens Sonnés
aux églifes, ou par la magnificence des rois, ou
par la piété des fideles , eft fondée*fur ce principe,
qu’ils font fpécialement voiiés 8c confacrés à Dieu
pour le foulagcment des pauvres, pour l’entretien
& la décoration des temples & des autels , 8c pour
la fubfiftance des miniftres du Seigneur. On a depuis
peu agité vivement cette queftion, 8c nous pourrons
entrer à cet égard dans des détails intéreffans à l’art.
Im m u n it é .
Nous, nous contenterons d’obferver i c i , que ces
biens ne font ni fi exceffifsnifi exempts de charges
publiques,que l’ont prétendu les adversaires du clergé.
Outre les droits d’amortiffement qu’il lui en a coûté
pour les retirer du commerce, ignore-t-on que lesira-
pofitions ordinaires connues lous le nom de décimes ,
8c les impofitions extraordinaires ou dons gratuits ,
font très-fortes ; qu’elles vont communément au dixième
, fouvent au feptieme, quelquefois même au
cinquième du revenu des bénéfices ? c’eft ce qu’il fe-
roit aifé de démontrer, fi c’en étoit ici le lieu. Qu’il
nous fuffife de remarquer que la religion ne pouvant
fe foûtenir fans miniftres, il faut qu’il y ait dans l ’état
des fonds affûrés pour leur fubfiftance ; 8c d’a-
jôûter avec M. l’abbé Fleury, « que puifque le public
» les entretient 8c les récompenfe de leur travail, il
» eft jufte au moins de leur conferver ce revenu , 8c
» de ne pas reprendre d’une main ce qu’on leur don-
» ne d’une autre ».
Les droits honorifiques du clergé font les honneurs
8c prérogatives attachées aux feigneuries , terres ,
fiefs, &c. que poffedent certains bénéficiers, chapitres
ou communautés , tels que les droits de haute ,
baffè & moyenne juftice , de chaffe , de pêche , &c.
Ses droits utiles confiftent ou en revenus fixes &
affûrés , attachés à chaque bénéfice , chapitre , ou
communauté religieule, 8c en rétributions ou offrandes
cafuelles. Fleury , injlitut. au droit eccléf. tomel.
part. I . ch.xxxjx. p. 2.58. &fuiv.
En France le clergé s’affemble fous' l’autorité du
R o i , ou pour traiter des matières eccléfiaftiques ,
on pour ordonner des impofitions. Ces affemblées
font ou ordinaires ou extraordinaires. Les ordinaires
font ou particulières de chaque diocèfe, ou provinciales
de chaque province eccléfiaftique , ou générales
de tout le clergé de France. A ces dernieres affemblées
on fait les députations par métropoles,
qu’on appelle provinces cccléfaftiques, Voye{ Métropol
e.
Les
Les affemblées générales, du clergé font de deux
fortes; les grandes, auxquelles chaque province ec-
ciéfiaftique envoyé deux députés du premier ordre
& deux du fécond ; on les. appelle les affemblées du
contrat ; 8c les petites affemblées, auxquelles les
provinces ne députent qu’un eccléfiaftique du premier
,ordre 8c un du fécond ; on les nomme les affemblées
des comptes. Celles qu’on appelle du contrat, ou
les grandes affemblées, lé tiennent tous les dix ans ;
8c cinq ans après la convocation de l’affemblée du
contrat, on convoque une affemblée moins nombreu-
f e , dans laquelle les comptes du receveur général
font examinés. Toutes les affemblées ordinaires font
indiquées dans l’ufage au 25 de Mai; mais elles ont
été quelquefois avancées, 8c quelquefois remifes ,
fuivant les circonftances. Vart. 24. du réglement de
1625, porte que les grandes affemblées ne pourront
durer plus de fix mois, & les affemblées des comptes
plus de trois mois. Le Roi fixe le lieu pour chaque
affemblée, & pour l’ordinaire elles fe tiennent
à Paris, dans le couvent des grands Auguftins. Il s’en
eft cependant tenu autrefois à Melun, à Saint-Ger-
main-en-Laye & ailleurs. Mém.du clergé, tome VIII.
Les députés aux affemblées doivent être dans les ordres,
& pourvûs d’fin bénéfice dans la province qui
les députe. Le rochet & le camail font l’habit des
députés du 'premier ordre ; 8c ceux du. fécond y affi-
ftent en habit long 8c en bonnet quarré. Ces députés
ont le privilège d’être tenus préfens, pendant
le tems de l’affemblée, à leurs bénéfices qui demandent
réfidence, & celui de faire furfeoir auffi pendant
le même tems les pourfuites des procès 8c des
différends intentés contr’eux, avant la convocation
ou pendant le tems de l’affemblée. Ils ont auffi une
rétribution ou taxe pour leur féjour ou leur voyag
e , que leur paye la chambre eccléfiaftique de leur
province. Les préfidens font toujours choifis dans
le premier ordre, foit. évêques, foit archevêques.
L ’affemblée nomme auffi des promoteurs 8c fecré-
taires tirés des députés du fécond ordre. Enfin il eft
d’ufagë qu’au commencement 8c à la fin de chaque
affemblée, on nomme une députation pour aller çom-
' plimenter le. Roi. Voyel les mémoires du clergé, tome vin:
On diftingue encore dans lé c{ergé des affemblées
extraordinaires, & il y en a de deux fortes ; les unes
font générales, & font convoquées dans la forme
ufitée pour la convocation des affemblées ordinaires
; les autres, qu’on peut appeller des affemblées extraordinaires
particulières, fe font fans folennites ; les
provinces n’y envoyent point leurs députés, 8c les
prélats qui les compofent n’ont fouvent ni l’ordre ni
la permiffion du Roi dê s’affenfoler. La convocation
des affemblées extraordinaires particulières fe fait
dans cette forme: lorfqu’iLfe préfente quelque cas
extraordinaire qui intéreffe l’Eglife, les agens en
donnent. avis aux évêques qui font à Paris ou .en
cour ; le plus ancien des àrchéyêques ou éyêques,
s’il ne s’y trouve point d’archevêque, donne fes.prj
dres aux agens d’envoyer des billets de convocation
à tous'ces prélats. Cette forme eft expliquée dans
le procès verbal de l’affemblée de 16 50.. Celle dé
1655 a réglé que les évêqùès in pdrtibus ne feroient
point appelles à ces fortes d’affemblées, mais feulement
les coadjuteurs d'évêques., les anciens évêques
qui fe font démis. Elles peuvent faire des députations
au R o i, & être d’une très-grande utilité ,
quoiqu’ elles ne puiffent pas ftatuer fur bien des choies
avec la même autorité ni la même plénitude dé
pouvoir quêtes affemblées ordinaires du clergé'. Vôy.
A gens Dû C lergé. Voye{ aujîi les mém,. dû çlèrgé ±
tome VIII. & M. Fleury, mém. des affairés du clergé
de France , inféré à la füité de Tinf il. au droit éccléfiaff.
dôme I I .p . 2C4. &fuivt (G)
fonte I II,
Réflexions tirées de Vefprit des lois fur la puiffanct
eccléjiafiicjue. i. Autant le pouvoir du clérgé eu dangereux
dans une république, autant eft-il convenable
dans une monarchie, fur-tout fi elle tend au
défpotifme. Où en feroient PEfpagnc & le Portugal
depuis'la perte deleUrs lois, fans de pouvoir
qui arrête feul la puiffance arbitraire? barrière toûj
jours bonne quand il n’y en a point d’autres : car
comme le defpotifme caufe à la nature des maux effroyables
, le mal même qui le limiteroit feroit un
bien.
2. Dès les commencemens de la première race
on voit les chefs de l’Eglife arbitres des jugemens ;
ils affiftent aux affemblées de la nation ; ils influent
puiffamment fur les réfolutions des rois ; on leur
avoit accordé des privilèges ; ils étoient comblés de
biens. L’auteur que nous citons rend raifon de cette
autorité.
3. Le clergé a tant reçu pendant les trois races,
qu’on a été jufqu’à dire qu’on lui a donné la valeur',
de tous les biens du royaume : mais fi la nation
lui donna trop alors, elle trouva depuis les moyens
de lui reprendre. Le clergé a toûjours acquis ; il a
toûjours rendu ; il acquiert encore. Voye\ l ’efprit des
lois. .
C lergés , (Jurifp.) dans quelques anciennes ordonnances,
fignifie les gens de jujlice, comme en l’ordonnance
de Charles V. de l’an 13 ç6 , art. j . On les
appelloit ainfi comme étant gens lettrés ; car anciennement
les clercs ou eccléfiaftiques étant prefque les
feuls qui euffent quelque connoiffance des lettres ,
on appelloit clerc tout homme de lettres, & la feien-
ce fe nommoit clergie. (^ )
CLERGIE, ( Jurifprud. ) anciennement fignifioit
fcience, à caufe que les clercs étoient alors les feul9
qui fuffent favans : & comme toute écriture étoit con-
fidérée comme une fcience, & que ceux qui écri-
voient étoient la plupart clercs ou qualifiés tels, 8c
fingulierement ceux qui faifoient la fonélion de greffiers
; on appella auffi clergies les greffes des. jurifdi*
âions. C’eft ainfi qu’ils font nommés dans les anciennes
ordonnances. Philippe de Valois , par des lettres
du 10 Septembre 1331, rappelle une ordonnance
précédente, portant que les écritures, clergies,
& notaires de toutes les fenéchauffées, bailliages 8c
prévôtés, feroient réunies à fon domaine , & vendues
par cris & fubhaftations -, c’eft-à-dire données
à ferme au plus offrant, comme les autres fermes
du domaine. Le même prince ordonna, par un mandement
du 13 Mai ij 4 J , que lès Clergies des bailliages
& les prévôtés royales, feroient données eri
garde, & que les clergiesdes prevôtés feroient ajoutées
aux prévôtés, & données aux prévôts en diminution
de- leurs gages;. Charles V. étant régent dit
royaume, fit une ordonnance au mois de Mars
portant entr’autres chôfes que les clergies ne fê-
roientplus vendues ni données à ferme comme par
le paffé, parce, que les fermiers commettoient des
èxaélions fur le peuple, mais qu’elles feroient données
à garde, /par le confeil des gens du pays & des
environs.. Cet article ne fut pas long-tems ÔbferVé ,
car le mêmeiprince ordonna le 4 Septembre 13 57
aux gens des comptes, d’affermer les prévôtés, écritures.
& tabellionages ; or ces termes écritures
étoient fynonymes de clergies ou greffes. Il eft dit
qu’on les donnera au plus offrant, mais neanmoins
à des perfonnes idoines. On pratiquoit encore la même
choie eh 1370, même pour les greffes de villes,
fuivant une autre ordonnance de Charles V. du C. Fé-
vrier, portant que les éche'vîns de Tournai donneront,
lès offices de la ville en la forme ufitée anciennement,
excepté la clergie ;des échevins, qui fera
donnée à ferme au profit de là ville. Le greffe d#