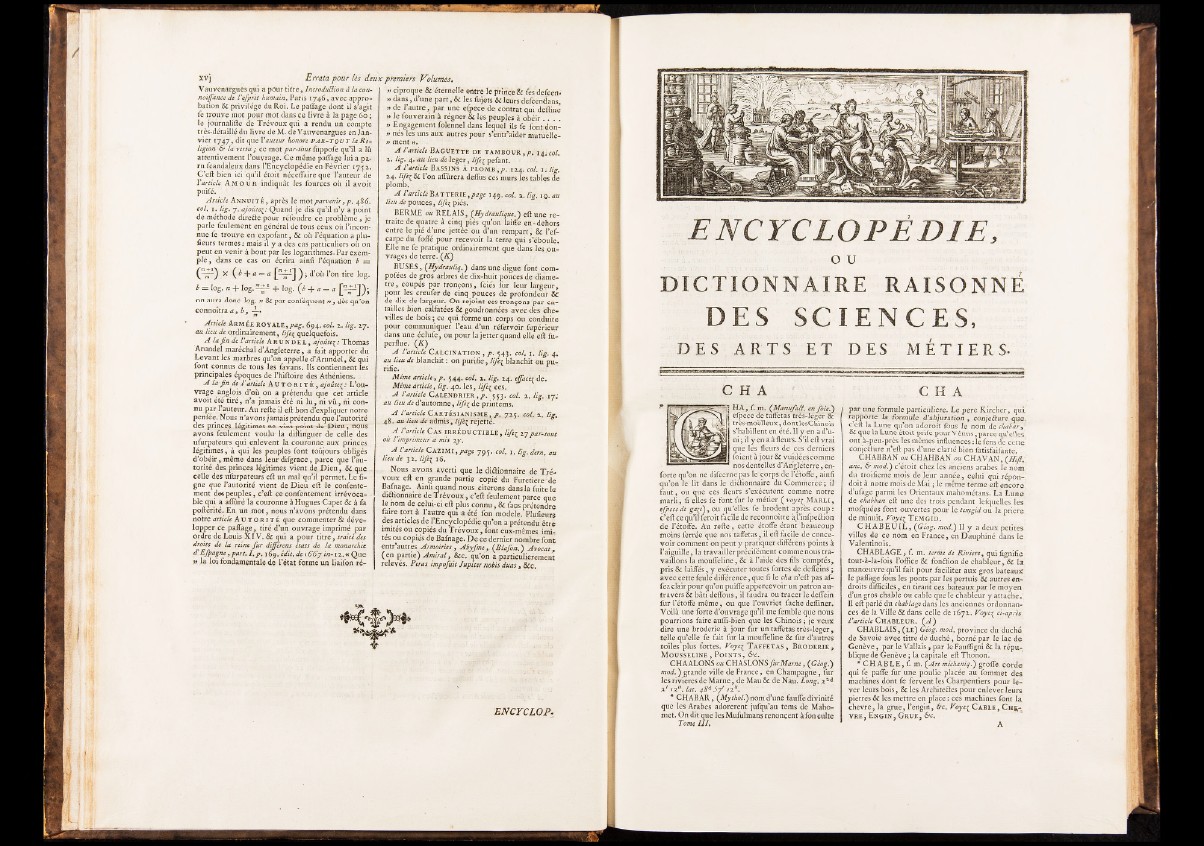
xvj Errata pour lés deux premiers Volumes*
Vauvenargues qui a pour titre, Introduction à la con-
noijfance de l'efprit humain. Paris 1746, avec approbation
8c privilège du Roi. Le paflage dont il s’agit
fe trouve mot pour mot dans ce livre à la page 60 ;
le journalise de Trévoux qui a rendu un compte
très-détaillé du livre de M. de Vauvenargues en Janvier
1747, dit que l'auteur honore p a r -T ov T la Religion
& la vertu ; ce mot par-tout fuppofe qu’il a lu
attentivement l’ouvrage. Ce même paflage lui a paru
fcandaleux dans l’Encyclopédie en Février 1752.
C ’eft bien ici qu’il étoit néceflaire que l’auteiir de
Y article A m O u R indiquât les fources où il avoit
p u i f e . ç
Article A n n u it é , après le mot parvenir, p. 4 86.
col. 1. lig. 7. ajouteç: Quand je dis qu’il n’y a point
de.méthode direélé pour réfoudre ce problème , je
parle feulement en général de tous ceux où l’inconnue
fe trouve en expofant, 8c où l’équation a plu-
fieurs termes : mais il y a des cas particuliers où on
peut en venir à bout par les logarithmes. Par exemp
le , dans ce cas on écrira ainli l’équation b =
0~/îr~) * ( b + o- — [ ^ - 1 ) ; d’où l’on tire log.
l = i°g- ? + ■ »g-— + lo g .'(if+ « - t a p i r 1] ) ;
on aura donc log. n 8c par conféquent n , dès qu’on
connoîtra u , b , -L.
Article Armee ROYALE fpng. 694. col. 1. lig. 27.
au Lieu de ordinairement, life[ quelquefois.
A la fin de Varticle A r u n d e l , ajoute[ : Thomas
Arundel maréchal d’Angleterre, a fait apporter du
Levant les marbres qu’on appelle d’Arundel, & qui
font connus de tous les favans. Ils contiennent les
principales époques de l’hiftoire des Athéniens. ,
A la fin de Tarticle A u t o r i t é , a j o u t e L’ou-
vrage anglois d’où on a prétendu que cet article
avoit été tiré, n’a jamais été ni lu , ni v û , ni con-
nu par l’auteur. Au relie il ell bon d’expliquer notre
penfee. Nous n’avons jamais prétendu que l’autorité
des princes, légitimes ne vîiït-point de E>ieu,.nous
avons feulement voulu-la dillinguer de celle des
ufurpateurs <jui enlevent la couronne aux princes
légitimes, à qui les peuples font toujours obligés
d’obéir, même dans leur d ifgrace, parce que l’autorité
des princes légitimes vient de D ieu , 8c que
celle des ufurpateurs ell un mal qu’il permet. Le ligne
que l’autorité vient de Dieu ell le confente-
ment d©6peuples, c’ell ce confentëment irrévocable
qui a alluré la couronne à Hugues Capet & à fa
pollerité. En un mot, nous n’avons prétendu dans
notre article A u t o r i t é que commenter & développer
ce paflage, tiré d’un ouvrage imprimé par
ordre de Louis X IV . & qui a pour titre, traité des
droits de la reine fur différens états de la monarchie
d Efpagne , part. I .p . 169. édit, de 166y in-12.« Que
n la loi fondamentale de l’état forme un liaifon ré-
» ciproque & éternelle entre le prince & fes defcerl-
» dans, d’une part, 8c les fujets & leurs defeend’ans,
» de l’autre, par une espece de contrat qui deRine
» le fouverain à régner & les peuples à obéir . . . .
» Engagement folennel dans lequel ils fe fontdon-
» nés les uns aux autres pour s’entr’aider mùtüèlle-
» ment ».
A l'article Ba g u e t t e DE TAMBOUR , p. \4.c0l.
2. lig. 4. au lieu de leger, life^ pefant.
A l'article Bassins à plomb ,/». 124. col. u lig.
24. lifci&t l’on alïùrera deflùs ces murs les tables de
plomb.
A l'article Ba t t e r ie ,/ȉge 149. col. a. lig, iq. au
lieu de pouces, life{ pies.
BERME ou RELAIS, (Hydraulique. ) ell une retraite
de quatre à cinq pies qu’on laiffe en-dehors
entre le pié d’une jettée ou d’un rempart, & l’ef-
carpe du folle pour recevoir la terre qui s’éboule.
Elle ne fe pratique ordinairement que dans les tou-
vrages de terre. (K )
BUSES, (Hydrauliq. ) dans une digue font com-
pofées de gros arbres de dix-huit pouces de diamètre,
coupés par tronçons, fciés fur leur largeur,
pour les creufer de cinq pouces de profondeur 8c
de dix de largeur. On rejoint ces tronçons par entailles
bien calfatées 8c goudronnées avec des che*
villes de bois ; ce qui forme un corps ou conduite
pour communiquer l’eau d’un réfervoir fupérieur
dans une éclufe, ou pour la jetter quand elle ell fu-
perflue. (A )
A L'article C a l c in a t io n ,/». 543. col. 1. lig. 4.
au lieu de blanchit : on purifie, lift1 blanchit ou purifie.
Même article, p. 544. col. 2. lig. 24. efface^ de.
Même article, lig. 40. les, liftç ces.
A Carticle CALENDRIER,/». 553; col. 2. lig. 17.'
au lieu de d’automne, lift{ de printems.
A L'article CARTÉSIANISME, p. 725. col. 2. lig.
48. au lieu de admis, lifè[ rëjëtté.
I A l ’article C AS IRRÉDUCTIBLE, lift{ xypantout
où l'imprimeur a mis zy.
A l ’article^ C a z im i , page 795. col. 1. lig.dern. au
lieu de 3 2. Hfej 16.
Nous avons averti que le diffionnaire de Trévoux
eft en grande partie copié du Furetiere;de
Bafnage. Ainfi quand nous citerons dans la fuite le
diûîonnàire de T ré vou x, c ’eft feulement parce que
le nom de celui-ci eft plus connu, & faps prétendre
faire tort à l’autre qui a été fon modèle. Plufieurs
des articles de l’Encyclopédie qu’on a prétendu être
imités ou copiés du T révoux, font eux-mêmes imites
ou copiés de Bafnage. De ce dernier nombre font
entr’autres Armoiries , Abyfmc,. (Blafon.) Avocat,
(en partie) Amiral, & c . qu’on a particulièrement
relevés. P trac impofuit Jupiter nobis duas , Sec.
E N C Y C L O P -
ENCYCLOPÉDIE,
O U
DIC T IONNAIR E RAI SONNÉ
DES SCIENCES,
D E S A R T S E T DE S MÉ T I E R S -
C H A
HA , f. m. ('Mdnûfact. en Joie.')
efpece de taffetas très-léger &
très-moelleux, dontlesChihois
s’habillent en été. Il y en a d’uni;
il y en a à fleurs. S’il ell vrai
que les fleurs de çês derniers
loie.nt à jour 8c vuidées!comme
nos dentelles d’Ânglëterrè, en:
forte qu’on ne difeerne pas le corps de l’éloffè, ainfi
qu’on le lit dans le dictionnaire du Commerce ; il
faut, ou que ces fleurs s’exécutent comme nôtre
marli, fi elles fe font fur le métier ( voyej Marli ,
efpece de gaçf) , ou qu’elles fe brodent après coup :
c ’ell ce qu’il feroit facile 4e reconnoître à,l’infpe£lion
de l’étoffe. Au relie , cette étoffe étant beaucoup
moins ferrée que nos taffetas, il ell facile de concevoir
comment on peut y pratiquer dilférèfis points à
l ’aiguille, la travailler précifément comme nous travaillons
la moufleline, 8c à l’aide des fils comptés,
pris & làilfés, y exécuter toutes fortes de deffeins ;
avec cette feule différence, que fi le cha n’ell pas af-
fez clair pour qu’on puilfe appercevoir un patron au-
travers & bâti deffous, il faudra ou tracer le delfein
fur l’étoffe même, ou que l’ouvrief fâchédelïïner.
Voilà une forte d’ouvrage qu’il me femblë que nous
pourrions faire aufli-bien que les Chinois ; je veux
dire une broderie à jour fur un taffetas très-leger,
telle qu’elle fe fait fur la moufleline 8c fur d’autres
toiles plus fortes. Voye^ T a f f e t a s , Br o d er ie ,
Mousseline , Point s , &c.
CHA ALONS ou CHASLONS fur Marne, (’Géog. )
mod. ) grande ville de France, en Champagne, fur
les rivières de Marne, de Mau 8c de Nau. Long. z * d
f iz " . lat. df.8dóy' i z 11.
* CHA BAR, (Mytkol. ) nom d’une fauffe divinité
que les Arabes adorèrent jufqu’au tems de Mahomet.
On dit que les Mufulmans renoncent à fon culte
Tome III.
C H A
I par une formule particulière. Le pere Kircher, qui
rapporte la formule d’abjuration , conjeélure que.
c’eft la Lune qu’on adôroit fous le nom de chabarf
ÔC que la Lune cto'it prife pour Vénus, parce qu’elles
ont àrpeu-près les mêmes influences : le fens de cette
conjefture n’ell pas d’une clarté bien fatisfaifante.
CHABBAN ou CHAHBAN ou CHAVAN, (Hift;
anc. & mod.) c’étoit chez les anciens arabes le nom
du troifieme mois de leur année , celui qui répon-.
doit à notre mois de Mai ; le même terme ell encore
d’ufage parmi les Orientaux mahométans. La Lune
de chabban ell une des trois pendant lefquelles les
mofquées font ouvertes pour le tenfgid ou la priere
de minuit. Voyer T em g id .
C H A B E U I L , (Géog. mod.) Il y a deux petites
villes de ce nom en France, en Dauphiné dans le
Valentinois.
CHABLAGE, f. m. terme de Riviere, qui lignifie
tout-à-la-fois l’office & fonélion de chableur, 8c la
manoeuvre qu’il fait pour faciliter aux gros bateaux
le paflage fous les ponts par les pertuis & autres endroits
difficiles, en tirant ces bateaux par le moyen
d’un gros chable ou cable que le chableur y attache.'
Il ell parlé du chablage dans les anciennes ordonnances
de la Ville 8c dans celle de 1672. Voye^ ci-après
l'article C hableur. (A')
CHABLAIS, ( le) Géog. mod, province du duché
de Savoie avec titre de duché, borné par le lac de
Genève, par le Vallais, par le Fauflxgni 8c la république
de Genève ; la capitale ell Thonon.
* C H A B L E , f. m. (Art méchaniq.) groflé. corde
qui fe paffe fur une poulie placée au fommet des
machines dont fe fervent les Charpentiers pour lever
leurs bois, 8c les Architeéles pour enlever leurs
pierres 8c les mettre en place : ces machines font la
chevre, la grue, l’engin, &c. Voye{ C a b l e , C hr-
v r e > En g in , Grue, &c.
A