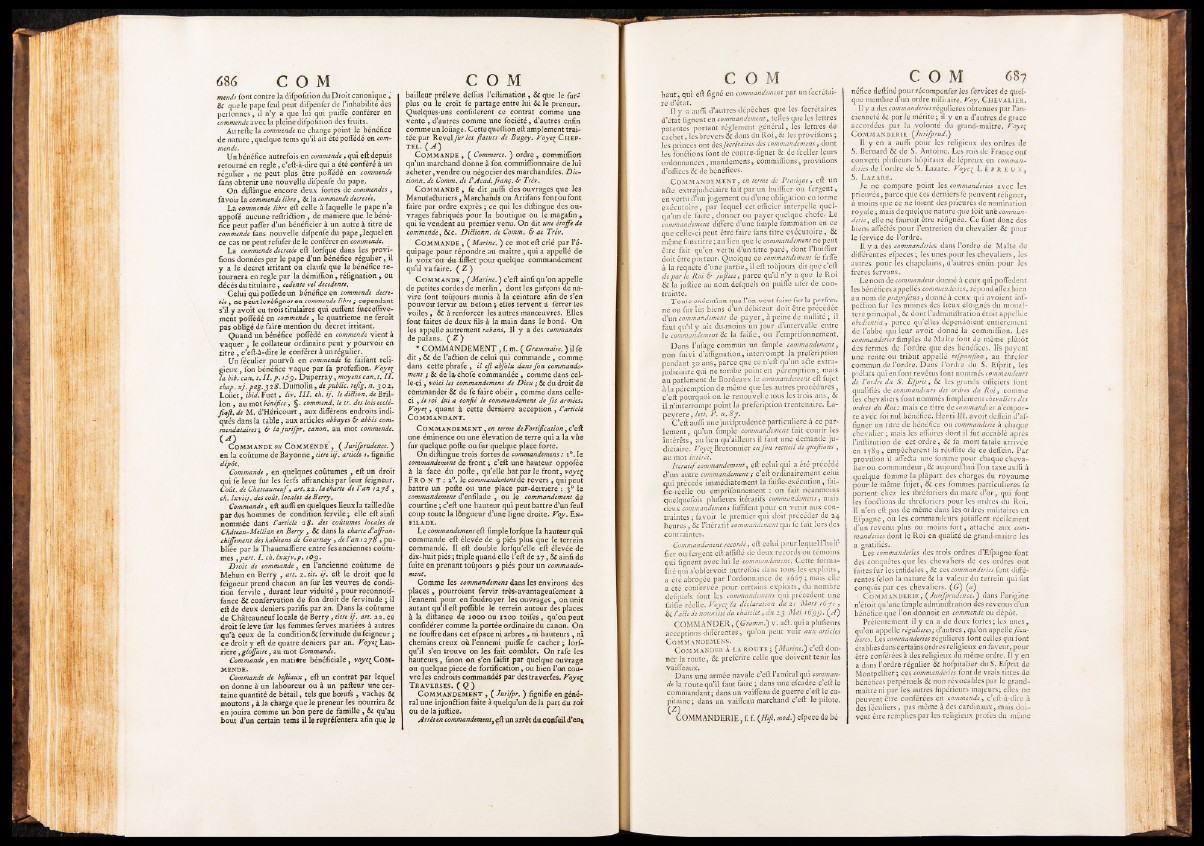
menât font contre la difpofition du Droit canonique,'
& que le pape feui peut difpenfer de l’inhabilité des
personnes, il n’y a que lui qui puiffe conférer en
commende avec la pleine difpofition des fruits.
Aurefte la commende ne change point le bénéfice
de nature, quelque tems qu’il ait été poffédé en commende.
Un bénéfice autrefois en commende, qui eft depuis
retourné en réglé, c’eft-à-dire qui a été conféré à un
régulier » ne peut plus être poffédé en commende
fans obtenir une nouvelle difpenfe du pape.
On diftingue encore deux fortes de commendes ,
fàvoir la commende libre, & la commende décrétée.
La commende libre eft celle à laquelle le pape n’a
appofé aucune reftriâion, de maniéré que le bénéfice
peut paffer d’un bénéficier à un autre à titre de
commende fans nouvelle difpenfe du pape, lequel en
ce cas ne peut refufer de le conférer en commende.
La commende décrétée eft lorfque dans les provi-
fions données par le pape d’un bénéfice régulier, il
y a le decret irritant ou claufe que le bénéfice retournera
en réglé par la démiflion, réfignation, ou
décès du titulaire, cedente vel decedente.
Celui qui poffede un bénéfice en commende décrétée
, ne peut le réfigner en commende libre ; cependant
s’il y avoit eu trois titulaires qui euffent fucceflive-
ment poffédé en commende , le quatrième ne ferait
pas obligé de faire mention du decret irritant.
Quand un bénéfice poffédé en commende vient à
vaquer , le collateur ordinaire peut y pourvoir en
titre , c’eft-à-dire le conférer à un régulier.
Unféculier pourvû en commende fe faifant religieux
, fon bénéfice vaque par fa profeffion. Voye{
la bib. can. t. II. p .ib g . Duperray, moyens can. t. II.
chap. x j. pag.328. Dumolin, de public, rejîg. n. 3 02.
Loiiet, ibid. Fuet, liv. I I I . ch. ij. le diction, de Brillon
, au mot bénéfice , § . commend. le tr. des lois ecclé-
Jiafi. de M. d’Héricourt, aux différens endroits indiqués
dans la table, aux articles abbayes & abbés com-
mendataires ; & la jurifpr. canon. au mot commende.
( ^ ) t
C ommande ou C ommende , ( Jurifprudence. )
en la coûtume de Bayonne, titre iij. article 1. fignifie
dépôt.
Commande , en quelques coutumes , eft un droit
qui fe leve fur les ferfs affranchis par leur feigneur.
Coût, de Chateauneuf 9 art. 22. la charte de Van 12 78 ,
ch. Ixviij. des coût, locales de Berry.
Commande, eft aufti en quelques lieux la taille due
par des hommes de condition fervile ; elle eft ainli
nommée dans l'article 28 • des coutumes locales de
Chdteau-Mellian en Berry , & dans la charte cVaffran-
chijfement des habitons de Gournay , de Van 1278 , publiée
par la Thaumafliere entre fes anciennes coûtu-
mes , part. I . ch. Ixxjv.p. 10g.
Droit de commande, en l’ancienne coûtume de
Mehun en Berry , art. 2. tit. ij. eft le droit que le
feigneur prend chacun an fur les veuves de condition
fervile , durant leur viduité , pour reconnoif-
fance & conservation de fon droit de fervitude ; il
eft de deux deniers parifis par an. Dans la coûtume
de Châteauneuf locale de Berry, titre ij. art. 22. ce
droit fe leve fur les femmes ferves mariées à autres
qu’à ceux de la condition & fervitude du feigneur;
ce droit y eft de quatre deniers par an. Voyt^ Lau-
riere, glojfaire, au mot Commande.
Commande, en matière bénéficiai, voyc{ Comm
e n d e .
Commande de bejliaux, eft un contrat par lequel
on donne à un labôureur ou à un pafteur une certaine
quantité de bétail, tels que boeufs , vaches &
moutons, à la charge que le preneur les nourrira &
en jouira comme un bon pere de famille, & qu’au
bout d’un certain tems il le repréfentera afin que le
bailleur prélevé deffus l’eftimation, & que le fur-
plus ou le croît fe partage entre lui & le preneur.
Quelques-uns confiderent ce contrat comme une
vente , d’autres comme une fociété, d’autres enfin
comme un loiiage. Cette queftion eft amplement traitée
par RevelJ'ur les fiatuts de Bugey. Voye{ C hept
e l . ( A )
C ommande , ( Commerce. ) ordre , commiflion
qu’un marchand donne à fon commiffionnaire de lui
acheter, vendre ou négocier des marchandifes. Die-
tionn. de Comm. de VAcad.franç. & Trév.
C ommande , fe dit auffi des ouvrages que les
Manufacturiers, Marchands ou Artifans font ou font
faire par ordre exprès ; ce qui les diftingue des ouvrages
fabriqués pour la boutique ou le magafin ,
qui le vendent au premier venu. On dit une étoffe de
commende y & c . Dicliohn. de Comm. & ae Trév.
C ommande , ( Marine. ) ce mot eft crié par l’équipage
pour répondre^aü maître , qui a appelle de
la yeùrotr-étt-ûffîet'pour quelque commandement
cpfil va faire. ( Z )
C ommande , ( Marine. ) c’eft ainli qu’on appelle
de petites cordes de merlin, dont les garçons de navire
font toûjours munis à la ceinture afin de s’en
pouvoir fervir au befoin ; elles fervent à ferrer les
vo ile s , & à renforcer les autres manoeuvres. Elles
font faites de deux fils à la main dans le bond. On
les appelle autrement rubans. 11 y a des commandes
de palans. ( Z )
* COMMANDEMENT , f. m. ( Grammaire. ) il fe
d i t , & de l’aérion de celui qui commande , comme
dans cette phrafe , il ejl abfolu dans fon commandement
; & de 1& chofe commandée , comme dans celle
ci , voici les commandemens de Dieu ; & du droit de
commander & de fe faire obéir, comme dans celle-
ci , le roi lui a confié le commandement de fes armées.
Voye^ y quant à cette derniere acception, l'article
C om m an d a n t.
C ommandement ,«x terme de Fortification, c’eft
une éminence ou une élévation de terre qui a la vûe
fur quelque pofte ou fur quelque place forte.
On diftingue trois fortes de commandemens : i° . le
commandement de front ; c’eft une hauteur oppofée
à la face du pofte, qu’elle bat par le front, voye^
F R O N T : i ° . le commandenient de revers , qui peut
battre un pofte ou une place par-derriere : 30 le
commandement d’enfilade , ou le commandement de
courtine ; c’eft une hauteur qui peut battre d’un feul
coup toute la lôngueur d’une ligne droite. Voy. Enfilad
e.
Le commandement eft fimple lorfque la hauteur qui
commande eft élevée de 9 piés plus que le terrein
commandé. Il eft double lorfqu’elle eft élevée de
dix-huit piés ; triple quand elle l’eft de 2 7, & ainli de
fuite en prenant toûjours 9 piés pour un commandement.
Comme les commandemens dans les environs des
places, pourraient fervir très-avantageufement à
l’ennemi pour en foudroyer les ouvrages , on unit
autant qu’il eft poffible le terrein autour des places
à la diltance de 1000 ou 1200 toife s , qu’on peut
confidérer comme la portée ordinaire du canon. On
ne fouffre dans cet efpace ni arbres > ni hauteurs , ni
chemins creux oh l’ennemi puiffe fe cacher ; lorf-
qu’il s’en trouve on les fait combler. On rafe les
hauteurs, linon on s’en failit par quelque ouvrage
ou quelque piece de fortification, ou bien l’on couvre
les endroits commandés par destraverfes* Voyeç
T raverses. ( Q )
C ommandement , ( Jurifpr. ) lignifie en général
une injonction faite à quelqu’un de la part du çoir
ou de la juftice.
Arrêt en commandement, çft un arrêt du copfeil d’en*
haut, qui eft ligné en commandement par un fecrétai-
re d’état. ' , . ,, .
Il y a auffi d’autres depeches que les lecretaires
d’état fignent en commandement, telles que les lettres
patentes portant réglement général, les lettres de
cachet, les brevets dons du R oi, & les provifions ;
les princes ont des fecrétaires des commandemens, dont
les fondions font de contre-figner & de fceller leurs
ordonnances, mandemens, commilfions, provifions
d’offices & de bénéfices.
C ommandement, en terme de Pratique, eft un
ade, extrajudiciaire fait par un huiffier ou fergent,
en vertu d’un jugement ou d’une obligation en forme
exécutoire, par lequel cet officier interpelle quelqu’un
de faire, donner ou payer quelque chofe. Le
commandenient différé d’une fimple fommation en ce
que celle-ci peut être faire fans titre exécutoire, &
même fans titre ; au lieu que le commandement ne peut
être fait qu’en vertu d’un titre.paré, dont l’huiflîer
doit être porteur. Quoique ce commandement fe faffe
à la requête d’une partie, il eft toujours dit que c’eft
de par le Roi & jujlice, parce qu’il n’y a que le Roi
& la juftice au nom defquels on puiffe ufer de contrainte.
Toute exécution que l’on veut faire fur la perfon-
ne ou fur les biens d’un débiteur doit être précédée
d’un commandement de payer, à peine de nullité ; il
faut qu’il y ait du-moins un jour d’intervalle entre
le commandement & la faifie, ou i’emprifonnement.
Dans l’ufage commun un fimple commandement,
non fuivi d’aflignation, interrompt la prefeription
pendant 30 ans, parce que ce n’eft qu’un aûe extrajudiciaire
qui ne tombe point en péremption ; mais
au parlement de Bordeaux le commandement eft fujet
à la péremption de même que les autres procedures,
c’eft pourquoi on le renouvelle tous les trois ans, &
il n’interrompt point la prefeription trentenaire. La-
peyrere, lett. P. n. 8f i : '
C ’eft aufti une jurifprudence particulière à ce parlement,
qu’un fimple commandement fait courir les
intérêts, au lieu qu’ailleurs il faut une demande judiciaire.
Voyei Bretonnier en fon recueil de quefiions ,
au mot intérêt.
Itératif commandement, eft celui qui a ete précédé
d’un autre commandement , c’eft ordinairement celui
qui précédé immédiatement la faifie-exécution, fai-
fie-réelle ou emprifonnement : on fait néanmoins
quelquefois plufieurs itératifs commandemens, mais
deux commandemens fuffifent pour en venir aux contraintes
; favoir le premier qui doit précéder de 24
heures, & l’itératif commandement qui fe fait lors des
contraintes.
Commandement recordé, eft celui pour lequel l’huif1
fier 011 fergent eft.aflifté de deux records ou témoins
qui fignent avec lui le commandement. Cette formalité
qui s’obfervoit autrefois dans tous.les exploits,
a été abrogée, par l’ordonnance de 1667; mais elle
a été confervée pour certains exploits, du nombre
defquels font les commandemens qui précédent une
faifie-réelle. Voye^la déclaration du 21 Mars 1C71,
& l'acle de notoriété du châtelet, du 23 Mai 1 (%£)$ . (A')
COMMANDER, (Grdmm.) v. a£h qui a plufieurs
acceptions différentes, qu’on peut voir aux articles
C ommandemens.
C ommander À la r o u t e ; (Marine.) c’eft donner
la route, & preferire celle que doivent tenir les
vaiffeaux.
Dans une armée navale c’eft l’amiral qui commande
la route qu’il faut faire ; dans une efeadre c’eft le
commandant; dans un vaiffeau de guerre c’eft le capitaine
; dans un vaiffeau marchand c’eft le pilote.
(Z)C
OMMÀNDERIE, f. f. (JHfi, mod.) efpece de bé •
néfice deftxhé pourrécompenfer les ferviceS de qttel*
que membre d’un ordre militaire. Voy. C hev al ier.
Il y a des commanderiesrégulières obtenues par l’ancienneté
& par le mérité ; il y en a d’autres de grâce
accordées par la volonté du grand-maître. Voye{
C ommanderie ( Jurifprud.)
Il y en a auffi pour les religieux des ordres de
S. Bernard & de S. Antoine. Les rois de France ont
converti plufieurs hôpitaux de lépreux en commun-
deries de l’ordre de S. Lazare. Voyeç L é p r e u x ,
S. L a zar e .
Je ne compare point les commanderies avec les
prieurés, parce que ces derniers fe peuvent réfigner,
à moins que ce ne foient des prieurés de nomination
royale ; mais de quelque nature que foit unfe commanderie,
elle ne fauroit être réfignée. Ce font donc des
biens affettés pour l’entretien du chevalier & pour
le fervice de l’ordre.
Il y a des commanderies dans l’ordre de Malte de
différentes efpeces ; les unes pour les chevaliers, les
autres pour les chapelains, d’autres enfin pour les
freres fervans.
Le nom de commandeur donné à ceux qui poffedent
les bénéfices appellés commanderies, répond affez bien
au nom depmpojitus, donné à ceux qui avoient inf-
peftion fur les moines des lieux éloignés du monaf-
tere principal, & dont l’adminiftration étoit appellée
obedientia-y parce qu’eUes dépendpient entièrement
de l’abbé qui leur avoit. donné la commiflion. Les
commanderies fimples de Malte font de même plûtôt
des fermes de l’ordre que des bénéfices. Ils payent
une rente ou tribut appelle refponjion, au thréfor
commun de l’ordre. Dans l’ordre du S. Elprit, les
prélats qui en font revêtus font nommés commandeurs
de l'ordre du S. Efprit, & les grands officiers font
qualifiés de commandeurs des ordres du Roi, comme
lès chevaliers font nommés fimplement chevaliers des
ordres du Roi: mais ce titre de commandeur n’emporte
avec foi nul bénéfice. Henri III. avoit deffein d’af*
ligner un titre de bénéfice ou commanderie à chaque
chevalier ; mais les affaires dont il fut accablé après
l’inftitution de cet ordre, & fa mort fatale arrivée
en 1589, empêchèrent la réuflite de ce deffein. Par
proyifion il affe&a une fomme pour chaque chevalier
ou commandeur, & aujourd’hui l’on taxe auffi à
quelque fomme la plûpart des charges du royaume
pour le même fujet, & ces fommes particulières fe
portenti'chez les thréforiers du marc d’o r , qui font
les fondrions de thréforiers pour les ordres du Roi.
Il n’en eft pas de même dans les ordres militaires en
Efpagne, oit les commandeurs joiiiffent réellement
d’un revenu plus ou moins fort, attaché aux commanderies
dont le Roi en qualité de grand-maître les
a gratifiés.
Les commanderies des trois ordres d’Efpagne font
des conquêtes que les chevaliers de ces ordres ont
faites fur les infidèles, & ces commanderies font différentes
félon la nature & la valeur du terrein qui fut
conquis par ces chevaliers. (G ) (a)
■ C om m ANDERIE, ( Jurifprudence. ) dans l’origine
n’étoit qu’une fimple adminiftration des revenus d’un
bénéfice que l’on donnoit en commende ou dépôt.
Préfentement il y en a de deux fortes; les unes,
qu’on appelle régulières; d’autres, qu’on appelle fécu-
lieres. Les commanderies régulières font celles qui font
établies dans certains ordres religieux en faveur, pour
être conférées à des religieux du même ordre. Il y en
a dans l’ordre régulier & hofpitalier du S. Efprit de
Montpellier ; ces commanderies font de vrais titres de
bénéfices perpétuels & non révocables par le grand-
maître ni par les autres fupérieurs majeurs; elles ne
peuvent être conférées en commende, c’eft-à-dire à
des féculiers, pas même à des cardinaux, mais doivent
être remplies par les religieux profès du même
ilfi