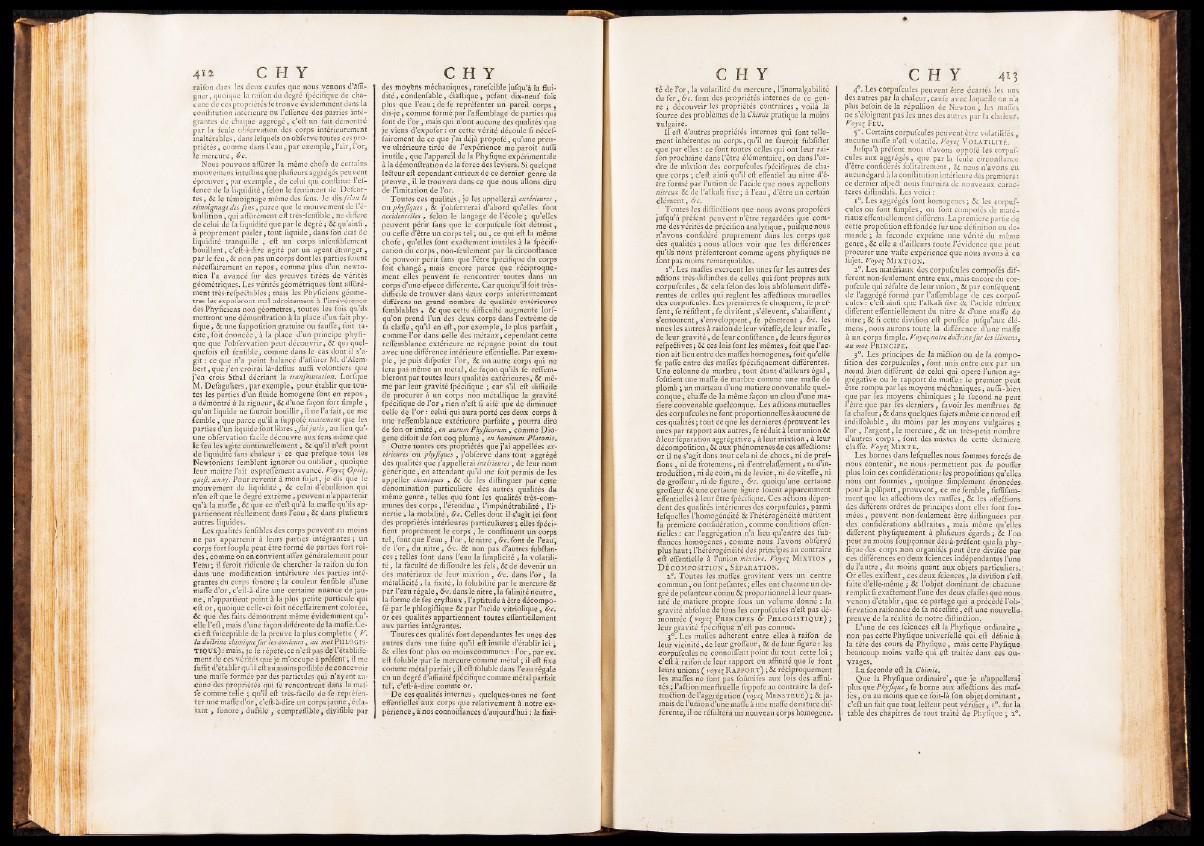
raifon dans les deux caufes que nous venons d’àfll-
.gner, quoique la raifon du degré fpécifique de chacune
de ces propriétés fe trouve évidemment dans la
conftitution intérieure ou l’effence des parries intégrantes
de chaque aggrégé, c’eft un fait démontré
par la feule obfervation des corps intérieurement
inaltérables, dans le {'quels on obferve toutes ces propriétés
, comme dans l’eau, par exemple, l’air, l’or,
le mercure, &c.
Nous pouvons a {Tarer la même chofe de certains
mouvemens inteftins que plufieurs aggrégés peuvent
éprouver ; par exemple, de celui qui conftitue Pef-
fence de la liquidité, félon le fendment de Defcar-
tes, & le témoignage même des fens. Je dis félon le
témoignage des fens, parce que le mouvement de l’é-
imllition , qui aflurément elt très-fenfible, ne différé
de celui de la liquidité que par le degré ; &C qu’ainfi ,
•à proprement parler, tout liquide, dans fon état de
liquidité tranquille , eft un corps infenfiblement
bouillant, c’eft-à-dire agité par un agent étranger ,
par le feu, & non pas un corps dont les parties foient
néceffairement en repos, comme plus d’un newtonien
l’a avancé fur des preuves tirées de vérités
géométriques. Les vérités géométriques font afluré-
ment très-refpe&ables ; mais les Phyliciens géomètres
les expol'eront mal adroitement à l’irrévérence
des Phyliciens non géomètres, toutes les fois qu’ils
mettront une démonftradon à la place d’un fait physique
, & une fuppofition gratuite ou fauffe, foit tacite
, foit énoncée, à la place d’un principe p'nyfi-
«jue que l’obfervation peut découvrir, & qui quelquefois
ell fenliblë, comme dans le cas dont il s’agit
: ce que n’a point balancé d’affûrer M. d’Alem-
bert, que j ’en croirai là-deffus aufli volontiers que
j’en crois Sthal décriant la tranfmutation. Lorfque
M. Defaguliers, par exemple, pour établir que toutes
les parties d’üft fluide homogène font en repos ,
a démontré à la rigueur, & d’une façon fort fimple ,
qu’un liquide ne faitroit bouillir, il në l’a fait, ce me
Semble, que parce qu’il a fuppofé tacitement que les
parties d’un liquide font libres ,fu i juris, au lieu qu’une
obfervation facile découvre aux fens même que
le feu les agite continuellement, ôc qu’il n’eft point
de liquidité fans chaleur ; ' ce que prefque tous les
Newtoniens femblént ignorer ou oublier, quoique
leur maître l’ait expreflement avancé, foye^ Optiq.
quejl. x x x j; Pour revenir à'mon fujet, je dis que le
mouvement de liquidité , & celui d’ébullition qui
n’en eft que le degré extrême , peuvent n’appartenir
qu’à la malfe, &: que ce n’eft qu’à la maffe qu’ils appartiennent
réellement dans l’eau, & dans plufieurs
autres liquides.
Les qualités fenfibles dès corps peuvent au moins
ne pas appartenir à lèurs parties intégrantes ; un
corps fort fouple peut être formé de parties fort roi-
de s , comme on en convient affez généralement pour
l’eau ; il feroit ridicule de chercher la raifon du fon
dans une modification intérieure des parties intégrantes
du corps fonore ; là couleur fenfible d’une
maffe d’o r, c’eft-à-dire une certaine nuance de jaune
, n’appartient point à la plus petite particule qui
eft o r , quoique celle-ci foit néceffairement colorée,
& que des faits démontrent même évidemment qu’elle
l’eft, mais d’une façon différente de la mafife.Ce-
c i èft fufeeptible de la preuve la plus eômpletie ( V.
la doctrine chimique fur les couleurs, au mot P H L O G I S -
t iq u e ) : mais, je le répété,ce n’eft pas’de l’établiffe-
ment de ces vérités que je m’occupe à préfent ; il me
luffit d’établir qu’il eft au;moins pofliblede concevoir
une maffe formée’par des particules qui n’ayent aucune
des propriétés qui fe rencontrent dans la maffe
comme telle ; qu’il eft très-facile de fe repréfen-
ter une maffe d’or, c’eft-à-dire un corps jaune » éclatant
, fonore, du&ile , compreffible, diyifible par
des moyens méchaniques, rarefcible jufqu’à la fluidité
, condenfable, élaftique, pefant dix-neuf fois?
plus que l’eau ; de fe repréfenter un pareil corps ,
dis-je, comme formé par l’affemblage de parties qui
font de l’or , mais qui n’ont aucune des qualités que
je viens d’expofer : or cette vérité découle fi néceffairement
de ce que j’ai déjà propofé, qu’une preuve
ultérieure tirée de l’expérience me paroît aufli
inutile, que l’appareil de la Phyfique expérimentale
à la démonftration de-la force des leviers. Si quelque
le&eur eft cependant curieux de ce dernier genre de
preuve, il le trouvera dans ce que nous allons dire
de l’imitation de l’or.
Toutes ces qualités, je les appellerai extérieures ,
ou phyfiques, & j’obferverai d’abord qu’ellès font
accidentelles , félon : lé langage de l’école ; qu’elles
peuvent périr fans que le corpufcule foit détruit,
ou ceffe d’être un corps tel ; o u , ce qui eft la même
chofe, qu’elles font exactement inutiles à la fpécifi-
eation du corps, non-feulement par là circonftance
de pouvoir périr fans que l’être fpécifique dù corps
foit changé, mais encore parce que réciproquement
elles peuvent fe rencontrer toutes dans un
corps d’une efpece differente. Car quoiqu’il foit très-
difficile de trouver dans deux corps intérieurement
differens un grand nombre de qualités extérieures
femblables , & que cette difficulté augmente lorf-
qu’on prend l’un des deux corps dans l’extrême de
fa claffe, qu’il en eft, par exemple, le plus parfait,
comme l’or dans celle des métaux, cependant cette
reffemblance extérieure ne répugne point du tout
avec une différence intérieure eflentielle. Par exemple,
je puis difpofer l’o r , & un autre corps qui ne
fera pas même un métal, de façon qu’ils fe reffem-
bleront par toutes leurs qualités extérieures, & même
par leur gravité fpécifique ; car s’il eft difficile
de procurer à un corps non métallique la gravité
fpécifique de l’o r , rien n’ëft fi aifé que de diminuer
celle de l’or : celui qui aura porté ces deux corps à
une reffemblance extérieure parfaite , pourra dire
de fon or imité , en aurum Phyficorum , comme Dio-
gene difoit de fon coq plumé , en hominem Platonis.
■ -Outre toutes ces propriétés que j’ai appellées extérieures
oti phyfiques , j’obferve dans tout aggrégé
des qualités que j’appellerai intérieures, de leur nom
générique, en attendant qu’il me foit jaermis de les
appeller chimiques , & de les diftinguer par cette
dénomination particulière des autres qualités du
même genre, telles que font les qualités très-eom-
mùnes des corps, l’étendue , l’impénétrahilité , l’inertie
, la mobilité, &c. Celles dont i f s’agit ici font
des propriétés intérieures particulières’; ellë^ Spécifient
proprement le corps , lë conftituent un corps
te l, font que l’eau , l’o r , le nitre , &c. font de l’eau,
de l’or , du nitre, &c. & non pas d’autres fubftan-
ces ; telles font dans l’eau la fimplicité , la volatilité
, la faculté de difloudre les fels, & dé devenir un
des matériaux de leur mixtion , &c. dans l’o r , la
métallicité, la fixité, la folubilité par le mercure &
par l’eau régale, &c. dans le nitre, la falinité neutre,
îa forme de fes çryftaux, l ’aptitude à être décompo-
fé par le phlogiftique & par l’acide vitriolique, &c.
or ees qualités appartiennent toutes effentièllement
aux parties intégrantes.
Toutes ces qualités font dépendantes les unes des
autres dans une fuite qu’il eft inutile d’établir ici ,
& elles font plus ou moins communes : l’o r , par ex.
eft foluble par le mercure comme métal ; il eft fixe
comme métal parfait ;;il eft foluble dans l’eau régale
en un degré d’affinité fpécifique comme métal parfait
tel | c’efl>à-dire comme or.
D e ces qualités internes, quelques-unes ne font
ëffénriëlles aux corps que relativement à notre expérience
, à;nos connoiffances d’aujourd’hui ; la fixir
té de Por, la volatilité du mercure, l’inamalgabilité
du fe r , &c. font des propriétés internes de ce genre
; découvrir les propriétés contraires , voilà la
fource des problèmes dé la Chimie pratique la moins
.vulgaire.
Il eft d’autres propriétés internes qui font tellement
inhérentes au corps,qu’il ne fauroit fubfifter
que par elles : ce font toutes celles qui ont leur raifon
prochaine dans l’être élémentaire, ou dans l’ordre
de mixtion dès corpufcules fpécifiques de chaque
corps ; c’eft ainfi qu’il eft effentiel au nitre d’être
formé par l’union de l’acide que nous appelions
nitreux &c de l’alkali fixe; à l’eau, d’être un certain
élément, &c.
Toutes les diftin&ions que nous avons propofées
jufqu’à préfent peuvent n’être regardées que comme
des vérités de précifion analytique, puifque nous
n’avons confidére proprement dans les corps que
des qualités ; nous allons voir que les différences
qu’ils nous préfenteront comme agens phyfiques ne
1ont pas moins remarquables.
i° . Les mafies exercent les unes fur les autres des
aâions très-diftin£tes de celles qui font propres aux
corpufcules, & cela félon des lois abfolument différentes
de celles qui règlent les affections mutuelles
des corpufcules. Les premières fe choquent, fe pref-
fent, fe réfiftent, fe divifent, s’élèvent, s’abaiflent,'
s’entourent, s’enveloppent, fe pénètrent 3 &c. les
unes les autres à raifon de leur vîtefle,de leur maffe,
de leur gravité, de leur confiftance, de leurs figures
refpeCtives ; & ces lois font les mêmes, foit que l’action
ait lieu entre des maffes homogènes, foit qu’elle
fe paffe entre des maffes fpécifiquement différentes.
Une colonne de marbre, tout étant d’ailleurs é g a l,
foûtient une maffe de marbre comme une maffe de
plomb ; un marteau d’une matière convenable quelconque
, chaffe de la même façon un clou d’une matière
convenable quelconque. Les actions mutuelles
des corpufcules ne font proportionnelles à aucune de
ces qualités ; tout ce que les dernieres éprouvent les
unes par rapport aux autres, fe réduit à leur union &
à leur féparation aggrégative, à leur mixtion, à leur
décompofition, & aux phénomènes de ces affeûions:
o r il ne s’agit dans tout cela ni de ehocs, ni de pref-
fions , ni de frotemens, ni d’entrelaffement, ni d’in-
troduâion, ni de coin, ni de levier, ni de vîteffe, ni
de groffeur, ni de figure , &c. quoiqu’une certaine
groffeur & une certaine figure foient apparemment
effentielles à leur être fpécifique. Ges actions dépendent
des qualités intérieures des corpufcules, parmi
lefquelles l’homogénéité & l’hétérogénéité méritent
la première confidération., comme conditions effentielles:
car l’aggrégation n’a lieu qu’entre des fub-
ftances.homogènes, comme noiis l’avons obfervé
plus haut ; l’hétérpgéjieité des principes au contraire
eft eflentielle à l’union tn ix ù v e . Voyeç M i x t i o n ,
DÉ COMPOSITION', SÉPARATION.
a0. Toutes les inaffes gravitent vers un centre
commun, ou font pefàntes; elles ont chacune un degré
de pefanteur connu & proportionnel à leur quantité
dev matière propre fous un volume donne : la
gravité abfolue dé tous les corpufcules n’eft pas démontrée
( v o y e i P r i n c i p e s & P h l o g i s t i q u e ) ;
leur gravité fpécifîqïié n’eft pas connue.
3°. Les maffes adhèrent entre elles à raifon de
leur vicinité, de lçur groffeur, & de. leur figure : les
corpufcules ne cpnnoiffent point dit tout cette loi ;
c ’eft à raifon de leur rapport ou affinité que fe font
leurs unions ( voye^ R a p p o r t ) ; & réciproquement
lés maffes ne font pas foûmifes aux lois des affinités
; I’aftion menftruelle fuppofe au contraire la def-
truélion deraggrégatiori (yoyei M e n s t r u e ) ; & jamais
de l’unipn d’une maffe à une màfle de nature dif-
férente, il né réfûlterà un nouveau çorps homogène.
40. Les corpufcules peuvent être écartés les uns
des autres par la chaleur ,caufe avec laquelle on n'a
plus befoin de la répulfion de Newton ; les maffes
ne s’éloignent pas les unes des autres par la chaleur.
Voye^ Feu.
50. Certains corpufcules peuvent être volatilifés ,
aucune maffe n’eft volatile. Voyc^ V o l a t il it é .
Jufqu’à préfent nous n’avons oppofé les corpufcules
aux aggrégés, que par la feule circonftance
d’être confidérés folitairement, & nous n’avons eu
aucun egard à la conftitution intérieure des premiers :
ce dernier afpeét nous fournira de nouveaux caractères
diftinftifs. Les voici :
i° . Les aggrégés font homogènes ; & les corpufcules
ou font fimples, ou font compofé.s de matériaux
effentiellement differens. La première partie de
cette propofition eft fondée fur une définition ou demande
; la fécondé exprime une vérité du même
genre, & elle a d’ailleurs toute l’évidence que peut
procurer une vafte expérience que nous avons à ce.
fujet. Voye% Mix t io n .
z°. Les matériaux des corpufcules compofés different
non-feulement entre eux,mais encore du cor-,
pufcule qui réfulte de leur union, & par conféquent
de l’aggrégé formé par l’affemblage de ces corpufcules
: c’eft ainfi que l’alkali fixe Sc l’acide nitreux
different effentiellement du nitre & d’une maffe de
nitre ;& fi cette divifion eft pouffee jufqu’aux élé-
mens, nous aurons toute la différence d’une maffe
à un corps fimple. Voyctmotre doctrine fur les élémens9
au mot Pr in c ip e . .
3°. Les principes de la miâion ou de la compo-
fi’tion des corpufcules , font unis entre eux par un
noeud bien différent de celui qui opéré l’union aggrégative
ou le rapport de maffe : le premier peut
être rompu par les moyens méchaniques, aufli-bien
que par ies moyens chimiques ; le fécond ne peut
l ’être que par les derniers, favoir les menftrues &
la chaleur; & dans quelques fujets même ce noeud eft
indiffoluble , du moins par les moyens vulgaires
l’or , l’argent, le mercure, & un très-petit nombre
d’autres corps , font des mixtes de cette derniere.
claffe. Poye( Mix t e .
Les bornes dans lefquelles nous fommes forcés de
nous contenir, ne nous-permettent pas de pouffer
plus loin ces confidérations: les propofitions qu’elles
nous ont fournies , quoique Amplement énoncées
pour la plupart, prouvent, ce me femble, fuffifam-
ment que les affeûions des maffes, & les affe&ions
des differens ordres de principes dont elles font formées
, peuvent non-feulement être diftinguées par
des confidérations abftraites, mais même qu’elles
different phyfiquement à plufieurs égards ; ôc l’on,
peut au moins foupçonner dès-à-préfent que là phyfique
des corps non organifés peut être divifée par
ces différences en deux fciences indépendantes l’une
de l’autre, du moins quant aux objets particuliers.'
Or elles exiftent, ces.deux fciences ,la divifion s’eft
faite d’elle-même ; & l’objet .dominant de chacune
remplit fi exaftement l’une des deux claffes que nous
venons d’établir, que. ce partage qui a précédé l’ob-,
fervation raifonnée de fa nécemté, eft une nouvelle^
preuve de la réalité de notre diftinètion.
L’une de ces fciences eft la Phyfique ordinaire,
non pas cette Phyfique univerfelle qui eft définie à
la tête des cours de Phyfique, mais cette Phyfique
beaucoup moins vafte qui eft traitée dans ces ouvrages.
La fécondé eft la Chimie.
Que la Phyfique ordinaire’ , que je n’appellerai
plus que Phyfique , fe borne aux affeftions des maffes
, ou au moins que ce fqit-là fon objet dominant,
c’eft un fait que tout leûeur peut vérifier,-1°. fur la
1 table des chapitres de tout traité de Phyfique ; i° .