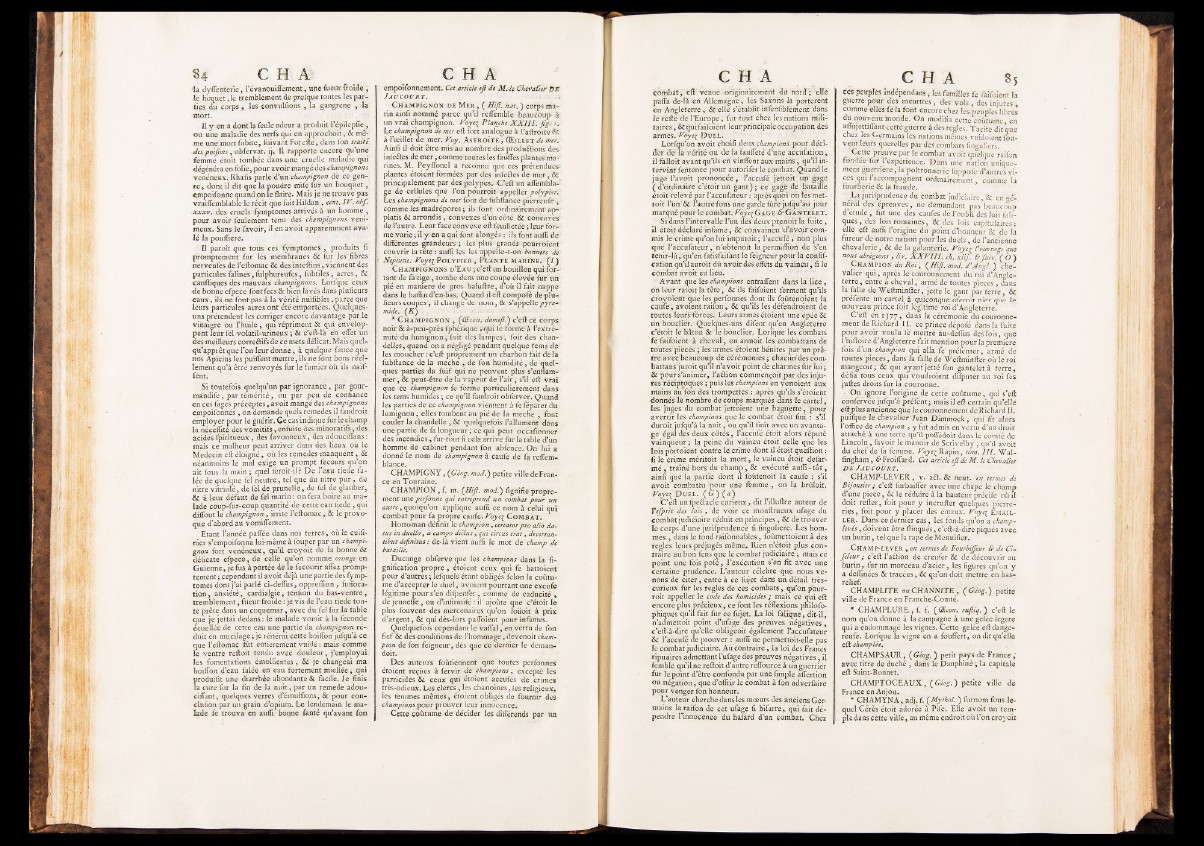
/
'la dyffenterie, l’é vanouiffement, une fueur froide ,
le hoquet ,1e tremblement de prelque toutes, lès parties
du -corps , les convuifions , 1 a gangrené , la
mort.
Il y en a dont la feule odeur a produit Pépileplte,
ou une maladie des nerfs qui en approchoit, & même
une mort fubite, fuivant For elle, dans fon traité
des poifons , obfervat. _ij, Il rapporte encore qu’une
femme étoit tombée dans une cruelle maladie qui
dégénéra en folie, pour avoir mangé des champignons
vénéneux. Rhafis parle tfunchampignon de ce genr
e , dont il dit que la poudre mife fur un bouquet,
empoifonne quand on le flaire. Mais je ne trouve pas
vraiffemblable le récit que faitHildan , cent. IF,obf.
-xxxv. des cruels fymptomes arrivés à un homme ,
pour avoir feulement tenu des champignons venimeux.
Sans le favoir, il en avoit apparemment avalé
la pouffiere.
' Il paroît que tous ces fymptomes , produits fi
promptement fur les membranès 8c fur les fibres
nerveufes de l’eftomac 8c des inteftins, viennent dès
particules falines, fulphureufes ,fu b tile s , acres, 8c
cauftiques des mauvais champignons. Lorfque ceux
-de bonne efpece foritfecs & bien lavés dans plufieurs
eaux, ils ne font pas à la vérité nuifibles, parce que
léitrs particules acres ont été emportées. Quelques-
uns prétendent les corriger encore davantage par le
vinaigre ou l’huile , qui répriment & qui enveloppent
leur fel volatil-urineux ; & c’eft-là en effet un
des meilleurs correûifs de ce mets délicat. Mais quel-
qu’apprêt que l’on leur donne, à quelque fauce que
nos Apicius les puiffent mettre, ils ne font bons réellement
qu’à être renvoyés fur le fumier où ils n'aif-
fent.
Si toutefois quelqu’un par ignorance, par gour-
mandife, par témérité, , ou par peu de confiance
en ces fages préceptes, avoit mangé des champignons
empoifonnés , on demande quels remedes il faudroit
employer pour le guérir. C e cas’indique fur le champ
la néceflité des vomitifs, enfüite des minpratifs, des
acides fpiritueux, dés favonneux, des adouciffans :
mais ce malheur peut arriver dans des lieux ou le
Médecin eft éloigné, où les remedes manquent, &
néanmoins le mal exige un prompt fecours qu’on
ait fous la main ; quel feroit-il? D e l’eau tiede fa-
lée de quelque fel neutre, tel que du nitre pur, de
nitre vitriolé, de fel de prunelle, de fel de glaüber,
& à leur défaut de fel marin : on fera boire au malade
coup-fur-coup quantité de cette eau tiede , qui
diffout le champignon, irrite l’eftomac, & le provoque
d’abord au vomiffement.
Etant l’année paffée dans nos terres, où le cuifi-
nier s’empoifonna lui-même à fouper par un champignon
fort vénéneux, qu’il croyoit de la bonne 8c
délicate efpece, de celle qu’on nomme oronge en
Guienne, je fus à portée de le fecourir affez promptement
; cependant il avoit déjà une partie des fymptomes
dont j’ai parlé ci-deffus, oppreffion , fuffoca-
tion, anxiété, cardialgie, tenfion du bas-ventre,
tremblement, fueur froide : je vis de l’eau tiede toute
prête dans un coquemar, avec du fel fur la table
que je jettai dedans: le malade vomit à la fécondé
ecuellée de cette eau une partie du champignon réduit
en mucilage ; je réitérai cette boiflon jufqu’à ce
que l’eftomac fût entièrement vuidé : mais comme
le ventre reftoit tendu avec douleur, j’employai
les fomentations émollientes, 8c je changeai ma
boiflon d ’eau faléé en eau fortement miellée, qui
produifit une diarrhée abondante & facile. Je finis
la cure fur la fin de la nuit, par un rçmede adou-
cifîant, quelques verres d’émulfions, & pour con-
cluiion par un grain d’opium. Le lendemain le malade
fe trouva en aufli bonne fanté qu’avant fon
empoifonnement. Cet.article ejl de M;le Chevalier DE
J a u c o u r t . H V.ï
C h amp ignon de Mer , ( Hijl. hat. ) corps marin
ainfi nommé parce qu’il reffemble beaucoup à.
un vrai champignon, Foye{ Planche X X I I I . fig.- t.
Le champignon de mer .eft fort analogue à l’aftroïté:8c'
à l’oeillet de mer. Foy. AstroïXE , (Eill et de mer.
Ainfi il doit être mis au nombre des productions dés •
infeCtes de mer, comme toutes les fanfles plantes marines.
M. Peyflonel a reconnu que ces prétendues1
plantes étoient formées par des infe&es de nier,8c
principalement par des polypes. C ’ eft un aflembla-1
ge de cellules què l’on pourroit appelier pôiytëèn
Les champignons de mtr font defnbftânGe-pierfeufe ,
comme les madrépores ; ils; font ordinairement- -àp*»*
platis & arrondisconvexes d’un côté 8c conca ves'
de.l’autre. Leur face convexe êft feùi'lletéfe j leur forr
me varie ;il y en a qui font alongés : ils font aufli d e
différentes grandeurs les plus-grands p'Ourroiënf
couvrir la-tête : aufli les les appel le-t-on bonnets de
Ntpiune; FoyeçPolypier * PEante marin e. CI)
C hamp ignons d’E au ; g’eft un bouillon qui for-
tànt de fa t ig e , tombe dans une coupe élevée fur tin
pié en maniéré de gros balüftfê, d’où il fait nappe
dans le baffind’en-baîs. Quand il eft compofé dëplü-
fieurs coupes | il changé de nom , & s'appellep y r a mide.
(X ) .
* C ham p ign o n , (OEcon.ydomejl.) c?eft ce corps
noir & à-peu-près fphérique ?qui lé formé à l’extrémité
du lumignon j-foit des lampes5, foit des chandelles,
quand’ on a négligé; pendant quelque fems de
les moucher : c’eft proprement un charbon fait delà
fubftance de la meche , de fon humidité, de quelques
parties du fuif qui ne peuvent plus s’enflammer,
8c peut-être de la vapeur de l’air, s?il eft vrai
que ce'champignon fe forme particulièrement dans
les tems humides ; ce qu’il faudroit obferver. Quand
les parties, de ce champignon viennent à feféparer du
lumignon, elles tombent au pié de la mèche, g font
couler la chandelle , 8c quelquefois l’allument dans
une partie de fa longueur ; ce qui peut occafionner
des incendies, fur-tout fi cela arrive fur la table d?un
homme de cabinet pendant fon abfence. On lui a
donné le nom de champignon à caufe de fa reflem-
blancè. ;
CHAMPIGNY, (Géog, mod.) petite v ille de France
en Touraine,
CHAMPION, f. m. (Hijl. mod.) fignifieproprement
une perfonne qui entreprend un combat pour un
autre, quoiqu’on applique aufli ce nom à celui qui
combat pour fa propre caufe. Foye^ C om b a t .
Hottoman définit 1 e champion , certatorpro alio da-
tus in duello, à campo diclus, qui circus erat, decertan-
tibus definitus : de-là vient aufli le mot de champ de
bataille.
Ducange obferve que les champions dans la lignification
propre , étoient ceux qui fe battoient
pour d’autres ; lefquels étant obligés félon la coutume
d’accepter le duel, avoient pourtant une exeufe
légitime pours’én difperifer, comme de caducité ,
de jeunefle, ou d’infirmité : il ajoute que c’étoit le
plus fouvent des merceriaires qu’on loiioit à prix
d’argent, 8c qui dès-lors paffoient pour infâmes.
Quelquefois cependant le vaffal, en vertu de fon
fief & des conditions de l’hommage, devenoit champion
de fon feigneur, dès que c'è dernier le deman-
doit.
Des auteurs foûtiennent que toutes perfonnes
étoient reçues à fervir de champions, excepté les
parricides 8c ceux qui étoient accufés de crimes
très-odieux. Les clercs, les chanoines, ies religieux,
les femmes mêmes, étoient obligés de fournir des
champions pour prouver leur innocence.
Cette coutume de décider les différends par un
combat, èft Venue origihàiremèrit dû fior<ï]:;eïIe
palfa de-là en Allemagne, les Saxons la portèrent
en Angleterre , 8c;elle s’établit infenfiblement dans
le refte dé l’Europe, fur-tout chez les nations niili-
taires, Scquifaifoient leur principale occupation des
armes.-Fojyeç D u e l .
Lorfqu’on avoit choifi deux championJ pour décider
d e là vérité Où de la Fauffeté d’une açcufation,
il falloit avant qu’ils en vinlfeiit aux mains, qu’il intervînt
fentence pour autorifer le combat. Quand le
jtige l’avoit prononcée , l’accufé jettôit, un1 ^agô
( d^ôrdinàire c’étoit un gant ) ; ce .'gagé'de bataille
étoit relevé par l’accufateur : iaprés qùOi’ôrt îes met-
toît l’ùn 'ÔC l’autre fous ùne'garde f ûfè jufùü’aii jour
marqué pour le çombàt.^ Foÿe{Ga g e ^(S’ G'AN'I'eLë t .
Si dans Fintervalle l’un deS deux pf,enôit'la fuite,
il étoit déclaré infâme, &c convaincu ‘d^àVojr com-
mis le- crime qu’on lui imputoit; l’accùfé iibri plus
que l ’accufateur, n’obtenoit la permiflion de Ven
tenir-là , qu’en fatisfaifant lé feigneur pour là confif-
cation qu’il àuroit dû avoir deseffets du vaincu, fi le
combat avoit eu lieu.
Avant que les champions entraffent dans la liée ,
on leurrai oit la tête, 8c ils faifoient fehiie ht qu’ils
croÿôiërit ique les perfonnes dont ils foûtènoient la
càiife ', avdient raiion, 8c’ qu’ils les défendrôient de
toutes reufs'forcèsi Leurs armes étoient une épéb 8c
iln boucliér. ' Quelques-uns difent qu’en Angleterre
c’étoit l’éb ’âtort 8c lé bouclier. Lorlque les combats
fe faifoiéht à cheval:, on armoit les combàtfans de
toutes pièces lés armes étoient bénites par un prêtre.
dVè'C beaucoup de cérémonies; chacun’desdôm-
Battàns juroit qu’il n’a Voit point de charmes fur lui ;
8i pour s’animer, l’aftion commençoit par des injures
réciproques ; puis les champions en ÿenoient aùx
mains àùTô'n des trompettes : après qu’ils s’étoient
donnés le nombre de coups marqués dans le cartel,
les jugés du combat jettoient une baguette , pour
avertir les champions., que le combat étoit fini : s’il
dutôit jufqü’à la nuit, ou qu’il finît avec un avantage
égal1 des deux côtés, Tàccufé étoit alors réputé
vainqueur; la peine du vaincu étoit celle que les
lois portoient contre le crime dont il étoit queftion :
fi le crime méritoit la mort, le vaincu étoit defar-
mé , traîné hors du champ, 8c exécuté au fli-tôt,
ainfi que la partie dont il foûtenoit la caufe :' s’il
avoit combattu pour une femme , on la brûioit.
Foye^ D u el. ( G ) (<*)
C ’eft un fpedacle curieux, dit l’illuftre auteur de
Ÿefprit des lois , de voir ce monftrueux ufage du
combat judiciaire réduit en principes, 8c de trouver
le corps d’une jurifprudence fi finguliere. Les hommes
, dans le fond raifonnables, foûmettoiènt à des
réglés leurs préjugés même. Rien n’étoit plus contraire
au bon fens que le combat judiciaire ; mais ce
point une fois pofé, l ’exécution s’en fit avec une
certaine prudence. L’auteur célébré que nôUs v e nons
de citer, entre à ce fujet dans un détail très-
curieux fur les réglés de ces combats, qu’on pour-
roit appelier le code des homicides ; mais ce qui eft
encore plus précieux, ce font les réflexions philofo-
phiques qu’il fait fur ce fujet. La loi falique, dit-il,
n’admettoit point d’ufage des preuves négatives,
c’eft-à-dire qu’elle obligeoit également l’accufateur
8c l’accufé de prouver : aufli ne permettbit-elle pas
le combat judiciaire. Au contraire, la loi des Francs
ripuaires admettant l’ufage des preuves négatives, il
femble qu’il ne reftoit d’autre reffource à un guerrier
fur le point d’être confondu par une Ample affertion
ou négation, que d’offrir le combat à fon adverfaire
pour venger fon honneur.
L’auteur cherche dans les moeurs des anciens Germains
la raifon de cet ufage fi bifarre, qui fait dépendre
l’innocence du halard d’un combat. Chez
ces peuplés indépendai». les fahiilles fe faifoient la
guerre pour des meurtres , des1 vols , des injures ,
•Comme elles fê la font encore cher lès peuples libres
du nouveau inonde. On modifia cette coutume en
affujettiffantbette guerre à des réglés. Tacite dit que
chez les Germains les nations mêmes vuidoient fou-
vent leurs querelles par dés combats finguliers.
. Pa.r W. combat avoit quelque raifon
fondeè-fur l’expérience. Dans une nation uniquement
guerrière, la poltronnerie fuppofe d’autres vi-
ces .qui raccompagnent ordinairement, comme la
fourberie 8c la fraude.
' ;La jurifpmdence du côhibat judiciaire, ÔC en <*é-
nérâl des épreuves,, ne demandant pas beaucoup
fletude, flit une des .caufes de l’oubli des lois fali-
quës ,' des lois romaines, 8c des lois capitulaires :
elle eft aufli l’origine du point d’honneur 8ç de la
fureur de notre nation pour lés duels, dé l’ancienne
chevalerie, 8c de la galanterie. Foyesr F ouvrage que
nous abrégeons , liv , X X F I I I . ch. xiij. ' &fuiv : ( O )
C hampion du Roi j ( Hifi. mod. d’Arigi. ) chevalier
qui , après le courohriement du roi d’Angleterre
, entre à cheval, armé de toutes pièces , dans
lafalle de'Weftminfter, jette le: gant parterre, &
prëfente un cartel à qliîcoïique oferôit nier que le
nôuve'àu prince foit légitimé roi d’Angleterre.
C ’eft en 1377 > dans la cérémonie du couronnement
de Richard II. ce prince dépofé dans la fuite
pour avoir voulu fe mettre au-dèffus des lois, que
l ’hiftoire d’Angleterre fait mention pour la première
fois d’un champion qui alla fe préfenter, armé dé
toutes pièces, dans la falle de Weftminfter où le roi
mangeoit; 8c qui ayant jette fon gantelet à terre,
défia tous ceux qui vôudroient difputer au roi fes
juftes droits fur la .couronne.
• On ignore l’origine de cette coûtume, qui s'eft
confervée jufqu’à préfent; mais il eft certain qu’éllé
eft plus ancienne que le couronnement de Richard If.
puifque le chevalier Jean D im m o ck , qui fit alors
l'office de champion , y fut admis en vertu d’un droit
attaché à une terre qu’ït pofledoit dans le comté de
Lincoln, favoir le manoir de Scrivelby, qu’il avoit
du chef de fa femme. Foyc{ Rapin, tom. I I I . Wal-
fingham, &Troiffard. Cet article ejl de M . le Chevalier
d e Ja u c o u r t .
CHAMP-LEVER, v. aél. 8c neut. en termes de
Bijoutier ; c’eft furbaiffer avec une chape le champ
d’une piece, 8c le réduire à fa hauteur précife où il
doit refter, foit pour y incrufter quelques pierreries
, foit_ pour y placer des émaux. Foyeç Email-
ler. Dans ce dernier cas, les fonds qu’on a champ-
levés ,àôrvery.t être flinqués , c’eft-à-dire piqués avec
un burin, tel que la râpe de Mehuifier.
CHAMP-LEVER , en termes de Fourbijfeur & de Ci-
feleùr ; c’eft l’aâion de creufer 8c de découvrir au
burin, fur un morceau d’acier, les figures qu’on y
a deffinées & tracées, 8c qu’on doit mettre en bas-,
relief.
CHAMPLITE ou CHANNITE , ( Géog. ) petite
ville de France en Franchç-Comté.
* CHAMPLURE , f. f. {OEcon. rujliq. ) c’eft le
nom qu’on donne à la campagne à une gelée legere
qui a endommagé les vignes. .Cette gelée eft dange-»
reufe. Lorfque la vigne en a fouffert, on dit qu’elle
eft champlée.
CHAMPSAUR, (Géog. ) petit pays de France,’
avec titre de duché, dans le Dauphiné ; la capitale
eft Saint-Bonnet.
CHAMPTOCEAUX, ( Géog. ) petite ville dé
France en Anjou.
* CHAMYNA, adj. f. ( Mythol. ) furnom fous lequel
Cérès étoit adorée à Pife. Elle avoit un temple
dans cette ville, au même endroit où Ton croyoit