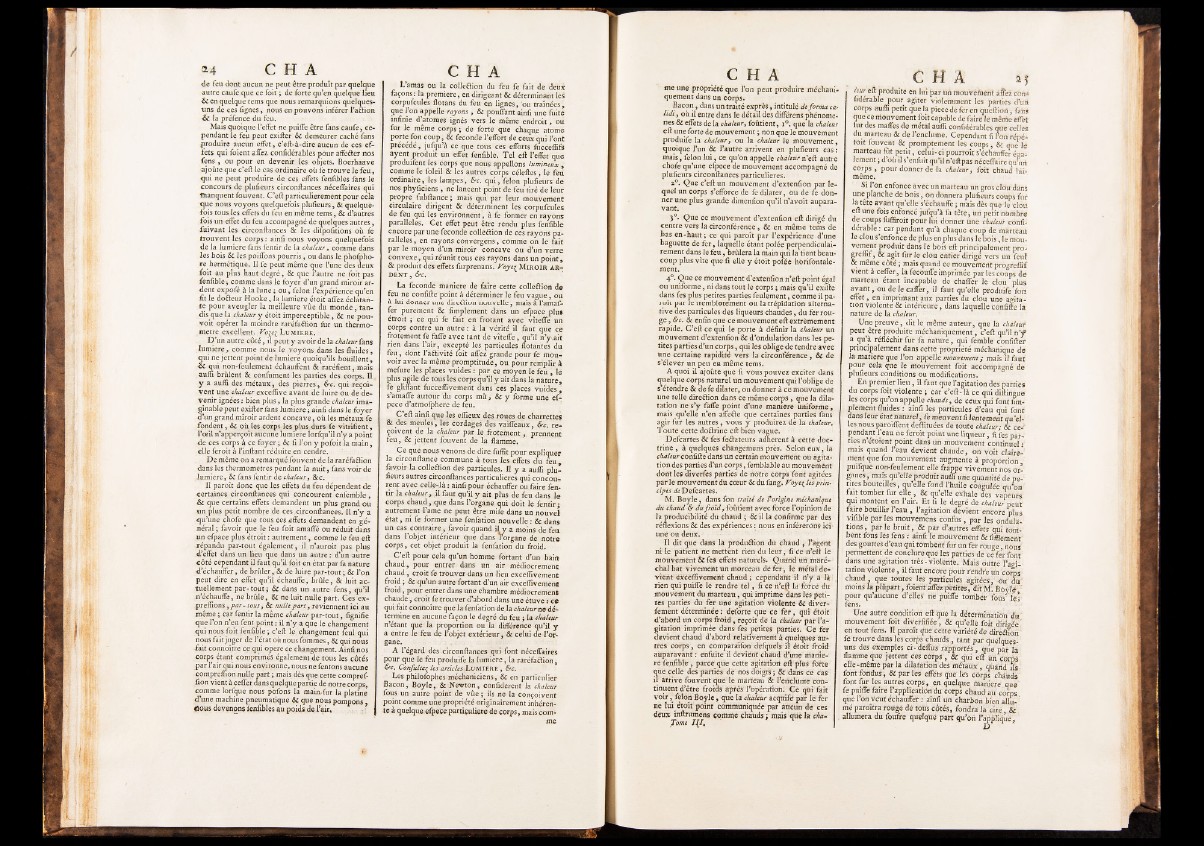
de feu dont aucun ne peut être produit par quelque
autre caufe que ce foit ; de forte qu’en quelque lieu
& en quelque tems que nous remarquions quelques-
uns de ces lignes, nous en pouvons inférer Faction
& la préfence du feu.
Mais quoique l ’effet-ne puilfe être fans caufe* cependant
le fep peut exifter & demeurer caché fans
produire aucun effet, c’eft-à-dire aucun de ces effets
qui foient affez confidérables pour affe&er nos
fens , ou pour en devenir les objets. Boerhaaye
ajoute que c’eft le cas ordinaire où fe trouve le feu,
qui ne peut produire de ces effets fenfibles fans le
concours de plufiéurs circonftances nécelfaires qui
manquent fouvent. C ’eft particulièrement pour cela
que nous voyons quelquefois plulieurs, & quelquefois
tous les effets du feu en même tems, & d’autres
fois un effet du feu accompagné de quelques autres,
fuivant les circonllances & les dilpofitions où fe
trouvent les corps : ainli nous voyons quelquefois
de la lumière fans fentir de la chaleur, comme dans
les bois & les poiffons pourris, ou dans le phofpho-
re hermétique. Il fe peut même que l’une des deux
foit au plus haut degré, & que l’autre ne foit pas
•fenfibie $ comme dans le foyer d’un grand miroir ardent
expofé à la lune ; ou, félon l’expérience qu’en
fît le do&eur H ooke, la lumière étoit affez éclatante
pour aveugler la meilleure vûe du monde, tandis
que la chaleur y étoit imperceptible, & ne pou-
voit opérer la moindre raréfaction fur un thermomètre
excellent. Vo^i L umière.
D ’un autre côté, il peut y avoir de la chaleur fans
lumière, comme nous le voyons dans les fluides.,
qui ne jettent point de lumière quoiqu’ils bouillent,
Sc qui non-feulement échauffent & raréfient, mais
auffi brûlent & confument les parties des corps. Il
y a auffi des métaux, des pierres, &c. qui reçoivent
une chaleur exceffive avant de luire ou de devenir
ignées: bien p lus, la plus grande chaleur imaginable
peut exifter fans lumière ; ainfi dans le foyer
d ’un grand miroir ardent concave, où les métaux fe
fondent, & où les corps les plus durs fe vitrifient,
i’oeil n’apperçoit aücune lumière lorfqu’il n’y a point
de ces corps.à ce foyer ; & fi l’on y pofoit la main,
elle feroit à l’inftant réduite en cendre.
De même on a remarqué fou vent de la raréfaction
dans les thermomètres pendant la nuit, fans voir de
lumière, & fans fentir de chaleur, &c.
II paroît donc que les effets du feu dépendent de
certaines circonftances qui concourent enfeffible,
& que certains effets demandent un plus grand ou
un plus petit nombre de ces .circonftances. Il n’y a
qu’une chofe que tous ces effets demandent en général
; favoir que le feu foit amaffé ou réduit dans
un efpace plus étroit : autrement, comme le feu eft
xépandu par-tout également, il n’auroit pas plus
d’effet dans un lieu que dans un autre : d’un autre
côté cependant il faut qu’il foit en état par fa nature
d’échauffer, de brûler, & de luire par-tout ; & l’on
peut dire en effet qu’il échauffe, brûle, & luit actuellement
par-tout; & dans un autre fens, qu’il
n ’échauffe, ne brûle, & ne luit nulle part. Ces ex-
preffions, par- tout,, & nulle part, reviennent ici au
même ; car fentir la même chaleur par-tout, fignifie
que l’on n’en fent point : il n’y a que le changement
qui nous foit fenfibie ; ç’eft le changement k u l qui
nous fait juger de l’état où nous fommes, & qui nous
fait connoître ce qui opéré ce changement. Ainfi nos
corps étant comprimés également de tous les côtés
par l’air qui nous environne, nous ne fentons aucune
compreffion nulle part ; mais dès que cette compref-
fion vient à ceffer dans quelque partie de notre corps,
comme lorfque nous pofons fa main,fur la platine
d’une machine pneumatique & que nous pompons *
llous devenons fenfibles ru poids de l’air*
L’amas ou la colleétion du feu fe fait de deux
façons : la première, en dirigeant & déterminant les
corpufcules ftotans du feu en lignes, ‘ou traînées,
511e l’on appelle rayons , & pouffant ainfi une fuite
infinie d’atomes ignés vers le même endroit, ou
fur le même corps ; de forte que chaque atome
P°rte fon coup, & fécondé l’effort de ceux qui l’ont
précédé, jufqu’à ce que tous ces efforts fucceffifs
ayent produit un effet fenfibie. Tel eft l’effet que
produifent les corps que nous appelions lumineux ,
comme le foleil & les autres corps céleftes, le feu
ordinaire, les lampes, &c. qui, félon plufieürs de
nos phyfîcieris , ne lancent point de feu tiré de leur
propre fubftance ; mais qui par leur mouvement
circulaire dirigent & déterminent les corpufcules
de feu qui les environnent, à fe former en rayons
parallèles. Cet effet peut être rendu plus fenfibie
encore par une fécondé collection de ces rayons parallèles
, en rayons convergens, comme on le fait
par le moyen d’un miroir concave ou d’un verre
convexe, qui réunit tous ces rayons dans un point,
& produit des effets furprenans. Voye^ Miro ir ard
e n t , &c.
La fécondé maniéré de faire cette collection de
feu ne confifte point à déterminer le feu vague, ou
à lui donner une direction nouvelle, mais à l’amaf-
fer purement & Amplement dans un efpace plus
étroit ; ce qui fe fait en frotant avec vîteffe un
corps contre un autre : à la vérité il faut que ce
frotement fe faffe avec tant de vîteffe, qu’il n’yvait
rien dans l’air, excepté les particules flotantes du
feu , dont FaCtivité foit affez grande pour fe mouvoir
avec la même promptitude, ou pour remplir à
mefure les places vuides : par ce moyen le feu , lé
plus agile de tous les corps qu’il y ait dans la nature,
fe gliffant fucceffivement dans ces places vuides ,
s’amaffe autour du corps mû , & y forme une ef-
pece d’atmolphere de feu.
C ’eft ainfi que les effieux des roues de charrettes
& des meules, les cordages des vaiffeaux, &c. reçoivent
de la chaleur par le frotement, prennent
feu., & jettent fouvent de la flamme.
Ce que nous venons de dire fuffit pour expliquer
la circonftance commune à tous les effets du feu
favoir la collection des particules. II y a auffi plu-
fieurs autres circonftances particulières qui concourent
avec celle-là : ainfi pour échauffer ou faire fentir
la chaleur y .il faut qu’il y ait plus de feu dans le
corps chaud, que dans l’organe qui doit le fentir;
autrement Faîne ne peut être mife dans un nouvel
état, ni fe former une fenfation nouvelle : & dans
un cas contraire, favoir quand il y .a moins de feu
dans l’objet intérieur que dans l’organe de notre
corps, cet objet produit la fenfation du froid.
C ’eft pour cela qu’un homme fortant d’un bain
chaud, pour entrer dans un air médiocrement
chaud, croit fe trouver dans un lieu exceffivement
froid ; & qu’un autre fartant d’un air exceffivement
froid, pour entrer dans une chambre médiocrement
chaude', croit fe trouver d’abord dans une étuve : ce
qui fait connoître que la fenfation de. la chaleur ne détermine
en aucune façon le degré du feu ; la chaleur
n’étant que la proportion ou la différence qu’il y
a entre le feu de l’objet extérieur, & celui de l’or-
ganè.
A l’égard des circonftances qui font néceffaires
pour que le feu produife la lumière, la raréfaction ,
&c. Confulte^ les articles LUMIERE, &c.
Les philofophes méchaniciens, & en particulier
Bacon, Boyle, & Nevton, confiderent la chaleur
fous un autre point de vûe ; ils ne la conçoivent
point comme une propriété originairement inhérente
à quelque efpece particulière de corps, mais comme
me une propriété que l’on peut produire méchani-
quement dans un corps.
Bacon, dans un traité exprès, intitulé de forma ca-
lidiy où il entre dans le détail des différens phénomènes
& effets de la chaleur, foûtient, i°. que la chaleur
eft une forte de mouvement ; non que le mouvement
produife la chaleur, ou la chaleur le mouvement,
quoique l’un & l’autre arrivent en plufiéurs cas :
mais, félon lu i, ce qu’on appelle chaleur n’eft autre
chofe qu’une efpece de mouvement accompagné de
plufiéurs circonftances particulières*
x°. Que c’eft un mouvement d’extenfion par lequel
un corps s’efforce de fe dilater, ou de le donner
une plus grande dimenfion qu’il n’avoit auparavant.
3°* Que ce mouvement d’extenfion eft dirigé du
centre vers la circonférence, & en même tems de
bas en-haut; ce qui paroît par l’expérience d’üne
baguette de fe r , laquelle étant polée perpendiculairement
dans le feu , brûlera la main qui là tient beaucoup
plus v îte que fi elle y étoit poféè horifôntâle-
ment.
4°. Que ce mouvement d’extenfion n’eft point égal
ou uniforme, ni dans tout le corps ; mais qu’il exifte
dans fes plus petites parties feulement, comme il paroît
par le tremblotement ou la trépidation alternative
des particules des liqueurs chaudes, du fer rouge
, &c. & enfin que ce mouvement eft extrêmement
rapide. C ’eft ce qui le porte à définir là chaleur un
mouvement d’extenfion St d ’ondulation dans les petites
parties d’un corps, qui les oblige de tendre avec
une certaine rapidité vers la circonférence, & de
s’élever un peu en même tems.
A quoi il ajoûte que fi vous pouvez exciter dans
quelque corps naturel un mouvement qui l’oblige de
s’étendre & dé fe dilater, ou donner à ce mouvement
une telle direction dans ce même corps, que la dilatation
ne s’y faffe point d’une manière uniforme,
mais qu’elle n’en affeCte que certaines parties fans
agir fur les autres , vous y produirez de la chaleur.
Toute cette doCtrine eft bien vague.
Defcartes & fes feCtateürs adhèrent à cëttê doctrine
, à quelques changemens près. Selon eu x, la
chaleur confifte dan9 un certain mouvement ou agitation
des parties d’un corps, femblable au mouvement
dont les diverfes parties de nôtre corps fôrif agitées
par le mouvement du Coeur & du fang. Voye^ Us pria*
cipes de Defcartes.
M. Boy le, dans fon traité de Vorigine mèchanique
du chaud & du froid, foûtient avec force l’opinion de
la producibilité du chaud ; & il la Confirme par des
réflexions & des expériences : nous en inférêrôrîS ici-
une ou deux.
Il dit que dans la production du chaud , Fàgent
ni le patient ne mettent rien du leur, fi ce n’eft le
mouvement & fes effets naturels. Quand un maté- "
chai bat vivement un morceau dé fer-, le métal devient
exceffivement chaud ; cependant il n’y a là
rien qui puiffe le rendre t e l , fi ce n’e$ la forcé du
mouvement du marteau, qui imprime dans les petites
parties du fer une agitation violente & diver-
fement déterminée : deforte que ce f e r , qui étoit
d’abord Un corps froid, reçoit de la tkaleur par l’agitation
imprimée dans fes petites parties. Ce fér
devient chaud d’abord relativement à quelques autres
corps, en comparaifon defquels il étoit froid
auparavant : enfuite il devient chaud d'une rtianie-
ré fenfibie, parce que cette agitation eft plus fofte
que celle des parties de nos doigts ; & dans ce cas
il arrive fouvent que le marteau St ï’enclume continuent
d’être froias aptës l’opération.' C e qui fait
v o ir , félon B o y le , que la chaleur acqttife par le fer
ne lui étoit point communiquée par aucun de ces
detix: inftfumens comme chauds ; maisque la cha-
Tome /{/,
hur eft produite en lui par tffi mouvèlhént affez cbn*
fidérable pour agiter violemment les parties d’urit
corps auffi petit que la piece de fer en queftion ; fanS
que ce mouvement foit capable de faire lé mêffie effet
fur des maffes de métal auffi confidérables que celles
du marteau & de l’enclume. Cependant fi l’on répé-
toit fouvent & promptement les coups ; & que lé
marteau fut petit / celui-ci pourrait s’échauffer également
; d’où il s’enfuit qu’il n’eft pas néceffaire qu’nrii
. Côfps * pour donner de la chaletir, foit chaud lui*
même.
Si l ’on enfonce àvec urt marteau un gros clou dâftS
une planche de bois, on donnera plufiéurs coups fur
la tete avant qu’elle s’échauffe ; mais dès que lé clou
eft une fois enfoncé jufqu’à fa tête* uri petit n&mbre
de coups fuffiroit pour lui donner Une chaleur confi*
dérable : carppndant qu’à chaque coup de marteau
le clou s’enfonce de plus ën plus dans le bois * lé mouvement
produit dans lé bois eft principalement pro-
greft*f> & agit fur le clou entier dirige Vers un feu!
& meme coté ; mais quand ce mouvement progreffif
vient à cèffer, la fecouffe imprimée par les coups dé
marteau étant incapable de chafler le clou plus
avan t, ou de le cafter, il faut qu’elle produifê fon
e/fet > en imprimant aux parties du clou Une agitation
violente & intérieure, dans laquelle confifte là
nature de la chaleur.
Une p reuve, dit le même auteur, que la chahut
peut être produite méchaniquement, c’eft qu’il n ' f
a qu’à réfléchir fut fâ nature, qui femble confifter
principalement dans cette propriété mèchanique de
là matière que l’on appelle mouvement ; mais il faut
pour cela que le mouvement foit accompagné de
plufiéurs conditions ou modifications.
En premier lieu , il faut que l’agitation dés parties
du corps foit violente ; car c’eft-là ce qui diftingue
les corps qu’on appelle chauds, de ceux qui font Amplement
fluides : ainfi les particules d’eau qui font
dans leur état naturel, fé meuvent fi lentethent au ’elles
nous paroiffent deftituées de toute chaleur; 6t ce-'
pendant l’èâu ne feroït point une liqueur, fi fes parties
h ’étoient point dans tin mouvement continuel Ÿ
mais quand l’eau devient chaude, on voit clairement
que fon mouvement augmente à proportion
puifque non-feulement elle frappe Vivement nos organes,
mais qu’elle produit auffi une quantité de petites
bouteilles, qu’éllé fonff l’huile coagulée qu’on
fait tomber fur elle , & qu’elle exhale dés vaôéüfs
qui montent en l’air. Et fi le degré de chaleur peut
faire bouillir l’eau , l’agitation dévient-encore plus
vifible par les mouvemens confus, par les Ondulations,
par le bruit, 6c par d’autres effets qui tombent
fous lés ferts : âinfi le mouvement & fixement'
des gouttes d’éaü qui tombent fur tin fer rOugeriOtis
permettent de conclure que les parties de clféVfont
dans uné agitation très - Violente. Mais diitré fà ê i-
tation violente, il faut encore pour réftdFe üh corps
chaud , que toutes les particules agitées, Ou“ dU:
moins la plupart, foient affezpèffites, ditM. Éôÿfe
pour qu’aucune d’elles' iie puiffe tomber fôüS' ï é l
fens.
Une autfe condition efi%ê la d&ftWfflaiiïV dn
niouvêritent foit tfiVetflKç', Sc qü’eîiè foit tÜngee'
en tout fens. Il paftnît cjtté cette variété' <fe; di¥èffion;
fe tïôitve dans leS cdfprcHauds,, tant paf quelques-
uns des exemples ci - deflus rapportés, que" par ta
flamme que jettent Ces c*tps;, Si qui eff üh dSrps
effecmêtné par la diiatatiendes métaw, quand %:
font fondus, St par leS eflfes qüê les côrpl chaiiis'
font fur les autres corps, en quelque manière que
fè puiffe faire J’appfeàtidn'clnUofpS chaud au corps
que l’ôtti>dut échanffér :-ainfl ufl charbon bleu alitt-:
nié paroîtra rouge dé tous côtés, fondra la ciré Sc
alhimera du (batte quelque part qu‘on i’appiiiiuï,
■ D