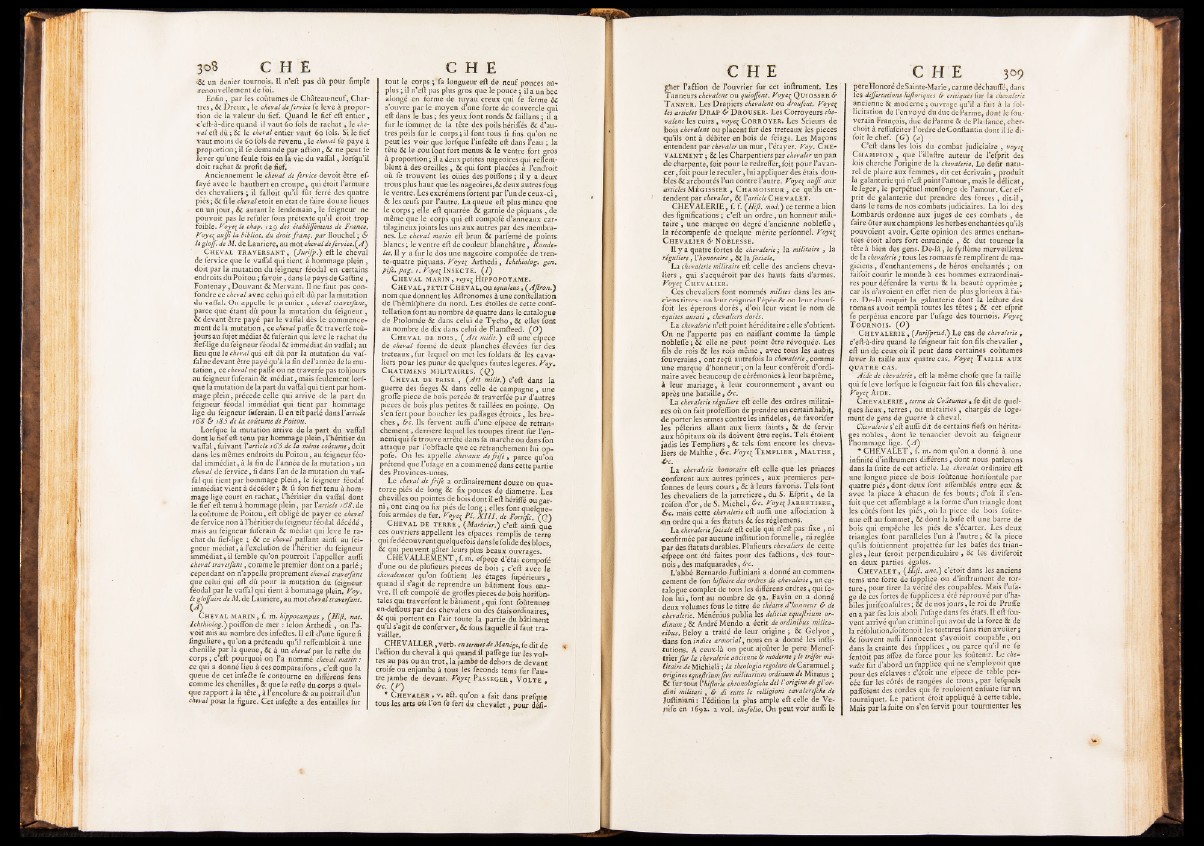
<8c un denier tournois. Il n’eft pas dû pour fimple
^renouvellement de foi.
Enfin, par les coutumes de Château-neuf, Chartres
, 8c D reux, le cheval de fervice fe leve à proportion
de la valeur du fief. Quand le fief eft entier ,
<’eft-à-dire-quand il vaut ■ 60 fols de rachat , le cheval
eft dû ; 8c le cheval entier vaut 60 fols. Si le fief
vaut moins de 60 fols de revenu, le cheval fe paye à
proportion ; il fe demande par aâion, 8c ne peut fe
lever qu’une feule fois en la vie du vafla l, lorfqu’il
doit rachat & profit de fief.
Anciennement le cheval de fervice devoit être ef-
fayé avec le hautbert en croupe, qui étoit l’armure
des chevaliers ; il falloit qu’il fût ferré des quatre
piés ; 8c fi le cheval etoit en état de faire douze lieues
en un jour, 8c autant le lendemain, le feigneur ne
pouvoit pas le refufer fous prétexte qu’il étoit trop
foible. Voyc{ le chap. 12g des établiffemens de France.
Vyyeç aufji la bibliot. du droit franç. par Bouchel ; &
lt gloff. de M. de Lauriere, au mot cheval defervice.(A)
C h e v a l t r a v e r s a n t , ( Jurifp.) eft le cheval
de fervice que le vaflal qui tient à hommage plein,
doit par la mutation du ieigneur féodal en certains
endroits du Poitou ; favoir, dans le pays de Gaftine,
Fontenay, Douvant 8c Mervant. Il ne faut pas confondre
ce cheval avec celui qui eft dû par la mutation
du vaflal. On appelle le premier , cheval traverfant,
parce que étant dû pour la mutation du feigneur ,
8c devant être payé par le vaflal dès le commencement
de la mutation, ce cheval pafle 8c traverfe toû-
jours au fujet médiat 8c fuferain qui leve le rachat du
fief-lige du feigneur féodal 8c immédiat du vaflal ; au
lieu que le cheval qui eft dû par la mutation du vaf-
fal ne devant être payé qu’à la fin de l’année de la mutation,
ce cheval ne pafle ou ne traverfe pas toujours
au feigneur fuferain 8c médiat, mais feulement lorf-
que la mutation de la part du vaflal qui tient par hommage
plein, précédé celle qui arrive de la part du
feigneur féodal immédiat qui tient par hommage
lige du feigneur fiiferain. Il en eft parlé dans Y article
168 & 18S de la coutume de Poitou.
Lorfque la mutation arrive de la part du vaflal
dont le nef eft tenu par hommage plein, l’héritier du
v afla l, fuivant l'article 1 6S de la meme coutume, doit
dans les mêmes endroits du Poitou, au feigneur féodal
immédiat, à la fin de l’année de la mutation > un
cheval de fervice, fi dans l’an de la mutation du vaf-
fal qui tient par hommage plein, le feigneur féodal
immédiat vient à décéder ; & fi fon fief tenu à hommage
lige court en rachat, l’héritier du vaflal dont
le fief eft tenu à hommage plein, par l'article 168. de
la coûtume de Poitou, eft obligé de payer ce cheval
de fervice non à l’héritier du feigneur féodal décédé,
mais au feigneur fuferain 8c médiat qui leve le rachat
du fief-lige ; & ce cheval paflant ainli au feigneur
médiat, à l’exclufion de l’héritier du feigneur
immédiat, il femble qu’on pourroit l’appeller aufli
cheval traverfant, comme le premier dont on a parlé ;
cependant on n’appelle proprement cheval traverfant
que celui qui eft dû pour la mutation du feigneur
féodal par le vaflal qui tient à hommage plein. Voy.
le gloffaire de M. de Lauriere, au mot cheval traverfant.
C h e v a l m a r in , f. m. hippocampus, (Hift. nat.
Ichthiolog.) poiflon de mer : félon Arthedi , on l’a-
voit mis au nombre des infeftes. Il eft d’une figure fi
finguliere , qu’on a prétendu qu’il reflembloit à une
chenille par la queue, 6c à un cheval par le refte du
corps ; c’eft pourquoi on l’a nommé cheval marin :
ce qui a donné lieu à ces comparaifons, c’eft que la
queue de cet infe&e fe contourne en différens fens
comme les chenilles, & que le refte du corps a quelque
rapport à la tête, à l’encolure & au poitrail d’un
cheval pour la figure. Cet infe.ûe a des entailles fur
tout le corps ;Ta longueur eft de neuf pouces au*
plus ; il n’eft pas plus gros que le pouce ; il a un bec
alongé en forme de tuyau creux qui fe ferme 8c
s’ouvre par le moyen d’une forte de couvercle qui
eft dans le bas ; fes yeux font ronds 6c faillans ; il a
fur le (ommet de la tête des poils hérifîes 6c d’autres
poils fur le corps ; il font tous fi fins qu’on ne
peut les voir que lorfque l’infe&e eft dans l’eau ; la
tête 6c le cou font fort menus & le ventre fort gros
à proportion ; il a deux petites nageoires qui reflem-
blent à des oreilles , 8c qui font placées à l’endroit
où fe trouvent les oiiies des poiflons ; il y a deux
trous plus haut que les nageoires,6c deux autres fous
le ventre. Les excrémens fortent par l’un de ceux-ci,
8c les oeufs par l’autre. La queue eft plus mince que
le corps ; elle eft quarrée 6c garnie de piquans, de
même que le corps qui eft compofé d’anneaux cartilagineux
joints les uns aux autres par des membranes.
Le cheval marin eft brun 8c parfemé de points
blancs ; le ventre eft de couleur blanchâtre, Rondelet.
Il y a fur le dos une nageoire compofée de trente
quatre piquans. Voye[ Arthedi, Ichthiolog. gen.
pifc. pag. 1. Vqye{ INSECTE. (/)
C hev al marin , vqye^ Hip po po tam e .
C h e v a l , p e t it C h e v a l , ou equuleus, ( Aftron.)
nom que donnent les Aftronomes à une conftellation
de l’hémifphere du nord. Les étoiles de cette conftellation
font au nombre de quatre dans le catalogue
de Ptolomée 6c dans celui de Ty ch o , 8c elles lont
au nombre de dix dans celui de Flamfteed. (O )
C heval de bo is , ( Art milit.) eft une elpece
de cheval formé de deux planches élevées fur des
tréteaux, fur lequel on met les foldats 8c les cavaliers
pour les punir de quelques fautes Iegeres. Voy.
C hatimens m il it a ir e s . (Q)
C heval de frise , (Art milité) c’eft dans la
guerre des fieges 6c dans celle de campagne , une
grofle piece de bois percée 8t traverfée par d’autres
pièces de bois plus petites 8c taillées en pointe. On
s’en fert pour boucher les paflages étroits, les brèches
, &c. Ils fervent aufli d’une efpece de retranchement
, derrière lequel les troupes tirent fur l’ennemi
qui fe trouve arrêté dans fa marche ou dans fon
attaque par l’obftacle que ce retranchement lui op-
pofe. On les appelle chevaux de frife , parce qu’on
prétend que l’ulage en a commencé dans cette partie
des Provinces-unies.
Le cheval de frife a ordinairement douze ou quatorze
piés de long 6c fix pouces de diamètre. Les
chevilles ou pointes de bois dont il eft hérifle ou garn
i, ont cinq ou fix piés de long ; elles font quelquefois
armées de fer. Voye^ PI. X I I I . de Fortifie. (Q )
C heval de terre , (Marbrier.') c’eft ainfi que
ces ouvriers appellent les efpaces remplis de terre
qui fe découvrent quelquefois danslefolidedes blocs,
6c qui peuvent gâter leurs plus beaux ouvrages. B CHEVALLEMENT, f. m. efpeçe d’étai compofé
d’une ou de plufieurs pièces de bois ; c’eft avec le
chevalement qu’on foûtient les étages fupérieurs
quand il s’agit de reprendre un bâtiment fous oeuvre.
Il eft compofé de greffes pièces de bois horifon-
tales qui traverfent le bâtiment, qui font foûtenues
en-deflous par des chevalets ou des étais ordinaires,
6c qui portent en l’air toute la partie du bâtiment
qu’il s’agit de conferver, 6c fous laquelle il faut travailler.
CHEVALLER, verb. en termes de Manège, fe dit de
l’a&ion du cheval à qui quand il paffege fur les vol-
tes au pas ou au trot, la jambe de dehors de devant
croife ou enjambe à tous les féconds tems fur l’autre
jambe de devant. Voyez Passeger , V o lte
* C hevaler j v 4 aft. qu’on a fait dans prefque
tous les arts où l’on fe fert du chevalet, pour défigher
Paftion de l’ouvrier fur cet infiniment. Les
Tanneurs chevalent ou quiojfent. Voye%_ Q u i O S S E R &
T anner. Les Drapiers chevalent ou droufent. Voye%_
les articles D rap 6* D rouser. Les Corroyeurs chevalent
les cuirs, voye[ C orroyer. Les Scieurs de
bois chevalent ou placent fur des tréteaux les pièces
qu’ils ont à débiter en bois de feiage. Les Maçons
entendent par chevaler un mur, l’étayer. Voy. C hevalement
; 6c les Charpentiers par chevaler un pan
de charpente, foit pour le redreffer, foit pour l’avancer
, foit pour le reculer, lui appliquer des étais doubles
6c areboutés l’un contre l’autre. Voye^ aufji aux
articles MÈGissier , C hamoiseur , ce qu’ils entendent
par chevaler, 6c Varticle C h e v a l e t .
CHEVALERIE, f. f. (Hift. mod.) ce terme a bien
des lignifications ; c’eft un ordre, un honneur militaire
, une marque ou degré d’ancienne noblefle,
la récompenfe de quelque mérite perfonnel. Voye£
C hevalier & Noblesse.
Il y a quatre fortes de chevalerie ; la militaire > la
reguliere, l’honoraire , 6c la fociale.
La chevalerie militaire eft celle des anciens chevaliers
, qui s’acquéroit par des hauts faits d’armes.
Voye1 C hevalier.
Ces chevaliers font nommés milites dans les anciens
titres : on leur ceignoit l’épée 6c on leur chauf-
foit les éperons dorés, d’où leur vient le nom de
1équités aurati , chevaliers dorés.
La chevalerie n’eft point héréditaire : elle s’obtient.
On ne l’apporte pas en naiflant comme la fimple
noblefle ; 8c elle ne peut point être révoquée. Les
fils de rois 6c les rois même , avec tous les autres
fouverains, ont reçû autrefois la chevalerie, comme
une marque d’honneur ; on la leur conféroit d’ordinaire
avec beaucoup de cérémonies à leur baptême,
à leur mariage, à leur couronnement, avant ou
après une bataille , &c.
La chevalerie régulière eft celle des ordres militaires
où on fait profeflion de prendre un certain habit,
de porter les armes contre les infidèles, de favorifer :
les pèlerins allant aux lieux faints, 8t de fervir
aux hôpitaux où ils doivent être reçûs. Tels étoient
jadis les Templiers, 8c tels font encore les chevaliers
de Malthe, &c. Voye{ T emplier , Ma l th e ,
4rc. ' \ '■ ‘lr -■ • -
La chevalerie honoraire eft celle que les princes
confèrent aux autres princes, aux premières per-
fonnes de leurs cours, 6c à leurs favoris. Tels lont
les chevaliers de la jarretière, du S. Efprit, de la
îoifon d’o r ,d e S. Michel, &c. Voye^ Ja r r e t ièr e ,
pfc. mais cette chevalerie eft aufli une aflbciation à
,nn ordre qui a fes ftatuts 8c fes réglemens.
La chevalerie fociale eft celle qui n’eft pas fixe , ni
confirmée par aucune inftitution formelle, ni réglée
par des ftatuts durables. Plufieurs chevaliers de cette
•efpece ont été faites pour des factions, des tournois
, des mafquarades, &c.
L’abbé Bernardo Juftiniani a donne au commencement
de fon hiftoire des ordres de chevalerie, un catalogue
complet de tous les différens ordres, qui félon
lui, font au nombre de 92.;Favin en a donné
deux volumes fous le titre de théâtre d'honneur & de
chevalerie. Ménénius publia les delicice equeftrium or-
dinum; 8c André Mendo a écrit «/« ordinibus milita-
ribus. Beloy a traité de leur origine ; 6c G e ly o t ,
dans fon indice armorial, nous en a donné les infti-
tutions. A ceux-là on peut ajoûter le pere Menef-
trier fur la chevalerie ancienne & moderne ; le tréfor militaire
de Michieli ; la theologia regolare de Caramuel ;
origines tquejlriumfive militarium otdinum de Mirsus j
6C fur-tout l'hiftorie chronologiche del l'origine de gl'or-
dini militari , & di tutte le relligioni cavalerefche de
Juftiniani : l’édition la plus ample eft celle de Ve-
^ife en 1692. 2 vol. in-folio. On peut voir aufli le
père Honoré deSainte-Marie, carme déchaufle, dans
fes dijfertations hifioriques & critiques fur la chevalerie
ancienne 8c moderne ; ouvrage qu’il a fait à la fol-
licitation de l’envoyé du duc de Parme, dont le fou-
verain François, duc de Parme & de Plaifance, cher-
choit à reflufeiter l’ordre de Conftantin dont il fe di-
foit le chef. (G ) (a)
C ’eft dans les lois du combat judiciaire , voyt?
C hampion , que i’illuftre auteur de l’efprit des
lois cherche l’origine de la chevalerie. Le défit naturel
de plaire aux femmes , dit cet écrivain , produit
la galanterie qui n’eft point l’amour, mais le délicat,
le leger, le perpétuel menfonge de l’amour. Cet efprit
de galanterie dut prendre des forces , dit-il,
dans le tems de nos combats judiciaires. La loi des
Lombards ordonne aux juges de ces combats , de
faire ôter aux champions les herbes enchantées qu’ils
pouvoient avoir. Cette opinion des armes enchantées
étoit alors fort enracinée , & dut tourner la
tête à bien des gens. De-Ià, le fyftème merveilleux
de la chevalerie ; tous les romans le remplirent de magiciens
, d’enchantemens, de héros enchantés ; on
faifoit courir le monde à ces hommes extraordinaires
pour défendre la vertu 6c la beauté opprimée ;
car ils n’avoient en effet rien de plus glorieux à faire.
De-là naquit la galanterie dont la leéture des
romans avoit rempli toutes les têtes ; & cet efprit
fe perpétua encore par l’ufage des tournois. Voye^
T o urn ois. (O )
C hev alerie , (Jurifprud.) Le cas de chevalerie,
c’eft-à-dire quand le feigneur fait fon fils chevalier,
eft un de ceux où il peut dans certaines coûtumes
lever la taille aux quatre cas. Voyeç T a ille aux
q u a tr e c a s .
Aide de chevalerie, eft la même chofe que la taille
qui fe leve lorfque le feigneur fait fon fils chevalier.
Voyt%_ Aid e.
C hevalerie , terme de Coutumes , i e dit de quelques
lieux, terres, ou métairies , chargés de logement
de gens de guerre à cheval.
Chevalerie s’eft aufli dit de certains fiefs ou héritages
nobles, dont le tenancier devoit au feigneur
l’hommage lige. (Al)
* CHEVALET, f. m. nom qu’on a donné à une
infinité d’inftrumens différens, dont nous parlerons
dans la fuite de cet article. Le chevalet ordinaire eft
une longue piece de bois, foûtenue horifontale par
quatre piés, dont deux font aflemblés entre eux 8c
avec la piece à chacun de fes bouts; d’où il s’enfuit
que cet aflemblage a la forme d’un triangle dont
les côtés font les piés, où la piece de bois foûtenue
eft au fommet, 6c dont la bafe eft une barre de
bois qui empêche les piés de s’écarter. Les deux
triangles font parallèles l’un à l’autre ; 6c la piece
qu’ils foûtiennent projettée fur les bafes des triangles
, leur feroit perpendiculaire , 6c les diviferoit
en deux parties égales.
C hev alet , (Hift. anc.) c’étoit dans les anciens
tems une forte de fupplice ou d’inftrument de torture
, pour tirer la vérité des coupables. Mais I’ufa-
ge de ces fortes de fupplices a été réprouvé par d’habiles
jurifconfultes ; 6c de nos jours, le roi de Prufie
en a par fes lois aboli l’ufage dans fes états. Il eft fou-
vent arrivé qu’un criminel qui avoit de la force 8c de
la réfolution,foûtenoit les tortures fans rien avouer ;
6c fouvent aufli l’innocent s’avoiioit coupable, ou
dans la crainte des fupplices , ou parce qu’il ne fe
fentoit pas allez de force pour les foûtenir. Le chevalet
fut d’abord un fupplice qui ne s’employoit que
pour des efclaves : c’étoit une efpece de table percée
fur les côtés de rangées de trous, par lefquels
paffoient des cordes qui fe rouloient enfuit e fur un
tourniquet. Le patient étoit appliqué à cette table.
Mais par la fuite on s’en fer vit pour tourmenter les