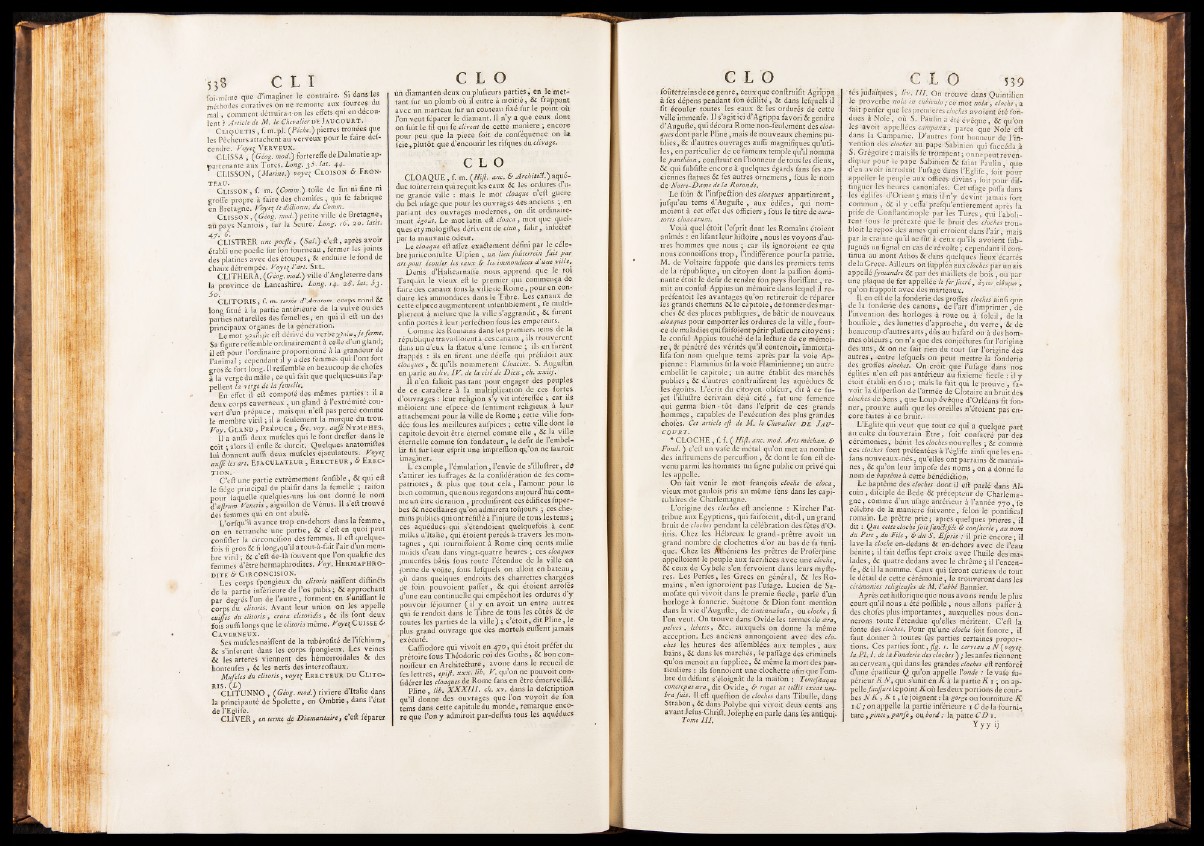
53^ . . ,
foi-même que d’imaginer le contraire. Si dans les
ftiéthodes curatives on ne remonte aux fources du
mal, comment détruira-t-on les effets qui en découlent
? Article de M. le Chevalier OV. JAUCOURT.
C lique tis , f. m .p\. (Pèche.) pierres trouees que
les Pêcheurs attachent au verveux pour le .faire- def-
cendre. Voye^ V erVeux. ' ;
GLISSA , ( Géog. mod.) fortereffedeDalmatie ap-
«partenante aux Turcs. Long. lat. 44*
CLISSON, (Marine.) voye[ CLOISON & FRONTEAU.
. - .
C lisson , f. m. (Comm.)-toue de lin ni fine ni
groffe propre à faire des chemifes , qui fe fabrique
en Bretagne. Voye^ le diclionn.du Comm.
C lisson , (Géog. inod.) petite v ille de Bretagne,
aù pays Nantois, fur la Seure. Long. 1C.20. latit.
4J$ 6V; " v ) } ■ - ' ■ i'i ^
CLISTRER une poejle, (Sal.) c’e ft , apres avoir
établi une poefle fur fon fourneau, fermer les joints
des platines avec des étoupes * & enduire le fond de
chaux détrempée. Voye^l'art. Sel.
ÇLITHERA, (Géog. moi.) ville d’Angleterre dans
la province de Lancashire. Long. 14. 28. lot. 53.
60. ■ '%
CLITORIS, f. m. terme d'Anatom.corps rond 6C
long fitué à la partie antérieure de la vulve ou des
parties naturelles des femelles , en qui il eft un des
principaux organes de la génération. :
Le mot %Xe/]opk eft dérivé du verbe je,ferme.
Sa figure reffemble ordinairement à celle d’un gland;
il eft pour l’ordinaire proportionné à la grandeur de
l ’aniffial ; cependant il y a des femmes qui-l’ont fort
gros & fort long. Il reffemble en beaucoup de chofes
à la verge du mâle * ce qui fait que quelques-uns l’appellent
la verge de la femelle. ^ '
En effet il eft compofé des mêmes parties : il a
deux corps caverneux, un gland à l’extrémité Couvert
d’un prépuce, mais qui n’eft pas percé comme
le membre viril ; il a feulement la marque du trou.
Voÿ. Gl a n d , Pr é pu c e , & c. voy. aujjiNym ph e s ;
Il a auffi deux mufcles qui le font dreffer dans le
coït ; alors il enfle 6c durcit. Quelques anatomiftes
lui donnent aufli deux mufcles éjaculateurs. Voy ci
auffi les art. Eja cu la teu r , ERECTEUR, & Erec-
T c ï f t une partie extrêmement fenfible, & qui eft
le fiége principal du plaifir dans la femelle ; raifon
pour laquelle quelques-uns lui ont donné le nom
A'afirum Veneris, aiguillon de Vénus. Il s’eft trouvé
des femmes qui en ont abufe.
L’orfqu’il avance trop en-dehors dans la femme,
on en retranche une partie, & c’eft en quoi peut
confifter la circoncifion des femmes. Il eft quelquefois
fi gros 6c fi long,qu’il atout-à-fait l’air d’un membre
viril ; 6c c’eft de-là fouvent que l’on qualifie des
femmes d’être hermaphrodites. Voy. Hermaphrod
it e & C ir c o n c is io n . . . . ,n.
Les corps fpongieux du clitoris naiffent diftmfts
de ia partie inférieure de l’os pubis ; 6c approchant
par degrés l’un de l’autre, forment en s’unifiant le
corps du clitoris. Avant leur union on les appelle
cuiffes du clitoris- , crura- clitoridis, 6c ils font deux
fois aufli longs que le clitoris même. Voye{C\nssh&
C a vern eu x. ,
Ses mufcles naiffent de la tuberolite de I îlchium,
& s’inferent dans les corps fpongieux. Les veines
& les arteres viennent des hémorroïdales & des
honteufes , 6c les nerfs des intercoftaux.
Mufcles du clitoris, voye^ Erec teur DU C lito -
R IS . (L)
CLITUNNO , (Géog. mod.) rivtere d Italie dans
la principauté de Spolette, en Ombrie, dans l’etat
de l’Eglife. .
CLIVER, en terme de Diamantaire, c eft feparer
itn diamant en deux ouplufieurs partiés, en le mettant
fur un plomb où il entre à moitié, 6c frappant
avec un marteau fur un couteau fixé lïir le point où
l’on veut féparer le diamant. Il n’y a que ceux dont
on fuit le fil qui fe clivent de cette maniéré ; encore
pour peu que la piece foit de confequence on la
lc ie , plutôt, que d’encourir les rifques du clivage.
C L O
CLO AQU E, f. m. (Hijl. anc. & Architecte aqueduc
loûterrein qui reçoit l.es eaux 6c les ordures d’une
grande ville : mais le mot cloaque n eft guere
du bel ufagè que pour les ouvrages des anciens ; en
pariant des ouvrages modernes, on dit ordinairement
égout. Le mot latin eft cloaca, mot que quelques
çtyinologiftes dérivent de duo, falir, infe&et
par fa mauvaile odeur,
Le cloaque eft affez exactement défini par le célébré
juritconfulte Ulpien ,u n lieu foûterrein fait par
art pour écouler- les eaux b les immondices d'une ville,
Denis d’Halicarnaffe nous, apprend que le roi
Tarquin le vieux eft. le premier qui commença de
faire des canaux fous la ville de Rome, pour en conduire
les immondices dans le Tibre. Les canaux de
cette efpece augmentèrent inlénfiblement, fe multi-
I plièrent à.melure'que la ville s’aggrandit, 6c furent
enfin portés à leur perfection fous les empereurs.
Comme les Romains dans les premiers tems de la
république travailloient à ces canaux , ils trouvèrent
dans un d’eux la ftatue d’une femme ; ils en furent
frappés : ils en firent une déeffe qui préfidoit aux
cloaques y & qu’ils nommererit Cloacine. S. Auguftin
en parle au liv. IV. de la cité de Dieu , ch. x x iij. 1
Il n’en falioit pas tant pour engager des peuples
de ce caraCtere à la multiplication de ce$ fortes
d’ouvrages : leur religion s’y v it intéreffée ; car ils
mêloient une efpece de fentiment religieux à leur
attachement pour la v ille de Rome ; cette ville fondée
fous les meilleures aufpices ; cette ville dont le
capitole devoit être éternel comme elle , & la ville
éternelle comme fon fondateur , le defir de l’embellir
fit-fur leur efprit une impreffion qç’on ne lauroit
imaginer,
L exemple, l’émulation, l’envie de s’illuftrer, dô
s’attirer les luffrages 6c la confidération de fes compatriotes
, & plus que tout ce la , l’amour pour le
bien commun, que nous regardons aujourd’hui comme
un être de ration ,produifirent ces édifices fuper-
bes 6c néçeflaires qu’on admirera toujours ; ces chemins
publics qui ont réfifté à l’injure de tous les tems ;
ces aquéducs qui s’étendoient quelquefois à cent
milles d’Italie, qui étoient percés à-travers les montagnes
, qui lourniffoient à Rome cinq cents mille
muids d’eau dans vingt-quatre heures’; ces cloaques
immenles bâtis fous toute l’étendue de la ville en
forme de voûte, fous lefquels on alloit en bateau,
où dans quelques endroits des charrettes chargées
de foin pouvoient paffer, 6c qui étoient arrofes
d’une eau continuelle qui empêchoit les ordures d y
pouvoir féjourner ( il y en avoit un entre autres
qui fe rendoit dans le T ibre de tous les cotés 6c de
toutes les parties de la ville) ; c’étoit, dit Pline, le
plus grand ouvrage que des mortels euffent jamais
exécuté. . , . ,
Cafliodôre qui vivoit en 470, qui etoit pretet du
prétoire fous Théodoric roi des Goths, 6c bon con-
noiffeur en A rchiteaure, avoue dans le recueil de
fes lettres, epift. xxx. lib. V. qu’on ne pouvoit con-
fidérer les cloaques de Rome fans en être émerveillé.
Pline Hb, X X X I I I . ch. xv. dans la defeription
qu’il donne des ouvrages que l’on voyoit de fon
tems dans cette capitale du monde, remarque encore
que l’on y admiroit par-deffus tous les aquéducs
foûtefreins de ce genre, ceux que conftruifit Agrippa. .
à fes dépens pendant fon édilité, & dans lefquels il
fit écouler toutes les eaux & les ordures de cette
ville immenfe. Il s’agit ici d’Agrippa favori & gendre
d’Augufte, qui décora Rome non-feulement des cloaques
dont parle Plinè ,mais de nouveaux chemins publics
, 6c d’autres ouvrages aufli magnifiques qu’utiles,
en particulier de ce fàmeux temple qu’il nomma
le panthéon, conftruit en l’honneur de tous les dieux,
6c qui fubfifte encore à quelques égards fans fes anciennes
ftajues 6c fes autres ornemens, fous le nom
dt-Notre-Dame de la Rotonde.
Le foin & l’infpe&ion dès cloaques appartinrent,
jufqu’au tems d’Àugufte , aux édiles, qui noni-
moient à cet effet des officiers, fôlis le titre de cura-
tores cloacârùm.
Voilà quel étoit l’efprit dont les Romains étoient
animés : en lifantleur hiftoire, nous les voyonis d’autres
hommes que nous ; car ils ignoroient ce que
nous connoiffons trop, l’indifférence pour la patrie.
M. de Voltaire fuppofe que dans les premiers tems
de la république * un citoyen dont la paflion dominante
étoit le defir de rendre fon pays floriffant, remit
au conful Appius un mémoire dans lequel il re-
préfentoit les avantages qu’on retireroit de réparer
les grands chemins 6c le capitole, de former des marchés
6c des places publiques, de bâtir de nouveaux
cloaques pour emporter les ordures de la v ille , four-
ce de maladies qui faifoient périr plufieurs citoyens :
le conful Appius touché dé la leâure de ce mémoir
e , & pénétré des vérités qu’il contenoit, immorta-
lifa fon nom quelque tems après par la voie Ap-
pienne : Flaminius fit la voie Flaminienne ; un autre
embellit le capitole ; un autre établit’ dès marchés
publics ; & d’autres conftruifirent les aquéducs 6c
les égouts. L’écrit du citoyen'obfcur, dit à ce fu-
jet l’illuftre écrivain déjà cité , fut une femence
qui germa bien - tôt - dans l’efprit de • ces ’ grands
hommes, capables de l’exécution des plus grandes
chofes. Cet article efi de M. le-Chevalier DE Ja u -
COVRT.
* CLOCHE , f. f . ( Hiß. dnc. mod. Arts mèckan. &
Fond. ) c’eft un vafe de métal qu’on met au nombre
des inftrumens de pereuflion , 6c dont le fon eft devenu
parmi les hommes un ligne public ou privé qui
les appelle.
On fait venir le mot françois cloche de cloca,
vieux mot gaulois pris au même fens dans les capitulaires
de Charlemagne.
L’origine des cloches eft ancienne : Kircher l’attribue
aux Egyptiens, qui faifoient, dit-il, un grand
bruit de cloches pendant la célébration des fêtes d’O-
firis. Chez les Hébreux- le grand-prêtre avoit un
grand nombre de clochettes d’or au bas de fa tunique.
Chez les Athéniens les prêtres de Proferpine
appelloient le peuple aux facrifices avec une cloche,
& ceux de Cybele s’en fervoient dans leurs myfte-
res. Les Perles, les Grecs en général, 6c les Romains
, n’en ignoroient pas l’ulage. Lucien de Sa-
mofate qui vivoit dans le premie fiecle, parle d’un
horloge à fonnerie. Suétone & Dion font mention
dans la v ie d’Augufte, de tintinnabula, ou cloche, fi
l’on veut. On trouve dans Ovide les termes de ara,
pelves , lebetes, &c.’,' auxquels on donne la même
acception. Les anciens annonçoient avec des cloches
les heures des affemblées aux temples ; aux
bains, 6c dans les marchés, le paffage des criminels
qu’on menoit au fupplice, 6c même la mort des particuliers
: ils fonnoient une clochette afin que l’ombre
du défunt s’éloignât de la maifon : Temefoeaque
concrepat fera, dit Ovide, & rogdt ut teclis exeat um-
brafuis. Il eft queftion de cloches dans Tibulle, dans
Strabon, 6c dans Polybe qui vivoit deux cents ans
avant Jefus-Chrift, Jofephe en parle dans fes antiqui-
Tome III.
tes judaïques, liv. m . On trouve dans Quinrilien
le proverbe nota in cùbïcuLo; ce mot nota, cloche, a
fait -penfer que les premières cloches avoient été fondues
à Noie, où S. Paulin a été évêque, & qu’on
les-avoit appellées campante„ parce que Nolé éft
dans la Campanie. D ’autres font honneur de l ’invention
d es ’cloches au pape 'Sabinien qui fuccéda .à
S . Grégoire : mais ils fe trompent ; on ne peut revendiquer
pour le pape Sabinien 6c faint Paulin, que
d’en avoir introduit l’ufage'dans l’Eglife, foit pour
appeller le peuple aux offices-divins, foit pour dif-
tinguer-les heures canoniales. Cet ufage paffa dans
les églifès- d’Orient ; mais il n’y devint jamais fort
commun , 6c il y cefla prefqu’entierement après ia
prife de-Conftantinople par les Turcs, qui l’aboli-
rent fous le prétexte qué le bruit des cloches trou-
bloit le repos des âmes qui erroient dans l’air, mais
par la crainte qu’il ne fût à ceux qu’ils avoient fub-
jugués un lignai en cas dé révolte ; cependantïl continua
au mont Athos & dans quelques lieux écartés
de la Grece. Ailleurs oh fuppléà aux cloches pat un ais
appellèfymandre 6c par dés maillets de bois, ou par
une plaque de fer appel! éèïeferfacré, iyiàvfiPnpcov,
qu’on frappoit avec des marteaux.
Il en elt de la fonderie desgroffes cloches ainfi que
de la fonderie des canons, .de l’art d’imprimer, de
l’invention des horloges à roue ou à foleil , de là
bouffole, des lunettes d’àpprbehe, du verre, &, de
beaucoup d’autres arts, dûs au hafard ou à des hom-
mes. obfcurs on n’a que des conjeélures fur l’origine
des uns, & on ne fait rien du tout fur l’origine des
autres, entre lefquels on peut mettre la fonderie
des groffes •cloches. On croit que l’ufage dans nos
égliies n’en eft pas antérieur au fixieme, fiecle.: il y
etoit établi en 610 ; mais le fait qui le-prouve , fa-
voir la difperfion de l’armée dé Clotaire au bruit des
clochesAe Sens , que Loup évêque d’Orléans fit fon-
ner, prouve aufli que les oreilles n’étoient pas encore
imites à ce bruit. -
L!Eglife qui veut que tout cé qui a quelque part
au culte du fouverain Être, foit eonfaefé par des
cérémonies, bénit lesé/oeAesnouvelles ; 6c comme
ces cloches font prefentées à l’églife ainfi quë les en-
fans nouveaux-nés, qu’elles ont parrains & marraines
, 6c qu’on leur impofe des nomis, on a donné le
nom de baptême à cette bénédi&'iont
Le baptême des cloches dont il eft parlé dans Alcuin
, difciple de Bede 6c précepteur de Charlemagne,
comme d’un ufage antérieur à l’année 770 , fé
célébré de la maniéré fuivante, félon le pontifical
romain. Le prêtre prie; après quelques prières, il
dit : Que cette cloche foit fanctifiée & confacrée , au nom
du Pere, du Fils , & du S . Efprit : il prié encore ; H
lave la cloche en-dedans & en-dehors avec de l’eau
bénite; il fait deffus fept croix avec l’huile dësfmalades
, 6c quatre dedans avec le chrême ; il l’encen-
f e , 6c il la nomme. Ceux qui feront curieux de tout
le détail de cette cérémonie, le trouveront dans les
cérémonies religieufes de M. l'abbé Bannier.
Après cet hiftorique que nous avons rendu le plits
court qu’il nous a: été poflible, nous allons paffer à
des chofes plus importantes, auxquelles nous donnerons
toute l’étendue qu’elles méritent. C ’eft la
fonte des cloches. Pour qu’une cloche foit fonore, il
faut donner à toutes fes parties certaines proportions.
Ces parties font ,fig. 1. le cerveau a N (voyez.
la PI. I. de la Fonderie des cloches ) ; les anfes tiennent
au cerveau, qui dans les grandes cloches eft renforci
d’une épaiffeur Q qu’on appelle Y onde : le vafe fu-
périeur K N , qui s’unit en À à la partie K 1 ; on appelle
fauffure le point K où les deux portions de courbes
N K , K 1 , fe joignent : la gorge ou fourniture K
1 C ; on appelle la partie inférieure 1 C de la fourniture,
pince ypanfe 9 ou bord ; la, patte C D 1.
Y y y ij