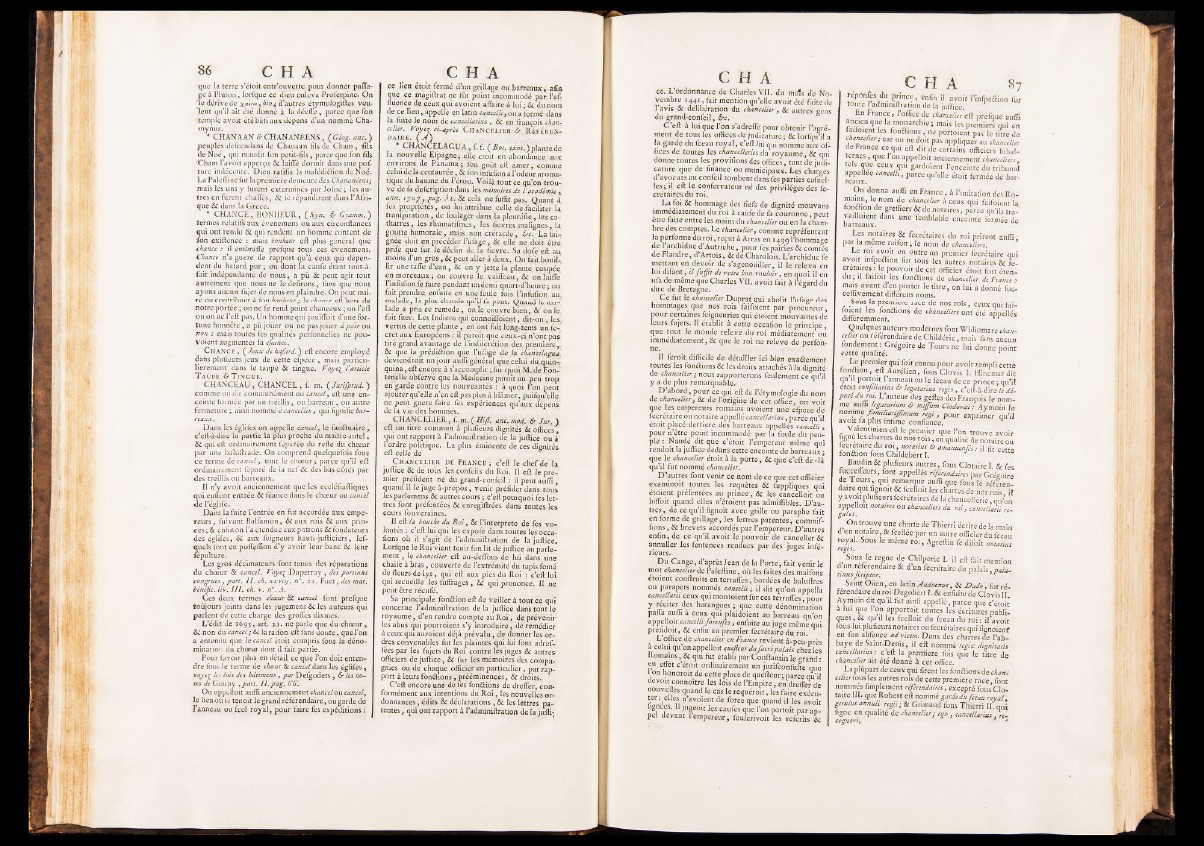
que la terre s’étoit entr’ouverte pour donner pacage
à Pluton, lorfque ce dieu enleva Proferpine. On
ï e dérive de x aim > ^l0S d’autres étymologiftes veulent
qu’il ait été donné à la déeffe, parce que fon
Ctcmple avoit été bâti aux dépens d’un nommé Cha-
jmynus.
* CHANAAN & CHANANÉENS, (Géog. anc.)
peuples defcendans de Chanaan fils de Çham , fils
de Noé, qui maudit fon petit-fils, parce que fon fils
th am Favoit apperçu & laiffé dormir dans une pof-
ture indécente. Dieu ratifia la malédiérion de Noé-.
La Paleftine fut la première demeure des Chananéens;
mais les uns y furent exterminés par Jofué ; les .autres
en furent chaffés, & fe répandirent dans l ’Afrique
& dans la Grece.
* CHANCE, BONHEUR, (Syn. & Gramm.')
termes relatifs aux événements ou aux circonftances
qui ont rendu & qui rendent un homme content de
ion exi'ftence : mais bonheur eft .plus général que
chance : il embraffe prefque tous ces ë-venemens.
Chance n’a guere de rapport qu’à ceux qui dépendent
du ha fard pur ; ou dont la caufe étant tout-à-
fait indépendante de nous, a pu & peut agir tout
autrement que nous ne le délirons , fans que nous
ayons aucun fujet de nous'en plaindre. On peut nuire
ou contribuer à fon bonheur ; la chance eft hors de
notre portée ; on ne fe rend point chanceux ; on l’eft
ou on ne Peft pas. Un homme qui jouiffoit d’une fortune
honnête , a pu jouer ou ne pas joiier à pair ou
non : mais toutes fes qualités perfonnelles ne pou-
.voient augmenter fa chance.
C hance , ( Jeux de hafard.y eft encore employé
dans plufieurs jeux de cette elpece , mais particiir
lierement dans le taupe & tingue. Voye^ Varticle
T aupe & T ingue.
CHANCEAU, CH ANCEL, f. m. Qurifp'rudè)
comme on dit communément ou cancel, eft une enceinte
formée par un treillis, ou barreau , ou autre
fermeture ; ainli nommé à cancellis , qui lignifie barreaux.
Dans les églifes on appelle, cancel, le fanftuaire,
c’eft-à-dire la partie la plus proche du maître-autel,
& qui eft ordinairement féparée du refte du choeur
par une baluftrade. On comprend quelquefois fous
ce terme de cancel, tout le choeur ; parce qu’il eft
ordinairement féparé de la nef & des bas côtés par
des treillis ou barreaux,
ÎI n’y avoit anciennement que les eccléfiaftiques
qui euffent entrée & féance dans le choeur ou cancel
de l’églife.
Dans la fuite l’entrée en fut accordée aux empereurs
, fuivant Balfamon, & aux rois & aux princes
; & enfin on l’a étendue aux patrons & fondateurs
des églifes, & aux feigneurs hauts-jufticiers, lef-
quels font en poffeflion d’y avoir leur banc & leur
fépulture.
Les gros décimateurs font tenus des réparations
du choeur & cancel. Voye^ Duperray, des portions
congrues f part. I I . ch. x x v iij.n 0. z z . Fuet, des mat.
bénéfic. liv. II I . ch. v. n°. à.
Ces deux termes choeur & cancel font prefque
toujours joints dans les jugemens & les auteurs qui
parlent de cette charge des grolfes dixmes. .
L’édit de 1695, art< 11 • ne Parle que du choeur,
& non du cancel; &. laraifon eft fans cloute, que l’on
a entendu que le cancel étoit compris fous la dénomination
du choeur dont il fait partie.
Pour favoir plus en détail ce que l’on doit entendre
fous le terme de choeur & cancel dans les églifes ,
voye^ les lois des bdtimens , par DefgodetS , & les notes
de Goupy , part, ll.pag. SS.
On appelloit aufîi anciennement chancel ou cancel,
le lieu où fe tenoit le grand référendaire, ou garde de
l ’anneau ou feel royal, pour faire fes expéditions ;
ce lien étoit fermé d’un grillage ou barreaux , afin
que ,ce magiftrat ne fût point incommodé par l’affluence
de ceux qui avpient affaire à lui ; & du nom
de ce lieu, appelle en latin cancelli y on a formé dans
la fuite le nom de cancellarius, & ep françois chpn-
celïer. Voye{ ci-après CHANCELIER &/RÉFÉREN-
BAIRE. .( A')
CHANCELAGUA, f. f. f Bot. ex or. ) plante de
la nouvelle Efpagne ; elle croît en abondance 'aux
environs de Panama; fon,goût eft,amer, comme
celui de la centauree, & fon infufion a l’odeur aroma-
tique dubaume duPérou. Voilà tout ce qu’on trouve
delà defçription dans 1 mémoires de l ’académie y,
anpi iy.oyr pag. J z . & cela ne fuffit pas. Quant à
^ p ro p r ié té s , on lui attribue celle de faciliter la
tranfpiration., de foulâgèr dans la plpuréfie., les ca-
tharres, lesrhumatifmes, • les fievres malignes, la
goutte humorale, mais non crétaçée, &c. La fai-}
gnée doit en précéder l’ufage, & elle ne doit être
prife que fur ,1e déclin de la fievre. Sa dofe eft .au,!
moins d’un gros, & peut aller à deux, On fait bouillir
une taffe d’eau, &"on y jette la plante coupée
en morceaux ; on couvre le vàjffeau, & on laiffe
Finfufionfe faire pendant undèmi-quart-d’heure ; on
fait prendreenfuite en uneTeuIe fois l’infufipn .au.
malade , la plus chaude qu’il fe peut. Quand le malade
a pris ce remede, on le couvre biep, & on le
fait fuer. Les Indiens qpi connoiffoient, ditrOn, lesi
vertus de.cette, plante , en ont”fait longrtems un fe*
cret awx Énropéens ; il paroît que ceux-ci n’ont pas
tiré grand avantage de l’indifcrétion des. premiers,,
& que la prédiftion que l’ufage de la chantelagua.
deviendrait un jour auffi général que, celui" du,quin~
quina^ eft encore à s’accomplir ; fur quoi Al. deFon-
tehjellé'obféfye que la ’Medecine paroît un peu trop!
en garde contre les nouveautés : à quoi l ’pn peut
ajoûter qu’elle n’en eft pas plus à blâmer, puifqu’ellè
ne peut guere faire fes' expériences qu’aux dépens!
de la vie des hommes.,
CHANCELIER, f. m. ( Hiß. anc. mod. Çr Jur. Y
eft un titre commun à plufieurs dignités &. öffices ’
qui ont rapport à l’admiuiftration de la juftice ou à
1 ordre politique. La plus eminente de ces dignités
éft celle de
Ç h^ ce.lïer dé Fr a n c e ; c’eft le chef de la
juftice & dé tous les confeils du Roi. Il eft le premier
préfide'nt né du grand-confeil : il peut auffi ,
quand il le juge à-propos, venir p/réfider dans tous
les parlemens & autres cours ; c’eft pourquoi fes lettres
font préfentées & enregiftrées dans toutes les
cours fouveraines.
Il eft la bouche du Roi, & l’interprete de fes volontés
: c’eft lui qui les expofe dans toutes les occa-
fions où il s’agit de l’adminiftration de la juftice.
Lorfque le Roi vient tenir fon lit de juftice au parlement
, le chancelier eft au-deffous de lui dans une
chaife à bras, couverte de l’extrémité du tapis ferne
de fleurs-de-lys, qui eft aux piés du Roi : c’eft lui
qui recueille les fufîrages , & qui prononce. Il ne
peut être réeufé.
Sa principale fon&ion eft de veiller à tout ce qui
concerne l’adminiftration de la juftice dans tout le
royaume , d’en rendre compte au R o i, de prévenir
les abus qui pourroient s’y introduire, de remédier
à ceux qui auroient déjà prévalu, de donner les ordres
convenables fur les plaintes qui lui font adref-
fées par les fujets du Roi contre les juges & autres
officiers de juftice, & fur les mémoires des compagnies
ou de chaque officier en particulier , par rapport
à leurs fondions, px ééminences, & droits.
C ’eft encore une de fes fondions de dreffer, conformément
aux intentions du R o i, les nouvelles ordonnances
, édits & déclarations , & les lettres patentes,
qui ont rapport à l’adminiftration de la jufti-
Cé. L’ordonnancé de Charles VII. du mois de Novembre
1441, fait mention qu’elle avoit été faite de
1 avis Sc deliberation du chancelier , de autres gens
du grand-confeil, &c.
C ’eft à lui que l’on s’adreffe pour obtenir l’agrément
^de tous les offices de judicature; & lorfqu’il a
la gardé du fceau ro y al, c’eft lui qui nomme aux offices
de toutes les chancelleries du royaume, & qui
donne toutes les provifions des offices, tant de jueff-
cature que de finance ou municipaux. Les charges ;
d avocats au confeil tombent dans fes parties cafuel-
les ; il eft le confervateur né des privilèges des fe-
crétaires du roi»
La foi & hommage des fiefs de dignité mouvans
immédiatement du roi à caufe de fa couronne, peut
etre faite entre les mains du chancelier ou en la chambre
dés comptes. Le chancelier, comme repréfentant
la perfonne du roi, reçut à Arras en 1499 l’hommage
de 1 archiduc d’Autriche, pour fes pairies & comtés
de Flandre, d’Artois, & de Charolois. L ’archiduc fe
mettant en devoir de s’agenouiller, il le releva en
lui difant, il fujjît de votre bon vouloir y en quoi il en
Ufa de même que Charles VII. avoit fait à l’égard du
duc de Bretagne.
Ce fut le chancelier Dupraf qui abolit l’ufage des
hommages que nos rois faifoient par procureur,
pour certaines feigneuries qui étoient mouvantes de
leurs fujets. Il établit à cette OCcafion le principe ,
que tout le monde releve du roi médiatement oit
immédiatement, & que le roi ne releve de perfon-
ne. . ■
Il feroit difficile de détailler ici bien exaélement
toutes les fondions & les droits attachés à la dignité
de chancelier ; nous rapporterons feulement ce qu’il
y a de plus remarquable.
D ’abord, pour ce qui eft de l’étymologie du nom
de chancelier y & de l’origine de cet office, on voit
que les empereurs romains avoient une efpece de
fecretaire ou notaire appelle cancellarius y parce qu’il
étoit placé derrière des barreaux appellés cancelli,
pour n’être point incommodé par la foule du peuple
: Naudé dit que c’ étoit l’empereur même qui
rendoit la juftice dedans cette enceinte de barreaux ;
que le chancelier étoit à la porte, & que c’eft de-là
qu’il fut nommé chancelier.
D ’autres font venir ce nom de ce que c et officier
examinoif I toutes les requêtes & uippliques qui
étoient préfentées au prince, & les cancelloit ou.
biffoit quand elles n’étoient pas admiffibles. D ’autres,
de ce qu’il fignoit avec grille ou paraphe fa it
en forme de grillage, les lettres patentes, commif-
fions, & brevets accordés par l’empereur. D ’autres
enfin, de ce qu’il avoit le pouvoir de canceller &
annuller les fentences rendues par des juges inférieurs.
Du Cange, d’après Jean de la Porte, fait venir le
mot chancelier de Paleftine , où les faîtes des maifons
étoient conftruits en terraffes, bordées de baluftres
ou parapets nommés cancelli; il dit qu’on appella
cancellarii ceux qui montoient fur ces terraffes, pour
y *Jc*teiLdf s harangues ; que cette dénomination
pafla aulfi à ceux qui plaidoient au barreau qu’on
appelloit cancelli forenfes , enfuite au juge même qui
prefidoit, & enfin au premier fecrétaire du roi.
L’office de chancelier en France revient à-peu-près
à celui qu’on appelloit quefieur du facrépalais chez les
Romains, & qui fut établi par Conftantin le orand :
en effet c’étoit ordinairement un jurifconfulte que
I on honoroit de cette place de quefteur; parce qu’il
devoir connoître les lois de l’Empire, en dreffer de
nouvelles quand le cas le requéroit, les faire exécuter
pelles n’avoient de force que quand il les avoit
lignées. Il jugeoit les caufes que l’on portoit par appel
devant 1 empereur, fouferivoit les referits ôc
l^pOftftÿdu ferne«, 'enfin il avoit i'infpeâïoh fur
toute I adminiftratiort de la juftice.
En France, 1 office de chancelier eft prefque auffi
ancien que la monarchie; mais les premiers qui en
faifoient les fondrions, ne portoient pas le titre de
Chancelier; car on ne doit pas appliquer au chancelier
de France ce qui eft dit de certains officiers fubal-
ternes, que l on appelloit anciennement chanceliers,
tels que ceux qui gardoient l’enceinte du tribunal
appellee cancelli, parce qu’elle étoit fermée de bar-
reaijx.
On:donna auffi en France, à l'imitation desRo-
H D H "0“ de: D B H à ceux qui faifoient la
fonftion de greffiers & de' notaires, parce qu’ils tra-
vailloient dans une femblable enceinte fermée de
barreaux.
Les notaires & fiscrétaires du roi prirent auffi t
par la meme raifon , le nom de chanceliers.
*"5 r.°\. en un premier fecrétaire qui
avoit infpedhon fur tous les autres notaires & fe-
cretaires : ie pouvoir de cet officier étoit fort étendu
; il failoit les fondrions de chancelier de France '
mais avant d’en porter le titre, on lui a donné f u i
ceflivement différens noms.
Sous la première race de nos rois, ceux qui faifoient
les fondrions de chanceliers ont été appellés
différemment»
Quelques auteurs modernes font Vidiomare duuü
référendaire de CHildéric, mais fans aucun
fondement : Grégoire de Tours ne lui donne point
cette qualité. .
Le preihier qui foif connu pour avèir rempli cette
fonâton, eft Aurélien, fous Glovis I. HinCmar dit
qu il portoit Panneau ou leTçeau de ce prince ; qu’il
etoit conjüiarius & Ugdîariùs regis, c’eft-à-dire le M-
L ’auteur des ,geîtès des François le nomme
au ™ hg*taniim& miffum Clodavm: Aymoin le
nomme fdmUtarÿ/imum régi , pour exprimer qu’il
avoit fa plus intime confiance. ’
Valentinien eft le premier que l’on trouvé àvcÔ
figne les ctartesde nos rois’, en,qualité de notaire ou
fecrétaire du toi mtarius & amamenßs,: il fit cette
fondhon fous Childebert I.
Baudin & plufieurs autres, fous Clotaire t. & f -
fucceffeurs, font appellés rifiretidains par Grégoire
de Tours qui remarque auffi que fous ié référendaire
qui fignoit & fcelloit les chartes de nos fois il
y avoitplufieurs fécrémires de la’diancellerie, Qu’on
appelloit notaires ou chanceliers du roi, Cancellarii re
gales. .
On trouve une charte de Thierri écrite de la main
d un notaire, & fcellée par un autre officier du fceau
rojrah Sous le même roi., Agreftin fe difoit nMariai
regis.
■ S B tegne de Chilperic I. il eft fait mention
d un référendaire & d’un fecrétaire du palais, polo-
tinus Jcriptor.
Saint Oiien, en latin Audoenus, & Dadô , fat rés
férendaire du roi Dagobert I. & enfuite dé Clovis II
Aymoin dit qu’il fut air.fi appelle, parce que c’étoit
à lui que l’on apportoit tontes les écritures publiques
, &c qu’il les fcelloit du fceau du roi : il avoit
fous lui plufieurs notaires ou fecrétaireS qui fignoienr
en fon abfence ad viccni. Dans des chartes de l’abbaye
de Saint-Denis, il eft nommé régies dignitatis
cancellarius : c ’eft la première fois que le titre de
chancelier ait été donné à cqt office.
La plupart de ceux qui firent les fondions de charte
Cilierfousles autres rots de cette première race, font
nommés fimplement référendaires, excepté fous*Clo-
taire III. que Robert eft nommé garde du fceau royal
gtrülus annuli regiij & Grimâud fous Thierri IL qui
figne en qualité de chancelier; ego , cancellarius , n -
cognovi, -*