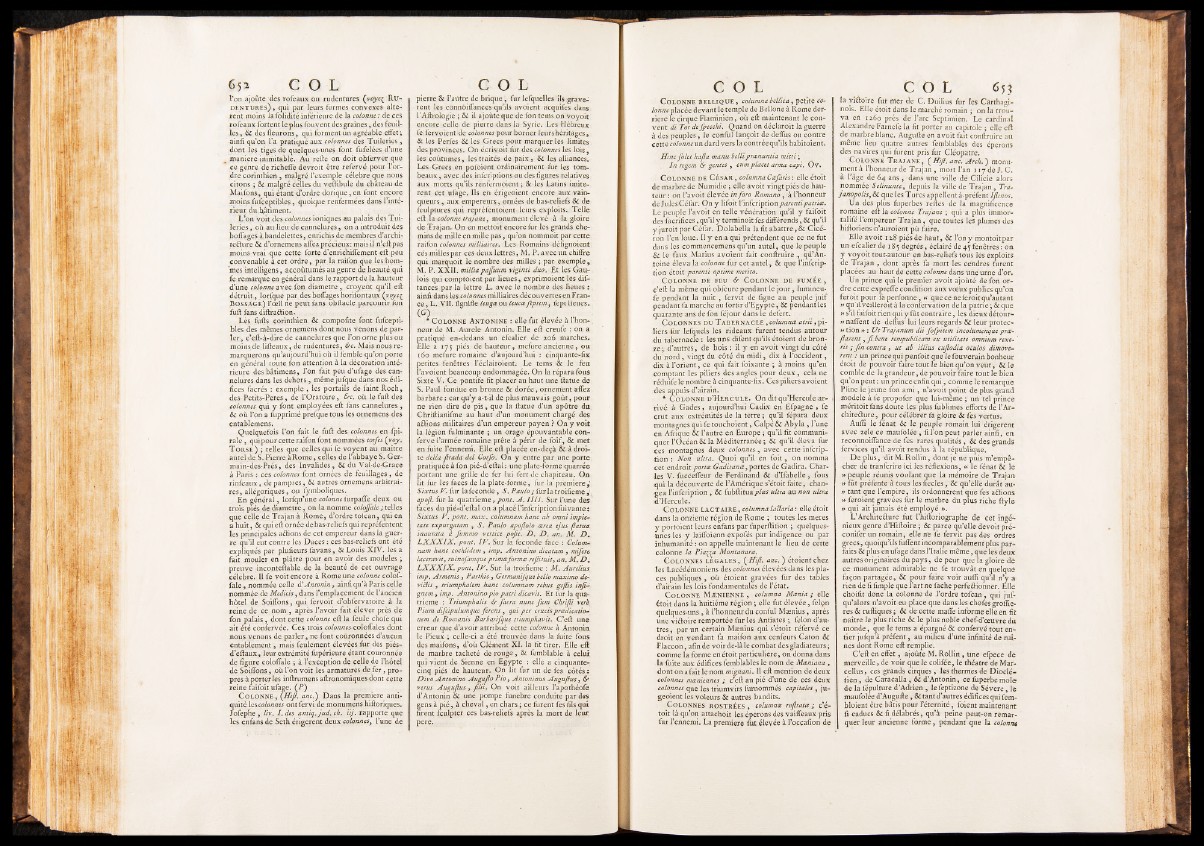
l’on ajoute des rofeaux ou rudentures; (yoye{ R u-
d en tu r e s ) , qui par leurs, formes convexes altèrent
moins lafolidité inférieure de la colonne: de ces
rofeaux portent le plus fouvent des graines, des feuilles
, 6c des fleurons, qui forment un agréable effet ;
ainfi qu’on l’a pratiqué aux colonnes des Tuileries ,
dont les tiges de quelques-unes font fufelées d’une
maniéré-inimitable. Au refte on doit obferver que
ce genre de richefie devroit être refervé pouf l’ordre
corinthien , malgré l’exemple célébré que nous
citons ; 6c malgré celles du veftibule du château de
Maifpns, qui,étant d’ordre dorique,en font encore
jnoins fufceptibles, quoique renfermées dans l’intérieur
du .bâtiment.
L ’on voit des colonnes ioniques au palais des Tui;
le rie s, où au lieu de cannelures, on a introduit des
boflages à,bandelettes, enrichis de membres d’archi-
teÔure 6c d’ornemeps aflèz.préçieux: mais il n’eftpas
moins vrai que cette forte d’enrichiflement eft peu
convenable à cet ordre, par la raifon que, les hommes
infelligens, accoûtumés au genre, de beauté.qui
fe remarque en général dans le rapport de la hauteur
d’une colonne avec fon diamètre , croyent qu’il eft
détruit, Jorfque par des boflages horifontaux (voye{
Bossage) l’oeil ne peut fans obftacle parcourir fon
fuft fans diftraéHon. .
Lès fufts corinthien 6c compofite font fufcepti-
bles des mêmes ornemens dont nous venons de parle
r , c’eft-à-dire de cannelures que l’on orne plus ou
moins de.lifteaux, de rudentures, &c. Mais nous remarquerons
qu’aujourd’hui où il femble qu’on porte
en général toute fon attention à la décoration intérieure
des bâtimens, l’on fait peu d’ufage des cannelures
dans les dehors, même jufque dans nos édifices
facrés : exemple , les portails de faint Roch,
des Petits-P eres, de l’Oratoire, &c. où le fuft des
colonnes qui y font employées eft fans cannelures ,
& où l’on a fupprimé prefque tous les ornemens des
entablemens.
Quelquefois l’on fait le fuft des colonnes en fpi-
r a le , qui pour cette raifon font nommées torfes ( voy.
T orse) ; telles que celles qui fe voyent au maître
autel de S . Pierre àR om e , celles de l’abbaye S,. Ger-
main-des-Prés, des Invalides, & du Val-de-Grace
à Paris : cès colonnes font ornées de feuillages , de
rinfeaux, de pampres, 6c autres ornemens arbitraires
, allégoriques, ou fymboliques.
En g énéral, lorfqu’une colonne furpafle deux ou
trois pies de diamètre, on la nomme colojfale;te lle s
que celle de Trajan à Rome, d’ordre tolcan, qui en
a huit, & qui eft ornée de bas-reliefs qui repréfentent
les principales aérions de cet empereur dans la guerre
qu’il eut contre les Daces ces bas-reliefs ont été
expliqués par plufieurs fav an s, & Louis XIV . les a
fait mouler en plâtre pour en avoir des modèles ;
preuve inconteftable de la beauté de cet ouvrage
célébré. Il fe voit encore à Rome une colonne colof-
f a le , nommée celle à’Antonin, ainfi qu’à Paris celle
nommée de Medicis, dans l’emplacement de l’ancien
hôtel de Soiflons, qui fervoit d’obfervatoire à la
reine de ce nom , après l’avoir fait élever près de
fon p a la is, dont cette colonne eft la feule chofe qui
ait été confervée. Ces trois colonnes coloflales dont
nous venons de parler, ne font couronnées d’aucun
entablement, mais feulement élevées fur des piés-
d’eftaux, leur extrémité fupérieure étant couronnée
de figure coloflale ; à l’exception de celle de l’hôtel
de Soiflons, où l’on voit les armatures de f e r , propres
à porteries inftrumens aftronomiques dont cette
reine faifoit ufage. (P )
C olonne, (Hiß. anc.) Dans la première antiquité
les colonnes ontfervi de monumens hiftoriques.
Jofephe , Uv. I. des antiq.jud. ch. iij. rapporte que
les enfans de Seth érigerent deux colonnes, l’une de
pierre 6c l’aütre de brique , fur lefquelles ils gravèrent
les cOnnôiflances-qu’ils avoient acquifes dans
l ’Aftrologie ; 6c il ajoute que de fon tems on voyoit
encore celle de pierre dans la Syrie. Les Hébreux
fçiferyoient de colonnes pour borner leurs héritages,
& les Perfes &; les Grecs pour marquer.les limites
des provinces. On éçriy;oit-,fiir des, colonnes les lo is ,
les coutumes, les traités de p a ix , 6c les alliances.
Les Grecs.en pofoient ordinairement fur les tombeaux
, avec des inferiptions. ou des figures relatives
aux morts qu’ils rënfermoient ; & les Latins imitèrent
cet ufàge. Ils en erigeoient encore aux vainqueurs,
aux empereurs., ornées de bas-reliefs & de
foulptures qui repréfentoient leurs exploits.. Telle
eft Iz-câlonnetrajane, monument élevé à la gloire
de Trâjan.. On en mettoit encore fur les grands chemins
de mille en mille p a s , qu’on nommoit par cette
raifon colonnes militaires. Les Romains» défignoient
ces milles par ces deux lettres, M. P. avec un chiffre
qui marquoft le nombre des milles ; par exemple ,
M. P. X X I I. milita pajfuum viginti duo. Et les Gaulois
qui eomptoient par lieues, exprimoient les distances
par la lettre L. avec le nombre .des lieues :
ainfi'dans les colonnes milliaires découvertes en France
, L . VII. fignifie leugce ou leucce feptem, fept lieues.
(G) : v , :
* C olonne Antonine : elle fut élevée à l’hon-
neur de M. Aurele Antonin. Elle eft creufe i on a
pratiqué en-dedans un efcalier de 206 marches.
Elle a 175 piés de hauteur, mefure ancienne, ou
160 mefure romaine d’aujourd’hui : cinquante-fix
petites fenêtres l’éclairôienf; Le tems & le feu
l’àvoient beaucoup endommagée. On la répara fous
Sixte V. Ce pontife fit placer au haut une ftatue de
S. Paul fondue en bronze & dorée, ornement allez
barbare : car qu’y a-t-il de plus mauvais g o û t, pour
ne rien dire de p is , que la ftatue d’un apôtre du
Chriftianifme au haut d’un monument chargé des
aérions militaires d’un empereur payen ? On y voit
la. légion fulminante ; un orage épouvantable con-
ferve l’armée romaine prête à périr de fo if, 6c met
en fuite l’ennemi. Elle eft placée en-deçà & à droite
délia Jlrada del Corfô. On y entre par une porte
pratiquée à fon pié-d’eftal : une plate-forme quarrée
portant une grille de fer fui fert de chapiteau. On
lit fur les faces de la plate-forme, fur la première,'
Sixtus V. fur lafeconde, S.Paulo ; fur la troifieme,1
apofi. fur la quatrième, pont. A . III1. Sur l’une des
faces du pié-d’eftal on a placé l’infcription fui vante:
Sixtus V. pont. max. columnam hanc ab omni impie-
tate expurgatam , S. Paulo apofiolo cerea ejus flatua
inaurata à fummo vertice pojit. D. D. an. M. Z?.
LXXXIX. pont. IV. Sur la fécondé face : Columnam
hanc cochlidem, imp. Antonino dicatam , mifere
lace ravit, ruinofamque prima forma refiituit, an. M. D.
LXXXIX. pont. IV. Sur la troifieme : M. Aurelius
imp. Armenis , Parthis , GermaniJque bello maximo de-
viclis , triumphalem hanc columnam rebus gefiis inji~
gnem, imp. Antonino pio patr 't dicavit. Et f ur la quatrième
: Triumphalis & facra nunc fum Chrijli verh
Pium difcipulumque ferens, qui per crucis pradicatio
nem de Romanis Bar bar i f que triumphavit. C ’eft une
erreur que d’avoir attribué cette colonne à Antonin
le Pieux ; celle-ci a été trouvée dans la fuite fous
desmaifons, d’où Clément X I. la fit tirer. Elle eft
de marbre tacheté de rou g e , & femblable à celui
qui vient de Sienne en Egypte : elle a cinquante-,
cinq piés de hauteur. On lit fur un de fes côtés :
Divo Antonino Augufto Pio , Antoninus Augufius , 6*
ver us Augufius, filii. On voit ailleurs l’apothéofe
d’Antonin 6c une pompe funebre conduite par des
gens à pié, à cheval, en chars ; ce furent fes fils qui
firent fculpter ces bas-reliefs après la mort de leur:
pere. .
C olonne b e l l iq u e , columna bellica, petite ào-
lonne placée devant le temple de Bellone à Rome derrière
le cirque Flaminien, où eft maintenant le couvent
di Tor de fpecchi. Quand on déclaroit la guerre
à des peuples, le conful lançoit de deflits ou contre
cette colonne un dard vers la contrée qu’ils habitoienL
Hinc folet hafia manu belli pranuntia mitti ;
In regem & gentes , cum placet arma capi. Ov.
C olonne de C ésar , columna Cafarisi elle étoit
de marbre de Numidie ; elle avoit vingt piés de hauteur
: on l’âvoit élevée ira foro Romano, '.à l’honneur
de J ules Céfar. On y lifoit i’infeription parentipatria.
Le peuple l’avoit en telle vénération qu’il y faifoit
des facrifices, qu’il y terminoit fes différends, 6c qu’il
y juroit par C éfar. Dolabella la fit abattre, 6c Cicé- ;
ron l’en loue. Il y en a qui prétendent-que ce ne frit
dans les commencemens qu’un autel, que le peuple |
■ Sc le faux .Marius avoient fait conftruire , qû’An-
toine éleva la colonne fur cet autel, & que l’infcription
étoit parenti optime merito.
C olonne de feu & C olonne de fumée , I
c’eft la même qui obfcure pendant le jo u r, lumineu-
fe pendant la nuit , fervit de figne au peuple juif
pendant fa marche au fortir d’Egy pte, & pendant les .
quarante ans de fon féjour dans le defert.
C olonnes du T abern ac le , columna atrii, piliers
fur lefquels les rideaux furent tendus autour
du tabernacle : les uns difent qu’ils étoient de bronz
e ; d’autres, de bois : il y en avoit vingt du côté
du n ord , vingt du côté du midi, dix à l ’occident,
dix à l’orient, ce qui fait foixante ; à moins qu’en
comptant les piliers des angles pour d eu x , cela ne
réduife le nombre à cinquante-fix. Ces piliers avoient
des appuis d’airain.
* C olonne d’Hercule. On dit qu’Hercule ar- 1
rivé à G ad e s, aujourd’hui Cadix en Efpagne , fe
crut aux extrémités de la terre ; qu’il fépara deux
montagnes qui fe touchoient, Calpé & Abyla , l ’une
en Afrique & l’autre en Europe ; qu’il fit communiquer
l’Océan 6c la Méditerranée ; 6c qu’il éleva fur
ces montagnes deux colonnes, avec cette inferip-
tion : Non ultra. Quoi qu’il en fo it , on nomma
cet endroit porta Gaditana^ portes de Gadira. Charles
V. fucceffeur de Ferdinand & d’Ifabelle , . fous
qui la découverte de l’Amérique s’étoit faite, changea
l’infcription , 6c fubftitua plus ultra au non ultra
'd’Hercule.
C olonne l a c t a ir e , columna laBaria: elle étoit
dans la onzième région de Rome ; toutes les meres
y portoient leurs enfans par fuperftition ; quelques-
unes les ÿ laiffoienn expofés par indigence ou par
inhumanité : on appelle maintenant le lieu de cette
colonne la Pia^ra Montanara.
C olonnes légales , (j.ffifi, anc. ) étoient chez
les Lacédémoniens des colonnes élevées dans les places
publiques , où étoient gravées fur des tables
d’airain les lois fondamentales de l’état.
C olonne Mænienne , columna Mania ; elle
étoit dans la huitième région ; elle fut é lev é e , félon
quelques-uns , à l’honnenrdu conful Mænius, après
une vittoire remportée fur les Antiates ; félon d’autres
, par un certain Mænius qui s ’étoit réfervé ce
droit en vendant fa maifon aux cenfeurs Caton 6c
Flaccon, afin de voir de-là le combat des gladiateurs ;
comme la forme en étoit particulière, on donna dans
la fuite aux édifices femblables le nom de Maniana ,
dont on a fait le nom mignani. Il eft mention de deux
colonnes maniennes ; c’eft au pié d’une de ces deux
colonnes que les triumvirs furnommés capitales , ju-
geoient les voleurs & autres bandits.
C olonnes rostrées , columna rofirata ; c’é-
toit là qu’on attachoit les éperons des vaiffeaux pris
fur l’ennemi. La première fut élevée à l’occafion de
la yi&oire fur mer de C. Duilius fur les Carthaginois.
Elle étoit dans le marché romain ; on la trouv
a en 1260 près de l’arc Septimien. Le cardinal
Alexandre Farnefe la fit porter au capitole ; elle eft
de marbre blanc. Aùgufte en avoit fait conftruire au
même lieu quatre autres femblables des éperons
des navires qui furent pris fur Cléopâtre.
Colonne T rajane, ( Hifi.anc. Arck.') monument
à l’honneur de T r a jan , mort l’an 117 de J . O.
à l’âge dé 64 ans , dans une ville dé Ciliciè alors
nommée Selinuntey depuis la ville de T r a jan , Trà-
janopolis, & que les Turcs appellent à-préfent Ifienos.
Un des plus fuperbes reftes de la magnificence
romaine eft la colonne Trajane ; qui à plus immon-
talifé l’empereur T r a jan , que toutes les plumes des
hiftoriens n’auroient pu faire.
Elle avoit 128 piés de -haut, & l’on y montoitpar
un efcalier de 18 5 degrés, éclairé de 45 fenêtres : on
y voyoit tout-autour en bas-reliefs tous lés exploits
de Trajan , dont après fa mort les cendres furent
placées au haut de cette colonne dans ünéurne d’or.
Un prince qui le premier avoit ajouté de fon ordre
cette expreffe condition aux voêiix publics qu’on
feroit pour fa perfonne, « queceneferoitqu’autant
» qu’il veilleroit à la conservation de la patrie ; & que
» s’il faifoit rien qui ÿ fût contraire, les dieux détour-
»naflent de deflits -lui leurs regards 6c leur protec-
» tion » : Ut Trajanùm dît fofpitem incolumenque pra-
fiarent, Ji bene rempublicatn ex ütilitate omnium rexe- ‘
rit ; fin contra , ut ab illius eufiodia oculos dirnove-
rent : un prince qui penfoit que le fouverairt bonheur
étoit de pouvoir faire tout le bien qu’on v e u t, & le
comble de la grandeur, de pouvoir faire tout le bien
qu’on peut : un prince enfin q u i, comme le remarque
Pline le jeune fon am i , n’avoit point de plus grand
; modèle à fe propofer que lui-même ;• un tel prince
méritoit fans doute les plus fublirtiês efforts de l’Ar-
chite&ure, pour célébrer fa gloire & fes vertus.
Aufli le fénat 6c le peuple romain lui érigerent
avec zele ce maufolée , fi l’on peut parler ainfi, en
reconnoiflance de fes rares qualités , 6c des grands
fervices qu’il avoit rendus à la république.
De plus, 'dit M.R ollin , dont jé ne puis m’empêcher
de trànfcrire ici les réflexions, « le fénat & le
» peuple .réunis voulant que la mémoire de Trajan
» fût préfente à-tous les fiecles, 6c qu’elle durât au-
» tant que l’empire, ils ordonnèrent que fes aérions
» feroient gravées fur le marbre du plus riche ftyle
» qui ait jamais été employé ».
L’Architefture fut l’hiftoriographe de cet ingé*
nieux genre d’Hiftoire ; 6c parce qu’elle devoit pré-
conifer un romain, elle ne fe fervit pas des ordres
grecs, quoiqu’ils fuflent incomparablement plus parfaits
6c plus en ufage dans l’Italie m ême, que les deux
| autres originaires du p a y s , de peur que la gloire de
ce monument admirable ne fe trouvât en quelque
, façon partagée, 6c pour faire voir aufli qu’il n’y a
rien de fi fimple que l’art ne fâche perfectionner. Elle
choifit donc la colonne de l’ordre tofean , qui juf-
qu’alors n’a voit eu place que dans les chofes groflie*
res & ruftiques ; 6c de cette maffe informe elle en fit
naître le plus riche 6c le plus noble chef-d’oeuvre du
monde, que le tems a épargné & confervé tout entier
jufqu’à préfent, au milieu d’une infinité de ruines
dont Rome eft remplie.
C’eft en e ffe t, ajoûte M. Ro llin , une elpece de
merveille, de voir que le colifée, le théâtre de Mar-
cellus, ces grànds cirques , les thermes de Dioclétien
, de Caracalla, 6c d’Antonin, ce fuperbe mole
de la fépulture d’Adrien , le feptizone de S év e re , le
maufolée d’Augufte, & tant d’autres édifices qui fem-
bloient être bâtis pour l’éternité, foient maintenant
fi caducs 6c fi délabrés, qu’à peine peut-on remarquer
leur ancienne forme, pendant que la colonne