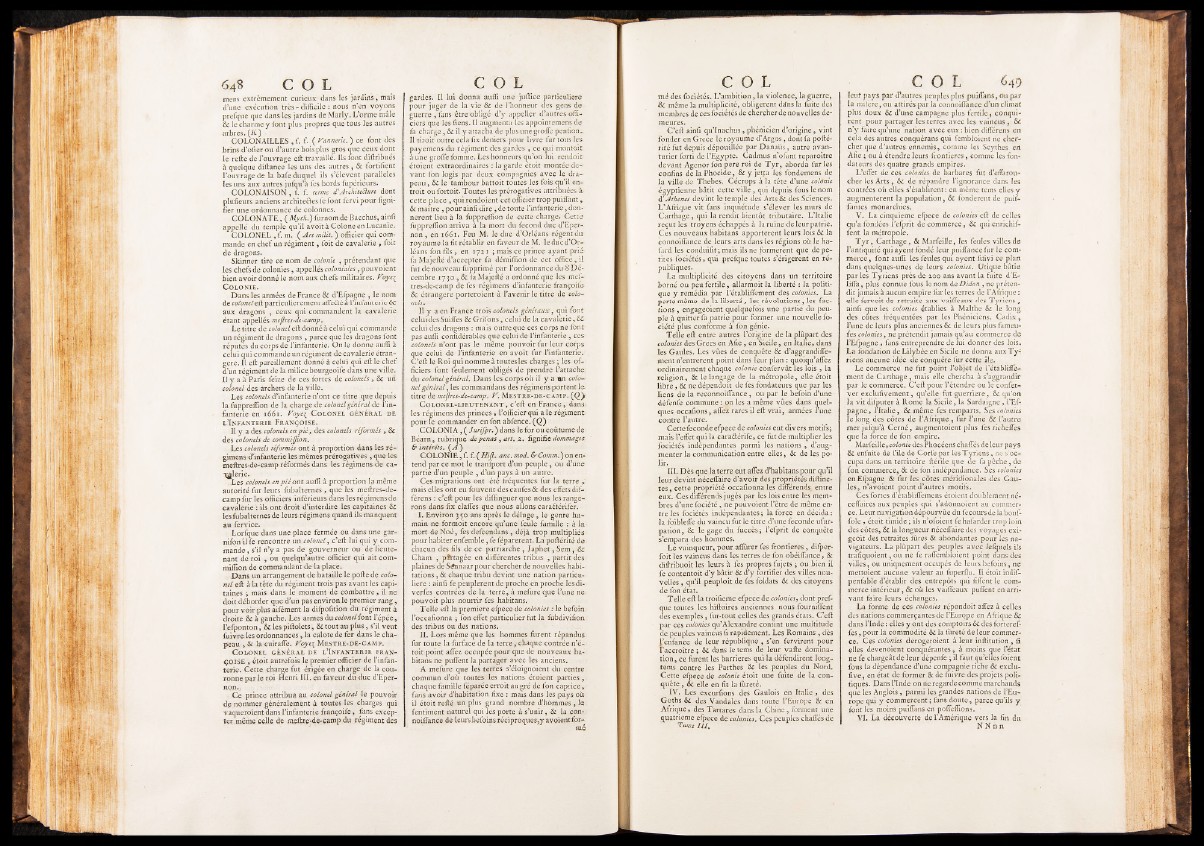
6 4 8 C O L
mens extrêmement curieux dans les jardins, mais
d’une exécution très - difficile : nous n’en voyons
prefque que dans les jardins de M arly. L ’orme mâle
& le charme y font plus propres que tous les autres
arbres, ( i f ) ■
COLONAILLES , f. f. ( Vannerie. ) ce font des
brins d’ofier ou d’autre bois plus gros que ceux dont
le relie de l’ouvrage efl travaillé. Ils font diftribués
à quelque dillance les uns des autres , & fortifient
l’ouvrage de la bafe duquel ils s’élèvent parallèles
les uns aux autres jufqu’à fes bords fupérieurs.
COLONAISON , f. f. terme <TArchitecture dont
plufieurs anciens archite&es fe font lervi pour lignifier
une ordonnance de colonnes.
CO LO N A T E , ( Mytk.') furnom de Bacchus, ainfi
appelle du temple qu’il a voit à Colone en Lucanie.
COLONEL , f. m. ( Art milit. ) officier qui commande
en chef un régiment, foit de cavalerie , foit
de dragons.
Skinner tire ce nom de colonie , prétendant que
les chefs de colonies, appellés coloniales, pouvoient
bien avoir donné le nom aux chefs militaires. Voye1
C olon ie.
Dans les armées de France & d’Efpagne , le nom
de colonelelt particulièrement affeûé à l’infanterie &
aux dragons , ceux qui commandent la cavalerie
étant appellés meflres-de-camp.
L e titre de colonel ell donné à celui qui commande
un régiment de dragons , parce que les dragons font
réputés du corps de l’infanterie. On le donne auffi à
celui qui commande un régiment de cavalerie étrangère.
Il ell pareillement donné à celui qui ell le chef
d’un régiment de la milice bourgeoife dans, une ville.
Il y a à Paris feize de ces fortes de colonels , & un
colonel des archers de la ville.
Les colonels d’infanterie n’ont ce titre que depuis
la fuppreffion de la charge de colonel général de l’infanterie
en 1661. Voye{ C olonel GENERAL DE
l ’Infanterie Françoise.
Il y a des colonels en piét des colonels réformés , &
des colonels de commijjion.
Les colonels réformés ont à proportion dans les régimens
d’infanterie les mêmes prérogatives , que les
melires-de-camp réformés dans les régimens de ca-
•^ le rie .
.L e s colonels enpiéant auffi à proportion la même
autorité fur leurs fubalternes , que les meflres-de-
camp fur les officiers inférieurs dans les régimens de
cavalerie': ils ont droit d’interdire les capitaines &
les fubalternes de leurs régimens quand ils manquent
au fervice.
Lorfque dans une place fermée ou dans une gar-
nifon'il fe rencontre un .colonel, c ’efl lui qui y commande
, s’il n’y a pas de gouverneur ou de lieutenant
de roi , ou quelqu’ autre officier qui ait com-
miffion de commandant de la place.
Dans un arrangement de bataille le polie de colonel
ell à la tête du régiment trois pas avant les capitaines
; mais dans le moment de combattre, il ne
doit déborder que d’un pas environ le premier ran g ,
pour voir plus aifément la difpofition du régiment à
droite & à gauche. Les armes du colonel $ont l’épée,
1’efponton, &.les piftolets, & tout au p lu s, s’il veut
fuivre les ordonnances, la calote de fer dans le chapeau
, & la cuiraffe. Voye^ Mestre-de-c am p .
C olonel général de l’Infanterie Franço
ise , étoit autrefois le premier officier de l’infanterie.
Cette charge fut érigée en charge de la couronne
par le roi Henri III. en faveur du duc d’Eper-
non.,
Ce prince attribua au colonel général le pouvoir
dp nommer généralement à toutes les charges qui
vaqueraient dans l’infanterie françoife, fans excepter
même celle de meltre-de-camp du régiment des
C O L
gardes. Il lui donna auffi une jullice particulière
pour juger de la vie & de l’honneur des gens de
guerre , fans être obligé d’y appeller d’autres officiers
que les liens. Il augmenta les appointemens de
fa charge, & il y attacha de plus une groffe penfion.,
Il tiroit outre cela fix deniers pour livre fur tous les
payemens du régiment des gardes , ce qui montoit
à une groffe fomme. Les honneurs qu’on lui rendoit
étoient extraordinaires : la garde etoit montée devant
fon logis par deux compagnies avec le drapeau
, & le tambour battoit toutes les fois qu’il entroit
ou fortoit. Toutes les prérogatives attribuées A
cette place , qui rendoient cet officier trop piaffant,
& maître , pour ainfi dire, de toute l’infanterie, donnèrent
lieu à la fuppreffion de cette charge. Cette
fuppreffion arriva à la mort du fécond duc d’Epcr-
n on , en 1661. Feu M. le duc d’Orléans régent du
royaume la fit rétablir en faveur de M. le duc d’Orléans
fon fils , en 1721 ; mais ce prince ayant prié
fa Majeflé d’accepter fa démiffion de cet office, il
fut de nouveau fupprimé par l’ordonnance du 8 D é cembre
1 7 3 0 , &c fa Majeflé a ordonné que les mef-
tres-de-camp de fes régimens d’infanterie françoife
&c étrangère porteraient à l’avenir le titre de colonels.
Il y a en France trois colonels généraux, qui font
celui des Suiffes & Grifons, celui de la c avalerie, ôc
celui des dragons : mais outre que ces corps ne font
pas auffi considérables que celui de l’infanterie , ces*
colonels n’ont pas le même pouvoir fur leur corps
que celui de l’infanterie en a voit fur l’infanterie.
C ’efl le R o i qui nomme à toutes les charges ; les officiers
font feulement obligés de prendre l’attache,
du colonel général. Dans les corps oii il y a un colo-'
ntl générales commandans des régimens portent le
titre de meflres-de-camp. V. Mestre-de-camp. (Q}
C olonel-lieutenant, c ’efl en France , dans»
les régimens des princes, l’officier qui a le régiment
pour le commander en fon abfence. (Q )
COLONIA , ( Jurifpr. ) dans le for ou coutume de
Béarn, rubrique depenas, art. z. fignifie dommages,
& intérêts. (A )
CO LO N IE , f. f. ( Hijt. anc. mod. & Comm.') on en-
tend par ce mot le tranfport d’un peuple, ou d’une
partie d’un peuple , d’un pays à un autre.
Cesmigrations ont été fréquentes fur la terre »
mais elles ont eu fouvent des caufes & des effets dif-
férens : c’efl pour les diflinguer que nous les rangerons
dans fix claffes que nous allons caraélérifer.
I. Environ 350 ans après le déluge , le genre humain
ne formoit encore qu’une feule famille : à la
mort de N oé , fes defeendans , déjà trop multipliés
pour habiter enfemble, fe féparerent. L a poflérité de
chacun des fils de ce patriarche , Ja p h e t, S em , ôc
Gham , partagée en différentes tribus , partit des
plaines de Sennaar pour chercher de nouvelles habitations
, & chaque tribu devint une nation particulière
: ainfi fe peuplèrent de proche en proche les di-
verfes contrées de la terre, à mefure que l’une ne
pouvoit plus nourrir fes habitans.
Telle efl la première efpece de colonies : le befoin
l’occafionna ; fon effet particulier fut la fubdivifion
des tribus ou des nations.
II. Lors même que les hommes furent répandus
fur toute la furface de la terre, chaque contrée n’é-
toit point affez occupée pour que de nouveaux habitans
ne puffent la partager avec les anciens.
A mefure que les terres s’éloignoient du centre
commun d’oii toutes les nations étoient p a rtie s,
chaque famille féparée errait au gré de fon caprice,
fans avoir d’habitation fixe : mais dans les pays oii
il étoit refié un plus grand nombre d’hômmes , le
fentiment naturel qui lés porte à s’unir, & la eon-
noiffance de leurs befoins réciproques,y avoientfori
lgî f j
C O L
mé des fociétés. L’ambition, la violence, la guerre,
6c même la multiplicité, obligèrent dàns la fuite des
membres de ces fociétés de chercher de nouvelles demeures.
C’efl ainfi qu’Inachus, phénicien d’origine, vint
fonder en Grece le royaume d’Argos, dont fa poflérité
fut depuis dépouillée par Dana iis, autre avan-
turier forti de l’Egypte. Cadmus n’ofant reparoître
devant Agenor fon pere roi de T y r , aborda fur les
confins de la Phocide, & y jetja les fondemens de
la ville de Thebes. Cécrops à la tête d’une colânie
égyptienne bâtit cette ville , qui depuis fous le nom
d’Athènes devint le temple des A rts& des Sciences.
L ’Afrique vit fans inquiétude s’élever les murs de
Carthage, qui la rendit bientôt tributaire. L ’Italie
reçut les troyens échappés à la ruine de leur patrie.
Ces nouveaux habitans apportèrent leurs lois & la
connoiffance de leurs arts dans les régions oh le ha-
fard les conduifit ; mais ils ne formèrent que de petites
fociétés, qui prefque toutes s’érigèrent en républiques.
L a multiplicité des citoyens dans un territoire
borné ou peu fertile, allarmoit la liberté : la politique
y remédia par l’établiffement des colonies. La
perte même de la liberté , les révolutions, les factions
, engageoient quelquefois une partie du peuple
à quitter fa patrie pour former une nouvelle fo-
ciété plus conforme à fon génie.
Telle efl entre autres l’origine de la plupart des
colonies des Grecs en Afie , en Sicile , en Italie, dans
les Gaules. Les vues de conquête & d’aggrandiffe-
ment n’e'ntrerent point dans leur plan : quoiqu’affez
ordinairement chaque colonie confervât les lois , la
religion, & le langage de la métropole, elle étoit
lib re , & ne dépendoit de fes fondateurs que par les
liens de la reconnoiffance , ou par le befoin d’une •
défenfe commune : on les a même vûes dans quelques
occafions, affez rares il efl v ra i, armées l’une
contre l’autre.
Cette fécondé efpece de colonies eut divers motifs;
mais l’effet qui la caraétérife, ce fut de multiplier les
fociétés indépendantes parmi les nations , d’augmenter
la communication entre elles, & de les polir.
III. D è s que la terre eut affez d’habitans pour qu’il
leur devînt néceffaire d’avoir des propriétés diflinc-
îe s , cette propriété occafionna les différends, entre
eux. Ces différends jugés par les lois entre les membres
d’une fociété, ne pouvoient l’être de même entre
les fociétés indépendantes ; la force en décida :
la foibleffe du vaincu fut le titre d’une fécondé ufur-
pation, & le gage du fuccès; l’efprit de conquête
s’empara des hommes.
Le vainqueur, pour affûrer fes frontières, difper-
foit les vaincus dans les terres de fon obéiffance, &
diflribuoit les leurs à fes propres fujets ; ou bien il
fe contentoit d’y bâtir & d’y fortifier des villes nouvelles
, qu’il peuploit de fes foldats & des citoyens
de fon état.
Telle efl la troifieme efpece de colonies, dont p refque
toutes les hiftoires anciennes nous fourniffent
des exemples, fur-tout celles des grands états. C ’efl
par ces colonies qu’Alexandre contint une multitude
de peuples vaincus fi rapidement. Les Romains , dès
l’enfance de leur république , s’en fervirent pour
l’accroître ; & dans le tems de leur vafte domination
, ce furent les barrières qui la défendirent long-
téms contre les Parthes & les peuples du Nord.
Cette efpece de colonie étoit une fuite de la conq
u ê te , & elle en fit la fureté.
IV. Les excurfions des Gaulois en Ita lie , des
Goths &c des Vandales dans toute l’Europe & en
Afrique, des Tartares dans la Chine , forment une
quatrième efpece de colonies. Ces peuples chaffés de
LW/e HI.
C O L 6 4 9
leuf pays par d’autres peuples plus puiffans, ou par
la mifere, ou attirés par la connoiffance d’un climat
plus doux & d’une campagne plus fertile, conquirent
pour partager les terres avec les v aincu s, &C
n’y faire qu’une nation avec eux : bien différens en
cela des autres conquérans qui fcmbloient ne chercher
que d ’autres ennemis, comme les Scythes en
Afie ; ou à étendre leurs frontières, comme les fondateurs
des quatre grands empires.
L ’effet de ces colonies de barbares fut d’effarOu-
cher les Arts , & de répandre l’ignorance dans les
contrées où elles s’établirent : en même tems elles y
augmentèrent la population, & fondèrent de puif*
fantes monarchies.
V. L a cinquième efpece de colonies efl de celles
qu’a fondées i’efprit de commerce, 6c qui enrichif-
fent la métropole.
T y r , Carthage, &Marfeille, les feules villes de
l’antiquité qui ayent fondé leur puiffance fur le commerce
, font auffi les feules qui ayent fuivi ce plan
dans quelques-unes de leurs colonies. Utique bâtie
par les Tyriens près de 200 ans avant la fuite d ’E-
liffa, plus connue fous le nom deDidon, ne prétendit
jamais à aucun empire fur les terres de l’Afrique :
elle fervoit de retraite aux vaiffeaux des T y riens ,
ainfi que les colonies établies à Malthe & le long
des côtes fréquentées par les Phéniciens. C ad ix ,
l’une de leurs plus anciennes & de leurs plus fameu-
fes colonies, ne prétendit jamais qu’au commerce de
l’Efpagne, fans entreprendre de lui donner des lois.
L a fondation de Lilybée en Sicile ne donna auxTy^
riens aucune idée de conquête fur cette île.
Le commerce ne fut point l’objet de rétabliffe-
ment de Carthage, mais elle chercha à s’aggrandir
par le commerce. C ’efl pour l’étendre ou le confer-
ve r exclufivement, qu’elle fut guerriere, & qu’on
la vit difputer à Rome la Sicile , la Sardaigne, l’Efpagn
e, l’Ita lie, & même fes remparts. Ses colonies
le long des côtes de l’Afrique , fur l’une &c l’autre
mer jufqu’à Cerné, augmentoient plus fes richeffes
que la force de fon empire.
Marfeille, colonie des Phocéens chaffés de leur pay s
Sc enfuife de l’île de Corfe par les T y rien s, ne s’occupa
dans un territoire flérile que de fa pêche, de
fon commerce, & de fon indépendance. Ses colonies
en Efpagne & fur les côtes méridionales des Gaule
s, n’a voient point d’autres motifs.
Ces fortes d’établiffemens étoient doublement né-
ceffaires aux peuples qui s’adonnoient au commerce.
L eur navigation dépourvûe du fecoursde la bouf*
fo ie , étoit timide ; ils n’ofoient fe hafarder trop loin
des côtes, & la longueur néceffaire des voyages exi-
geoit des retraites fures & abondantes pour les navigateurs.
La plupart des peuples avec lefquels ils
trafiquoient, ou ne fe raffembloient point dans des
villes, ou uniquement occupés de leurs befoins, ne
mettoient aucune valeur au fuperflu. Il étoit indif-
pénfable d’établir des entrepôts qui fiffent le commerce
intérieur, & oh les vaiffeaux puffent en arrivant
faire leurs échanges.
L a forme de ces colonies répondoit affez à celles
des nations commerçantes de l’Europe en Afrique &C
dans l’Inde : elles y ont des comptoirs & des forteref-
fe s , pour la commodité & la fureté de leur commerce.
Ces colonies dérogeroient à leur inflitution , fi
elles devenoient conquérantes, à moins que l’état
ne fe chargeât de leur dépenfe ; il faut qu’elles foient
fous la dépendance d’une compagnie riche & exclu-
five, en état de former & de fuivre des projets politiques.
Dans l’Inde on ne regarde comme marchands
que les Anglois, parmi les grandes nations de l’Europe
qui y commercent ; fans doute, parce qu’ils y
font les moins puiffans en poffeffions. *
VI. La découverte de l’Amérique vers la fin du
N N n n