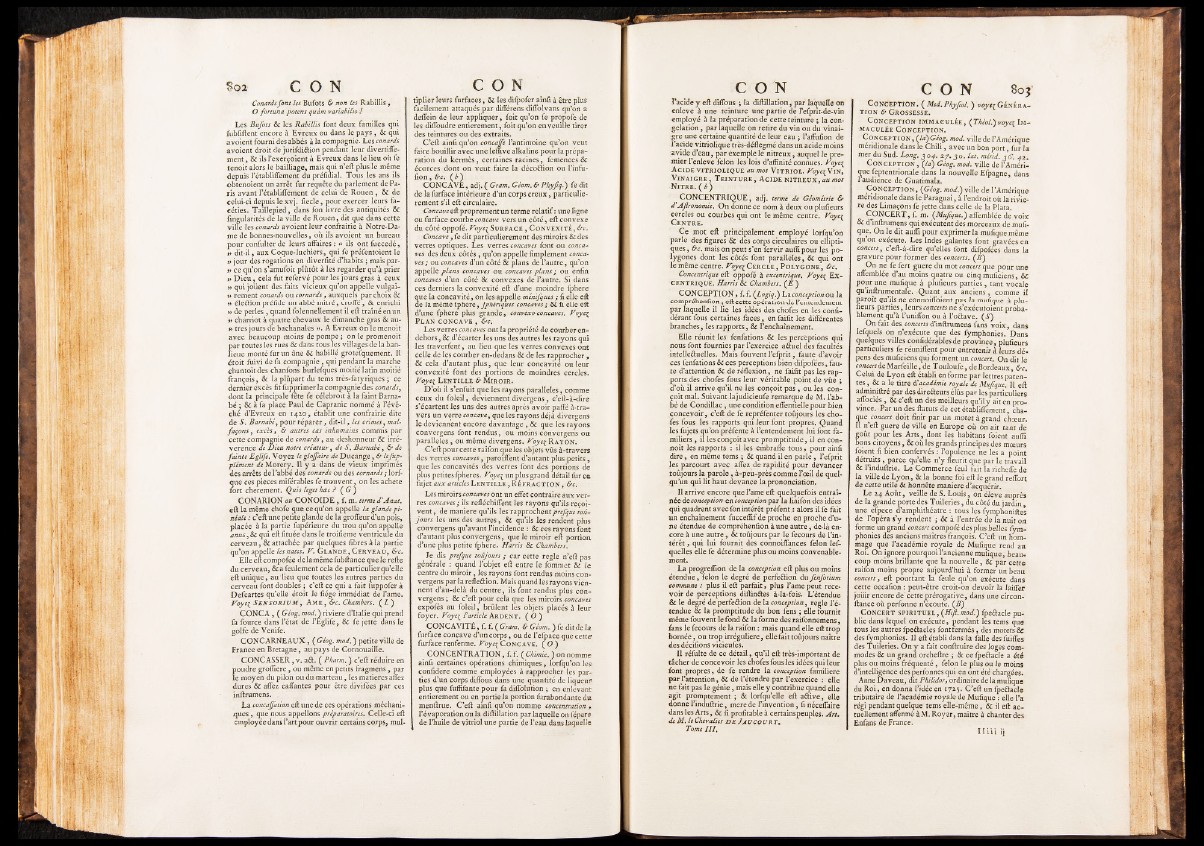
•Conards font les Bufots & non tes Rabillis,
O fortuna potens quàm vaiiabilis J
Les Bufots St les Rabillis font deux familles qui
fubfiftent encore à Evreux ou dans le pays , & qui
avoient fourni des abbés à la compagnie. Les conards
avoient droit de jurifdiélion pendant leur divertiffe-
ment, St ils l’exerçoient à Evreux dans le lieu où fe
tenoit alors le bailliage, mais qui n’eft plus le même
depuis l’établiffement du préfidial. Tous les ans ils
obtenoient un arrêt fur requête du parlement de Paris
avant l’établiffement de celui de Rouen , St de
celui-ci depuis le xv j. fiecle, pour exercer leurs facéties.
Taillepied, dans fon livre des antiquités St
fingularités de la ville de Rouen, dit que dans cette
ville les conards avoient leur confrairie à Notre-Dame
de bonnes-nouvelles, où ils avoient un bureau
pour confulter de leurs affaires : « ils ont fuccedé,
» dit-il, aux Coque-luchiers, qui fe préfentoient le
» jour des rogations en diverfité d’habits ; mais par-
» ce qu’on s’amufoit plutôt à les regarder qu’à prier
» D ie u , cela fut refervé pour les jours gras à ceux I
» qui jouent des faits vicieux qu’on appelle vulgai-
>» rement conards ou cornards , auxquels par choix St
» éleâion préfide un abbé mitré, croffé, & enrichi
» de perles, quand folennellement il eft traîné en un
»> charriot à quatre chevaux le dimanche gras & au-
#> très jours de bachanales ». A Evreux on le menoit
avec beaucoup hioin's de pompe ; on le promenoit
par toutes les rues St dans tous les villages de la banlieue
monté fur un âne & habillé grotefquement. Il
ctoit fuivi de fa compagnie, qui pendant la marche
chantoit des chanfons burlefques moitié latin moitié
françois, & la plûpart du tems très-fatyriques ; ce
dernier excès fitfupprimerla compagnie des conards,
dont la principale fête fe célebroit à la faint Barna-
bé ; & à fa place Paul de Capranic nommé à l’évêché
d’Evreux en 1420, établit une confrairie dite
de S. Barnabe, pour réparer , dit-il, les crimes, malfaçons
, excès , & autres cas inhumains commis par
cette compagnie de conards, au deshonneur & irrévérence
de Dieu notre créateur , de S . Barnabe, & de
fainte Eglife. V oyez legloffaire de D ucange, & lefup-
pllment de Morery. Il y a dans de vieux imprimés
des arrêts de l ’abbé des conards ou des cornards; lorf-
que ces pièces miférables fe trouvent, on les acheté
fort chèrement. Quis leget hoec ? { G )
CONARION ou CONOIDE , f. m. terme d'Anat.
eft la même chofe que ce qu’on appelle la glande pi-
néale : c’eft une petite glande de la groffeurd’un pois,
placée à la partie fupérieure du trou qu’on appelle
anus, St qui eft fituée dans le troifieme ventricule du
cerveau, & attachée par quelques fibres à la partie
qu’on appelle lesnates. V . Glande,C erveau, &c.
Elle eft compofée de la même fubftance que le refte
du cerveau, St a feulement cela de particulier qu’elle
eft unique, au lieu que toutes les autres parties du
cerveau font doubles ; c’eft ce qui a fait fuppofer à
Defcartes qu’elle étoit le fiége immédiat de l’ame.
Voyez S e n s o r i v M, A m e , & c. Chambers. ( Z )
CONCA , ( Géog. mod. ) riviere d’Italie qui prend
fafource dans l’état de l’Eglife, St fe jette dans le
golfe de Venife.
CONCARNEAUX, ( Géog. mod. ) petite ville de
France en Bretagne , au pays de Cornouaille.
CONCASSER, v . a£t. ( Pharm. ) c’eft réduire en
poudre grofliere, ou même en petits fragmens, par
le moyen du pilon ou du marteau, les matières allez
dures St affez caftantes pour être divifées par ces
inftrumens. ,
La co/icajfation eft une de ces opérations méchani-
ques, que nous appelions préparatoires. Celle-ci eft
employée dans l’art pour ouvrir certains corps, multiplier
leurs furfaces, & les difpofer ainfi à être plus
facilement attaqués par différens diffolvans qu’on a
deffein de leur appliquer, foit qu’on fe propofe de
les diffoudre entièrement, foit qu’on en veuille tirer
des teintures ou des extraits.
C ’-eft ainfi qu’on concajfe l’antimoine qu’on veut
faire bouillir avec une lelîive alkaline pour la préparation
du kermès, certaines racines, femences St
écorces dont on veut faire la décoftion ou l’infu-
fion, &c. ( b )
CO NC A VE , adj. ( Gram. Géom. & Pkyfiq.') fe dit
de la furface intérieure d’un corps creux, particulièrement
s’il eft circulaire.
Concave eft proprement un terme relatif : une ligne
ou furface courbe concave vers un côté, eft convexe
du côté oppofé. Voye^ Su rface , C o n v ex it é , &c.
Concave , fe dit particulièrement des miroirs St des
verres optiques. Les verres concaves font ou concaves
des deux côtés , qu’on appelle fimplement concaves;
ou concaves d’un côté & plans de l’autre, qu’on
appelle plans concaves ou concaves plans ; ou enfin
concaves d’un côté & convexes de l’autre. Si dans
ces derniers la convexité eft d’une moindre fphere
que la concavité, on les appelle ménifques ; fi elle eft
de la même fphere, fphériques concaves; St fi elle eft
d’une fphere plus grande, convexo-concaves. Voye£
Plan co n c a v e , &c.
Les verres concaves ont la propriété de courber en-
dehors , & d’écarter les uns des autres les rayons qui
les traverfent, au lieu que les verres convexes ont
celle de les courber en-dedans St de les rapprocher ,
& cela d’autant plus, que leur concavité ou leur
convexité font des portions de moindres cercles.
Foye[ Len til le & Miroir.
D ’où il s’enfuit que les rayons parallèles, comme
ceux du foleil, deviennent divergens, c’eft-à-dire
s’écartent les uns des autres après avoir paffé à-travers
un verre concave, que les rayons déjà divergens
le deviennent encore davantage , St que les rayons
convergens font rendus, ou moins convergens ou
parallèles, ou même divergens. Voye{ Ra yo n .
C ’eft pour cette raifon que les objets vus à-travers
des verres concaves, paroiffent d’autant plus petits,
que les concavités des verres font des portions de
plus petites fphereç. Voye^ un plus grand détail fur ce
lu je t a u x articles L en t il le , Ré f r a c t io n , & c.
Les miroirs concaves ont un effet contraire aux verres
concaves; ils refléchiffent les rayons qu’ils reçoiv
ent, de maniéré qu’ils les rapprochentprefque toujours
les uns des autres, St qu’ils les rendent plus
convergens qu’avant l’incidence : St ces rayons font
d’autant plus convergens, que le miroir eft portion
d’une plus petite fphere. Harris St Chambers,
Je , dis prefque toujours ; car cette réglé n’eft pas
générale : quand l’objet eft entre le fommet St le
centre du miroir, les rayons font rendus moins convergens
par la refleélion. Mais quand les rayons viennent
d’au-delà du centre, ils font rendus plus convergens
; & c’eft pour cela que les miroirs concaves
expofés au foleil, brûlent les objets placés à leur
foyer. Voye^ Varticle Ardent. ( O )
CONCAVITÉ, f. f. ( Gram. & Géom. ) fe dit de la
furface concave d’un corps, ou de l’efoace que cette*
furface renferme. Voye^ C o n c a v e . ( O )
CONCENTRATION, f. f, ( Chimie. ) on nomme
ainfi certaines opérations chimiques, lorfqu’on les
çonfidere comme employées à rapprocher les parties
d’un corps diffous dans une quantité de liqueur*
plus que fuffifante pour fa diffolution ; en enlevant
entièrement ou en partie la portion furabondante du
menftrue. C ’eft ainfi qu’on nomme concentration ,
l’évaporation ou la diftillation par laquelle on fépare
de l’huile de vitriol une partie de l’eau dans laquelle
l’acide y eft diffous ; la diftillation, par laquelle on
enleve à une teinture une partie de l’efprit-de-vin
employé à la préparation de cette teinture ; la congélation
, par laquelle on retire du vin ou du vinai-
-gre une certaine quantité de leur eau ; l’affufion de
l’acide vitriolique très-déflegmé dans un acide moins
avide d’eau, par exemple le nitreux, auquel le premier
Fenleve félon les lois d’affinité connues. Voye^
A cide v itr io l iq u e au mot V it r io l . VoyefSfin,
Vin a ig r e , T e in tu r e , A cide n itr eu x , au mot
Nit r e . ( é )
t CONCENTRIQUE, adj. terme de Géométrie &
d’AJlronomie, On donne ce nom à deux ou plufieurs
cercles ou courbes qui ont le même centre. Foye{
C en tr e .
Ce mot eft principalement employé lorfqu’on
parle des figures St des corps circulaires ou elliptiques
, &c. mais on peut s’en fervir auffi pour les polygones
dont les côtés font parallèles, St qui ont
le même centre. Voy e^C e r c le , Po l yg o n e , & c.
Concentrique eft oppofé à excentrique. Voyeç Ex cen
tr iqu e. Harris St Chambers. ( E )
CONCEPTION, f. f. ([Logiq.) La conception ou la
compréhenfion, eft cette opération de l’entendement
par laquelle il lie les idées des chofes en les confi-
dérant fous certaines faces, en faifit les différentes
branches, les rapports, St l’enchaînement.
Elle réunit les fenfations & les perceptions qui
nous font fournies par l’exercice aftuel des facultés
intelleftuelles. Mais fouvent l’efprit, faute d’avoir
ces fenfations & ces perceptions bien difpofées, faute
d’attention Si de réflexion, ne faifit pas les rapports
des chofes fous leur véritable point de vue ;
d’où il arrive qu’il ne les conçoit p a s, ou les conçoit
mal. Suivant lajudicieufe remarque de M. l’abbé
de Condillac, une condition effentielle pour bien
concevoir, c’eft de fe repréfenter toûjours les chofes
fous les rapports qui leur font propres. Quand
les fujets qu’on préfente à l’entendement lui font familiers
, il les conçoit avec promptitude, il en con-
noît les rapports : il les embraffe tous, pour ainfi
dire, en même tems ; St quand il en parle , l’efprit
les parcourt avec affez de rapidité pour devancer
toûjours la parole, à-peù-près comme l’oeil de quelqu’un
qui lit haut devance la prononciation.
Il arrive encore que l’ame eft quelquefois entraînée
de conception en conception par la liaifon des idées
qui quadrent avec fon intérêt préfent,: alors ilfe fait
un enchaînement fucceffif de proche en proche d’une
étendue de compréhenfion à une autre, de-là encore
à une autre, St toûjours par le fecours de l’intérêt
, qui lui fournit des connoiffances félon lesquelles
elle fe détermine plus ou moins convenablement.
La progreflion de la conception eft plus ou moins
étendue, félon le degré de perfeftion du fenforium
commune : plus il eft parfait, plus l’ame peut recevoir
de perceptions diftinâes à-la-fois. L’étendue
St le degré de perfeûion de la conception, réglé l’étendue
St la promptitude du bon fens ; elle fournit
même fouvent le fond & la forme des raifonnemens,
fans le fecours de la raifon : mais quand elle eft trop
bornée, ou trop irrégulière, elle fait toûjours naître
des décifions vicieufes.
Il réfulte de ce détail, qu’il eft très-important de
tâcher de concevoir les chofes fous les idées qui leur
font propres, de fe rendre la conception familière
par l’attention, St de l’étendre par l’exercice : elle
ne fait pas le génie, mais elle y contribue quand elle
-agit promptement ; & lorfqu’elle eft aftive, elle
donne l’induftrie, mere de l’invention, fi néceffaire
dans les Arts, St fi profitable à certainspeuples. Art.
de M. le Chevalier D E J A U GO U R T,
Tome III.
C oncept ion . ( Med. Phyfiol. ) voyt^ Générat
io n & Grossesse.
C once pt ion im m a cu lé e , ( Théol.)voye{ Immaculée
C once pt ion.
C o nce pt io n , ( là) Géog. mod. ville de l’Amérique
méridionale dans le C h ili, avec un bon port, fur la
mer du Sud. Long. 304. 2 7 .3 0 . lat. mérid. 36 . 42.
C o nce pt io n , {la) Géog. mod. ville de l’Amérique
feptentrionale daris la nouvelle Efpagne, dans
l’audience de Guatimala.
C o n c e pt io n , {Géog. mod.') ville de l ’Amérique
méridionale dans le Paraguai, à l’endroit où la rivière
des Limaçons fe jette dans celle de la Plata.
CONCERT, f. m. (Mujique.) affemblée de voix
St d’inftrumens qui exécutent des morceaux de mufi-
que. On le dit auffi pour exprimer la mufiquemême
qu’on exécute. Les Indes galantes font gravées en
concert, c*eft-à-dire qu’elles font difpofées dans la
gravure pour former des concerts. {B)
On ne fe fert guere du mot concert que pour une
affemblée d’au moins quatre ou cinq muficiens, St
pour une mufique à plufieurs parties, tant vocale
qu’inftrumentale. * Quant aux anciens , comme il
paroît qu’ils ne connoiffoient pas la mufique à plu-
ïieurs parties, leurs concerts ne s’exécutoient probablement
qu’à l’uniffon ou à l’oftave. {S)
On fait des. concerts d’inftrumens fans vo ix , dans
lefquels on n’exécute que des fymphonies. Dans
quelques villes confidérablesde province, plufieurs
particuliers fe réunifient pour entretenir à leurs dépens
des muficiens qui forment un concert. On dit le
concert de Marfeille, de Touloufe, de Bordeaux, 6*c.
Celui de Lyon eft établi en forme par lettres patentes
, St a le titre d’académie royale de Mufique. Il eft
adminiftré par des dire&eurs élûs par les particuliers
affociés, St c’eft un des meilleurs qu’il y ait en province.
Par un des ftatuts de cet établiffement, chaque
concert doit finir par un motet à grand choeur.
Il n’eft guere de ville en Europe où on ait tant de
goût pour les Arts, dont les habitans foient auffi
bons citoyens, St où les grands principes des moeurs
foient fi bien confervés : l’opulence ne les a point
détruits , parce qu’elle n’y fleurit que par le travail
St l’induftrie. Le Commerce feul fait la richeffe de
la ville de Lyon, & la bonne foi eft le grand reffort
de cette utile & honnête maniéré d’acquérir.
Le 24 Août, veille de S. Louis, on éleve auprès
de la grande porte des Tuileries, du côté du jardin,
une efpece d’amphithéatre : tous les fymphoniftes
de l’opéra s’y rendent ; St à l’entrée de la nuit on
forme un grand concert compofé des plus belles Symphonies
des anciens maîtres françois. C ’eft un hommage
que l’académie royale de Mufique rend au
Roi. On ignore pourquoi l’ancienne mufique, beaucoup
moins brillante que la nouvelle, St par cette
raifon moins propre aujourd’hui à. former un beau
concert, eft pourtant la feule qu’on exécute dans
cette occafion : peut-être croit-on devoir la laiffer
jouir encore de cette prérogative, dans une circon-
ftance où perfonne n’écoute. (B)
C oncert s p ir it u e l , {Hift.mod.) fpe&acle public
dans lequel on exécute, pendant les tems que
tous les autres fpettacles font fermés, des motets St
des fymphonies. Il eft établi dans la fa lie des fuiffes
des Tuileries. On y a fait conftruire des loges commodes
St un grand orcheftre ; & ce fpe&acle a été
plus ou moins fréquenté, félon le plus ou le moins
d’intelligence desperfonnes qui en ont été chargées.
Anne Daveau, dit Philidor, ordinaire de la mufique
du R oi, en donna l’idée en 1725. C ’eft un fpeftacle
tributaire de l’académie royale de Mufique : elle l’a
régi pendant quelque tems elle-même, St il eft actuellement
afferme à M. Royer, maître à chanter des
Enfans de France*
I l n i ij