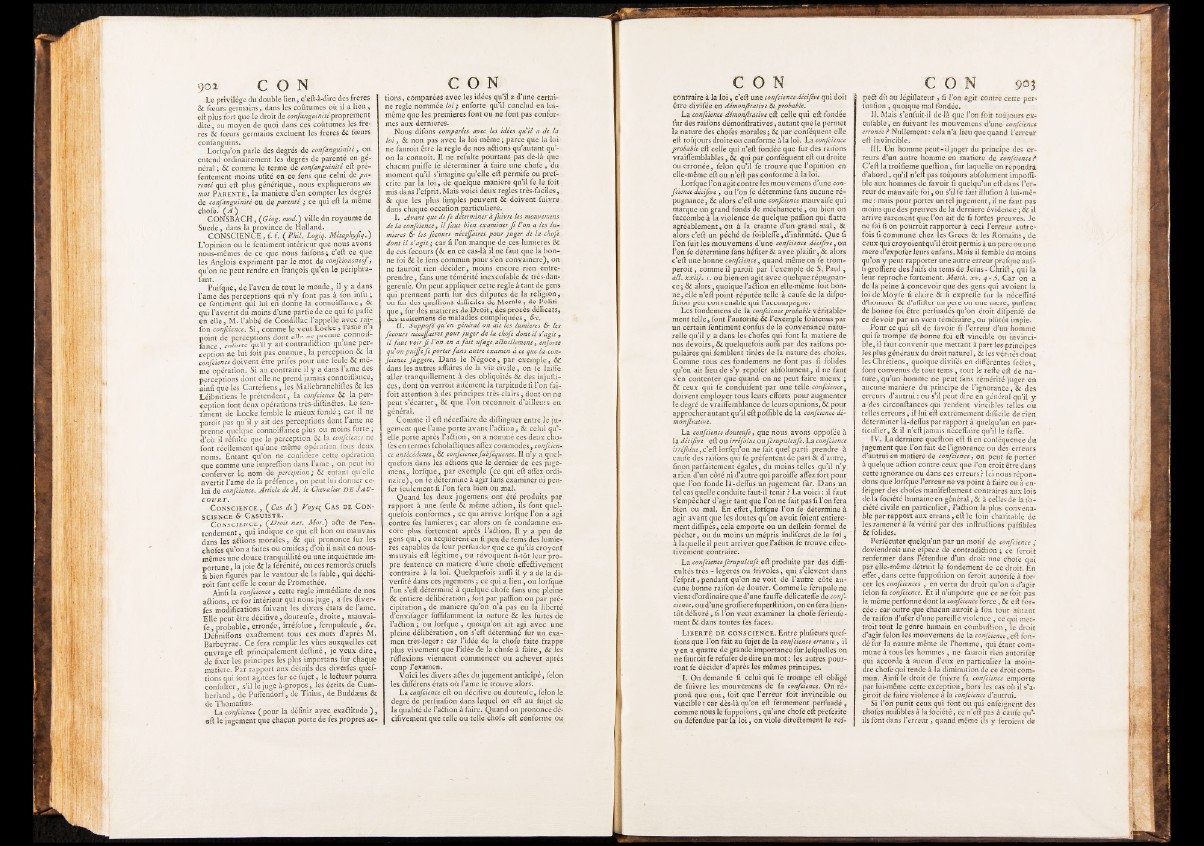
9 oi C O N
Le privilège du double lien, c’eft-à-dire des freres
& foeurs germains, dans les coutumes oii il a lieu ,
eft plus fort que le droit de confanguinité proprement
dite, au moyen de quoi dans ces coutumes les freres
& foeurs germains excluent les freres &c foeurs
confanguins.
Lorlqu’on parle des degrés de confanguinité, on
entend ordinairement les degrés de parente en général;
& comme le terme de confanguinité eft. pré-
fentement moins ufité en ce fens que celui de parenté
qui eft plus générique, nous expliquerons au
mot Parenté, la maniéré d’en compter les degrés
de confanguinité ou de parenté : ce qui eft la meme
chofe. (A )
CONSBACH, (Géog. mod.) ville du royaume de
Suede, dans la province de Halland.
CONSCIENCE, f. f. ( Phil. Logiq. Métaphyfiq.)
L’opinion ou le fentiment intérieur que nous avons
nous-mêmes de ce que nous faifons ; c’eft ce que
les Anglois expriment par le mot de confciousnesf,
qu’on ne peut rendre en françois qu’en le périphra-
lant.
Puifque, de l’aveu de tout le monde, il y a dans
l’ame des perceptions qui n’y font pas à fon mfu ;
ce fentiment qui lui en donne la connoiffance, &
qui l’avertit du moins d’une partie de ce qui fe pafle
en elle, M. l’abbé de Condillac l’appelle avec rai-
fon confcience. Si, comme le veut Locke , l arfte n a
point de perceptions dont eH** «•= prenne ^connoi -
lance, enforcc qu’il y ait contradiction qu une perception
ne lui foit pas connue, la perception & la
confcience doivent être prifes pour une feule & même
opération. Si au contraire il y a dans l’ame des
perceptions dont elle ne prend jamais connoiffance,
ainfi que les Cartéfiens, les Mallebranchiftes & les
Léibnitiens le prétendent, la confcience & la perception
font deux opérations très-diftindes. Le fentiment
de Locke femble le miéux fonde ; car il ne
paroît pas qu’il y ait des perceptions dont l’ame ne
prenne quelque connoiffance plus ou moins forte ;
d’où il réfulte que la perception & la confcience ne
font réellement qu’une même operation fous deux
noms. Entant qu’on ne confidere cette opération
que comme une impreffion dans l’ame , on peut lui
conferver le nom de perception; & entant qu’elle
avertit l’ame de fa préfence, on peut lui donner celui
de confcience. Article de M. le Chevalier DE Ja u-
COURT.
C onscience, ( G w de) Voyei C as de Conscience
6* C asuiste.
C o n s c i e n c e , (Droit nat. Mor.j acte de l’entendement
, qui indique ce qui eft bon ou mauvais
dans les adions morales, & qui prononce fur les
chofes qu’on a faites ou omifes ; d’où il naît en nous-
mêmes une douce tranquillité ou une inquiétude importune
, la joie & la férénité, ou ces remords cruels
fi bien figurés par le vautour de la fable, qui déchi-
roit fant ceffe le coeur de Promethée.
Ainfi la confcience, cette réglé immédiate de nos
adions, ce for intérieur qui nous juge, a fes diver-
fes modifications fuivant les divers états de l’ame.
Elle peut être décifive , douteufe, droite, mauvai-
f e , probable, erronée, irréfolue, fcrupuleufe, &c.
Définiffons exadement tous ces mots d’après M.
Barbeyrac. Ce fera remplir les vues auxquelles cet
ouvrage eft principalement deftiné, je veux dire,
de fixer les principes les plus importans fur chaque
matière. Par rapport aux détails des diverfes quef-
tions qui font agitées fur ce fujet, le ledeur pourra
confulter, s’il le juge à-propos, les écrits de Cumberland
, de Puffendorf, de Titius, de Buddæus &
de Thomafius. / .
La confcience (pour la définir avec exaditude ) ,
eft le jugement que chacun porte de fes propres ac-
C O N
tions, comparées avec les idées qu’il a d’une certaine
réglé nommée loi ; enforte qu’il conclud en lui-
même que les premières font ou ne font pas conformes
aux dernieres.
Nous difons comparées avec les idees qu’il a de la
loi, & non pas avec la loi même; parce que la loi
ne fauroit être la réglé de nos adions qu’autant qu’on
la connoît. Il ne refulte pourtant pas de-là que
chacun puiffe fe déterminer à faire une chofe, du
moment qu’il s’imagine qu’elle eft permife ou pref-
crite par la lo i, de quelque maniéré qu’il fe le foit
mis dans l’efprit. Mais voici deux réglés très-faciles,
& que les plus (impies peuvent & doivent fuivre
dans chaque occafion particulière.
I. Avant que de fe déterminer àfuivre les mouvemens
de la confcience 9 il faut bien examiner J i l ’on a les lumières
6* les fecours néceffaires pour juger de la chofe
dont i l s'agit ; car fi l’on manque de ces lumières &:
de ces fecours (& en ce cas-là il ne faut que la bonne
foi & le fens commun pour s’en convaincre), on
ne fauroit rien décider, moins encore rien entreprendre
, fans une témérité inexcufable & très-dan-
gereufe. On peut appliquer cette réglé à tant de gens
qui prennent parti fur des difputes de la religion,
ou fur des queftions difficiles de Morale, de Politique
, fur des matieres.de-Droit, des procès délicats,
des uaitemens de maladies compliquées, &c.
II. Suppofé qu’en général on ait les lumières & les
fecours néceJJaires pour juger de la chofe dont il s'agit,
il faut voir Ji l'on en a fait ufage actuellement, enforte
qu'on puiffe fe porter fans autre examen à ce que la confcience
fuggere. Dans le Négoce, par exemple, &
dans les autres affaires de la vie civile, on (è laiffe
aller tranquillement à des obliquités éc des injufti-
ces, dont on verroit aifément la turpitude fi l’on fai-
foit attention à des principes très-clairs, dont on ne
peut s’écarter, & que l’on reconnoît d’ailleurs en
général.
Comme il eft néceffaire de diftinguer entre le jugement
que l’ame porte avant l ’attion, & celui qu’elle
porte après l’aftion, on a nommé ces deux chofes
en termes fcholaftiques affez commodes, confcience
antécédente y & confcience fubféquente. Il n’y a quelquefois
dans les adions que le dernier de ces juge-
mens, lorfque, par exemple (ce qui eft affez ordinaire)
, on fe détermine à agir fans examiner ni pen-
fer feulement fi l’on fera bien ou mal.
Quand les deux jugemens ont été produits par
rapport à une feule & même a&ion, ils font quelquefois
conformes , ce qui arrive lorfque l’on a agi
contre fes lumières ; car alors on fe condamne encore
plus fortement après l ’adion. Il y a peu de
gens q ui, ou acquièrent en fi peu de tems des lumières
capables de leur perfuader que ce qu’ils croyent
mauvais eft légitime, ou révoquent fi-tôt leur propre
fentencè en matière d’une chofe effectivement
contraire à la loi. Quelquefois auffi il y a de la di-
verfité dans cës jugemens ; ce qui a lieu, ou lorfque
l’on s’eft déterminé à quelque chofe fans une pleine
& entière délibération, foit par paffion ou par précipitation
, de maniéré qu’on n’a pas eu la liberté
d’envifager fuffifamment la nature & les fuites de
l’adion ; ou lorfque , quoiqu’on ait agi avec une
pleine délibération, on s’eft déterminé fur un examen
très-leger : car l’idée de la chofe faite frappe
plus vivement que l’idée de la chofe à faire, & les
réflexions viennent commencer ou achever après
coup l’examen.
Voici les divers ades du jugement anticipé, félon
les différens états où l’ame fe trouve alors.
La confcience eft ou décifive ou douteufe, félon le
degré de perfuafion dans lequel on eft au fujet de
la qualité de l’adion à faire. Quand on prononce dé-
cifivement que telle ou telle chofe eft conforme ou
C O N
Contraire à la lo i, c’eft une confcience décifive qui doit
être divifée en démonjtrative & probable,
La confcience démonjtrative eft celle qui eft fondée
fur des raifons démonftratives, autant que le permet
la nature des chofes morales ; & par conféquent elle
eft toujours droite ou conforme à la loi. La confcience
probable eft celle qui n’eft fondée que fur des raifons
yraiffemblables, & qui par conféquent eft ou droite
ou erronée, félon qu’il fe trouve que l’opinion en
elle-même eft ou n’eft pas conforme à la loi.
Lorfque l’on agit contre les mouvemens d’une confcience
décifive, ou l’on fe détermine fans aucune répugnance
, & alors c’eft une confcience mauvaife qui
marque un grand fonds de méchanceté, ou bien on
fuccombe à la violence de quelque paffion qui flatte
agréablement, ou à la crainte d’un grand mal, &
alors c’eft un péché de foibleffe, d’infirmité. Que fi
l’on fuit les mouvemens d’une confcience décifive, ou
l’on fe détermine fans héfiter & avec plaifir, & alors
c’eft une bonne confcience, quand même on fe trom-
peroit, comme il paroît par l ’exemple de S. P au l,
uct. xx iij. i. ou bien on agit avec quelque répugnance
; & alors, quoique l’adion en elle-même foit bonne,
elle n’eft point réputée telle à caufe de la difpo-
fition peu convenable qui l’accompagne.
Les fondemens de la confcience probable véritablement
telle, font l’autorité & l ’exemple foùtenus par
un certain fentiment confus de la convenance naturelle
qu’il y a dans les chofes qui font la matière de
nos devoirs, & quelquefois auffi par des raifons populaires
qui femblent tirées de la nature des chofes.
Comme tous ces fondemens ne font pas^fi folides
qu’on ait lieu de s’y repofer abfolument, il ne faut
s’en contenter que quand on ne peut faire mieux ;
& ceux qui fe conduifent par une telle confcience,
doivent employer tous leurs efforts pour augmenter
le degré de vraiffemblance de leurs opinions, & pour
approcher autant qu’il eft poffible de la confcience dé-
monflrative.
La confcience douteufe, que nous avons oppofée à
la décifive eft ou irréfolue ou fcrupuleufe. La confcience
irre/ô/ue,c’eft lorfqu’on ne fait quel parti prendre à
caufe des raifons qui fe préfententde part & d’autre,
linon parfaitement égales, du moins telles qu’il n’y
a rien d’un côté ni d’autre qui paroiffe affez fort pour
que l’on fonde là-deffus un jugement fur. Dans un
tel cas quelle conduite faut-il tenir ? La voici : il faut
s’empêcher d ’agir tant que l’on ne fait pas fi l’on fera
bien ou mal. En effet, lorfque l’on fe détermine à
agir avant que les doutes qu’on avoit foient entièrement
diffipés, cela emporte ou un deffein formel de
pécher, ou du moins un mépris indiferet de la lo i ,
à laquelle il peut arriver que l’aâion fe trouve effectivement
contraire.
La confcience fcrupuleufe eft produite par des difficultés
très - legeres ou frivoles, qui s’élèvent dans
l’efprit, pendant qu’on ne voit de l’autre côté aucune
bonne raifon de douter. Comme le fcrupule ne
vient d’ordinaire que d’une fauffe délicateffe de conf
cience, ou d’une groffiere fuperftition, on en fera bientôt
délivré, fi l ’on veut examiner la chofe férieufe-
ment & dans toutes fes faces.
Liberté de conscience. Entre plufieurs queftions
que l’on fait au fujet de la confcience errante, il
y en a quatre de grande importance fur lefquelles on
ne fauroit fe refuler de dire un mot : les autres pourront
fe décider d’après les mêmes principes.
I. On demande fi celui qui fe trompe eft obligé
de fuivre les mouvemens de fa confcience. On répond
que o u i, foit que l’erreur foit invincible ou
vincible : car dès-là qu’on eft fermement perfuadé ,
comme nous le fuppofons, qü’une chofe eft preferite
ou défendue par la lo i, on viole dire&ement le ref-
C O N 9 Ô3
peâ du au légiflateur, fi l’on agit contre cette per-
(ùafion , quoique mal fondée.
II. Mais s’enfuit-il de-là que l’on foit toujours ex-
cufable, en fuivant les mouvemens d’une confiience
erronée ? Nullement; cela n’a lieu que quand l ’erreur
eft invincible.
III. Un homme p eut-il juger du principe des erreurs
d’un autre homme en matière de confcience?
C ’eft la troifieme queftion, fur laquelle on répondra
d’abord, qu’il n’eft pas toujours abfolument impoffi-
ble aux hommes de favoir fi quelqu’un eft dans l’ef-
reur de mauvaife fo i, ou s’il fe fait illufion à lui-mêa
me : mais pour porter un tel jugement, il ne faut pas
moins qüe des preuves de la derniere évidence ; & il
arrive rarement que l’on ait de fi fortes preuves* Je
në fai fi on pourroit rapporter à ceci l’erreur autrefois
fi commune chez les Grecs & les Romains, de
ceux qui croy oient qu’il étoit permis à un pere ou une
mere d’expoler leurs enfans. Mais il femble du moins
qu’on y peut rapporter une autre erreur preferue auffi
groffiere des Juifs du tems de Jefus - Chrift, qui la
leur reproche fortement. Matth. xv. 4 - S. Car on a
de la peine à concevoir que des gens qui avoient la
loi de M oyfe fi claire & fi expreffe fur la néceffité
d’honorer & d’affifter un pere ou une mere, puffent
de bonne foi être perfuadés qu’on étoit difpenfé de
ce devoir par un voeu téméraire, ou plutôt impie*
Pour ce qui eft de favoir fi l’erreur d’un homme
qui fe trompe de bonne foi eft vincible ou invincible,
il faut convenir que mettant à part les principes
les plus généraux du droit naturel, & les vérités dont
les Chrétiens, quoique divifés en différentes feftes,
font convenus de tout tems , tout le refte eft de nature,
qu’un homme ne peut fans témérité juger en
aucune maniéré du principe de l’ignorance, & des
erreurs d’autrui : ou 9’il peut dire en général qu’il y
a des cirCDnftances qui rendent vincibles telles ou
telles erreurs, il lui eft extrêmement difficile de rien
déterminer là-deffus par rapport à quelqu’un en particulier,
& il n’eft jamais néceffaire qu’il le faffe.
IV. La derniere queftion eft fi en conféquence du
jugement que l’on fait de l’ignorance ou des erreurs
d’autrui en matière de confcience, on peut fe porter
à quelque a&ion contre ceux que l’on croit être dans
cette ignorance ou dans ces erreurs? Ici nous répondons
que lorfque l’erreur ne va point à faire ou à en-
feigner des chofes manifeftement contraires aux lois
de la fôciété humaine en général, & à celles de la fo-
ciété civile en particulier, l’aftion la plus convena*
ble par rapport aux errans, eft le foin charitable de
les ramener à la vérité par des inftru&ions paifibles
& folides.
Perfécuter quelqu’un par un motif de confcience £
deviendroit une efpece de contradiction ; ce feroit
renfermer dans l’étendue d’un droit une chofe qui
par elle-même détruit le fondement de ce droit. En
effet, darts cette fuppofition on feroit autOrifé à forcer
les confciences , en vertu du droit qu’on a d’agir
félon fa confcience. Et il n’importe que ce ne foit pas
la même perfonne dont la confcience force * & eft forcée
: car outre que chacun auroit à fOn tour alitant
de raifon d’ufer d’une pareille violence , ce qui met-
troit tout le genre humain en combuftion, le droit
d’agir félon les mouvemens de la eorifcience, eft fondé
fur là nature même de l’homme, qui étant commune
à tous les hommes * ne fauroit rien autorifer
qui accorde à aucun d’eux en particulier la moindre
chofe qui tende à la diminution de ce droit commun.
Ainfi le droit de fiiivre fa confcience emporte
par lui-même cette exception, hors les cas Où il s’a-
giroit de faire violence à la confcience d’autrui.
Si l’on punit ceux qui font ou qui enfeignent des
chofes ntiifibles à la fôciété, ce n’eft pas à caufe qu’ils
font dans l’erreur, quand même ils y feroient de