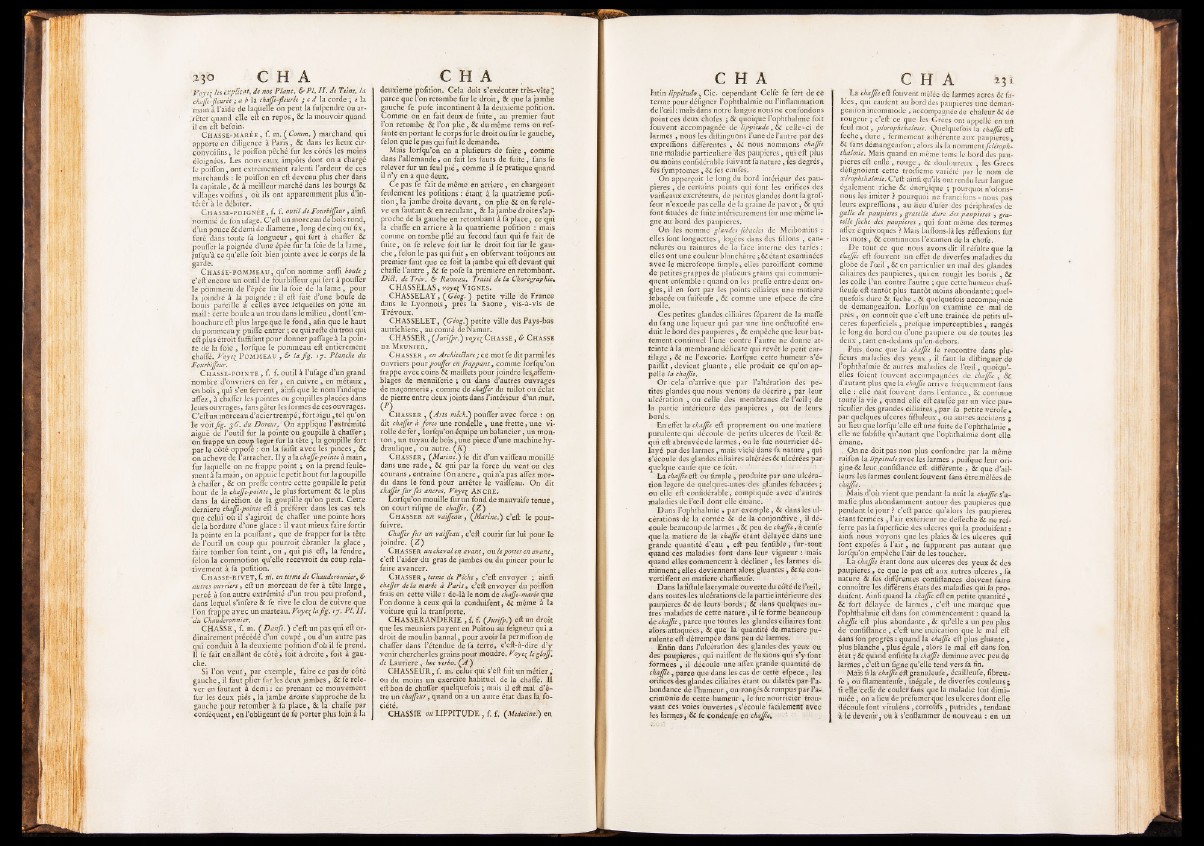
y 0yei lès ixplicat, de nos f iant. & PL I I . de Teint, la.
chaffe-fleurie ; a b la chajfe-fieurée ; c d la corde ; e la
main à l’aide de laquelle on peut la fufpendre ou arrê
te r quand elle eft en repos, 8c la mouvoir quand
il én eft béfoin.
C hasse-marée , f. m. ( Comm. ) marchand qui
apporte en diligence à Paris, & dans les lieux cir-
convoifins, le poiflon pêché fur les côtés les moins
éloignées. Les nouveaux impôts dont on a chargé
le poiffon, ont extrêmement ralenti l’ardeur de ces
marchands : le poiffon en eft devenu plus cher dans
la capitale, & à meilleur marché dans les bourgs &
villages voifins, où ils ont apparemment plus d’intérêt
à le débiter. # ■
C hasse-poignée , f. f. outil de Fourbiffeur, ainfi
nommé de fon ufage. C ’eft un morceau de bois rond,
d’un pouce & demi de diamètre, long de cinq où fix,
foré dans toute fa longueur, qui fert à chaffer &
pouffer la poignée d’une épée fur la foie de la lamé,
jufqu’à ce qu’elle foit bien jointe avec le corps de la
gardé;
C h AS SE-POMME a u , qu’on nomme aufli Boule ;
c’eft encore un outil de fourbiffeur qui fert à pouffer
le pommeau de l’épée fur la foie de la lame , pour
la joindre à la poignée : il eft fait d’une boule de
bouis pareille à celles avec lefquelles on joue au
mail i bette boule a un trou dans le milieu, dont l'embouchure
eft plus large que le fond, afin que le haut
du pommeau y puiffe entrer ; ce qui refte du trou qui
eft plus étroit fuffifant pour donner paffage à la pointe
de la foie , lorfque le pommeau eft entièrement
chaffe. Foye? Pommeau , & la fig. ty. Planche du
FourbiJJeur.
C hasse-po in te , f. f. outil à l’ufage d’un grand
nombre d’ouvriers en fer , en cuivre , en métaux,
en bois, qui s’en fervent, âihfi que le nom l’indique
aflëz, à chaffer les pointes ou goupilles placées dans
leurs ouvrages, fans gâter les formes de ces ouvrages.
C ’eft un morceau d’acier trempé ; fort aigu, tel qu’on
le voit fig. $6. du Doreur. On applique l’extrémité
aiguë de l’outil fur la pointe ou goupille à chaffer ;
on frappe un coup leger fur la tête ; la goupille fort
par le côté oppofé : on la faifît avec les pinces, &
on achevé de l’arracher. Il y a la. chajfe-pointe à main,
fur laquelle on ne frappe point ; on la prend feulement
à la main, on appuie le petit bout fur la goupille
à chaffer, & on preffe contre cette goupille le petit
bout de la chajfe-pointe, le plus fortement & le plus
dans la direftion de la goupille qu’on peut. Cette
derniere chajfe-pointe eft à préférer dans les cas tels
que celui où il s’agiroit de chaffer une pointe hors
de la bordure d’une glace : il vaut mieux faire fortir
la pointe en la pouffant, que de frapper fur la tête
de l’outil un coup qui pourroit ébranler la glace,
faire tomber fon teint, ou , qui pis eft, la fendre,
félon la commotion qu’elle recevroit du coup relativement
à fa pofition.
C hasse-r iv e t , f. m'. en terme de Chauderonrùer, &
autres ouvriers , eft un morceau de fer à tête large,
percé à fon autre extrémité d’un trou peu profond,
dans lequel s’infere & fe rive le clou de cuivre que
l’on frappe avec un marteau. Voyc^lafig. ty. Pl. I I .
'du Chàuderonnier.
CHASSÉ, f. m. ( Danfe. ) c’eft un pas qui eft ordinairement
précédé d’un coupé , ou d’un autre pas
qui conduit à la deuxieme pofition d’où il fe prend.
Il fe fait en allant de cô té, foit à droite, foit à gauche.
Si l’on veu t, par exemple, faire ce pas du côté
gauche, il faut plier fur les deux jambes , & fe relever
en fautant à demi : en prenant ce mouvement
fur les deux pies , la jambe droite s'approche de la
gauche pour retomber à fa place, & la chaffe par
conféquent, en l’obligeant de fe porter plus loin à la
C H A
deuxieme pofition. Cela doit s’exécuter très-vîte J
parce que l’on retombe fur le droit, & que la jambe
gauche fe pofe incontinent à la deuxieme pofition.
Comme on en fait deux de fuite, au premier faut
l’on retombe & l’on p lie, 8c du même tems on ref-
faute en portant le corps furie droit ou fur le gauche,
félon que le pas qui fuit le demande.
Mais lorfqu’on en a plufieurs de fuite , comme
dans l’allemande, on fait les fauts de fuite, fans fe
relever fur un feul p ié , comme il fe pratique quand
il n’y en a que deux.
Ce pas fe fait de même en arriéré, en chargeant
feulement les pofitions : étant à la quatrième pofition,
la jambe droite devant, on plie 8c on fe rele-
ve en fautant & en reculant, & la jambe droite s’approche
de la gauche en retombant à fa place, ce qui
la chaffe en arriéré à la quatrième pofition : mais
comme on tombe plié au fécond faut qui fe fait de
fuite, on fe releve foit fur le droit foit fur le gauche
, félon le pas qui fuit, en obfervant toûjours au
premier faut que ce foit la jambe qui eft devant qui
chaffe l’autre , 8c fe pofe la première en retombant.
Dicl. de Trév. & Rameau. Traité de la Chorégraphie*
CHASSELAS, voyeç V ignes.
CHASSELAY, (jGéog. ) petite ville de France
dans le Lyonnois, près la Saône, vis-à-vis de
Trévoux.
CHASSELET, (Géogf) petite ville des Pays-bas
autrichiens, au comté de Namur.
CHASSER, (Jurifpr.) voye{ C hasse , & C hasse
de Meunier.
C hasser , en Architecture; ce mot fe dit parmi les
ouvriers pour pouffer en frappant, comme lorfqu’on
frappe avec coins 8c maillets pour joindre les#affem-
blages de menuiferie ; ou dans d’autres ouvrages
de maçonnerie , comme de chaffer du tuilot ou éclat
de pierre entre deux joints dans l’intérieur d’un mur.
r a I , g I ■ |
C hasser , ( Arts meck.) pouffer avec force : on
dit chaffer à force une rondelle , une frette , une vi-
rolle de fer, lorfqu’on équipe un balancier, un mouton
, un tuyau de bois, une piece d’une machine hydraulique,
ou autre. (A )
C hasser , (Marine.) fe dit d’un vaiffeau mouillé
dans une rade, &c qui par la force du vent ou des
courans , entraîne fon ancre, qui n’a pas affez mordu
dans le fond pour arrêter le vaiffeau. On dit
chaffer fur fes ancres. Voyeç A ncre.
Lorfqu’on mouille fur un fond de mauvaife tenue,
on court rifque de chaffer. (Z )
C hasser un vaiffeau , (Marine.) c’eft le pour-
fuivre.
Chaffer fur un vaiffeau, c’eft courir fur lui pour le
joindre. (Z )
C hasser unckevalen avant, ou le porter en avant,
c’eft l’aider du gras de jambes ou du pincer pour le
faire avancer.
C hasser , terme de Pêche, c’eft envoyer ; ainfi
chaffer delà marée à Paris, c’eft envoyer du poiffon
frais en cette ville : de-là le nom de chaffe-marée que
l’on donne à ceux qui la conduifent, & même à la
voiture qui là tranlporte.
CHASSERANDERIE , f. f. (’Jurifp.) eft un droit
que les meuniers payent en Poitou au ieigneur qui a
droit de moulin bannal, pour avoir la permiflîon de
chaffer dans l’étendue de fa terre, c’eft-à-dire d’y
venir chercher les grains pour moudre. Voyeç leglojf.
de Lauriere , hoc verbo. (A )
CHASSEUR, f. m. celui qui s’eft fait un métier ,
ou du moins un exercice habituel de la chaffe. Il
eft bon de chaffer quelquefois ; mais il eft mal d’être
un chaffeur, quand on a un autre état dans la fo-
ciété.
CHASSIE oïl LIPPITUDE , f. f, (Médecinet) en
latin lippitudo, Cic. cependant Celfe le fert de cè
terme pour défigner l’ophthalmie ou l’inflammation
de l’oeil : maïs dans notre langue nous ne confondons
point ces deux chofes ; & quoique l’ophthalmie foit
fouvent accompagnée de lippitude, & celle-ci de
larmes , nous les diftinguons l’une de l’autre par des
expreflions différentes , & nous nommons chajfie
une maladie particulière'des paupières, qui eft plus
ou moins considérable fuivant fa nature, les degrés,
fes fyiftptomes , & fes eau fes.
On apperçoit le long du bord intérieur des paupières
, de certains points qui font les orifices des
vaiffeaux excréteurs, de petites glandes dont la grof*
feur n’excede pas celle de la graine de pavot, & qui
font fituées de fuite intérieurement fur une même ligne
au bord des paupières.
On les nomme glandes jèbacees de Meibomius :
elles font longuettes , logées dans des filions , cannelures
ou rainures de la face interne dés tarfe's :
elles ont une couleur blanchâtre ;& étant examinées
avec le microfcope fimple, elles paroiffent comme
de petites grappes de plufieurs grains qui communiquent
enfemble : quand'on les preffe entré deux ongles
, il en fort par les points ciliaires une matière
fobacée ou fuifeufe , 8c comme une efpece de ciré
molle.
Ces petites glandes ciliaires féparent de la maffe
du fang une liqueur qui par une fine on&uofité enduit
le bord des paupières , & empêche que leur battement
continuel l’une contre l’autre ne donne atteinte
à la membrane délicate qui revêt le petit cartilage,
8c ne.l’excorie. Lorlque 'céfte humeur s’é-
paiflit, devient gluante, elle produit ce qu’on appelle
la chajfie.
Or cela n’arrive que par l’altération des petites
glandes que nous. Venons de décrire ^ par leur
ulcération , ou celle des membranes de l’oeil £ de
la partie intérieure des paupières , ou de: leurs
bqrdsv -
En effet la chajfie eft proprement ou une matière:
purulente qui découle de petits ulcérés de l’oeil 8c
qui eft abreuvée de larmes, ou le fùc nourricier délayé
par des larmes , mais vicié'dans fa nature , qui
s’écoule des glandes ciliaires altérées & ulcérées par-
quelque cauie que ce foit.
La chaffe eü ou fimple, produite par une ulcération
legere de quelques-unes des glandes febacées ;
ou elle eft confidérablê, compliquée avec <fautres
maladies de l’oeil dont elle émane.
Dans l’ophthalmie , par- exemple, & dans les ul-
cérations de la cornée & de là conjonâive , il-découle
beaucoup de larmes , 8c peu de chajfie , h caufe
que la matière de la chajfie étant délayée' dans une
grande quantité d’eau , eft peu fenfible , 'für-toUt
quand ces maladies font dans-leur vigueur : mais
quand elles commencent à décliner , les larmes diminuent
; elles deviennent alors gluantes, & fe coh-
vertiffent en matière chaflieufe. ■
Dans la fiftule lacrymale Ouverte du coté de l’oeil,
dans toutes les ulcérations’de la partie intérieure des.
paupières 8c de leurs bords ; & dans quelques au tres
maladies de cette nature ,’ il fe forme'beaucoup
de chaffie, parce que toutes les glandes ciliaires font
alors- attaquées y & que la quantité de matière purulente
eft détrempée dans peu de larmes.
Enfin dans Tulcération des' glandes dès yeuX ou
des paupières, qui naiffent de fluxions qui s -y-font
formées , il découle une affez grande quantité de
chajfie, parce que dans les cas de-cette efpece,. les
orifices des glandes ciliaires étant ou dilates par l ’abondance
de l’humeur-, ou rongés & rompus par l’acrimonie
de cette humeur , le fuc nourricier trouvant
ces voies ouvertes, s’écoule facilemcrtt avec
les larmes , ôc fe condenfe en chajfie,
t La chajfie eft fouvent mêlée de larmes acres & fa-
lees, qui caufent au bord des paupières une demarf-
geaifon incommode, accompagnée de chaleur & de
rougeur ; c’eft ce que les Grecs ont appellé en un
feul mot, plorophthalmie. Quelquefois la chajfie eft
feche, dure , fermement adhérente aux paupières y
& fans demangeaifon ; alors ils la nomment feléroph*
thalmie. Mais quand en même tems le bord des paupières
eft enfle , rouge , & douloureux , les Grecs
défignoient cette troifieme variété par le nom de
xérophthalmie. C ’eft ainfi qu’ils ont rendu leur languO
également riche & énergique ; pourquoi n’ofons-
nous les imiter ? pourquoi ne francifons - nous pas
leurs expreflions, au lieu d’ufer des périphrafes de
galle de paupières , gratelle dure des paupières , gra-
telle feche des paupières , qui font même des termes
affez équivoques ? Mais laiffons-là les réflexions fur
les mots, & continuons l’examen de la chofe.
De tout ce que nous avons dit il réfulte que la
chajfie eft fouvent .un effet de diverfes maladies du
globe de l’oe i l , & en particulier un mal des glandes
ciliaires des paupières, qui en rougit les bords , &
les colle l’un contre l’autre ; que cette humeur chaf-
fieufe eft tantôt plus tantôt moins abondante ; quelquefois
dure & feche , & quelquefois accompagnée
de demangeaifon. Lorfqu’on examine ce mal de
près , on connoît que c’eft une .traînée de petits ulcérés
fuperficiels, prefque imperceptibles , rangés
.le long du. bord ou d’une paupière ou de toutes les
deux , tant en-dedans qu’en-dehors.
Puis(donc que la chajfie ,fe rencontre dans plu-
fiëurs maladies des yeux , il faut la diftinguerde
l’ophthalmie & autres maladies de l’oe il, quoiqu’elles
foient fouvent accompagnées de chajfie , 8c
d’autant plus que la chajfie arrive fréquemment fans
efte : elle naît fouvent dans l’enfance, & continue
toute'là v ie , quhhd elle eft caùféupar un vice particulier
des grandes ciliaires , par la petite vérole ,
par quelques ulcérés fiftuleux, ou autres accidens ;
àu lieu que lorfqu’elle eft une luite de l’ophthalmie ,
elle ne fubfifte qù’autant que l’ophthalmié dont elle
émane.
t On ne doit pas non plus confondre par la même
raifon la lippitude avec les larmes , puifque leur origine
& leur.çonfiftance eft différente, & que d’ailleurs
les larmes coulent fouvent fans être mêlées de
chajfie.
Mais d’où vient que pendant la nuit la chafie s’a-
maffe plus abondamment autour des paupières que
pendant le jour ? c’eft parce qü’alors les paupières
étant fermées , l’air extérieur ne deffeche & ne refr
ferre pas la fuperficie des ulcérés qui la produifent :
àihfi nous voyons que les plaies & les ulcérés qui
font éxpofes à l’a i r , ne fuppurent pas autant , que
lorfqu’on empêche l’air de les toucher.
La chajfie étant donc aux ulcérés des yeux & des
paupières, ce que le pus eft aux autres ulcérés, fa
nature & fes différentes çonfiftances doivent faire
Connoitrë les différens .états des maladies qui la produifent.
Ainfi quand la cli'ajjie eft en petite quantité ,
& fort délayee de larmes , .c’eft une marque que
l’ophth'almie eft dans fon commencement : quand la
chajfie eft plus abondante , & qu’elle a un peu plus
de confiftànee , c’eft une indication que le mal eft
dans fon' progrès : quand la chajfie eft plus gluante ,
plus blanche , plus égale , alors le mal eft dans fon
état ;'■ & quand enfiiitë la chajfie diminue avec peu dé
larmes, c’eft un ligne qu’elle tend vers fa fin.
Mais fila chajfie eftgranuleufe, écaillëilfe, fibreu-
fè > OÙ filàmènteufè,’ inégale, de diverfes couleurs ;
fi elle' ceffe de couler faiis que la maladie foit diminuée
, on a lieu de prélùmer que les ulcérés dont elle
•découle font vfruléns , corrofifs, putrides , tendant
à le devenir, ou à s’enflammer de nouveau : en un