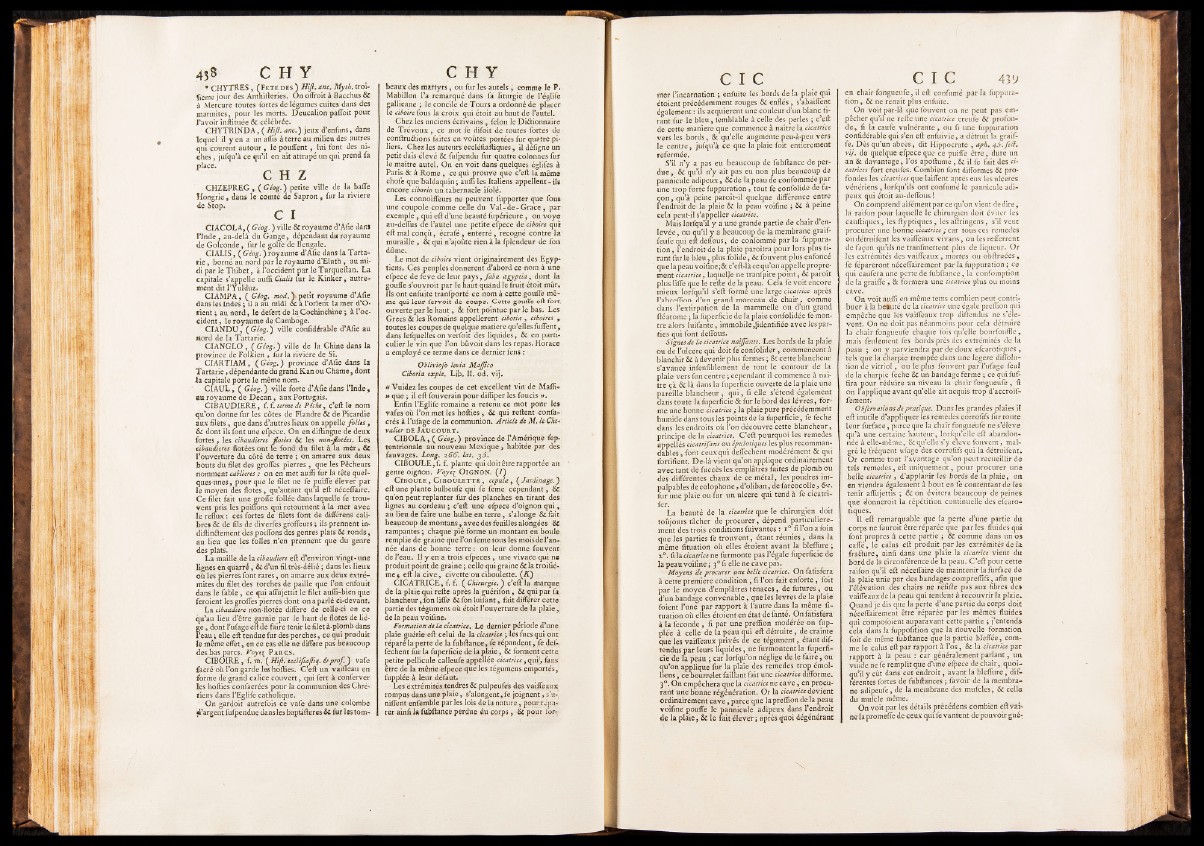
4 ? 8 C H Y
* CHYTRES, f Fete des ) Hiß. anc. Myth. troi-
fi'eme jour des Anthifteries. On offroit à Bacchus &
à Mercure toutes fortes de légumes cuites dans des
marmites, pour les morts. Deucalion paffoit pour
l’avoir inftituée & célébrée.
CHYTRINDA, ( Hiß. anc. ) jeux d’enfans, dans
lequel il y en a un affis à terre au milieu des autres
qui courent autour , le pouffent, lui font des niches
, jufqu’à ce qu’il en ait attrapé un qui prend fa
place.
C H Z
: CHZEPREG, ( Géog. ) petite ville de la baffe
Hongrie, dans le comté de Sapron , fur la rivière
de Stop.
C I
CIACÖLA, ( Géog. ) ville & royaume d’Afie dant
l’Inde , au-delà du Gange, dépendant du royaume
de Golconde, fur le golfe de Bengale.
CIALIS, ( Géog. ) royaume d’Afie dans la Tarta-
r ie , borné au nord par le royaume d’Eluth , au midi
par le Thibet, à l’ôccident par le Turqueftan. La
capitale s’appelle aulli Cialis fur le Kinker, autre*
ment dit l’Yuldüz.
CIAMPA, ( Géog. mod. petit royaume d’Afie
dans les Indes ; il a au midi ôc à l’orient la mer d’O-
rient ; au nord, le defert de laCochinchine ; à l’occident
, le royaume de Cambôge.
CIANDU, ( Géog. ) ville confidérable d’Afie au
nord de la Tartarie.
CIAN GLO, ( Géog. ) ville de la Chine dans la
province de Folkien , fur la riviere de Si.
CIARTIAM, ( Géog. ) province d’Afie dans la
Tartarie, dépendante du grand Kan ou Chame, dont
2a capitale porté le même nom.
C IA U L , ( Géog. ) ville forte d’Afie dans l’Inde »
au royaume de Decan, aux Portugais.
CIBAUDIERÉ, f. f. terme de Pêche, c’eft le nom
qu’on donne fur les côtes de Flandre & de Picardie
aux filets, que dans d’autres lieux on appelle folles ,
&C dont ils font une efpece. On en diftingue de deux
fortes, les cibaudieres fiotées & les non-fiotées. Les
cibaudierts fiotées ont le fond du filet à la mer > &
l ’ouverture du côté de terre ; on amarre aux deux
bouts du filet des groffes pierres , que les Pêcheurs
nomment cablierts : on en met auffi fur la tête quel*
ques-urtes, pour que le filet ne fe puiffe élever par
le moyen des Ilotes, qu’autant qu’il eft néceffaire.
Ce filet fait une greffe foliée dans laquelle fe trouvent
pris les poiffons qui retournent à la mer avec
le reflux : ces fortes de filéts font de différens calibres
& de fils de diverfes groffeiirs ; ils prennent in*-
diftinttement des poiffons des genres plats & ronds,
au lieu que les folles n’en prennent que du genre
des plats.
La maille.de la cibaudiere eft d’environ vingt-urtô
lignes èn quarré, & d ’un fil très-délié ; dans les lieux
où les pierres font rares, on amarre aux deux extrémités
du filet des torches de paille que l’on enfouit
dans le fable, ce qui affujettit le filet auffi-bien que
feroient les groffes pierres dont on a parlé ci-devant.
La cibaudiere non-flotée différé de celle-ci en ce
qu’au lieu d’être garnie par le haut de flotes de liège
, dont l’ùfage eft de faire tenir le filet à-plomb dans
l’eau ; elle eft tendue fur des perches, ce qui produit
le même effet, en ce cas elle ne différé pas beaucoup
des bas parcs. Voyeç Pa r c s .
CIBOIRE, f. m. ( Hiß.'tccUfiaßiq. & prof. ) vafe
facré où l’on garde les hofties. C ’eft un vaiffeau en
forme de grand calice couvert, qui fert à conferver
les hofties confacrées pour la communion des Chrétiens
dans l’Eglife catholique.
On gardoit autrefois ce vafe dans une colombe
d’argent fufpendue dans les baptifteres & fur les tom-
C H Y
beaux dés martyrs, ou fur les a u te ls com m e lé P*
Mabillon l’a remarqué dans fà liturgie de l’églife
gallicane ; le concile de Tours a ordonné de placer
le ciboire fous la croix qui étoit au haut de l’autel.
Chez les anciens écrivains , félon le Di&ionnaire
de T ré vou x, ce mot fe difoit de toutes fortes de
conftruélions faites en voûtes portées fur quatre piliers.
Chez les auteurs eccléfiaftiques, il defigne un
petit dais élevé & fufpendu fur quatre colonnes fur
le maître autel. On en voit dans quelques églifes à
Paris & à Rome , ce qui prouve que c’eft la même
chofe que baldaquin ; auffi les Italiens appellent - ils
encore ciborio un tabernacle ifolé.
Les connoiffeurs ne peuvent fupporter que fous
une coupole comme celle du V a l-d e -G râ c e , par
exemple, qui eft d’une beauté fupérieure, on voye
au-deffus de l’autel une petite efpece de ciboire qui
eft mal conçû, écrafé, enterré, recogné contre la
muraille, & qui n’ajoûte rien à la fplendeur de fon
dôme.
Le mot de ciboire vient Originairement des Egyptiens.
Ces peuples donnèrent d’abord ce nom à une
efpece de feve de leur pays, faba oegyptia, dont la
gouffe s’ouvroit par le haut quând le fruit étoit mûr.
Ils ont enfuite tranfporté ce nom à cette gouffe même
qui leur fetvoit de coupe. Cette gouffe eft fort,
ouverte par le h aut, & fort pointue par le bas. Les
Grecs & les Romains appelèrent ciboria , ciboires »
toutesles coupes de quelque matière qu’elles fuffent,
dans lefquelles on verfoit des liquides, & en particulier
le vin que l’on bûvoit dans les repas. Horace
a employé ce terme dans ce dernier fens :
Obliviofo levia Maffico
Ciboria expie. Lib. II. od. vij.
« Vuidez les coupes de cet excellent vin de Maffi*
» que ; il eft fouverain pour diffiper les foucis ».
Enfin l’Eglife romaine a retenu ce mot pour les
vafes où l’on met les hofties , & qui reftent confa-
crés à l’ufage de la communion. Article de M. le Che-
valier DE JAUCOURT.
C IBO LA , ( Géog. ) province de l’Amérique fep-
tentrionale au nouveau Mexique , habitée par des
fauvages. Long. z6 6 . lat. y S.
CIBOULE, f. f. plante qui doit être rapportée ait
genre oignon. Voye^ Oign on. (/)
C ïboulè , C ibo u le t te , cepula, ( Jardinage. )
eft une plante bulbeufe qui fe feme cependant, &
qu’on peut replanter fur des planches en tirant des
lignes au cordeau ; c’eft une efpece d’oignon q u i,
au lieu de faire une bulbe en terre, s’alonge & fait
beaucoup de montans, avec des feuilles alongées &
rampantes ; chaque pié forme un montant en boule
remplie de graine que l’on feme tous les mois de l’année
dans de bonne terre : on leur donne fouvent
de l’eau. Il y en a trois efpeces , une vivace qui ne
produit point de graine ; celle qui graine & la troifié-
me $ eft la c iv e , civette ou ciboulette. (K )
CICATR ICE, f. f. ( Chirurgie. ) c’eft la marque
de la plaie qui refte après la guérifon, & qui par fa
blancheur, ion liffe & fon luifant, fait différer cette
partie des tégumens où étoit l’ouverture de la plaie,
de la peau voifine.
Formation de la cicatrice. Le dernier période d’une
plaie guérieeft celui de la cicatrice ; les fucs qui ont
réparé la perte de la fubftance, fe répandent, fe dei-
fechent fur la fuperficie de la plaie, & forment cette,
petite pellicule calleufe appellée cicatrice, qui1, fans:
être de la même èfpece que les tégumens emportés,
fupplée à leur défaut.
Les extrémités, tendres & pulpeufes des vaiffeaux
rompus dans une p laie, s’alongent, fe joignent, s’u-
niffent enfemble par les lois de la nature, pour repu*,
rer ainfi la fubftance perdue du corps, & pour for-
C I C
mer l’incarnation ; enfuite les bords de la- plaie qui
étoient précédemment rouges & enflés, s’abaiffent
également : ils acquièrent une couleur d’un blanc tirant
fur le bleu, lèmblable à celle des perles ; e’ eft
de cette maniéré que commence à naître la cicatrice
vers les bords, & qu’elle augmente peu-à-peu vers
le centre, jufqu’à ce que la plaie foit entièrement
refermée.
S’il n’y a pas eu beaucoup de fubftance de perdue
, & qu’il n’y ait pas eu non plus beaucoup de
pannicule adipeux, & de la peau de confommée par
une trop forte fuppuration, tout fe confolide de façon
, qu’à peine paroît-il quelque différence entre
l’endroit de la plaie & la peau voifine ; & à peine
cela peut-il s’appelier cicatrice.
Mais lorfqu’il y a une grande partie de chair d’enlevée
, ou qu’il y a beaucoup de la membrane graif-
feufe qui eft dèffous, de confommé par la fuppuration
, l’endroit-de la plaie paroîtra pour lors plus tirant
fur le b leu, plus folide, & fouvent plus enfoncé
que la peau voifine;& c’eft-là ce qu’on appelle proprement
cicatrice, laquelle ne tranfpire point, & paroît
plus liffe que le refte de la peau. Cela fe voit encore
mieux lorfqu’il s’eft formé une large cicatrice après!
l ’abceffion d’un grand, morceau de chair, comme
dans l’extirpation de la mammelie ou d’un grand
ftéatome ; la fuperficie de la plaie confolidée fe montre
alors luifante, immobile,{identifiée avec les parties
qui font deffous.
Signes de la cicatrice naiffante. Les bords de la plaie
ou de l’ulcere qui doit fe confolider, commencent à
blanchir & à devenir plus fermes ; & cette blancheur
s’avance infenfiblemerit de tout le contour de la
plaie vers fon centre ; cependant il commence à naître
çà & là dans la fuperficie ouverte de la plaie une
pareille blancheur, q ui, fi elle s’étend également
dans toute la fuperficie & fur le bord des lèvres, forme
une bonne cicatrice ; la plaie pure précédemment
humide dans tous les points de la fuperficie, fe feche
dans les endroits où l’on découvre cette blancheur,
principe de la cicatrice. C’eft pourquoi les remedes
appelles cicatrifans ou épulotiques les plus recommandables
, font ceux qui deffechent modérément & qui
fortifient. De-là vient qu’on applique ordinairement
avec tant dè fuccèsles emplâtres faites de plomb ou
des différentes chaux de ce métal, les poudres impalpables
de colophone, d’oliban, de farcocolle , &c.
fur une plaie ou fur un ulcéré qui tend à fe cicatri-
fer.L
a beauté de \a cicatrice que le chirurgien doit
toûjours tâcher de procurer, dépend particulièrement
des trois conditions fui vantes : i° fi l’on a foin
que les parties fe trouvent, étant réunies, dans la
même fituation où elles étoient avant la bleflure ;
i° . fi la cicatrice ne furmonte pas l’égale fuperficie de
la peau voifine ; 30 fi elle ne cave pas.
Moyens de procurer une belle cicatrice. On fatisfera
à cette première condition, fi l’on fait enforte, foit
par le moyen d’emplâtres tenaces, de futures, ou
d’un bandage convenable., que les levres de la plaie
foient l’une par rapport à l’autre dans la même fituation
où elles étoient en état defanté. On fatisfera
à la fécondé , fi par une preffion modérée on fupplée
à celle de la peau qui eft détruite, de crainte
que les Vaiffeaux privés de ce tégument, étant distendus
par leurs liquides, ne furmontentla fuperficie
de la peau ; car lorfqu’On néglige de le faire, ou
qu’on applique fur la plaie des remedes trop émoi-
liens, ce bourrelet faillartt fait une cicatrice difforme.
30. On empêchera que la cicatrice ne c a ve , en procurant
une bonne régénération. Or la cicatrice devient
ordinairement ca ve , parce que la preflion de la peau
voifine pouffe le pannicule adipeux dans l’endroit
de la p laie, & le fait élever ; après quoi dégénérant
C I C mi
en chair fongueufe, il eft confumé par la fuppuration
, & ne renaît plus enfuite.
On voit par-là que fouvent on ne peut pas empêcher
qu’il ne refte une cicatrice creufe & profonde,
fi la caufe vulnérante, ou fi une fuppuration
confidérable qui s’en eft enfuivie, a détruit la graif-
fe. Dès qu’un abcès, dit Hippocrate , aph. qS.fecl.
vij. de quelque efpece que ce puiffe être, dure un
an & davantage, l’os apoftume , & il fe fait des cicatrices
fort creufes. Combien font difformes & profondes
les cicatrices que laiffent après eux les ulcérés
vénériens, lorfqu’ils ont confumé le pannicule adipeux
qui étoit au-deffous !
On comprend aifément par ce qu’on vient de dire ,
la raifon pour laquelle le chirurgien doit éviter les
cauftiques, les ftyptiques, les aftringens, s’il veut
procurer une bonne cicatrice ; car tous ces remedes
ou détruifent les vaiffeaux vivans, ou les refferrent
de façon qu’ils ne tranfmettent plus de liqueur. Or
les extrémités des vaiffeaux, mortes ou obftruées,
fe fépareront néceffairement par la.fuppuration ; ce
qui caufera une perte de fubftance, la confomption
de la graiffe, & formera une cicatrice plus ou moins
cave.
On voit auffi en même tems combien peut contribuer
à la beftuté de la cicatrice une égale preffion qui
empêche que les vaiffeaux trop diftendus né s’élèvent.
On ne doit pas néanmoins pour cela détruire
la chair fongueufe chaque fois qu’elle bourfouflle,
mais feulement fes bords près des extrémités de la
peau ; on y parviendra par de doux efearotiques ,
tels que la charpie trempée dans une legere diffolu-
tion de v itrio l, ou le plus fouvent par l’ufage feul
dé la charpie feche & un bandage ferme ; ce qui fuf-
fira pour réduire au niveau la chair fongueufe , fi
on l’applique avant qu’ elle ait acquis trop d’accroif-
fement.
Obfervations de pratique. Darisles grandes plaies il
eft inutile d’appliquer les remedes corroûfs fur toute
leur furface, parce que la chair fongue'ufe ne s’élève
qu’à une certaine hauteur, lorfqu’elle eft abandonnée
à elle-même, & qu’ elle s’y eleve fouvent, malgré
le fréquent ufage des corrofifs qui la détruifent.
Or comme tout l’avantage qu’on peut recueillir de
tels remedes, eft uniquement, pour procurer une
belle cicatrice , d’applanir les bords de la plaie, on
en viendra également à bout en fe contentant de les
tenir affujettis ; & on évitera beaucoup de peines
que donneroit la répétition continuelle des efearotiques.
il eft remarquable que la perte d’une partie du
corps ne fauroit être réparée que par les fluides qui
font propres à cette partie ; & comme dans un os
Gaffé, le calus eft produit par lés extrémités de la
frafture, ainfi dans une plaie la cicatrice vient du
bord de la circonférence de la peau. C ’eft pour cette
raifon qu’il eft néceffaire de maintenir la furface de
la plaie unie par des bandages compreffifs, afin que
l’élévation des chairs ne réfifte pas aux fibres des
vaiffeaux de la peau qui tendent à recouvrir la plaie.
Quand je dis que la perte d’une partie du corps doit
néceffairement être réparée par les mêmes fluides
qui compofoient auparavant cette partie ; j’entends
cela dans la fuppofition que la rlouvelle formation
foit de même fubftance que la partie bleffée, comme
le calus eft par rapport à l’o s , & la cicatrice par
rapport à la peau : car généralement parlant, un
vuidé.ne fe remplit que d’une efpece de chair, quoiqu’il
y eût dans cet endroit, avant la bleffure, différentes
fortes de fubftances ; favoir de la membrane
adipeufe, de la membrane des mufcles, & celle
du mufcle même.
On voit par les détails précédens combien eft vaine
la promeffe de ceux qui fe vantent de pouvoir gué