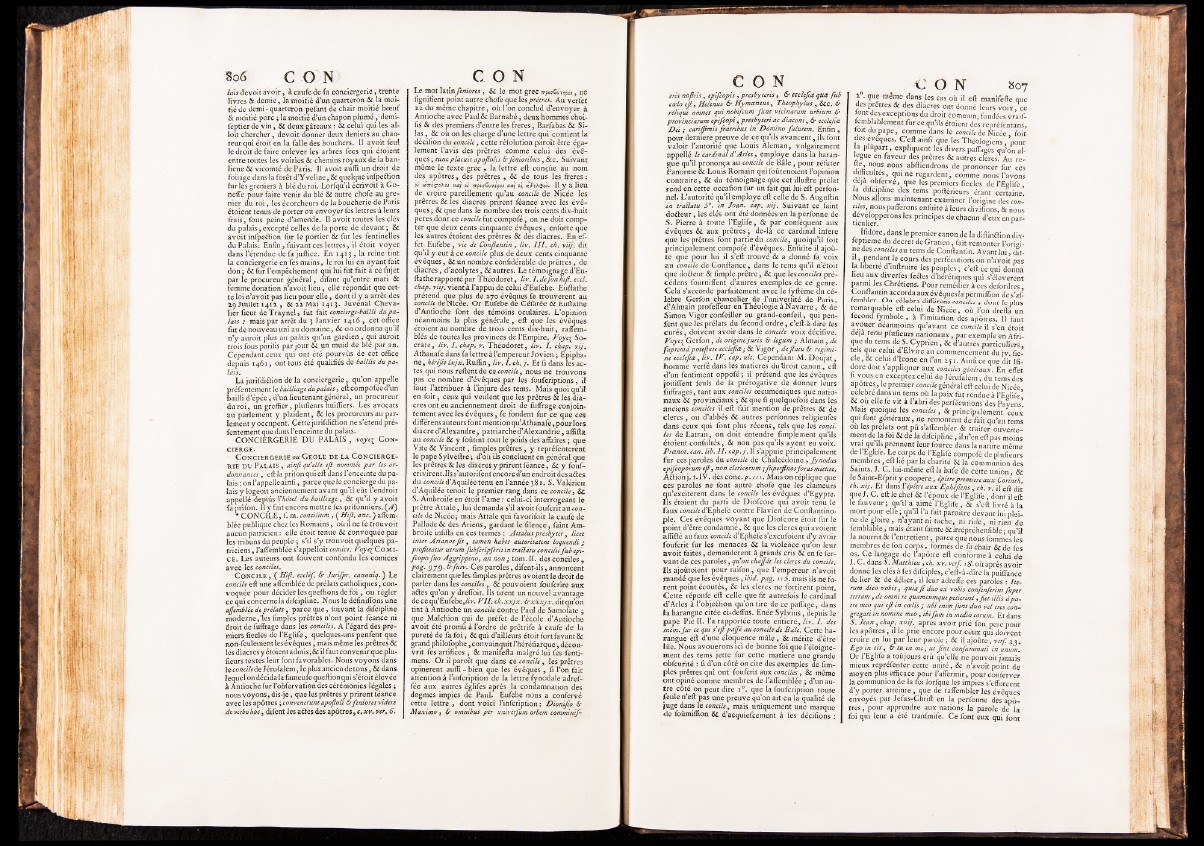
So 6 C O N
luis devoit avoir, à caufe de (a conciergerie, trente
livres & demie, la moitié d’un quarteron & la moitié
de demi - quarteron pefant de chair moitié boeuf
& moitié porc ; la moitié d’un chapon plumé, demi-
feptier de v in , 6c deux gâteaux : 6c celui qui les al-
k>it chercher, devoit donner deux deniers au chanteur
qui étoit en la falle des bouchers. Il avoit feul
le droit de faire enlever les arbres fees qui étoient
entre toutes les voiries & chemins royaux de la banlieue
6c vicomté de Paris. Il avoit aufli un droit de
foiiage dans la forêt d’Yveline, & quelque infpeôion
fur les greniers à blé du roi. Lorfqu’il écrivoit à Go-
neffe pour faire venir du blé & autre chofe au grenier
du ro i, les écorcheurs de la boucherie de Paris
étoient tenus de porter ou envoyer fes lettres à leurs
frais, fous peine d’amende. Il avoit toutes les clés
du palais, excepté celles de la porte de devant ; 6c
avoit infpeftion fur le portier 6c fur les fentinelles
du Palais. Enfin, fuivant ces lettres, il étoit voyer
dans l’étendue de fa juftice. En 1413 , la reine tint
la conciergerie en fes mains, le roi lui en ayant fait
don ; 6c fur l’empêchement qui lui fut fait à ce fujet
par le procureur général, difant qu’entre mari &
femme donation n’avoit lieu, elle répondit que cette
loi n’avoit pas lieu pour e lle, dont il y a arrêt des
19 Juillet 1 4 1 1 , & 12 Mai 1413. Juvenal Chevalier
fieur deTraynel, fut fait concierge-bailli du palais
: mais par arrêt du 3 Janvier 1416 , cet office
fut de nouveau uni au domaine, & on ordonna qu’il
n’y auroit plus au palais qu’un gardien , qui auroit
trois fous parifis par jour 6c un muid de blé par an.
Cependant ceux qui ont été pourvus de cet office
depuis 1461, ont tous été qualifiés de baillis du palais.
La jurifdi&ion de la conciergerie, qu’on appelle
préfentement le bailliage du palais, eft compofee d’un
bailli d’épée, d’un lieutenant général, un procureur
du roi, un greffier, plufieurs huiffiers. Les avocats
au parlement y plaident, & les procureurs au parlement
y occupent. Cette jurifdi&ion ne s’étend préfentement
que dans l’enceinte du palais.
CONCIERGERIE DU PALAIS , voye{ C onc
i e r g e .
C o n c i e r g e r i e ou G e ô l e d e l a C o n c i e r g e r
i e DD PALAIS , ainfi quelle efi nommée par les ordonnances
, eft la prifon qui eft dans l’enceinte du palais
: on l’appelle ainfi, parce que le concierge du palais
y logeoit anciennement avant qu’il eût l’endroit
appellé depuis Yhôtel du bailliage , & qu’il y avoit
fa prifon. H y fait encore mettre lés prifonniers. (^ )
* CONCILE, f. m. concilium, ( Hiß. anc. ) affera-
blée publique chez les Romains, où il ne fe trouvoit
aucun patricien : elle étoit tenue 6c convoquée par
les tribuns du peuple ; s’il s’y trouvoit quelques patriciens
, l’affemblée s’appelloit comice. Voye,[ C o m i c
e . Les auteurs ont fouvent confondu les comices
avec les conciles.
C o n c i l e , ( Hifi. eccléf. & Jurifpr. canoniq. ) Le
concile eft une affemblée de prélats catholiques, convoquée
pour décider les queftions de f o i , ou régler
ce qui concerne la difcipline. Nous le définiffons une
afiemblèe de prélats, parce que, fuivant la difcipline
moderne,‘les fimples prêtres n’ont point féance ni
droit de fuffrage dans 1 es conciles. A l’égard des premiers
fiecles de l’Eglife, quelques-uns penfent que
non-feulement les évêques, mais même les prêtres &
les diacresy étoientadmis;& il faut convenir que plufieurs
textes leur font favorables. Nous voyons dans
concile de Jérufalem, le plus ancien de tous, 6c dans
lequel on décidala fameufe queftion qui s’étoit élevée
à Antioche fur l’obfervation des cérémonies légales ;
nous voyons, dis-je, que les prêtres y prirent leance
avec les apôtres ; convenerunt apofioli & feniores vider.e
Jeverbohoc, difent les aûesdes apôtres, c,xv. ver. G.
C O N
Le mot latin feniores, & le mot grec Trpta^értpo/, ne
lignifient point autre chofe que les prêtres. Au verfet
1 1 du même chapitre, où l ’on conclud d’envoyer à
Antioche avec Paul 6c Barnabé, deux hommes choi-
fis & des premiers d’entre les freres, Barfabas 6c Si-
las , & où on les charge d’une lettre qui contient la
; décifion du concile, cette réfolution paroît être également
l’avis des prêtres comme celui des évêques
; tuneplacuit apofiolis & fenioribus, & c. Suivant
même le texte grec , la lettre eft conçue au nom
des apôtres, des prêtres , 6c de tous les freres :
oi ct7roç-oXot Kaj oi îrpêffôntpoi xetj ol. àS'tXtpo). Il y a lieu
de croire pareillement qu’au concile de Nicée les
prêtres 6c les diacres prirent féance avec les évêques
; 6c que dans le nombre des trois cents dix-huit
peres dont ce concile fut compofé, on ne doit compter
que deux cents cinquante évêques, enforte que
i les autres étoient des prêtres 6c des diacres. En ef-
; fet- Eufebe, vie de Conßantin, liv. I I I . ch. viij. dit
qu’il y eut à ce concile plus de deux cents cinquante
évêques, 6c un nombre confidérable de prêtres, de
diacres, d’acolytes, & autres. Le témoignage d’Eu-
ftathe rapporté par Théodoret, liv. I. de fon hiß. eccl.
chap. viij. vientjà l’appui de celui d’Eufebe. Euftathe
prétend que plus de 170 évêques fe trouvèrent au
concile de Nicee. Or Eufebe de Céfarée 6c Euftathe
d’Antioche font des témoins oculaires. L’opinion
néanmoins la plus générale, eft que les évêques
étoient au nombre de trois cents dix-huit, raffem-
blés de toutes les provinces de l’Empire. Voyer Socrate,
liv. I . chap.v. Théodoret , Uv. I. chap. vij.
Athanafe dans fa lettre à l’empereur Jovien ; Epipha-
ne, kérèfie Ixjx. Ruffin, liv. I . ch. j . Et fi dans les actes
qui nous reftent de ce concile, nous ne trouvons
pas ce nombre d’évêques par les fouferiptions, il
faut l’attribuer à l’injure des tems. Mais quoi qu’il
en foit, ceux qui veulent que les prêtres & les diacres
ont eu anciennement droit de fuffrage conjointement
avec les évêques, fe fondent fur ce que ces
différens auteurs font mention qu’Athanafe, pour lors
diacre d’Alexandre, patriarche d’Alexandrie, affifta
au concile 6c y foûtint tout le poids des affaires ; que
Vite 6c Vincent, fimples prêtres , y repréfenterent
le pape Sylveftre ; d’où ils concluent en général que
les prêtres & les diacres y prirent féance, 6c y foufi-
crivirent.Ils s’autorifent encore d’un endroit des aéles
du concile d’Aquilée tenu en l’année 381. S. Valérien
d’Aquilée tenoit le premier rang dans ce concile, &
S. Ambroife en étoit l ’ame : celui-ci interrogeant le
prêtre A ttale, lui demanda s’il avoit fouferit au concile
de Nicée; mais Attale qui favorifoit la caufe de
Pallade& des Ariens, gardant le filence, faint Ambroife
infifta en ces termes : Attalus presbyter, licet
inter Arianos f i t , tarnen habet autoritatem loquendi ;
profiteatur utrum fubfcripferitin traclatu concilii fubepi-
feopo fuo Aggrippino, an non j tom. II. des conciles ,
Paë; 9 7 9 ' &feiV' Ces paroles, difent-ils, annoncent
clairement que les fimples prêtres a voient le droit de
parler dans les conciles, 6c pouvoient fouferire aux
aftes qu’on y dreffoit. Ils tirent un nouvel avantage
de ce qu’Eulebe,/«'. VII. ch.xxjx. & x x x jx . dit qu’on
tint à Antioche un concile contre Paul de Samolate ;
que Malchion qui de préfet de l’école d’Antioche
avoit été promu à l’ordre de prêtrife à caufe de la
pureté de fa fo i , 6c qui d’ailleurs étoit fortfavant&
grand philofophe, convainquit l’héréfiarque, découvrit
fes artifices , & manifefta malgré lui fes fenti-
mens. Or il paroît que dans ce concile, les prêtres
opinèrent aufli - bien que les évêques , fi l’on fait
attention à l’infeription de la lettre fynodale adref-
fée aux autres églifes après la condamnation des
dogmes impies de Paul. Eufebe nous a confervé
cette lettre , dont voici l’infeription : Dionifio &
Maximo , & omnibus per uniyerfum orbem comminif-
C O N
cris nofiris, tpifeopis, presbyteris , 6* ecclefia qua fub
cotlo efi, Helenus & Hymæneus, Theophylus, & c . &
reliqui omnes qui nobifeum funt vicinarum urbium &
provinciarum epifeopi, presbyteri ac diaconi, & ecclefia
Déi ; cariffimis fratribus in Domino falutern. Enfin ,
pour derniere preuve de ce qu’ils avancent, ils font
valoir l’autorité que Louis Aleman, vulgairement
appellé le cardinal d'Arles, employé dans la harangue
qu’il prononça au concile de Bâle, pour réfuter
Panorme 6c Louis Romain qui foûtenoient l’opinion
contraire, & du témoignage que cet illuftre prélat
rend en cette occafion fur un fait qui lui eft perfon-
nel. L’autorité qu’il employé eft celle de S. Auguftin
in traclatu 5°. in Joan. cap. xij. Suivant ce faint
doéleur, les clés ont été données en la perfonne de
S. Pierre à toute l’Eglife, & par conléquent aux
évêques 6c aux prêtres ; de-là ce cardinal inféré
que les prêtres font partie du concile, quoiqu’il foit
principalement compofé d’évêques. Enfuite il ajoû-
te que pour lui il s’eft trouvé & a donné fa voix
au concile de Confiance, dans le tems qu’il n’étoit
que dofreur & fimple prêtre, 6c que les conciles pré-
cédens fourniffent d’autres exemples de ce genre.
Cela s’accorde parfaitement avec le fyftème du cé- j
lèbre Gerfon chancelier de l’univerfité de Paris,
d’Almain profeffeur en Théologie à Navarre, & de
Simon Vigor confeiller au grand-confeil, qui penfent
que les prélats du fécond ordre, c’ell-à-dire les
curés, doivent avoir dans le concile voix décifive.
Voyei G erfon, de origine juris & legum ; Almain, de
fupremâ potefiate ecclefia ; & Vigor , de fiatu & regimi-
ne ecclefia, liv. IV. cap. ult. Cependant M. Doujat,
homme verfé dans les matières du tiroit canon, eft
d’un fentiment oppofé ; il prétend que les évêques
joiiiffent feuls de la prérogative de donner leurs
fuffrages, tant aux conciles oecuméniques que nationaux
& provinciaux ; 6c que fi quelquefois dans les
anciens conciles il eft fait mention de prêtres & de
clerc s , ou d’abbés 6c autres perfonnes religieufes
dans ceux qui font plus récens, tels que les conciles
de Latran, on doit entendre Amplement qu’ils
étoient confultés, & non pas qu’ils ayent eu voix.
Pranot. can. lib. I I . cap.j. Il s’appuie principalement
fur ces paroles du concile de Chalcédoine , fynodus
epifeoporum efi , non clericorum ; fuperfiuos foras mittite.
Attion j. 1.1V . des conc. />.///. Mais on réplique que
ces paroles ne font autre chofe que les clameurs
qu’exciterent dans le concile les évêques d’Egypte.
Ils étoient du parti de Diofcore qui avoit tenu le
faux concile d’Ephefe contre Flavien de Conftantino-
ple. Ces évêques voyant que Diofcore étoit fur le
point d’être condamné, 6c que les clercs qui avoient
affilié au faux concile d’Ephefe s’exeufoient d’y avoir
fouferit fur les menaces 6c la violence qu’on leur
avoit faites, demandèrent à grands cris & en fe fer-
vant de ces paroles, qu'on chajfât les clercs du concile.
Us ajoûtoient pour raifon, que l’empereur n’avoit
mandé que les évêques, ibid. pag, 1 iS. mais ils ne furent
point écoutés, 6c les clercs ne fortirent point.
Cette réponfe eft celle que fit autrefois le cardinal
d’Arles à l’objefrion qu’on tire de ce paflage, dans
la harangue citée ci-deffus. Enée Sylvius, depuis le
pape Pie II. l’a rapportée toute entière, liv. I. des
mém.fur ce qui s'efi pajfé au concile de Bâle. Cette harangue
ell d’une éloquence mâle, & mérite d’être
lue. Nous avouerons ici de bonne foi que l’éloignement
des tems jette fur cette matière une grande
obfcurité : fi d’un côté on cite des exemples de fimples
prêtres qui ont fouferit aux conciles , 6c même
ont opiné comme membres de l’affemblée ; d’un autre
côté on peut dire i° . que la foufeription toute
feule n’eft pas une preuve qu’on ait eu la qualité de
juge dans le concile, mais uniquement une marque
de foûmiffion 6c d’acquiefcement à fes dédiions :
C O N 807
1°. que même dans les cas oii ii eft manifefte que
des prêtres & des diacres ont donné leurs vo ix , ce
iont des exceptions du droit commun, fondées vraif-f
lemWablement fur ce qu’ils étoient des repréfentàns,
101c du pape, comme dans le concile de Nicée foit
desevêques. C’eft ainfi que les Théologiens, pour
la plupart, expliquent les divers paffages qu’on allégué
en faveur des prêtres & autres clercs. Au re-
i ffi n? “S " 0US abffiendrons de prononcer fur ces
difficultés, qui ne regardent, comme nous l’avons
, ftue les premiers fiecles de l’Eglife,
la duciphne des tems poftérieurs étant certaine.
Wous allons maintenant examiner l’origine des con.
aies, nous paiferons enfuite à leurs divifions, & nous
développerons les principes de chacun d’eux en par-
tieuher. r
ne des conciles au tems de Conftantin. Avant lui, dir-
i 01 k cours ^es Perfécutions on n’avoit pas
la liberté d’tnftruire les peuples ; c’eft ce qui donna
lieu aux diverfes fefres ■ d’hérétiques qui s’élevèrent
parmi les Chrétiens. Pour remédier à ces defordres,
Conftantin accorda aux évêques la permiflîon de s’afi
lembler. On célébra différens conciles, dont le plus
remarquable eft celui de Nicée, où l’on dreffa un
lecond fymbole, à l’imitation des apôtres. Il faut
avouer neanmoins qu’avant ce concile il s’en étoit
déjà tenu plufieurs nationaux, par exemple en Afrique
du tems de S. Cyprien, 6c d’autres particuliers,
tels que celui d’Elvire au commencement du jv. fie-
c le , 6c celui d’Icone en l’an i<j 1. Ainfi ce que dit Ifi-
dore doit s’appliquer aux conciles généraux. En effet
fi vous en exceptez celui de Jérufalem, du tems des
apôtres, le premier concile général eft celui de Nicée
célébré dans un tems où la paix fut rendue à l’Eglife’
6c où elle fe vit à l’abri des perfécutions des Payens’
Mais quoique les conciles, & principalement ceux
qui font generaux, ne remontentde fait qu’au tems
ou les prélats ont pu s’affembler & traiter ouvertement
de la foi & de la difcipline, il n’en eft pas moins
vrai qu’ils prennent leur fource dans la nature même
de l’Eglife. Le corps de l’Eglife compofé de plufieurs
membres, eft lie par la charité 6c la communion des
Saints. J. C. lui-même eft la bafe de cette union, 6c
le Saint-Efprit y coopéré, épîtrepremière aux Corinth.
ch. xij. Et dans Yépître aux Ephéfiens, ch. v. il eft dit
que J. C. eft le chef & l’époux de l’Eglife, dont il eft
le fauveur ; qu’il a aimé l’Eglife, & s’eft livré à la
mort pour elle ; qu’il l’a fait paroître devant lui pleine
de gloire, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de
femblable, mais érantfainte &irrépréhenfible; qu’il
la nourrit 6t l’entretient, parce que nous fommes les
membres de fon corps, formés de fa chair & de fes
os. Ce langage de l’apôtre eft conforme à celui de
J. C . dans S .Matthieu, ch. xv. verf. 18. où après avoir
donné les clés à fes difcipjes, c’eft-à-dire la puiffance
de lier & de délier, il leur adreffe ces paroles : Ite-
rum dieo vobis, quia f i duo ex vobis confenferint fuper
terram , de omni re quameumque petierint ,fiet illis à pâtre
meo qui efi in ccelis ; ubi enim funt duo vel très con-
gregati in nomine meo , ibi fum in medio eorum. Et dans
S. Jean, chap. xvij. après avoir prié fon pere pour
les apôtres, il le prie encore pour ceux qui doivent
croire en lui par leur parole ; 6c il ajoute, verf. 23.
Ego in eis, & tu in me, ut fint confummati in unum.
Or l’Eglife a toujours crû qu’elle ne pouvoir jamais
mieux repréfenter cette unité, & n’avoit point de
moyen plus efficace pour l’affermir, pour conferver
la communion de la foi lorfque les impies s’efforcent
d’y porter atteinte, que de raffembler les évêques
envoyés par Jefus-Chrift en la perfonne des apôtres
, pour apprendre aux nations la parole de la
foi qui leur a été tranlmife. Ce font eux qui font