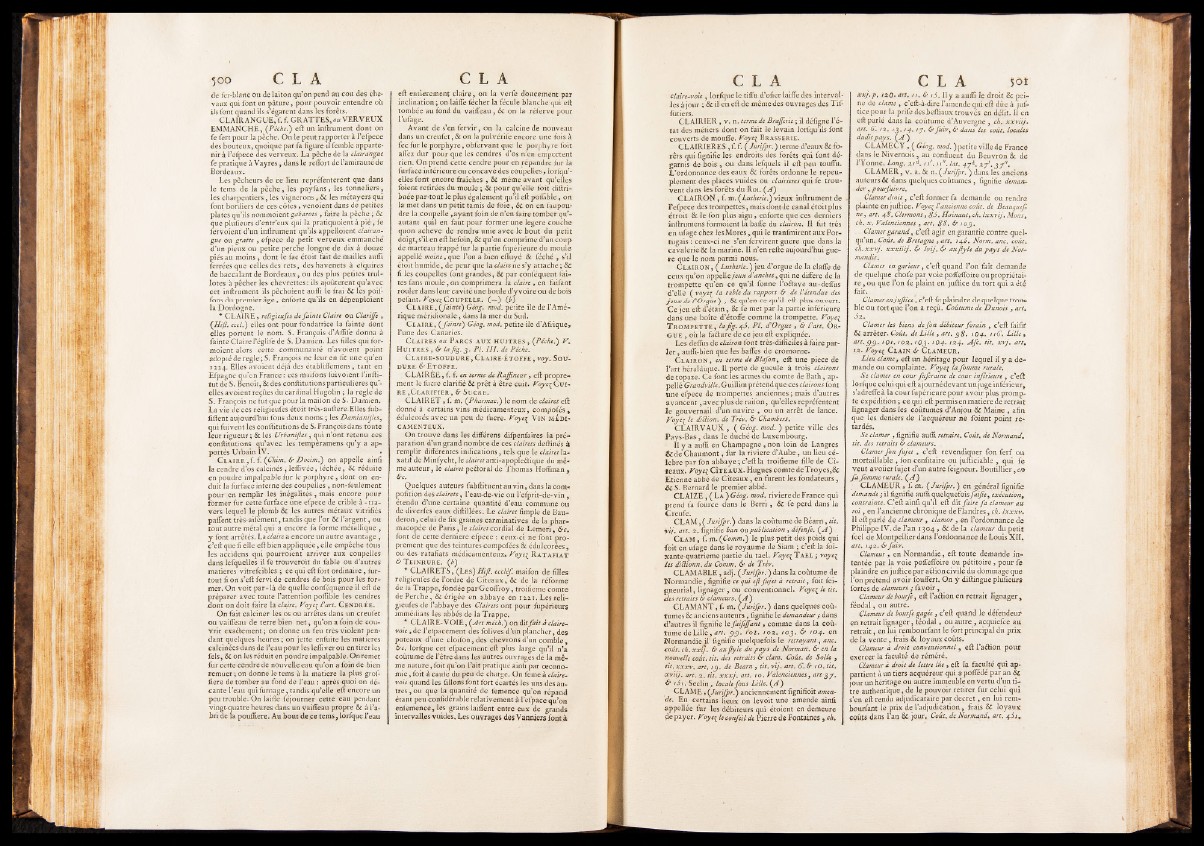
de fer-blanc ou de laiton qu’on pend au cou des chevaux
qui font en pâture, pour pouvoir entendre où
ils font quand ils s’égarent dans les forêts.
CLAIR ANGUE, f. f. GRATTES, ou VERVEUX
EMMANCHÉ, (Pêche.') eft un inftrument dont on
fe fert pour la pêche. On le peut rapporter à l’efpece
des bouteux, quoique par fa figure il femble appartenir
à l’efpece des verveux. La pêche de la clairangue
fe pratique à Vayres, dans le reffort de l’amirauté de
Bordeaux.
Les pêcheurs de ce lieu repréfenterent que dans
le tems de la pêche, les payfans, les tonneliers,
les charpentiers, les vignerons ,■ & les métayers qui
font bordiers de ces côtes, venoient dans de petites
plates qu’ils nommoient gabarots , faire la pêche ; 6c
que plufîeurs d’entr’eux qui la pratiquoient à pié , fe
fervoient d’un infiniment qu’ils appelaient clairan-
gue ou gratte , efpece de petit verveux emmanché
d’un pieux ou petite perche longue de dix à douze
pies au moins, dont le fac étoit fait de mailles aufli
ferrées que celles des rets, des havenets à efquires
de baecalant de Bordeaux, ou des plus petites trul-
lotes à pêcher les chevrettes : ils ajoûterent qu’avec
cet inftrument ils pêchoient aufli le frai &c les poif-
fons du premier âg e, enforte qu’ils en dépeuploient
la Dordogne.
* CLAIRE, religieufes de fainte Claire ou Clarifie ,
(tjjkijÈ eccl.) elles ont pour fondatrice la fainte dont
elles portent le nom. S. François d’Aflife donna à
fainte Claire l’églife de S. Damien. Les filles qui for-
moient alors cette communauté n’avoient point
adopté de réglé; S. François ne leur en fit une qu’en
1 124. Elles avoient déjà des établiffemens, tant en
Efpagne qu’en France: ces maifons fuivoient l’infti-
tut de S. Benoît, & des conftitutions particulières qu’elles
avoient reçues du cardinal Hugolin ; la réglé de
S. François ne fut que pour la mailon de S. Damien.
La vie de ces religieufes étoit très-auftere.Elles fub-
fiftent aujourd’hui fous deux noms ; les Damianifles,
qui fui vent les conftitutions de S. François dans toute
leur rigueur ; & les Urbanifies, qui n’ont retenu ces
conftitutions qu’avec les tempéramens qu’y a apportés
Urbain IV. •
C l a ir e , f. f. (Chim. b Docim.) on appelle ainfi
la cendre d’os calcinés , leflivée, léchée, & réduite
en poudre impalpable fur le porphyre, dont on enduit
la furface interne des coupelles , non-feulement
pour en remplir les inégalités, mais encore pour
former fur cette furface une efpece de crible à - travers
lequel le plomb & les autres métaux vitrifiés
paffent très-aifément, tandis que l’or & l’argent, ou
tout autre métal qui a encore fa forme métallique ,
y font arrêtés. La claire a encore un autre avantage ,
c ’eft que fi elle eft bien appliquée, elle empêche tous
les accidens qui pourroient arriver aux coupelles
dans iefquelles il fe trouveroit du fable ou d’autres
matières vitrefcibles ; ce qui eft fort ordinaire, fur-
tout fi on s’eft fervi de cendres de bois pour les former.
On voit par-là de quelle conféquence il eft de
préparer avec toute l’attention poflible les cendres
dont on doit faire la claire. Voyeç l'art. C endrée.
On fait calciner les os ou arrêtes dans un creufet
ou vaiffeau de terre bien net, qu’on a foin de couvrir
exaftement ; on donne un feu très-violent pendant
quelques heures ; on jette enfuite les matières
calcinées dans de l’eau pour les lefîiver ou en tirer les
fels, & on les réduit en poudre impalpable. On remet
fur cette cendre de nouvelle eau qu’on a foin de bien
remuer ; on donne le tems à la matière la plus grof-
fiere de tomber au fond de l’eau : après quoi on décante
l ’eau qui fumage, tandis qu’elle eft encore un
peu trouble. On laide féjourner cette eau pendant
vingt-quatre heures dans un vaiffeau propre & à l’abri
de la poulfiere. Au bout de ce tems, lorfque l’eau
eft entièrement claire, on la verfe doucement par
inclination ; on laiffe lécher la fécule blanche qui eft
tombée au fond du vaiffeau, & on la réferve pour
l ’ufage.
Avant de s’en fervir, on la calcine dé nouveau
dans un creufet, & on la pulvérife encore une fois à
fec fur le porphyre, obfervant que le porphyre foit
affez dur pour que les cendres d’os n’en emportent
rien. On prend cette cendre pour en répandre fur la
furface intérieure ou concave des coupelles, lorfqu’-
elles font encore fraîches , & même avant qu’elles
foient retirées du moule ; & pour qu’elle foit diftri-
buée par-tout le plus également qu’il eft poflihle, on
la met dans un petit tamis dé foie, & on en faupou>
dre la coupelle, ayant foin-de n’en faire tomber qu’-
autanc quil en faut pour former une legere couche
quon achevé de rendre unie avec le bout du petit
doigt, s’il en eft befoin, &: qu’on comprime d’un coup
de marteau frappé fur la partie fupérieure du moule
appel-lé moine, que l’on a bien effuyé & féché , s’il
étoit humide, de peur que la claire ne s’y attache ; ôc
fi les coupelles font grandes , & par eonféquent faites
fans moule, on comprimera la claire, en faifant
rouler dans leur cavité une boule d’y voire ou de bois
pefant. Voye^Coupelle. (—) (b)
C la ir e , (fainte) Géog. mod. petite île de l’Amérique
méridionale, dans la mer du Sud.
C laire, ( fainte) Géog. mod. petite île d’Afrique,
l’une des Canaries.
C laires ou Parcs aux h u îtr e s , (Pêche.) V.
Huîtres , 6* La fig. 3 . PL I II. de Pêche.
C laire-sou d u r e ,C laire-é t o f f e , voy. Soudure
& É to f fe .
CLAIREE, f. f. en terme de Raffineur, eft proprement
le fucre clarifié & prêt à être cuit. Voye^ C uire
, C larifier , b Sucre.
CLAIRET, f. m. (Pharmac.) le nom de clairet eft
donné à certains vins médicamenteux, compofés,
édulcorés avec un peu de fucre. Voye£ V in méd icamen
teux.
On trouve dans les différens difpenfaires la préparation
d’un grand nombre de ces clairets deftinés à
remplir différentes indications, tels que le clairet laxatif
de Minfycht, le £/<«>« anti-apopleftique du même
auteur, le clairet pe&oral de Thomas Hoffman ,
&c.
Quelques auteurs fubftituent au v in , dans la com-
pofition des clairets, Teau-de-vie ou l ’efprit-de-vin ,
étendu d’une certaine quantité d’eau commune ou
de diverfes eaux diftillées. Le clairet fimple de Bau-
deron, celui de fix graines carminatives de la pharmacopée
de Paris, le clairet cordial de Lemeri, &c.
font de cette derniere efpece : ceux-ci ne font proprement
que des teintures compofées & édulcorées ,
ou des ratafiats médicamenteux» Voye[ Ra t a f ia t
6-Teinrure. (b)
* CLAIRETS, (Les)Hifl. eccléf. maifon de filles
religieufes de l’ordre de Cîteaux, & de la réforme
de la Trappe, fondée par Geoffroy, troifieme comte
de Perche, & érigée en abbaye en 1221. Les religieufes
de l’abbaye des Clairets ont pour fupérieurs
immédiats les abbés de la Trappe.
* CLAIR E-VOIE, (Art méch.) on ditfait à claire-
voie , de l’elpacement des folives d ’un plancher, des
poteaux d’une cloifon, des chevrons d’un comble
&c. lorfque cet efpacement eft plus large qu’il n’a
coûtume de l’être dans les autres ouvrages de la même
nature, foit qu’on l’ait pratiqué ainfi par oecono-
mie, foit à caufe du peu de charge. On ferne à claire-
voie quand les filions font fort écartés les uns des autres
, ou que la quantité de l'emence qu’on répand
étant peu confiderable relativement à l’efpace qu’on
enfemence, les grains laiffent entre eux de grands
intervalles vuides. Les ouvrages des Vanniers font.à
claire-voie , lorfque le tiffti d’ofier laiffe des intervalles
à jour ; & ili en eft de même des ouvrages des Tif-
futiers.
CLAIRIER, v . n. terme de Brafierie ; il défigne l’état
des métiers dont on fait le levain lorfqu’ils font
couverts de moufle. Voye^ Brasserie.
CLAIRIERES, f. f. ( Jurifpr, ) terme d’eaux & forêts
qui fignifie les endroits des forêts qui font dégarnis
de bois , ou dans lefquels il eft peu touffu.
L ’ordonnance des eaux & forêts ordonne le repeuplement
des places vuides ou clairières qui fe trouvent
dans les forêts du Roi. (A)
CLAIRON , f. m. (Lutherie.) vieux inftrument de
l’efpece des trompettes, mais dont de canal étoit plus
étroit & le fon plus aigu, enforte que ces derniers
inftrumens formoient la baffe du clairon. Il fut très
en ufage chez les Mores, qui le tranfmirent aux Portugais
: ceux-ci ne s’en fervirent guere que dans la
cavalerie & la marine. Il n’en refte aujourd’hui guere
que le nom parmi nous.
C l a ir o n , (Lutherie.) jeu d’orgue de la claffe de
ceux qu’on appelle jeux d’anches, qui ne différé de la
trompette qu’en ce qu’il fonne l’o&ave au-deffus
d’elle ( voyeç la table du rapport b de l'étendue des
jeu x de l'Orgue ) , & qu’en ce qu’il eft plus ouvert.
C e jeu eft d’étain, & le met par la partie inférieure
dans une boîte d’étoffe comme la trompette. Voyei
T r om p e t t e , ta fig. 4S. PL d'Orgue, & l'art. Org
u e , où la fa&ure de ce jeu eft expliquée.
Les deffus de clairon font très-difficiles à faire parler
, aufli-bien que les baffes de cromorne.
C lairon , en terme de Blafon, eft une piece de
l ’art héraldique. Il porte de gueule à trois clairons
de topaze. Ce font les armes du comte de Bath, ap-
pellé Grandville. Guillim prétendque ces clairons font
une efpece de trompettes anciennes ; mais d’autres
avancent, avec plus de raifon, qu’elles repréfentent
le gouvernail d’un navire , ou un arrêt de lance.
Voye^ le diction, de Trév. & Chambers.
CLAIRVAUX , ( Géog. mod. ) petite ville des
Pays-Bas, dans le duché de Luxembourg.
Il y a aufli en Champagne , non loin de Langres
& d e Chaumont, fur la riviere d’Aube, un lieu célébré
par fon abbaye ; c’eft la troifieme fille de Cîteaux.
Voye( C ît eaux. Hugues comte deTroye$,&
Etienne abbé de Cîteaux, en furent les fondateurs,
& S. Bernard le premier abbé.
CLA IZE, ( La ) Géog. mod. riviere de France qui
prend fa fource dans le Berri, & fe perd dans la
Creufe.
CLAM, ( Jurifpr!) dans la coûtume de Béarn, tit.
yij, art. 2. fignifie ban ou publication , défenfe. (A )
C lam , f. m. (Comm.) le plus petit des poids qui
foit en ufage dans le royaume de Siam ; c’eft la foi-
xante-quatrieme partie du tael. VayefTA.Eh ; voyeç
les diclionn. du Comm, & de Trév»
CLAMABLE, adj. (Jurifpr.) dans la coûtume de
Normandie, fignifie ce qui eji fujet à retrait, foit fei-
gneurial, lignager, ou conventionnel. Voye^ le tit.
des retraits & clameurs. (A )
CLAMANT, f. m. (Jurifpr.) dans quelques coû-
tumes & anciens auteurs, fignifie le demandeur ; dans
d’autres il fignifie le faijîjfant, comme dans la coutume
de Lille , art. c>e>. /*oz. 102. 103. & 104. en
Normandie il fignifie quelquefois le retrayant, anc.
coût. ch. xx ij. & auJiyle du pays de Norman. & en la
nouvelle coût. tit. des retraits & clam. Coût, de Solle ,
tit. xxxv. art. ig. de Bearn , tit. vij. art. 6. b 10. lit.
xviij. art. 2. tit. x x x j. art. 10. Valenciennes , artgy.
b 1S1. Seclin, locale fous Lille. (A )
CLAME, (Jurifpr.) anciennement fignifioit amende.
En certains lieux on levoit une amende ainfi
appellée fur les débiteurs qui étoient en demeure
de payer. Voyei le confeil de Pierre de Fontaines, ch.
scxj.p. ï±ù. an. 11. b /J. Il y a aufli le droit & peine
de clame , c’eft-à-dire l’amende qui eft due à juf-
tic.e pour la prife des beftiaux trouves en délit. Il en
eft parlé dans la coûtume d’Auvergne , ch. xxviij.
art. G . 12, 13.14. ty. & fuiv, b dans les coût, locales
dudit pays. (A )
CLAME CY , ( Géog. mod. ) petite ville de France
dans le Nivernois, au confluent du Beuvron & de
l’Yonne. Long. 2 id. 111. n " . lat. 4yd. 2y}. 3 y".
CLAMER, v . a. & n. (Jurifpr. ) dans. les ancien*
auteurs & dans quelques coûtumes , fignifie deman*
der, pourfuivre.
Clamer droit, c’eft former fa demande ou rendre
plainte en juftice. Voye{ l'ancienne coût, de Beauquef-
ne, art. 48. Clermont, 8J. Hainaut, ch. Ixxvij. Mons,
ch. x. Valenciennes , art. 88.. b io,<):.
Clamer garand, c’eft agir en garantie contre quelqu’un.
Coût, de Bretagne , art. 146. Norm. anc. coût-,
ch. xxvj. xxxiiij. & Ivij. & au Jlyle du pays de Normandie.
Clamer en garieur, c’eft quand l’on fait demande
de quelque chofe par voie poffeffoire ou propriétaire
, ou que l’on fe plaint en juftice du tort qui a été
fait. Clamer en juftice, c’eft fe plaindre de quelque trou*
ble ou tort que l’on a reçu. Coûtume de Dunois , art.
$2.
Clamer les biens de fon débiteur forain , c’eft failli*
& arrêter. Coût., de Lille , art, $8. 104. n G,. Lille ,
9 $. 101,102.103. 104. 124. Afc. tit, xvj. art»
12. Vayei C LAIN b CLAMEUR.
Lieu clame, eft un héritage pour lequel il y a de*
mande ou complainte. Voye[ la fomme rurale.
Se clamer en cour fuferaine de cour inférieure , c’eft
lorfque celui qui eft ajournédevant un juge inférieur,
s’adreffeà la cour fupérieure pour avoir plus prompte
expédition ; ce qui eft permis en matière de retrait
lignager dans les coûtumes d’Anjou & Maine , afin
que les deniers de l’acquéreur ne foient point retardés.
Se clamer , fignifie aufli retraire, Coût, de Normand.
tit. des retraits b clameurs, .
Clamer fon fujet , c’eft revendiquer fon ferf ou
mortaillable , fon cenfitaire ou jufticiable , qui fe
veut avoüer fujet d’un autre feigneur. Boutillier, en
fa fomme rurale. (A )
CLAMEUR, f. m. ( Jurifpr. ) en général fignifie
demande ; il fignifie aufli quelquefois faifie, exécution,
contrainte. C’eft ainfi qu’il eft dit faire fa clameur au
roi, en l’ancienne chronique de Flandres, ch, Ixxxv.
Il eft parlé de clameur , clamor , en l’ordonnance de
Philippe IV. de l’an 1304, & de la clameur du petit
feel de Montpellier dans l’ordonnance de Louis XII*
art. 142. & fuiv.
Clameur, en Normandie, eft toute demande intentée
par la voie poffeffoire ou pétitoire, pour fe
plaindre en juftice par aâion civile du dommage que
l’on prétend avoir fouffert. On ÿ diftingue plufîeurs
fortes de clameurs ; favoir,
Clameur de bourfe, eft l’aftion en retrait lignager,
féodal, ou autre.
Clameur de bourfe gagée , c’eft quand le défendeur
en retrait lignager, féodal, ou autre , acquiefce ait
retrait, en lui rembourfant le fort principal du prix
de la vente, frais & loyaux coûts.
Clameur à droit conventionnel, eft l’a&ion pouf
exercer la faculté de réméré.
Clameur à droit de lettre lue , eft la faculté qui appartient
à un tiers acquéreur qui a poffédé par an &
jour un héritage ou autre immeuble en vertu d’un titre
authentique, de le pouvoir retirer fur celui qui
s’en eft rendu adjudicataire par decret, en lui rembourfant
le prix de l’adjudication, frais & loyaux
coû.ts dans l’an U jour* Coût, de Normand, art. 461,