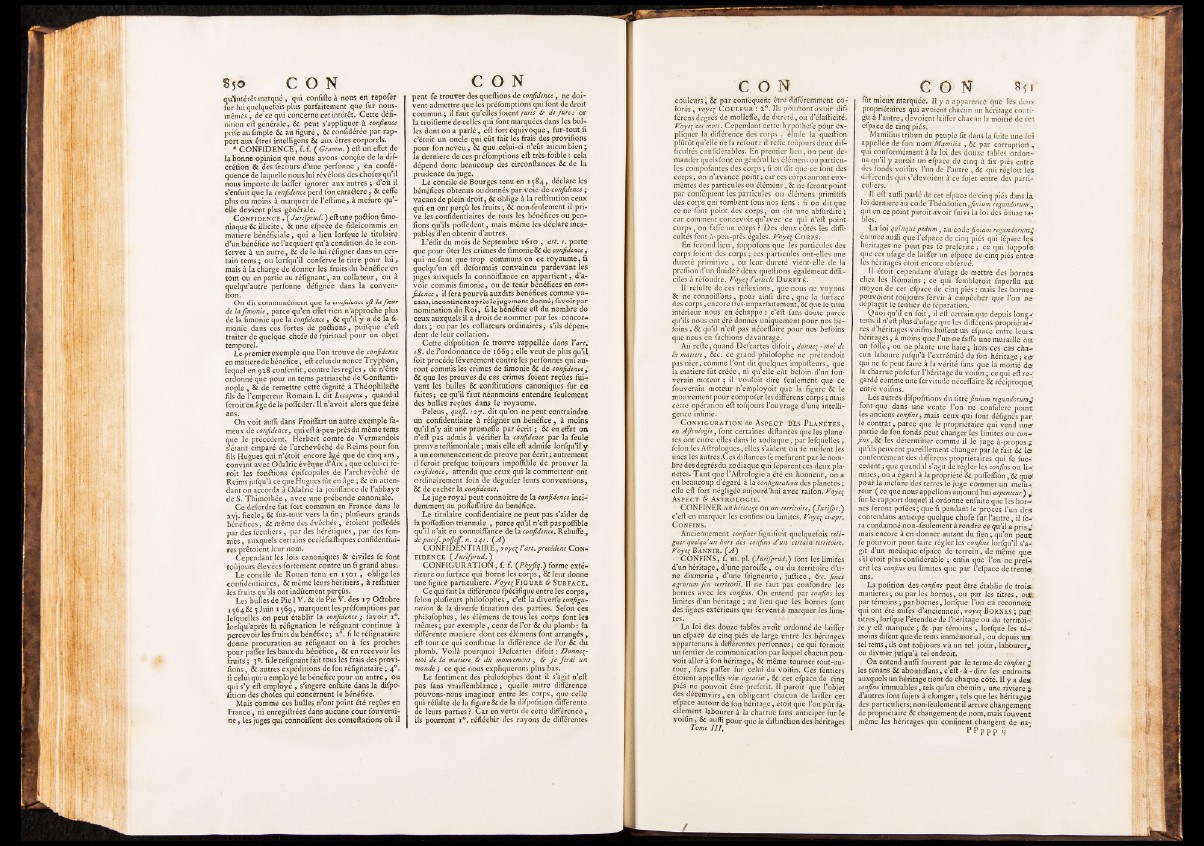
?u?|ntérêt marqué, qui confifte à nous en repofer
ur lui quelquefois plus parfaitement que fur nous-
mêmes , de ce qui concerne cet intérêt. Cette définition
eft générale, & peut s’appliquer à confiance
prife au fimple & au figuré, 8c confédérée par rapport
aux êtres intelligens 8c aux êtres corporels.
* CONFIDENCE, f. f. ( Gramm.) eft un effet de
la bonne opinion que nous avons conçue de la discrétion
& des fecours d’une perfonne , en confe-
quence de laquelle nous lui révélons des chofes qu’il
nous importe de laiffer ignorer aux autres ; d’oii il
s’enfuit que la confidence perd fon caraélere, & ceffe
plus ou moins à marquer de l’eftime, à mefure qu’elle
devient plus générale.
C onfidence , ( Jurifprud. ) eft une paôion fimo-
niaque ôc illicite, & une efpece de fideicommis en
matière bénéficiale, qui a lieu lorfque le titulaire
d’un bénéfice ne l’acquiert qu’à condition de le con-
ferver à un autre, 8c de le lui réfigner dans un certain
tems ; ou lorfqu’il conferve le titre pour lu i,
mais à la charge de donner les fruits du bénéfice en
tout ou en partie au réfignant, au collateur, ou à
quelqu’autre perfonne défignée dans la convention.
On dit communément que la confidence efi la foeur
de la fimonie, parce qu’en effet rien n’approche plus
de la fimonie que la confidence , 8c qu’il y a de la fimonie
dans ces fortes de pa âions, puifque c’eft
traiter de quelque chofe de fpirituel pour un objet
temporel.
Le premier exemple que l’on trouve de confidence
en matière de bénéfice, eft celui du nonce Tryphon,
lequel en 918 confentit, contre les réglés, de n’être
ordonné que pour un tems patriarche de Conftanti-
nople , & de remettre cette dignité à Théophila&e
fils de l’empereur Romain I. dit Lecaptne , quand il
feroit en âge delapofféder. Il n’avoit alors que feize
ans.O
n voit auffi dans Froiffart un autre exemple fameux
de confidence, qui eft à-peu-près du même tems
que le précédent. Herbert comte de Vermandois
s’étant emparé de l’archevêché de Reims pour fon
fils Hugues qui n’étoit encore âgé que de cinq ans ,
convint avec Odalric évêque d’Aix , que celui-ci feroit
les fondions épifcopales de l’archevêché de
Reims jufqu’à ce que Hugues fût en âge ; ôc en attendant
on accorda à Odalric la joüiffance de l’abbaye
de S. Thimothée ,.a v ec une prébende canoniale.
Ce defordre fut fort commun en France dans le
xvj. liecle, 6c fur-tout vers la fin; plufieurs grands
bénéfices, & même des évêchés, étoient poffédés
par des féculiers, par des hérétiques, par des femmes
, auxquels certains eceléfiaftiques confidentiai-
res prêtoient leur nom.
Cependant les lois canoniques & civiles fe font
toujours élevées fortement contre un fi grand abus.
Le concile de Rouen tenu en 1501 , oblige les
confidentiaires, & même leurs héritiers, à reftituer
les fruits qu’ils ont induement perçûs.
Les bulles de Pie IV . & de Pie V . des 17 Oâobre
1 5646c 5 Juin 1569, marquent les préfomptions par
lefquelles on peut établir la confidence ; favoir i°.
lorfqu’après la réfignation le réfignant continue à
percevoir les fruits du bénéfice ; z°. fi le réfignataire
donne procuration au réfignant ou à fes proches
pour palier les baux du bénéfice, 8c en recevoir les
fruits ; 3 °. fi le réfignant fait tous les frais des provi-
fions, 8c autres expéditions de fon réfignataire ; 40.
fi celui qui a employé le bénéfice pour un autre, ou
qui s’y eft employé , s’ingère enfuite dans la difpofition
des choies qui concernent le bénéfice.
Mais comme ces bulles n’ont point été reçûes en
France, ni enregiftrées dans aucune cour fouverai-
n e , les juges qui connoiffent des conteftations où il
peut fe trouver des queftions de confidence, he doivent
admettre que les préfomptions qui font de droit
commun ; il faut qu’elles foient juris & de jure: ot
la troifieme de celles qui font marquées dans les bulles
dont on a parlé, eft fort équivoque, fur-tout fi
c’étoit un oncle qui eût fait les frais des provisions
pour fon neveu, 8c que celui-ci n’eut aucun bien;
la derniere de ces préfomptions eft très-foible : cela
dépend donc beaucoup des circonftances 6c de la
prudence du juge.
Le concile de Bourges tenu en 1584, déclare les
bénéfices obtenus ou donnés par voie de confidence ;
vacansde plein d roit, 6c oblige à la reftitution ceux
qui en ont perçû les fruits ; ôc non-feulement il prive
les confidentiaires de tous les bénéfices ou pen-
fions qu’ils poffedent, mais même les déclare incapables
d’en obtenir d’autres.
L’édit du mois de Septembre 1610 , art. 1. porte
que pour ôter les crimes de fimonie 6c de confidence ,
qui ne font que trop communs en ce royaume, fi
quelqu’un eft déformais convaincu pardevant les
juges auxquels la connoiffance en appartient, d’avoir
commis fimonie, ou de tenir bénéfices en confidence
, il fera pourvu auxdits bénéfices comme v a -
cans, incontinent après le jugement donné; favoir par
nomination du R o i, fi le bénéfice eft du nombre de
ceux auxquels il a droit de nommer par les concor*
dats ; ou par les collateurs ordinaires, s’ils dépen-,
dent de leur collation.
Cette difpofition fe trouve rappellée dans Y art»
18. de l’ordonnance de 1669 ; elle veut de plus qu’il
foit procédé féverement contre les perfonnes qui auront
commis les crimes de fimonie 6c de confidence ,
6c que les preuves de ces crimes foient reçûes fui-
vant les bulles 6c conftitutions canoniques fur ce
faites ; ce qu’il faut néanmoins entendre feulement
des bulles reçûes dans le royaume.
Peleus, quefi. 127. dit qu’on ne peut contraindre
un confidentiaire à réfigner un bénéfice, à moins
qu’il n’y ait une promeffe par écrit ; 6c en effet on
n’eft pas admis à vérifier la confidence par la feule
preuve teftimoniale ; mais elle eft admife lorfqu’il y
a un commencement de preuve par écrit ; autrement
il feroit prefque toûjours impoflible de prouver la
confidence, attendu que ceux qui la commettent ont
ordinairement foin de déguifer leurs conventions,
6c de cacher la confidence.
Le juge royal peut connoître de la confidence incidemment
au poffeffoire du bénéfice.
Le titulaire confidentiaire ne peut pas s’aider de
la poffeflion triennale , parce qu’il n’eft pas pofiible
qu’il n’ait eu connoiffance de la confidence. Rebuffe ,
de pacif. poffejf. n. 241. (yf)
CONFIDENTIAIRE, voyez Vart,precedent CoN-j
FIDENCE ( Jurifprud. )
CONFIGURATION, f. f. (Phyfiq.) forme extérieure
ou furface qui borne les corps, ÔC leur donne
une figure particulière. Voyez Figure & Surface.
Ce qui fait la différence fpécifique entre les corps ,
félon plufieurs philofophes , c’eff la diverfe configuration
& la diverfe fituation des parties. Selon ces
philofophes, les élémens de tous les corps font les
mêmes ; par exemple, ceux de l’or 6c du plomb : la
différente maniéré dont ces élémens font arrangés ,
eft tout ce qui conftitue la différence de l’or 6c du
plomb. Voilà pourquoi Defcartes difoit : Donnez-
moi de la matière & du mouvement, & j e ferai un.
monde j ce que nous expliquerons plus bas.
Le fentiment des philofophes dont il s’agit n’eft
pas fans vraiffemblance ; quelle autre différence
pouvons-nous imaginer entre les corps, que celle
qui réfulte de la figure 6c de la difpofition différente
de leurs parties ? Car en vertu de cette différence,
ils pourront i ° . réfléchir des rayons de différentes
Couleurs ' 6c par conféquérit être différemment chlorés
, voyez; C ouleur \ i ° . Ils pourtant avoir dif*
férens degrés de molleffe, de dureté, ou d’élafticité.
Voyez ces mots. Cependant cette hypothefe pour expliquer
la différence des corps , élude la queftion
plûtôt qu’elle ne la réfout : il’ refte toûjours deux difficultés
confidétables. En premier lieu, on peut demander
quels font en général les élémens ou particules
compofantes des corps ; fi on dit que ce font des
corpS, on n’avance point ; Car cès corps auront eux-
mêmes des particules'ou élémens, 8c ne feront point
par COnféqüent les particules oit élémens primitifs
des corps qui tombent fous nos fens : fi on dit que
ce né font point des corps, on dit une abfurdité ;
car comment concevoir qu’avec ce qui ‘n’eft point
corps, on faffe un corps ? Des deux côtés les difficultés
font à-péu-près égales. Voyez C orps.
En fécond lieu, fuppofons que lés particules des
corps foient dés corps ; ces particules Ont-elles une
dureté primitive , ou leur dureté vient-elle de la
preffion d’un fluide ? deux queftions également difficiles
à f éfoudré. Voyez C article D ureté.
Il réfulte de ces réflexions, que nous ne voyons
8c ne connoiffons, pour ainfi dire, que la furface
des corps, encore très-imparfaitement, & que le tiffu
intêriéur nous en échappe : c’eft fans douté parce
qu’ils nous ont été donnés uniquement pour nos be-
foins, 8c qu’il n’eft pas néceffaire pour nos befoins
que nous en fâchions davantage.
Au refte, quand Defcartes difoit, donnez ' m01
la matière, 8cc. ce grand philofophe ne prétendoit
pas nier, comme l’ont dit quelques impoftéurs, que
la matière fût créée, ni qu’elle eût befoin d’un fou-
verain moteur ; il voulôit dire feulement que ce
fouvérain moteur n’employoit què la figure 8c le
mouvement pour compofer les différens corps ; mais
cette opération eft toûjours l’ouvrage d’une intelligence
infinie.
C o nfigurat ion ou As p e c t ïÆs Planètes ,
en Àfirologie, font certaines diftanê'è’s que les plane-
fés ont entre elles dans le zodiaque, par lefquelles ,
félon les Aftrologues ,elles s’aident ou fe nuifent lés
unes les autres.Ces diftances fe mefurent par le nombre
des degrés du zodiaque qui féparent ces deux planètes.
Tant que l’Aftrologie a été en honneur, on a
.eu beaucoup d’égard à la configuration des planètes ;
elle eft fort négligée aujourd’hui avec raifon. Voyez
A sp ect & A s tr o lo g ie .
CONFINER un héritage ou un territoire, ( Jurifpr.)
c’eft en marquer lés confins ou limites. Voyez ci-apr.
C onfins.
Anciennement confiner fignifioit quelquefois reléguer
quelqu’un hors des confins d'un certain territoire.
Voyez Bannir. (A )
- CONFINS, f. m. pl. (Jurifprud.') font les limites
d’un héritage, d-’une paroiffe, ou du territoire d’une
dixmerie , d’une feigneurié, juftice , &c. fines
agrorum feu territorii. Il ne faut pas confondre les
bornes avec, les confins. On entend par confins les
limites d’un héritage;'au lieu que les bornes font
des lignes extérieurs qui fervent à marquer les limites
.L
a loi des douze tables avélïf- Ordonné de laiffer
ünefpace de cinq piés'de large entré les héritages
appartenans à différentes perfonnes ; ce qui formoit
un fentier de communication par lequel chacun pou-
Voit aller à fon héritage , 6c même tourner tout-autour
, fans paffer fur celui du voifin. Ces fentiers
étoient appellés via dgraria, 8c cet efpace de cinq
piés ne pouvoit être preferit. Il paroît que l’objet
-deS: décemvirs , en Obligeant chacun de laiffer cet
efpace autour de fon héritage, était que l’on pût facilement
labourer, à la charrue fans anticiper fur le
voifin, & auffi pour que la diftin&ion des héritages
Tome I I I ,
ïïit mieux marquée. Il y â âpparéricô que lès deux
propriétaires qui avoient chacun un héritage conta
gu à l’autre, dévoient laiffer chacun la moitié de cet
efpace de cinq piés:
Mamilius tribun du peuple fit dans la fuite Une loi
appelleé dé fon nom Mamilià , 6c par corruptiort ,
, qui conformément à la loi des douze tables Ordon-
na qu’il y auroit un efpacé dë cinq à fix piés entre
des fonds voifins l’un de l’autre , 8c qui régloit les
différends qui s’élevoient à ce fujet entre des particuliers.
1'
Il eft auffi parlé dé cet efpace de cinq piés dans la
loi derniere au code Théodofien finium regundorum j|j
qui en ce point paroît avoir fuivi la loi des douze ta*
blés.
La loi quinque pedum, aü' coAq finium regundorum£
énoncé auffi que l’efpàce de cinq piés qui fépare les
héritages ne peut pas fe preferire ; ce qui fuppofe
que cet ufage de laiffer un efpace de cinq piés entre
; les héritages étoit encore obfervé.
Il était cependant d’ufâge de mettre des Jtarnës
chez lés Romains ; ce qui fémbleroit fuperflu air
moyen de cet efpace de cinq piés: mais les bornes
pouvoient toûjours fervir à empêcher que l’on ne
•; déplaçât le fentier de féparation,
Quoi qu’il en foit, il eft certain qite depuis lông-*'
. tems il n’eft plus d’ufage que les différens propriétaires
d’héritages voifins laiflent un efpace entre leurs
> à moins que i’un ne faffe une muraille oit
un foffé, ou ne plante une haie ; hors ces cas chacun
laboure jufqu’à l’extrémité de fon héritage ; ce|
qui ne fe peut faire à la vérité fans que la moitié de!
la charrue pofe fur l’héritage du voifin ; ce qui eft re+[
■ gardé comme une fervitude néceffaire & réciproque;
entre voifins.
Les autres difpofitions dit titre finium regundorum£
font que dans une vente l’on ne confidere point!
les anciens confins, mais ceux qui font défignés par,
le contrat, parce que le propriétaire qui vend une'
partie de fon fonds peut changer les limites ou con-
: fins ■> 8c. lës déterminer comme il le juge à-propos ÿ
qu’ils peuvent pareillement changer par le fait &c
confentement des différens propriétaires qui fe fuc-{
cèdent ; que quand il s’agit de régler les confins ou lH
mites, on a égard à la propriété ôc poffeflion, 6c quei
pour la mefure des terres le juge commet un mefu-*
reur ( ce que nous appelions aujourd’hui arpenteur ) J
fur. le-rapport duquel il ordonne enfuite que les bor-f
nés feront pofées ; que fi pendant le procès l’un de*
contendans anticipe quelque chofe fur l’autre, il fera
condamné non-feulement à rendre ce qu’il a pris j
mais encore à en donner autant du fien ; qu’on peut;
fe pourvoir pour faire régler les confins lorfqu’il s’a^
git d’un modique efpace de terrein, de même qud
Ski était plus confidérable ; enfin que l’on ne pref-;
critles confins ou limites , que par l’efpace de trente;
ans.
La pofition des confins peut être établie de trois ,
maniérés ; ou par les bornes, ou par les titres, oiife
par témoins ; par bornes, lorfque l’on eii recOnnoît
qui ont été mifes d’ancienneté, voyez Bornés ; pat4,
titres, lorfque l’étendue de l’héritage ou du territoire
y eft marquée ; 8c par témoins , lorfque les té-;
moins difent que de tems immémorial, ou depuis un’
tel tems , ils ont toûjours vû un tel joiiir, labOurerJ
ou dixmer jufqu’à tel endroit.
On entend auffi fouvent par le terme de confins J
les tenans ôc aboutiffans, c’eft - à - dire les endroits
auxquels un héritage tient de chaque côté. II y a dea|
confins immuables, tels qu’un chemin, • une riviere ÿ
d’autres font fujets à changer, tels que les héritages
des particuliers; non-feulement il arrive changement
de propriétaire 6c changement de nom, mais tauvent
même les héritages qui confinent changent de na