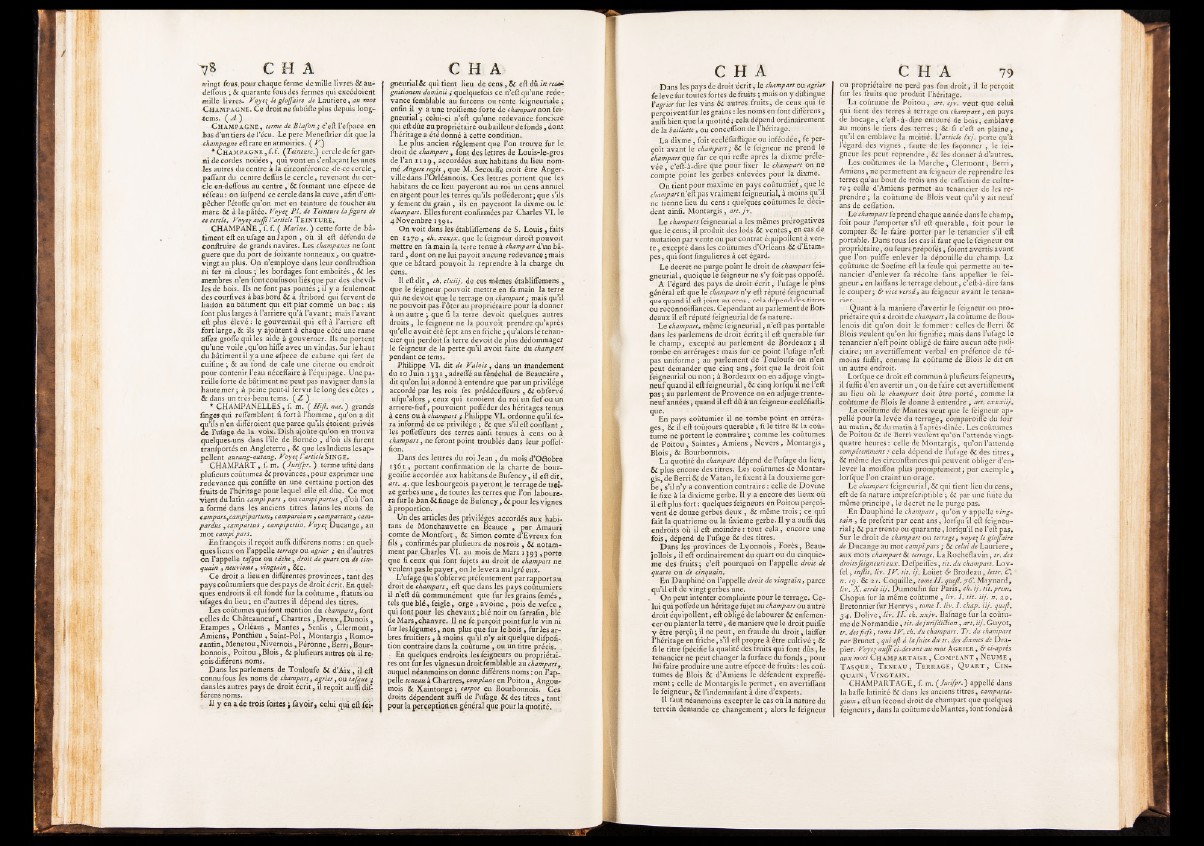
jvingt fous, pour chaque ferme de mille livres & au-
deflous ; & quarante fous des fermes qui excédoient
mille livres. V o y e lle glojjaire de Lauriere, au mot
•Champagne. Ce droit-ne fobfifteplus depuis long-
•tems. ( A )
-Cham pagne., terme de Blafon^ c'e ft l’efpace en
bas d’un tiers de l’écu. Le pere Meneftrier dit que la
■ champagne eft rare en armoiries..( V )
* C h am pagne , f. f. (Teinture.') cercle de fer garni
de cordes nouées, qui vont en s’enlaçant les unes
-les autres du centre à la circonférence <le c,e cercle,
paflant du centre deffus le cercle, revenant du cercle
en-deflous au centre formant une efpece de
réfeau : on ûifpend ce cercle dans la cu v e , afin d’em-
^pêcher l’étoffe qu’on met en -teinture de toucher au
-marc & à la-pâtée. Voyc{ P I. de Teinture la figure dé
ce cercle. Voye^ aujfi Varticle TEINT-URE.
CHAMPANE, f. f . .( Marine. ) cette forte de -bâtiment
eft en ufage au Japon , où il eft défendu de
conftruire de grands navires. Les champanes ne font
guere que du port de foixante tonneaux, ou quatre-
vingt au plus. On n’employe dans leur conftruûion
n i fer ni clous ; les bordages font emboîtés, & les
membres n ’enfontcoufusou liés que par des chevilles
de bois. Ils ne font pas pontés ; il y a feulement
des courfives à bas-bord & à ftribord qui fervent de
liaifon au bâtiment qui eft plat comme un bac : ils
font plus larges à l’arriere ■ qu’à l’avant ; mais l’avant
eft plus élevé : le gouvernail qui eft à l’arriere eft
fort large, & ils y ajoutent à chaque côté une rame
affez groffe qui les aide à gouverner. Ils ne portent
qu’une voile, qu’on hiffe avec un vindas. Sur le haut
du-bâtiment il y a une efpece de cabane qui fert de
cuifine ; & au fond de cale une citerne ou endroit
pour contenir l’eau néceffaire à l’équipage. Une pareille
forte de bâtiment ne peut pas naviguer dans la
haute mer ; à peine peut-il fervir le long des côtes ,
& dans un très-beau tems. ( Z )
* CHAMPANELLES, f, m. ( Hift. nat. ) grands
finges qui reffemblent fi fort à l’homme, qu’on a dit
qu’ils n’en différoient que parce qu’ils étoient; privés
de l’ufage de la voix. Dish ajoute qu’on en trouva
quelques-uns dans l’île de Bornéo , d’où ils furent
tranfportés en Angleterre, & que les Indiens les appellent
aurang-outang. Voye^ l'article SlNGE.
CHAMPART ,,f. m. (Jurifpr. ) terme ufitédans
plufieurs coûtumes & provinces, pour exprimer une
redevance qui confifte en une certaine portion des
fruits de l’heritage pour lequel elle eft dûe. Ce mot
vient du latin campi pars , ou campi partus, d’où l’on
a formé dans les anciens titres latins les noms de
camparSyCampipartum, camparcium, campartum, cam-
pardus, campartus , campipertio. Voye£ Duçange, au
mot campi pars.
En françois il reçoit auffi différens noms : en quelques
lieux on l’appelle terrage ou agrier ; en d’autres
on l’appelle tafque ou tâche, droit de quart ou de cin-
quain , neuvième , vingtain, &c.
Ce droit a lieu en différentes provinces, tant des
pays coutumiers que des pays de droit ,écrit. En quelques
endroits il eft fondé fur la coutume , ftatuts ou
nfages du lieu; en d’autres il dépend des titres.
Les coûtumes qui font mention du champart 9 font
celles de Châteauneuf, Chartres , Dreux ,Dunois ,
Etampes , Orléans , Mantes , Senlis § Clermont,
Amiens, Ponthieu , Saint-Pol, Montargis , Romo-
xantin, M enetou,Nivemois, Péronne, Berri,Bpur-
bonnois, Poitou, Blois, & plufieurs autres où il reçois
différens noms.
Dans les parlemens de Touloufe & d’A ix , il eft
connu fous les noms de champart > agrier, ou tafque:;
dans les autres pays de droit écrit, U reçoit auffi dif-
férens noms.
U y en a de trois fortes y favQir, celui qui eft feigneurial
& qui tient lieu de cens, & eft dû in rcaeï
gnitionem dominii ^quelquefois ce n’eft qu’une redevance
femblable au fiircens ou-rente feigneuriale ;
enfin il y a une troifieme forte de champart non fei*.
gneurial ; celui-ci n’eft qu’une redevance foncière
qui eft due au propriétaire ou bailleur de fonds, dont
l’héritage a été donné à cette condition.
Le plus ancien réglement que l’on trouve fur le
droit de champart, font des lettres de Louis-le-gros
de l’an 1 1 19 , accordées aux habitans du lieu nommé
Angere regis , que M. Secouffe croit être Ànger*
ville dans l’Orléannois. Ces lettres portent que les
habitans de ce lieu payeront au roi un cens annuel
en argent pour les terres qu’ils pofféderont ; que s’ils
y fement du grain, ils en payeront la dixme ou le
champart. Elles furent confirmées par Charles VI. le
4 Novembre 1391.
On voit dans les établiffemens de S. Louis, faits
en 1270 , ch. xcicjx. que le feigneur direét pouvoit
mettre en fa main la terre tenue à champart d’un bâtard
, dont on ne lui payoit aucune redevance ; mais
que cè bâtard pouvoir la reprendre à la charge du
cens.
Il eft d it , ch. clxiij. de ces mêmes établiffemens ,
que le feigneur pouvoit mettre en fa main la terre
qui ne devoit que le terrage ou champart ; mais qu’il
ne pouvoit pas l’ôter au propriétaire pour la donner
à un autre ; que fi la terre devoit quelques autres
droits , le feigneur ne la pouvoit prendre qu’après
qu’elle avoit été fept ans en friche ; qu’alors le tenancier
qui perdoit fa terre devoit de plus dédommager
le feigneur de la perte qu’il avoit faite du champart
pendant ce tems.
Philippe VI. dit de Valois, dans un mandement
du 10 Juin 13 3 1 , adrelfé aufénéchal de Beaucaire,
dit qu’pn lui a donné à entendre que par un privilège
accordé par les, rois fes prédéceffeurs , & obfervé
nfcju’alors , ceux qui tenoient du roi un fief ou un
arriere-fief, pouvoient pofféder des héritages tenus
à cens ou à champart j Philippe V I. ordonne qu’il fera
informé de ce privilège ; & que s’il eft confiant ,
les poffeffeurs des terres ainfi tenues, à cens ou à
champart, ne feront point troublés dans leur poffef-
fion.
Dans des lettres du roi Jean , du mois d’O&obre
1361 , portant confirmation de la charte de bour-
geoifie accordée aux habitans de Bufency, il eft dit,
art. 4. que les bourgeois payeront, le terrage de treize
gerbes une, de toutes les terres que l’on labourera
fur le ban & finage de Bufency, & pour les vignes
à proportion.
Un des articles des privilèges accordés aux habitans
de Monçhauvette en Beauee , par Amauri
comte de M ontfort, & Simon comte d’Evreux fon
fils , confirmés par plufieurs-de nos rois , & notamment
par Charles VI. au mois de Mars 1393 , porte
que fi ceux qui font fujets au droit de champart ne
veulent pas le payer, on .le .lèvera malgré eux.
L’ufage qui s’obferve préfentement par rapport au
droit de champart, eft que dans les pays coûtumiers
il n’eft dû communément que fur les grains femés,
tels que b lé , feigle, orge , avoine, pois de v e fe e ,
qui font pour les chevaux ; blé noir ou farrafin, blé
de Mars, chanvre. Il ne fe perçoit point fur le vin ni
fur les. légumes, non plus que fur le bois, furies arbres
fruitiers », à moins qu’il n’y ait quelque difpofi-.
tion contraire dans la coûtume, ou un titre précis.
En quelques endroits les feigneurs ou propriétaires
ont furies vignes un droit femblable au champart 9
auquel néanmoins on donne différens noms : on l’appelle
tenequ à Chartres, complant en Poitou, Angou-
mois & Xaintonge ; carpot en Bourbonnois. Ces
droits dépendent auffi de l’ufage & des titres, tant
pour la perception en général que pour la quotité.
Dans les pays de droit éc rit, le champart ou agrier
fe levefur toutes fortes de fruits ; mais on y diftingue
Y agrier fur les vins & autres fruits, de ceux qui fe
perçoivent fur les grains : les noms en font différens£
auffi bien que la quotité ; cela dépend ordinairement
de la baillette , ou conceffion de l’héritage. ■
La dixme, foit eccléfiaftique ou inféodée, fe perçoit
avant le champart; & le feigneur ne prend le
champart que fur ce qui refte après la dixme prélevée
c ’eft-à-dire que pour fixer le champart ovine
compte point les gerbes enlevées pour la dixme.
On tient pour maxime èn pays coûtumièjr, que le
champart n’eft pas vraiment feignèurial, à moins qu’il
ne tienne lieu du cens: quelques coutumes le décident
ainfi. Montargis , arttjv, ;
Le champart feigneurial a les mêmes prérogatives,
que le cens; il produit des lôds & ventes , en cas,de
mutation par vente ou par contrat équipojlent.à vente
, excepté dans les coûtumes d’Orléans & d’Etam-
pes, qui font fingulieres à çet égard.
Le decret ne purge point le droit de champart feigneurial
, quoique le feigneur ne s’y foit-pas oppofé.
A l’égard des pays de droit écrit, l’ulàge le plus>
général eft que le champart n’y eft réputé feigneurial
que quand il eft joint au cens, cela dépend des titres
ou reconnoiffances. Cependant au parlement de Bordeaux
il eft réputé feigneurial de fa nature.
Le champart y même feigneurial, n’eft pas portable
dans les parlemens de droit écrit ; il eft querable fur
le champ, excepté au parlement de Bordeaux ; il
tombe en arrérages : mais fur ce point l’ufage n’eft
pas uniforme ; au parlement de Touloufe on n’en
peut demander que cinq ans,' foit que le droit foit
feigneurial ou non ; à Bordeaux on en adjuge vingt-
neuf quand il eft feigneurial, & cinq lorfqu’il ne l’eft
pas ; au parlement de Provence on eh adjuge trente-
neuf années, quand il eft dû à un feigneur eccléfiaftique.
En pays coûtumier il ne tombe point en arrérages
, & il eft toûjours querable, fi le titre & la coûtume
ne portent le contraire ; comme les coûtumes
de Poitou, Saintes, Amiens, Nevers, Montargis,
Blois, & Bourbonnois.
La quotité du champart dépend de l’ufage du lieu',
& plus encore des titres, Les coûtumes de Montargis,
de Berri & de Vatan, le fixent à la douxieme gerbe
, s’il n’y a convention contraire : celle de Dovine
le fixe à la dixième gerbe. Il y a encore des lieux où
il eft plus fort : quelques feigneurs en Poitou perçoivent
de douze gerbes deux , & même trois ; ce qui
fait la quatrième ou la fixieme gerbe; Il y a auffi de$
endroits où il eft moindre : tout cela, encore une
fois, dépend de l’ufage & des titres.
Dans les provinces de Lyonnois, Forés, Beau-
jollois , il eft ordinairement du quart ou du cinquième
des fruits ; c’eft pourquoi on l’appelle droit de
quarte ou de cinquain.
En Dauphiné on l’appelle droit de vingtain, parce
qu’il eft de vingt gerbes une.
On peut intenter complainte pour le terrage. Celui
qui poffede un héritage fujet au champart ou autre
droit équipollent, eft obligé de labourer & enfemen-
cer ou planter la terre, de maniéré que le droit puiffe
y être perçû; il ne peut, en fraude du droit, laiffer
l’héritage en friche, s’il eft propre à être cultivé ; &
li le titre fpécifie la qualité des fruits qui font dûs, le
tenancier ne peut changer la furface du fonds, pour
lui faire produire une autre efpece de fruits : les coûtumes
de Blois & d’Amiens le défendent expreffé-
ment ; celle de Montargis le permet, en avertiflant
le feigneur, & l’indemnifant à dire d’experts.
Il faut néanmoins excepter le cas où la nature du
terrein demande ce changement; alors le feigneur
ou propriétaire ne perd pas fon droit, il le perçoit
fur les fruits que produit l’héritage.
La coûtume de Poitou, art. cjv. veut que celui
qui tient des-terres à terrage ou champart, en pays
de bocage, c’eft-à-dire entouré de bois, emblave
au moins le tiers des terres; &- fi c’eft en plaine,
qu’il en emblave -la moitié. L’article Ixj. porte qu’à
l’égard des vignes, faute de les façonner , le feigneur
les peut reprendre, & lès donner à d’autres.
Les coûfumes de la Marche, Clermont, Berri,
Amiens, ne permettent au feigneur de reprendre les
terres qu’au bout de trois ans de caffation de culture
; celle d’Amiens permet au tenancier de les reprendre
; la coûtume d e Blois veut qu’il y ait neuf
ans de ceffation.
Le:champart fe prend chaque année dansle champ,
foit pour l’emporter s’il eft querable, foit pour le
compter & le faire porter par le tenancier s’il eft
portable. Dans tous les cas il faut que le feigneur ou
propriétaire, ou leurs.prépôfés, foient avertis avant
que l’on puiffe enlever la dépouille du champ. La
coûtume-de Soefme eft la feule qui permette au tenancier
d’enlever fa-récolte fans appeller le feigneur,
en laiffans le terrage debout, c’eft-à-dire fans
le couper ; & vice versa, au feigneur avant le tenancier.
_
Quant à la maniéré d’avertir le feigneur ou propriétaire
qui a droit de champart, la coûtume de Boulenois
dit qu’on doit le fommer : celles de Berri &:
Blois veulent qu’on lui fignifie; mais dans l’ufage le
tenancier n’eft point obligé de faire aucun afte judiciaire
; un avertiffement verbal en préfence dë témoins
fuffit, comme la coutume de Blois le dit en
un autre endroit.
Lorfque ce droit eft commun à plufieurs feigneurs,
il fuffit d’en avertir un, Ou de faire cet avertiffement
au lieu où le champart doit être porté, comme là
coûtume de Blois le donne à eritendre, art. cxxxiij.
La coûtume de Mantes veut que le féignêur ap-
pellé pour la levée du terrage, comparoifle du foir
au matin, & du matin à l’après-dînée. Les coûtumes
de Poitou & de Berri veulent qu’ôn l’attende vingt-
quatre heures : celle de Montargis, qu’on l’attende
compéteniment • cela dépend de l’ufage & des titres,
& même des circonftances qui peuvent obliger d’enlever
la moiflbn plus promptement ; par exemple ,
lorfque Bon craint un orage.
Le champart feigneurial, & qui tient lieu du cens,
eft de fa nature imprefcriptible ; & par une fuite du
même principe, le decret ne le purge pas.
En Dauphiné le champart, qu’on y appelle vingtain
, fe preferit par cent ans, lorfqu’il eft feigneurial
; & par trente ou quarante, lorfqu’il ne l’eft pas.
Sur le droit de champart ou terrage, voye^ le glojjaire
de Ducange au mot campi pars ; & celui de Lauriere ,
aux mots champart & terrage. La Rocheflavin, tr. des
droitsfeigneuriaux. Defpeiffes, tit. du champart. Lov-
fe l, infiit. liv. IV. tit. ij. Loiiet & Brodeau, leur. Ci '
n. ic). & 2/. Coquille, tomell. quejl.yC. Maynard,
liv. X. arrêt iij. Dumoulin fur Paris, ch. ij. tit.prem.
Chopin fur la même coûtume , liv. I. tit. iij. n. 20.
Bretonnier fur Henrys, tome I. liv. I. chap. iij. quefl.
34. Dolive, liv. I I . ch. xxjv. Bafnage fur la coûtume
de Normandie, tit. de jurifdiclion, art. iij. Guyot,
tr. des fiefs t tome IV. ch. du champart. Tr. du champart
par Brunet, qui ejl à la fuite du tr. des dixmes de Drapier.
Voyeç aujfi ci-devant au mot AGRIER, & ci-après
aux mots C h àMPARTAGE , COMPLANT , NEUME ,
T a sq u e , T en eau , T er r ag e , Q u a r t , C inq
u a in , V in gtain.
CHAMPARTAGE, f. m. ( Jurifpt■ .) appellé dans
la baffe latinité & dans les anciens titres, camparta-
gium, eft un fécond droit de champart que quelques
feigneurs, dans la coûtume de Mantes, font fondés à