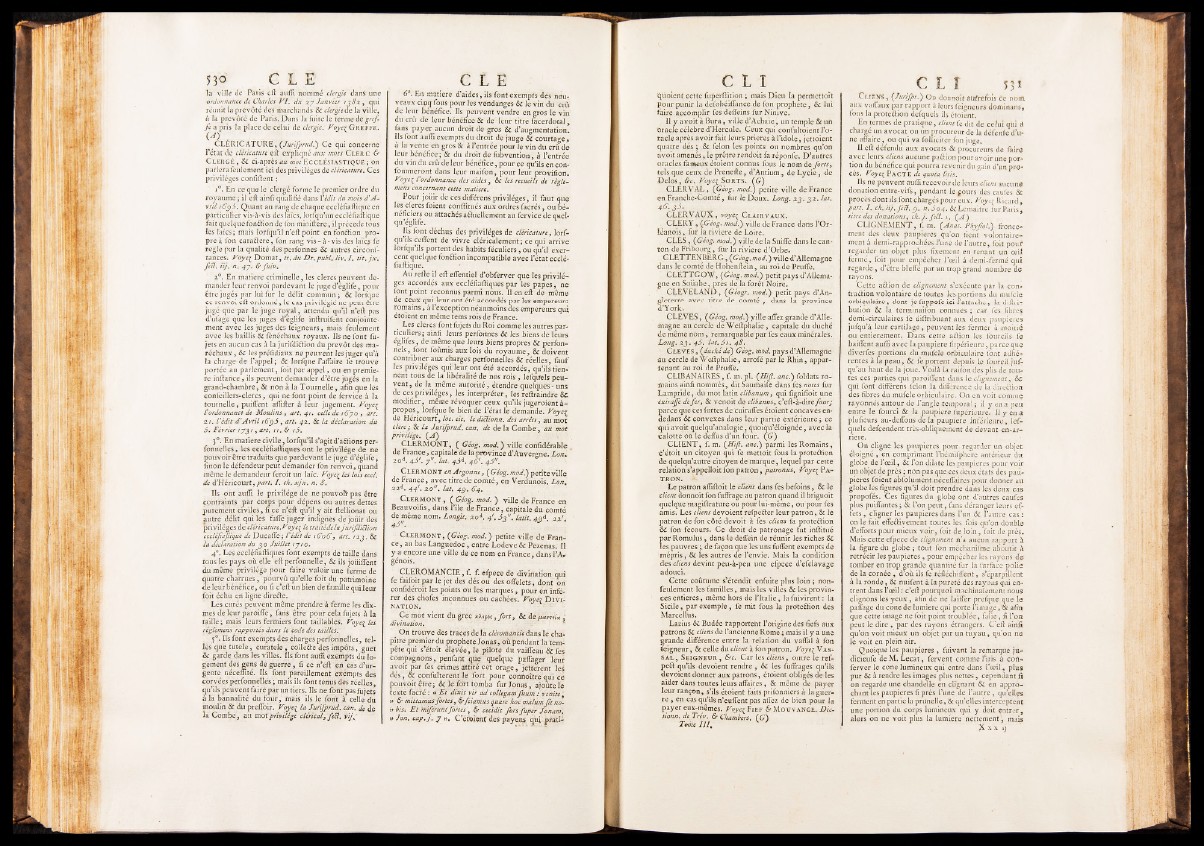
53° C L E
la ville de Paris eft auffi nommé clergie dans une
ordonnance de Charles VI. dit i j Janvier 138z , qui
réunit la prévôté des marchands & clergie de la ville,
à la prévôté de Paris. Dans la fuite le terme de greffe
a pris la place de celui de clergie. Voye? G reffe.
H j H .
CLÉRICÀTURE, (‘Jurifprud.) Ce qui concerne
l’état de cléricàture eft expliqué aux mots C lerc &
C le r g é , & ci-après au mot Ecc l é s ia s t iq u e ; on
parlera feulement ici des privilèges de clericature. Ces
privilèges confiftent :
i°. En ce que le clergé forme le premier ordre du
royaume ; il eft ainfi qualifié dans Y édit du mois d 'a vril
i&gS'. Quant au rang de chaque eccléfiaftique en
particulier vis-à-vis des laïcs, Ioriqu’un eccléfiaftique
fait quelque fönCHon de fon miniftere, il précédé tous
lès laïcs ; mais lorfqu’il n’eft point en fonfrion propre
à fon caraCtere, fon rang vis - à - vis des laïcÿ fe'
regle par la qualité des perfonnes & autres eirconf-
tanees. Voye^ Domat, tr. dû Dr. publ. liv. I . tit. jx .
fiel. ii/. n. 47. & J'uiv|
2Ö. En matière criminelle, les clercs peuvent demander
leur renvoi pârdevant le juge d’églife, pour
être jugés par lui fur le délit commun ; & lorlque
ce renvoi eft ordonné, le cas privilégié ne peut être
jugé que par le juge royal, attendu qu’il n’eft pas
d’ufage que les juges d’églife inftruifent conjointement
avec les juges des feigneurs, mais feulement
avec les baillis & féiiéchaux royaux. Ils ne fönt fu-
jets en aucun cas à la jurifdiCtion du prévôt des maréchaux,
& les préfidiaux ne peuvent les jliger qu’à
la charge de l’appel ; êc lorfque l’affaire fe trouve
portée au parlement, foit par appel, ou en première
inftance, ils peuvent demander d’être jugés en la
grand-chambre, & non à la Tournelle, afin que les
eonfeillers-elercs, qui ne font point de fervice à la
tournelle, puiffent aftifter à leur jugement. Voye^
P ordonnance de Moulins , art. 41. celle de i6yo , art.
z i . l'édit d'Avril i fy S , art. 42. & la déclaration du
6. Février 1731, art. 11. & iS.
30. En matière civile, lorfqu’il s’agit d’aClions per-
fonnelles, les eccléfiàftiques ont le privilège de ne
pouvoir être traduits que pardevant le juge d’églife ,
linon le défendeur peut demander fon renvoi, quand
même le demandeur feroit lin laïc. Voye£ les lois eccl.
de d’Héricourt, part. I . eh. x jx . n. 8.
Ils ont auffi le privilège de ne pouvoür pas être
contraints par corps pour dépens ou autres dettes
purement civiles, fi ce n’eft qu’il y ait ftellionat ou
autre délit qui les faffe juger indignes de jouir dés
privilèges de cléricàture. Voye[ le trâitédela jurifdiclion
eccléfiajlïque de Ducalfe; l'édit de iGoG, art. 123. &
la déclaration du 3 o Juillet iyi 0. ■
4°. Les eccléfiàftiques font exempts de taille dans
tous les pays oh elle èft perfonnelle, & ils joiiiffent
du même privilège pour faire valoir une ferme de
quatre charrues, pourvu qu’elle foit du patrimoine
dé leur bénéfice, ou fi c’eft un bien de famille qui leur
foit échu en ligne direâe.
Lés curés peuvent même prendre à ferme les dix-
mes de leur paroiffe, fans être polir cela fujets à la
taille ; mais leurs fermiers font taillablés. Voyer les
règlemens rapportés dans le code des tailles.
. 50. Ils font exempts des charges perfonnelles, telles
que iutèle, curàtele , collette des impôts, guet
& garde dans les villes. Ils fönt auffi exempts du logement
des gens de guerre, fi Ce n’eft en Cas d’urgente
néceffité. Ils font pareillement exémpts des
corvées perfonnelles ; mais ils font tenus dès réelles,
qu’ils peuvent fairé par un tiers. Ils ne font pas fujets
à la bannalité du foiir, mais ils le fönt à celle du
moulin & du preffoir. Voye^ la JuriJ'prud. can. de de
là Combe, au mot privilège clérical, fiel, v ijt
C L E
6°. En matière d’aides, ils font exempts des nou-
| veaux cinq fous pour les vendanges & le vin du crû
: de leur bénéfice. Ils peuvent vendre en gros le vin
du crû de leur bénéfice & de' lenr titre facerdotal,
| fans payer aucun droit de gros & d’augmentation.
Ils font auffi exempts du droit de jauge & courtage,
a" là vente eh gros & à l’entrée pour le vin du crû de
; leur bénéfice ; & du droit de fubvention, à l’entrée
du vin du crû de leur bénéfice, pour ce qu’ils en con-
fommeront dans leur maifon, pour leur provifion.
VOyeç l'ordonnance des a id e s , & les recueils de règle-
mens concernant cette matière.
Pour jouir de cesdifférens privilèges, il faut que
les clercs foient conftitués aux ordres facrés, ou bénéficiers
ou attachés actuellement au fervice' de qnel-
qu’églife.
Ils font déchus deS privilèges de cléricàture, Iorf-
qn’ils ceffent de vivre cléricalement ; ce qui arrive
lorfqu’ils portent des habits féculiers, ou qu’il exercent
quelque fonction incompatible avec l’état eccléfiaftique.
Au refte il eft effentiel d’obferver que les privilèges
accordés aux eccléfiàftiques par les' papes, ne
font point reconnus parmi nous. Il en eft de même
de ceux qui leur ont été accordés par les empereurs
romains, à l’exception néanmoins des empereurs qui
étoient en même tem's rois de France.
Les clércs font fujets du Roi comme les autres particuliers
; ainfi leurs perfonnes & les biens de leurs
églifes, de même que leurs biens propres & perfon-
rieis, font fournis aux lois du royaume, & doivent
contribuer aux charges perfonnelles & réelles, fauf
les privilèges qurleltf ont été accordés, qu’ils tiennent
tous de la libéralité de nos rois , lefqirels peuvent
, de la meme autorité , étendre quelques - uns
de ces privilèges, les interpréter, les reftraindre 8c.
modifier, même révoquer ceux qu’ils jugeroient à -
propos , lorfque le bien de l’état le demande. Voye£
de Hericourt, toc. rit. le diclionn. des arrêts , au mot
clerc; & la Jurifprud. can. de de la Combe, au mot
privilège. (A )
CLERMONT, ( Géog. mod. ) ville confidérable .
de France , Capitale de la province d’Auvergne. Z oæ, *
z o A, 4M . y " , lat. 4 M , 4 6 ' . 4 M .
C lermon t en A rg o n n e , (G é o g . m od.) petite ville
de France, avec titre de comté, en Verdunois. L o n .
z z d. 4 4 '. 2 0 " . la t. 4 g , 6 4 .
C le rm o n t , (G é o g . m o d . ) ville.de France en
Beauvoifis, dans l’île de France, capitale du comté
de même nom. L o n g it. 20A. 4 ' . S3". la tit. 4 M , x z '*
..
■ C lermon t , (G éo g . mod. ) petite ville de France
, au bas Languedoc, entre Lodeve & Pezenas. Il
y a encore une ville de ce nom en France, dans l’Av
génois.
CLEROMANCIE, f. f. efpece de divination- qui
fe faifoit par le jet des dés ou des offelets, dont on
confidéroit les points ou les marques, pour en inférer
dés chofes inconnues ou cachées. Voyè7 D iv i n
a t io n .
Ce mot vient du grec kM p o ç ,fo r t , & de f id A t ia ÿ
divination.
Ori trouve des traces de la clèrotfiûnde dans le chapitre
premier du prophète Jonâs, OÎi pendant la tempête
qui s’étoit élevée, le pilote du vaiffeau & fes
Compagnons , pénfaftt qüe quelque paffagei* leur
avoit par fês crimes attiré cet Orage, jetterent les
dés , & cônfulterent le fort pour conrtoître qui ce
pou voit être; & lé fort tomba furjon a s , ajoûtele
fexté facré : a Et dixitvir ad collegantfuum : demie'
» & mittamiis fo r te s , & fr iam u s quare hoc m à lum fit no-
» hiss E l diiferutit fo r t e s , & cecidit fo r s fu p e r J onam.
» Jon. cap.j. J », C ’éfoiçnt des paÿens qui -prati-
C L I
quoient cette fupérftition ; mais Dieu ïa permettoft
pour punir la defobéiffance de fon prophète, & lui
faire accomplir fes defleins furNinive.
Il y avoit à Bura, ville d’Achaïe, un temple & un
Oracle célébré d’Hercule» Ceux qui confultoient l’oracle
après avoir fait leurs prières à l’idole, jettoient
quatre dés ; & félon les points ou nombres qu’on
avoit amenés, le prêtre rendoit fa réponfe. D ’autres
oracles fameux étoient connus fous le nom de forts,
tels que ceiût de Prenefte, d’Antium, de L y c ie , de
Delos, &c. Voye^ Sorts. (G)
CLERVAL , (Géog. mod.) petite ville de France
en Franche-Comté, fur le Doux, Long. 2 3 .3 2. lat,
DHH H H
C L E R V A U X , vôyèi C lair v a u x .
C L E R Y , (Géog. mod.) ville de France dans l’Ôr-
léanois, fur la riviere de Loire.
C L E S , (Géog. mod.) ville de la Suiffe dans le canton
de Fribourg, fur la riviere d’Orbe.
GLETTENBERG, (Géog. mod.) ville d’Allemagne
dans le comté de Hohenftein, au roi- de Prufle.
C L È T T G O V , (Géog. mod.) petit pays d’Allemagne
en Soiiabe, près de la forêt Noire.
CLEVELAND, (Géogr. mod.) petit pays d’Angleterre
avec titre de comté , dans la province
d’Y ork.
CLEVES, (Géog. mod.) yille affez grande d’Allemagne
au cercle de'Weftphalie, capitale du duché
de même nOm, remarquable par fes eaux minérales.
Long. 23. 4-5. lat. S i. 48.
C leVe s , (duché de) Géog. Yfiod. pays d’Allemagne
au cercle de Weftphalie, arrofé par le Rhin, appartenant
au roi de Prufle.
CLIBANAIRES, f. m. pl. (Nifi. anc.) foldats romains
ainfi nommés, dit Saumaile dans fes notes fur
Lampride, du mot latin clibanum, qui fignifioit une
Cüirajfe de fer, & venoit de clibànus, c’eft-à-dire four)
parce que ces fortes de cuirafîes étoient concaves en-
dedans & convexes dans leur partie extérieure ; ce
qui avoit quelqu’analogie, quoiqû’éloignée, avec la
calotte oti le deflïis d’un four. (G)
CLIENT, f. m. (Hifi. anc.) parmi les Romains,
c’étoit un citoyen qui fe mettoit fous la proteâïon
de quelqu’autre citoyen de marque, lequel par cette
relation s’appelloit fon patron, patronus. Voyeç Patr
o n . *■
Le patron affiftoit le client dans fes béfôins, & le
client donnoit fon fuflrage au patron quand il briguoit
quelque magiftrature ou pour lui-même, ou'pout fês
amis. Les cliens devoieht refpefter leur patron, & le
patron de fon côté devoit à fés cliens fa protection
& fon fecouts. Ce droit de patronage fut inftitué
par Romulus, dans le dèflein de réunir les riches &
les pauvres ; de façon que les uns fuflënt exempts de
mépris, & les autres de l’envie. Mais la condition
des cliens devint peu-à-peu une efpece d’efclavage
adouci.
Cette coutume s*étertdit enfuite plus loin ; non-
feulement les familles, mais les villes & les provinces
entières, même hors de l’Italie, la fuivirent : la
Sicile, par exemple, fe mit fous la protection des
Marcellus.
Lazius & Budée rapportent l’origine des fiefs aux
patrons & cliens de l’ancienne Rome ; mais il y a une
grande différence entre la relation du vaffal à fon
feigneur, & celle du client à fon patron. Voye£ V assal
, Se ign eu r , & c. Car les cliens, outre le refi-
peCt qu’ils dévoient rendre , & les fuffrages qu’ils
dévoient donner aux patrons, étoient obligés de.les
aider dans toutes leurs affaires , & même de payer
leur rançon, s’ils étoient faits prifonniers à la guerre
, en càs qu’ils n’euffent pas affez de bien pour la
payer eux-mêmes. Voye{ Fief & Mouvanc e. Die-
Konn. tUTriy. & Charniers. (G)
Ternie I I I ,
e n *3*
C l ien s , (jurifpr.) On donnoit autrefois ee nom
aux vaffaux par rapport à leurs feigneurs dominans,
fous la protection defquels ils étoient.
En termes de pratique, client fe dit de celui qui A
chargé un avocat ou un procureur de la défenfe d’u*
ne affaire, ou qui va folliciter fon juge.
Il eft défendu aux avocats & procureurs de faire
avec leurs cliens aucune paCtion pour avoir une portion
du bénéfice qui pourra revenir du gain d’un pro»
cès. Vjyei PACTE de quota litis.
Ils ne peuvent auffi recevoir de leurs cliens aucun«
donation entre-vifs, pendant le jours des caufes &
procès dont ils font chargés pour eux. Voye^ Ricard *
part. I. ch. iij. ficl. g . S04. & Lemaître lur Paris,
titre des donations, ch. j . fiel. 1. (A )
CLIGNEMENT, f. ni. (Anat. Pkyjiol.) froncement
des deux paupières qu’on tient volontairement
à demi-rapprodiées l’une de l’autre, foit pouf
regarder un objet plus fixement en tenant un oeil
fermé, foit pour empêcher l ’oeil à demi-fermé qui
regarde , d’être bleffé par un trop grand nombre de
rayons.
Cette a Cf ion de clignement s’exécute par la contraction
volontaire de toutes les portions du mufcle
orbiçulaire, dont je fuppofe ici l’attache, la diftri-
bution & la terminaifon connues ; car fes fibres
demi-circulaires fe diftribuant aux deux paupières
jufqu’à leur cartilage, peuvent les fermer à moitié
ou entièrement. Dans cette aftion les fourcils fe
baiffent auffi avec la paupière fupérieure, parce que
diverfes portions du mufcle orbiçulaire font adhérentes
à la peau, & fe portent depuis le foureil j'uf-
qu’au haut de la joue. Voilà la raifon des plis de toutes
ces parties qui paroiffent dans le clignement, &
qui font différens félon la différence de la direction
des fibres du mufcle orbiçulaire. On en voit comme
rayonnés autour de l’angle temporal ; il y en a peu
entre le fourci & la paupière fupérieure. II y en 3
plufieurs au-deffous de la paupière inférieure, lef-
quels defeendent très-obliquement de devant en-ar-
ricre.
On cligne les paupières pour regarder un objet
éloigné , en comprimant l’hémifphere antérieur du
globe de l’oe il, & l’on dilate les paupières pour voir
un objet de près ; non pas que ces deux états des paupières
foient abfolument.néceffaires pour donner au
giobe lés figures qu’il doit prendre dans les deux cas
propofés. Ces figures du globe ont d’autres caufes
plus puiffantes ; & l’on peut, fans déranger leurs effets
, cligner les paupières dans l’un ôc l’autre cas :
on le fait effectivement toutes les fois qu’on double
d’efforts pour mieux voir, foit de loin, foit de près.
Mais cette efpece de clignement n’a aucun rapport à
la figure du globe ; tout fon méchanifme aboutit à
rétrécir les paupières , pour empêcher les rayons de
tomber en trop grande quantité fur la furface polie
de la cornée , d’où ils fe réfléchiffent, s’éparpillent
à la ronde, & nuifent à la pureté des rayons qui entrent
dans l’oeil : c’eft pourquoi machinalement nous
clignons les y e u x , afin de ne laiffer prefque que le
paflage du cône de lumière qui porte l’image,& afin
que cette image ne foit point troublée, falie, fi l’on
peut le dire , par des rayons étrangers. C ’eft ainfi
qu’on voit mieux un objet par un tuyau, qu’on ne
le voit en plein air.
Quoique les paupières , fuivant la remarque ju-
dicieufe de M. Lecat, fervent comme l’iris à con-
ferver le cône lumineux qui entre dans l’oe il, plus
pur & à rendre les images plus nettes, cependant fi
on regarde une chandelle en clignant ôc en approchant
les paupières fi près l’une de l’autre , qu’elles
ferment en partie la prunelle, & qu’elles interceptent
une portion du corps lumineux qui y doit entrer ,
alors on ne voit plus la lumière nettement mafs
X x 'x |