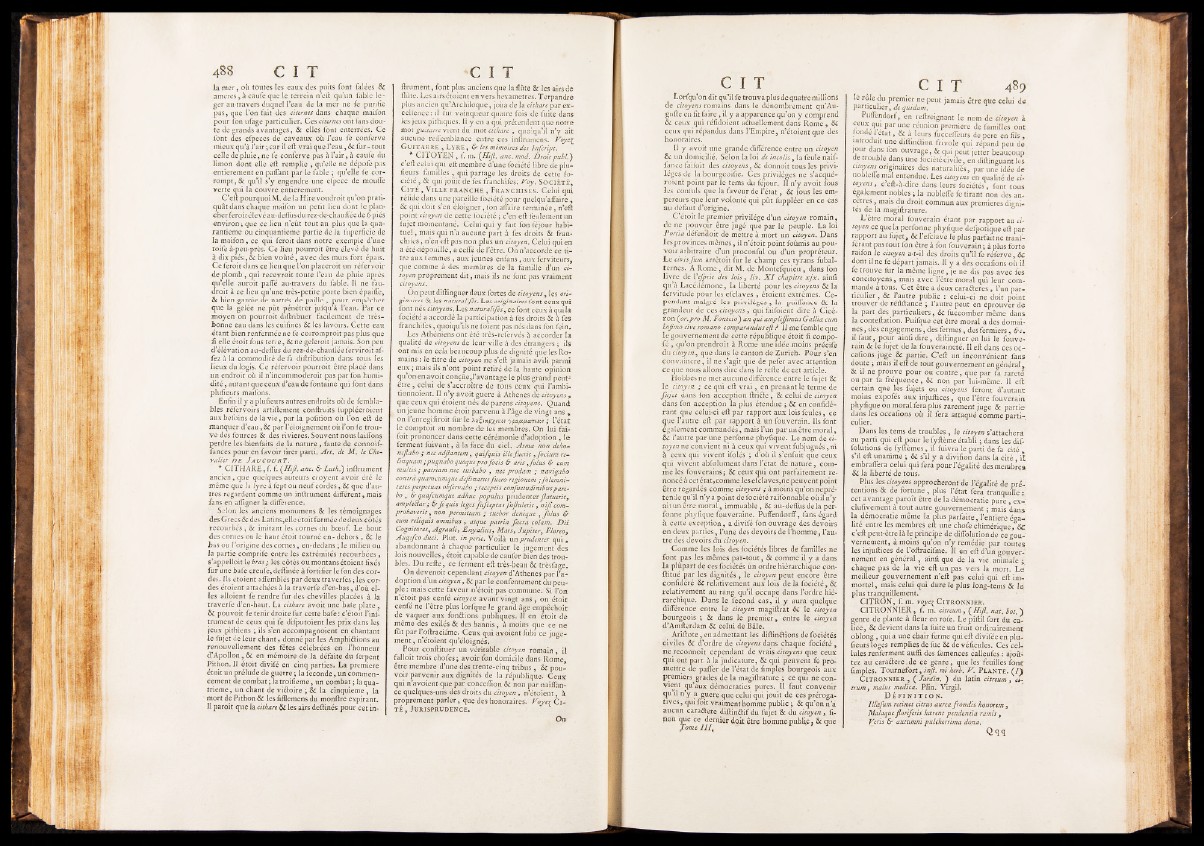
488 C I T
la m er, oii toutes les eaux des puits font falées &
ameres, à caufe que le terrein n’eft qu’un fable léger
au-travers duquel l’eau de la mer ne fe purifie
pas, que l’on fait des citernes dans chaque maifon
pour ion ufage particulier. Ces citernes ont fans doute
de grands avantages, & elles font enterrées. Ce
font des efpeces de caveaux oîi l’eau fe conl'erve
mieux qu’à l’air ; car il eft vrai que l’eau, & fur - tout
celle de pluie, ne fe conferve pas à l’air, à caufe du
limon dont elle eft remplie , qu’elle ne dépofe pas
entièrement en paffant par le fable ; qu’elle fe corrompt,
& qu’il s’y engendre une efpece de moufle
verte qui la couvre entièrement.
C ’eft pourquoi M. de la Hire voudroit qu’on pratiquât
dans chaque maifon un petit lieu dont le plancher
feroit élevé au-deflus du rcz-de-chauffée de 6 piés
environ; que ce lieu n’eut tout au plus que la quarantième
ou cinquantième partie de la fuperficie de
la maifon, ce qui feroit dans notre exemple d’une
toife à-peu-près. Ce lieu pourroit être élevé de huit
à dix piés, & bien voûté, avec des murs fort épais.
Ce feroit dans ce lieu que l’on placeroit un réfervoir
de plomb, qui recevroit toute l’eau de pluie après
qu’elle auroit paffé au-travers du fable. Il ne fau-
droit à ce lieu qu’une très-petite porte bien épaiffe,
& bien garnie de nattés de paille , pour empêcher
que la gelée ne pût pénétrer jufqu’à l’eau. Par ce
moyen on pourroit diftribuer facilement de très-
bonne eau dans les cuifines & les lavoirs. Cette eau
étant bien renfermée ne fe corromproit pas plus que
iî elle étoit fous terre, & ne geleroit jamais. Son peu
d’élévation au-deflus du rez-de-chanfl'ée ferviroit af-
fez à la commodité de fa diftribution dans tous les
lieux du logis. Ce réfervoir pourroit être placé dans
un endroit où il n’incommoderoit pas par Ion humidité
, autant que ceux d’eau de fontaine qui font dans
plufieurs maifons.
Enfin il y a plufieurs autres endroits où de fembla-
bles réfervoirs artiftement conftruits fuppléeroient
aux befoins de la v ie , par la pofition où l’on eft de
manquer d’eau, & par l’éloignement où l’on fe trouve
des fources & des rivières. Souvent nous laiflons
perdre les bienfaits de la nature, faute de connoif-
lances pour en favoir tirer parti. Art. de M. le Chevalier
DE J AU COU RT.
* CITHARE, f. f. (Hift- a.nc. & Luth.') inftrument
ancien, que quelques auteurs croyent avoir été le
même que la lyre à fept ou neuf cordes, & que d’autres
regardent comme un inftrument différent, mais
fans en afligner la différence.
Selon les anciens monumens & les témoignages
des Grecs & des Latins,elle étoit formée de deux côtés
recourbés, & imitant les cornes du boeuf. Le bout
des cornes ou le haut étoit tourné en - dehors , & le
bas ou l’origine des cornes, en-dedans ; le milieu ou
la partie comprife entre les extrémités recourbées ,
s’appelloit \ebras; les côtés oumontansétoient fixés
fur une bafe creufe, deftinée à fortifier le fon des cordes.
Ils étoient affemblés par deux traverfes ; les cordes
étoient attachées à la traverfe d’en-bas, d’où elles
alloient fe rendre fur des chevilles placées à la
traverfe d’en-haut. La cithare avoit une bafe plate ,
& pouvoit fe tenir droite fur cette bafe: c’étoit l’inf-
trument de ceux qui fe difputoient les prix dans les
jeux pithiens ; ils s’en accompagnoient en chantant
le fujet de leur chant, donné par les Amphifrions au
renouvellement des fêtes célébrées en l’honneur
d’Apollon, & en mémoire de la défaite du ferpent
Pithon. Il étoit divifé en cinq parties. La première
étoit un prélude de guerre ; la fécondé, un commencement
de combat ; la troifieme, un combat ; la quatrième,
un chant de vifroire ; & la cinquième , la
mort de Pithon & les fifflemens du monftre expirant.
Il paroît que la citkare & les airs deftinés pour cet in-
C I T
ftrument, font plus anciens que la flûte & les airs de
flûte. Les airs étoient en vers hexamètres. Terpandre
plus ancien qu’Archiloque, joiia de la cithare par excellence
: il fut vainqueur quatre fois de fuite dans
les jeux pithiques. Il y en a qui prétendent que notre
mot guitarre vient du mot cithare , quoiqu’il n’y ait
aucune reflemblance entre ces inftrumens. Foye^
G uitarre , Ly r e , & les mémoires des Infcript.
* CITOYEN , f. m. (JFUJI. anc. mod. Droitpubl.)
c’eft celui qui eft membre d’une fociété libre de plufieurs
familles , qui partage les droits de cette fociété,
& qui joüit de fes franchifes; Voy. So c ié t é ,
Cit é , V ille franche , Fran ch ises . Celui qui
réfide dans une pareille fociété pour quelqu’affaire ,
& qui doit s’en éloigner, ion affaire terminée, n’eft
point citoyen de cette fociété ; c’en eft feulement un
fujet momentané. Celui qui y fait fon féjour habituel,
mais qui. n’a aucune part à fes droits & fran-
chiles, n’en eft pas non plus un citoyen. Celui qui en
a été dépouillé, a ceffé de l’être. On n’accorde ce titre
aux femmes , aux jeunes enfans ,.aux ferviteurs,
que comme à des membres de la famille d’un citoyen
proprement dit, mais ils ne font pas vraiment
citoyens.
On peut diftinguer deux fortes de citoyens, les originaires
& les naturalifés. Les originaires font ceux qui
font nés citoyens. Les naturalifés, ce font ceux à qui la
fociété a accordé la participation à fes droits & à fes
franchifes, quoiqu’ils ne l'oient pas nés dans fon fein.
Les Athéniens ont été très-refervés à accorder la
qualité de citoyens de leur ville à des étrangers ; ils
ont mis en cela beaucoup plus de dignité que les Romains
: le titre de citoyen ne s’eft jamais avili parmi
eux ; mais ils n’ont point retiré de la haute opinion
qu’on en avoit conçûe,l’avantage le plus grand peut-
être , celui de s’accroître de tous ceux qui l’ambi-
tionnoient. Il n’y avoit guere à Athènes de citoyens ,
que ceux qui étoient nés de parens citoyens. Quand
{. un jeune homme étoit parvenu à l’âge de vingt ans ,
on l’enregiftroit fur le Xn^/xpxmov ypa/xyxmlov b l’état
le comptait au nombre de fes membres. On lui fai-
foit prononcer dans cette cérémonie d’adoption , le
ferment fuivant, à la face du ciel. Arma non deho-
nejlabo y nec adflantem, quifquis ille fuerit ,focium re-
linquam ;pugnabo quoque pro focis & aris , folus & cum
multis ; patriam nec turbabo , nec prodatn ; navigabo
contra quamcumque deflinatus fuero regionem ; folemni-
tates perpétuas obfervabo ; receptis confuttudinibus pare*
bo , & quafcumque adhuc populus prudenter Jlatuerit,
amplectar ; & Jîquis leges fujceptas JuJlulerit, nijï com-
probaverit, non permittam j tuebor denique , folus &
cum reliquis omnibus , atque patria facra colarn. D ii
CognitoreSy Agrauli, Enyalius, Mars, Jupiter, Floreo,
Augefco duci. Plut, in peric. Voilà un prudenter q u i,
abandonnant à chaque particulier le jugement des
lois nouvelles, étoit capable de caufer bien des troubles.
Du refte, ce ferment eft très-beau & trèsfage.
On devenoit cependant citoyen d’Athenes par l’adoption
d’un citoyen, & par le confentement du peuple:
mais cette faveur n’étoit pas commune/Si l’on
n’etoit pas cenfé citoyen avànfvingt ans, on étoit
cenfe ne l’être plus lorfque le grand âge empêchoit
de vaquer aux fondions publiques. Il en étoit de
même des exilés & des bannis, à moins que ce ne
fût par l’oftracifme. Ceux qui avoient fubi ce jugement,
n’étoient qu’éloignés.
Pour conftituer un véritable citoyen romain il
falloit trois chofes; avoir fon domicile dans Rome,
être membre d’une des trente-cinq tribus , & pouvoir
parvenir aux dignités de la république. Ceux
qui n’a voient que par conceflîon & non par naiflan-
ce quelques-uns des droits du citoyen, n’étoient, à
proprement parler, que des honoraires. F'oyei C i t
é , Jurisprudence.
On
Lorfqifon dit qu’il fe trouva plus de quatre millions
de citoyens romains dans le dénombrement qu’Au-
gufte en fit faire, il y a apparence qu’on y comprend
& ceux qui réfidoient actuellement dans Rome , &
ceux qui répandus dans l ’Empire, n’étoient que des
honoraires.
Il y avoit une grande différence entre un citoyen
& un domicilié. Selon la loi de incolis, la feule naif-
fance faifoit des citoyens, & donnoit tous les privilèges
de la bourgeoifie. Ces privilèges ne s’acqué-
a oient point par le tems du féjour. Il n’y avoit fous
les conflits que la faveur de l’é ta t, & fous les empereurs
que leur volonté qui pût fuppléer en ce cas
au défaut d’origine.
C ’étoit le premier privilège d’un citoyen romain,
de ne pouvoir être jugé que par le peuple. La loi
Portia défen’doit de mettre à mort un citoyen. Dans
les provinces mêmes, il n’étoit point foûmis au pouvoir
arbitraire d’un proconful ou d’un propréteur.
Le civisfum arrêtoit fur le champ ces tyrans fubal-
ternes. A Rome, dit M. de Montefquieu , dans fon
livre de Yefprit des lois, liv. X I chapitre x jx . ainfi
qu’à Lacédémone, la liberté pour les citoyens & la
fervitude pour les efclaves , étoient extrêmes. Cependant
malgré les privilèges , la puiffance & la
grandeur de ces citoyens, qui faifoient dire à Cicéron
(or.pro M, Fonteio) an qui ampliJJimus G allia cum
infimo cive romano comparandus cjl ? Il me femble que
le gouvernement de cette république étoit fi compo-
fé , qu’on prendroit à Rome une idée moins précife
du citoyen, que dans le canton de Zurich. Pour s’en
convaincre, il ne s’agit que de pefer avec attention
ce que nous allons dire dans le refte de cet article.
Hobbes ne met aucune différence entre le fu jet &
le citoyen ; ce qui eft v r a i, en prenant le terme de
fujet dans fon acception ftrifre, & celui de citoyen
dans fon acception la plus étendue ; & en confidé-
rant que celui-ci eft par rapport aux lois feules, ce
que l’autre eft par rapport à un fouverain. Ils font
également commandés, mais l’un par un être moral,
& l’autre par une perfonne phyfique. Le nom de citoyen
ne convient ni à ceux qui vivent fubjugués, ni
à ceux qui vivent ifolés ; d’où il s’enfuit que ceux
qui vivent abfolument dans l’état de nature, comme
les fouverains; & ceux qui ont parfaitement renoncé
à cet état,comme les elclaves,ne peuvent point
être regardés comme citoyens ; à moins qu’on nepré-
tende qu’il n’y a point de fociété raifonnable oùil n’y
ait un être moral, immuable , & au-deflus de la perfonne
phyfique fouveraine. Puffendorff, fans égard
à cette exception, a divifé fon ouvrage des devoirs
en deux parties, l’une des devoirs de l’homme, l’autre
des devoirs du citoyen.
Comme les lois des fociétés libres dé familles ne
font pas les mêmes par-tout, & comme il y a dans
la plûpart de ces fociétés un ordre hiérarchique con-
ftitué par les dignités , le citoyen peut encore être
confidéré & relativement aux lois de la fociété, &
relativement au rang qu’il occupe dans l’ordre hiérarchique.
Dans le fécond cas, il y aura quelque
différence entre le citoyen magiftrat & le citoyen
bourgeois ; & dans le premier, entre le citoyen
d’Amfterdam & celui de Bâle.
Ariftote, en admettant les diftinfrions de fociétés
civiles & d’ordre de citoyens dans chaque fociété ,
ne reconnoît cependant de vrais citoyens que ceux
qui ont part à la judicature, & qui peuvent fe promettre
de paffer de l’état de fimples bourgeois aux
premiers grades de la magiftrature ; ce qui ne convient
qu’aux démocraties pures. Il faut convenir
qu il n’y a guere que celui qui jouit de ces prérogatives
, qui foit vraiment homme public ; & qu’on n’a
aucun carattere diftinélif du fujet & du citoyen , fi-
pon que ce dernier doit être homme public, & que
fom e ƒƒƒ, v *
le rôle du premier ne peut jamais être que celui de
particulier, de quidam.
Puffendorf, en reftreignant le nom de àitoyen à
ceux qui par une réunion première de familles ont
ronde 1 état, & à leurs fuccefleurs de pere en fils ,
introduit une diftindion frivole qui répand peu de
jour dans fon ouvrage, & qui peut jetter beaucoup
de trouble dans une fociété civile, en diftinguant les
Moyens originales des naturalifés, par une idée de
noblefle mal entendue. Les citoyens en qualité de citoyens
, c’eft-à-dire dans leurs fociétés, font tous
egalement nobles ; la noblefle fe tirant non des an*
cêtres, mais du droit commun aux premières dignités
de la magiftrature.
L etre moral fouverain étant par rapport au citoyen
ce que la perfonne phyfique defpotique eft par
rapport au fujet, & l’efclave le plus parfait ne tranf-
ferant pas tout fon être à fon fouverain ; à plus forte
raifon le citoyen a-t-il des droits qu’il fe réferve, &
dont il ne fe départ jamais. Il y a des occafions où il
fe trouve fur la meme ligne, je ne dis pas avec fes
concitoyens, mais avec l’être moral qui leur commande
à tous. Cet être a deux cara&eres, l’un particulier
, & l’autre public : celui-ci ne doit point
trouver de refiftance ; l’autre peut en éprouver de
la part des particuliers, & fuccomber même dans
la conteftation. Puifque cet être moral a des domaines
, des engagemens, des fermes, des fermiers, &c.
il faut, pour ainfi dire, diftinguer en lui le fouverain
& le fujet de la fouveraineté. Il eft dans ces occafions
juge & partie. C ’eft un inconvénient fans
doute ; mais il eft de tout gouvernement en général,
& il ne prouve pour ou contre, que par fa rareté
ou par fa fréquence, & non par lui-même. Il eft
certain que les fujets ou citoyens feront d’autant
moins expofes aux injuftices, que l’être fouverain
phyfique ou moral fera plus rarement juge & partie:
dans les occafions où il fera attaqué comme particulier.
Dans les tems de troubles , le citoyen s’attachera
au parti qui eft pour le fyftème établi ; dans les dif-
folutions de fyftèmes, il fuivra le parti de fa cité
s’il eft unanime ; & s’il y a divifion dans la cité , i l
embraffera celui qui fera pour l’égalité des membres
& la liberté de tous.
Plus les citoyens approcheront de l’égalité de prétentions
& de fortune, plus l’état fera tranquille :
cet avantage paroît être de la démocratie pure ex-
clufivement à tout autre gouvernement ; mais dans
la démocratie même la plus parfaite, l’entiere égalité
entre les membres eft une chofe chimérique, ôC
c’eft peut-être là le principe de diffolution de ce gouvernement,
à moins qu’on n’y remédie par toutes
les injuftices de l’oftracifme. Il en eft d’un gouvernement
en général, ainfi que de la vie, animale ^
chaque pas de la vie eft un pas vers la mort. Le
meilleur gouvernement n’eft pas celui qui eft immortel
, mais celui qui dure le plus long-tems & le
plus tranquillement.
CITRON, f. m. voye{ Citronnier.
CITRONNIER, f. m. citreum, ( Hi(l. nat. bot. )
genre de plante à fleur en rofe. Le piftil fort du calice,
& devient dans la fuite un fruit ordinairement
oblong , qui a une chair ferme qui eft divifée en plufieurs
loges remplies de fuc & de véficules. Ces cellules
renferment aufli des femences calleufes : ajoû-
tez au carafrere.de ce genre, que les feuilles fonr
fimples. Tournefort, injl. rei herb. V. Plante. (l'y
Citronnier , ( Jardin. ) du latin citreum, cL
trumy malus medica. Plin. Virgil.
D é f in i t io n .
Iltcefum retinet citrus aurea frondis honorem ,
Malaque jloriferis htzrtnt pendentia ramis ,
V>tris & autumni puUherrima dona.
Q q q