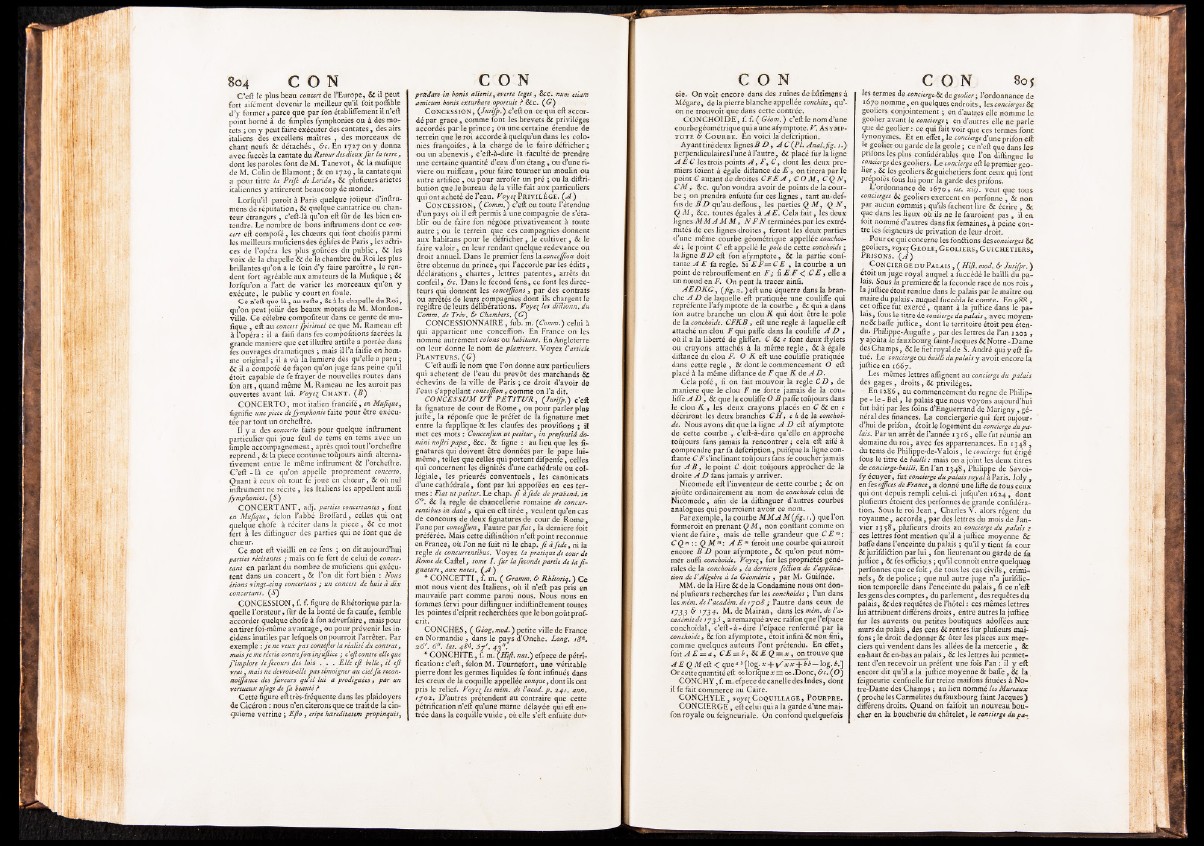
C ’eft le plus beau concert de l’Europe, ôc il peut
fort aifément devenir le meilleur qu’il foit poflibLe
d ’y former, parce que par fon établiffement il n’eft
point borné à de iimples fymphonies ou à des motets
; on y peut faire exécuter des cantates, des airs
italiens des excellens maîtres , des morceaux de
chant neufs 5c détachés, &c. En 17x7 on y donna
avec fuccès la cantate du Retour des dieux fur la terre ,
dont les paroles font de M. Tanevot, ôc la mufique
de M. Colin de Blamont ; & en 17 x9, la cantate qui
a pour titre la Prife de Lerida, ÔC plufieurs arietes
italiennes y attirèrent beaucoup de monde.
Lorfqu’il paroît à Paris quelque joueur d’inftru-
mens de réputation, ôc quelque cantatrice ou chanteur
étrangers , c’eft-là qu’on eft fur de les bien entendre.
Le nombre de bons inftrumens dont ce concert
eft compofé, les choeurs qui font choifis parmi
les meilleurs muficiens des égliies de Paris, les aâri-
ces de l’opéra les plus goûtées du public, ôc les
voix de la chapelle 5c de la chambre du Roi les plus
brillantes qu’on a le foin d’y faire paraître, le rendent
fort agréable aux amateurs de la Mufique ; ôc
lorfqu’on a l’art de varier les morceaux qu’on y
exécute, le public y court en foule.
Ce n’eft que là , au refte, & à la chapelle du R o i,
qu’on peut jouir des beaux motets de M. Mondon-
ville. Ce célébré compofiteur dans ce genre de mufique
, eft au concert fpirituel ce que M. Rameau eft
à l’opéra : il a faifi dans fes compofitions facrées la
grande maniéré que cet illuftre artifte a portée dans
les ouvrages dramatiques ; mais il l’a faifie en homme
original ; il a vu la lumière dès qu’elle a paru ;
& il a compofé de façon qu’on juge fans peine qu’il
étoit capable de fie frayer de nouvelles routes dans
fon a r t , quand même M. Rameau ne les auroit pas
ouvertes avant lui. Voye{ Chant. (R)
CO NC ER TO , mot italien francifé, en Mufique,
lignifie une piece de Jymphonie faite pour être exécutée
par tout un orcheftre.
Il y a des concerto faits pour quelque infiniment
particulier qui joue feul de tems en tems avec un
fimple accompagnement, après quoi toutl’orcheftre
reprend, & la piece continue toûj ours ainfi alternativement
entre le même infiniment 5c l’orcheftre.
C ’eft - là ce qu’on appelle proprement concerto.
Quant à ceux où tout le joue en choeur, & où nul
inftrument ne récite, les Italiens les appellent auffi
fymphonits. (S)
CONCERTANT, adj. parties concertantes , font
en Mufique, félon l’abbé BrofTard, celles qui ont
quelque chofe à réciter dans la piece , ôc ce mot
fort à les diftinguer des parties qui ne font que de
choeur.
Ce mot eft vieilli en ce fens ; on dit aujourd’hui
parties récitantes ; mais on fe fert de celui de concertant
en parlant du nombre de muficiens qui exécutent
dans un concert, & l’on dit fort bien : Nous
étions vingt-cinq concertans ; un concert de huit à dix
concertons. (S)
CONCESSION, f. f. figure de Rhétorique par laquelle
l’orateur, fur de la bonté de fa caufè, femble
accorder quelque chofe à fon adverfaire, mais pour
en tirer foi-même avantage, ou pour prévenir les in-
cidens inutiles par lefquels onpourroit l’arrêter. Par
exemple : je ne veux pas contéfier la réalité du contrat,
mais je me récrie contrefon injufiice ; c'efi contre elle que
j'implore le fecours des lois . . . Elle efi belle, il efi
vrai, mais ne devroit-elle pas témoigner au ciel fa recon-
noijfance des faveurs qu'il lui a prodiguées, par un
vertueux ufage de fa beaute ?
Cette figure eft très-fréquente dans les plaidoyers
de Cicéron : nous n’en citerons que ce trait de la cinquième
verrine ; Efio , eripe hcereditatem propinquis,
prcedare in bonis alienis, evertè leges, Sic. num etiatn
amicum bonis exturbare oportuit ? ÔC c. (Cr)
C o n ce ssio n, (Jurijp.) c’eft ou ce qui eft accordé
par grâce, comme font les brevets & privilèges
accordés parle prince ; ou une certaine étendue de
terrein que le roi accorde à quelqu’un dans les colonies
françoifes, à la charge de le faire défricher ;
ou un abenevis., c ’eft-à-dire la rfaculté de prendre
une certaine quantité d’eau d’un étang, ou d’une rivière
ou ruiffeau, pour faire tourner un moulin ou
autre artifice , ou pour arrofer un pré ; ou la diftri-
bution que.lebureau delà ville fait aux particuliers
qui ont acheté de l’eau. Foye^P R IV IL È G E . (A )
C oncession, ( Comm. ) c’eft ou toute l’étendue
d’un pays où il eft permis à une compagnie de s’établir
ou de faire fon négoce privativement à toute
autre ; ou le terrein que ces compagnies donnent
aux habitans pour le défricher, le cultiver, & le
faire valoir, en leur rendant quelque redevance ou
droit annuel. Dans le premier fens la concejfion doit
être obtenue du prince, qui l’accorde par les édits,
déclarations, chartes, lettres patentes, arrêts du
confeil, &c. Dans le fécond fens, ce font les directeurs
qui donnent les conctfifions , par des contrats
ou arrêtés de leurs compagnies dont ils chargent le
regiftre de leurs délibérations. Voye{ les diclionn. du
Comm. de Trèv. & Chambers. (G)
CONCESSIONNAIRE, fub. m. (Comm.) celui à
qui appartient une conceffion. En France on les
nomme autrement colons ou habitons. En Angleterre
on leur donne le nom de planteurs. Voyez l'article
Planteurs. (G)
C ’eft auffi le nom que l’on donne aux particuliers
qui achètent de l’eau du prévôt des marchands &
echevins de la ville de Paris ; ce droit d’avoir de
l’eau s’appellant concejfion , comme on l’a dit.
CONCESSUM U T PE T ITU R , (Jurifp.) c’eft
la fignature de cour de Rome, ou pour parler plus
jufte, la réponfe que le préfet de la fignature met
entre la fupplique & les claufes des provifions ; il
met ces mots : Concenfum ut petitur, in prafentiâ do-
mini nofiri pape, & c . & ligne : au lieu que les fi-
gnatures qui doivent être données par le pape lui-
même , telles que celles qui portent difpenfe, celles
qui concernent les dignités d’une cathédrale ou collégiale
, les prieurés conventuels, les canonicats
d’une cathédrale, font par lui appofées en ces termes
: Fiat ut petitur. Le chap. f i à fede de prcebend. in
6°. 5c la regle de chancellerie romaine de concur-
rentibus in data , qui en eft tirée, veulent qu’en cas
de concours de deux fignatures de cour de Rome,
l’une par conceffum, l’autre par fiat, la derniere foit
préférée. Mais cette diftin&ion n’eft point reconnue
en France, où l’on ne fuit ni le chap. f i à fede, ni la
regle de concur rentibus. Voyez la pratique de cour de
Rome de. Caftel, tome 1. fur la fécondé partie de la f i gnature
, aux notes. ( A )
* C O N C E T T I , f. m. ( Gramm. & Rhétoriq. ) Ce
mot nous vient des Italiens, où il n’eft pas pris en
mauvaife part comme parmi nous. Nous nous en
fommes fervi pour diftinguer indiflinfrement toutes
les pointes d’efprit recherchées que le bon goût prof*-
crit.
CONCHES, ( Géog. mod. ) petite ville de France
en Normandie , dans le pays d’Onche. Long. i8A.
z C . 6". lat. 48*. 5y ’ . 4g ".
* CONCHITE, f. m. (Hiß. nat.) efpece de pétrification:
c’eft, félon M. Tournefort, une véritable
pierre dont les germes liquides fe font infinués dans
les creux de la coquille appellée conque, dont ils ont
pris le relief. Voye{ lesmém. de Cacad. p. Z41. ann.
iy oz . D’autres prétendent au contraire que cette
pétrification n’eft qu’une marne délayée qui eft entrée
dans la coquille vuide, où elle s’eft enfuite durv
cie. On voit encore dans des ruines de bâfimens à
Mégare, de la pierre blanche appellée conckite, qu’on
ne trouvoit que dans cette contrée.
CONCHOÏDE, f. f. ( Géom. ) c’eft le nom d’une
courbe géométrique qui a une afymptote. V. Asymptote
& Courbe. En voici la description.
Ayant tiré deux lignes B D , A C (PI. Analfig. /.)
perpendiculaires l’une à l’autre, 5c placé fur la ligne
A E C les trois points A , F , C , dont les deux premiers
foient à égale diftance de E , on tirera par le
point C autant de droites C F E A , C O M , C QN ,
CM , &c. qu’on voudra avoir de points de la courbe
; on prendra enfuite fur ces lignes , tant au-def-
fusde B D qu’au-deffous, les parties Q_M, Q N ,
Q M , Sic. toutes égales à A E . Cela fa it , les deux
lignes M M A M M , N F N terminées par les extrémités
de ces lignes droites, feront les deux parties
d’une même courbe géométrique appellée canchoi-
de ; le point C eft appellé le pôle de cette conchoïde ;
la ligne B D eft fon afymptote, 5c la partie confiante
A E fa réglé. Si E F — CE , la courbe a un
point de rebrouffement en F ; fi E F < jC' E , elle a
un noeud en F. On peut la tracer ainfi.
A E D K G , (fig.z.)cû, une équerre dans la branche
A D de laquelle eft pratiquée une couliffe qui
repréfente l’afymptote de la courbe , 5c qui a dans
fon autre branche un clou K qui doit être le pôle
de la conchoïde. CFKB , eft une réglé à laquelle eft
a ttaché un clou F* qui paffe dans la couliffe A D ,
où il a la liberté de gliffer. C 5c c font deux ftylets
ou crayons attachés à la même réglé, 5c à égale
diftance du clou F. O K eft une couliffe pratiquée
dans cette réglé , & dont le commencement O eft
placé à la même diftance de F que K de A D .
Cela pofé, fi on fait mouvoir la réglé C D , de
maniéré que le clou F ne forte jamais de la cour
lifte A D , 5c que la couliffe O B paffe toûjours dans
le clou K , les deux crayons placés en C 5c en c
décriront les deux branches C H , c h de la conchoïde.
Nous avons dit que la ligne A D eft afymptote
de cette courbe , c’eft-à-dire qu’elle en approche
toûjours fans jamais la rencontrer ; cela eft aifé à
comprendre par fa defeription, puifque la ligne confiante
CF* s’inclinant toûjours fans fe coucher jamais
fur A B , le point C doit toûjours approcher de la
droite A D fans jamais y arriver.
Nicomede eft l’inventeur de cette courbe ; 5c on
ajoûte ordinairement au nom de conchoïde celui de
Nicomede, afin de la diftinguer d’autres courbes
analogues qui pourraient avoir ce nom.
Par exemple, la courbe MMAM( f ig. / .) que l’on
formerait en prenant Q_M, non confiant comme on
vient de faire, mais de telle grandeur que C E m:
CQ"* : : Q M m: A E m ferait une courbe qui auroit
encore B D pour afymptote, & qu’on peut nommer
auffi conchdide. Foye[, fur les propriétés générales
de la conchoïde , la derniere feclion de l'application
de VAlgèbre à la Géométrie , par M. Guifnée.
MM. de la Hire 5c de la Condamine nous ont donné
plufieurs recherches fur les conchoïdes ; l’un dans
les mém. de l'académ. de t jo8 ; l'autre dans ceux de
‘733 & '734' M. de Mairan, dans les mém. de l'académie
de rygS, a remarqué avec raifonque l’efpace
conchoïdal, c’eft-à-dire l’efpace renfermé par la
conchoïde , 5c fon afymptote, étoit infini 5c non fini,
comme quelques auteurs l’ont prétendu. En effet,
foit A E x z a , CE — b, 5l E Q — x , on trouve que
A E QM eft ^.que“ b[log.x-{‘ \/xx-\- bb— log. £.]
Or cette quantité eft oolorfqueA:= 00 .Donc, (O )
CONCHY, f. m. efpece de canelle des Indes, dont
il fe fait commerce au Caire.
CO N CH Y LE , voye^ C oquillage , Pourpre.
CONCIERGE, eft celui qui a la garde d’une mai-
fon royale ou feigneuriale. On confond quelquefois
les termes de concierge.de de geôlier ; l’ordonnance de
1670 nomme, en quelques endroits, les concierges 5c
geôliers conjointement ; en d’autres elle nomme le
geôlier avant le concierge ; en d’autres elle ne parle
que de geôlier : ce qui fait voir que ces termes font
fynonymes. Et en effet, le concierge d’une prifon eft
le geôlier ou garde de la geôle ; ce n’eft que dans les
priions les plus confidérables que l’on diftingue le
concierge des geôliers. Le concierge eft le premier geo-
, ' *es ge°hers 5c guichetiers font ceux qui font
préparés fous lui pour la garde desprifons.
^ordonnance de 1670, tit. xiij. veut que tous
concierges 5c geôliers exercent en perfonne , & non
par aucun commis ; qu’ils fâchent lire ôc écrire , 5c
que dans les lieux où ils ne le fauroient pas , il en
foit nomme d’autres dans fix fèmaines, à peine con-,
tre les feigneurs de privation de leur droit.
Pour ce qui concerne les fondions des concierges &
geôliers, voye[ Geôle, G eôliers, G u iche tier s,
Prisons» ( A )
' Co n cie rg e du Palais , ( Hifl. mod. & Jurijpr. )
etoit un juge royal auquel a fuccédé le bailli du palais.
Sous la première« la fécondé race de nos rois ,
la juftice étoit rendue dans le palais par le maître ou
maire du palais, auquel fuccéda le comte. En 988 ,
cet office fut exercé, quant à la juftice dans le palais
, fous le titre de concierge du palais, avec moyenne
5c baffe juftice, dont le territoire étoit peu eten-
du. Philippe-Augufte , par des lettres de l’an 1201 ,
y ajoûta.le fauxbourg faint-Jacques &Notre-Dame
des Champs, & le fief royal de S. André qui y eft fi-
tue. Le concierge ou bailli du palais y avoit encore la
juftice en 1667.
Les mêmes lettres aflignent au concierge du palais
des gages , droits, & privilèges.
En 1286, au commencement du régné de Philippe
- le - B el, le palais que nous voyons aujourd’hui
fut bâti par les foins d’Enguerrand de Marigny, général
des finances. La conciergerie qui fert aujourd’hui
de prifon, étoit le logement du concierge du palais.
Par un arrêt de l’année 13 16 , elle fut réunie au
domaine du roi, avec fes appartenances. En 1348 ,
du tems de Philippe-de-Valois, le concierge fut érigé
fous le titre de bailli : mais on a joint les deux titres
de concierge-bailli. En l ’an 1348, Philippe de Savoi-
fy écuyer, fut concierge du palais royal à Paris. Joly ,
en fes offices de France, a donné une lifte de tous ceux
qui ont depuis rempli celui-ci jufqu’en 1614, dont
plufieurs étoient des perfonnes de grande confidéra-
tion. Sous le roi Jean , Charles V . alors régent du
royaume, accorda, par des lettres du mois de Janvier
1358, plufieurs droits au concierge du palais :
ces lettres font mention qu’il a juftice moyenne &
baffe dans l’enceinte du palais ; qu’il y tient fa cour
5c jurifdiélion par lu i , fon lieutenant ou garde de fa
juftice, & fes o f f ic ia ; qu’il connoît entre quelques
perfonnes que ce foit, de tous les cas civils, crimi-.
nels, Se de police ; que nul autre juge n'a jurifdic-
tion temporelle dans l’enceinte du palais, fi ce n’eft
les gens des comptes, du parlement, des requêtes du
palais, & des requêtes de l’hôtel : ces mêmes lettres
lui attribuent différens droits, entre autres la juftice
fur les auvents ou petites boutiques adoffées aux
murs du palais, des cens & rentes fur plufieurs mai-
fons ; le droit de donner & ôter les places aux merciers
qui vendent dans les allées de la mercerie , 5c
en-haut 5c en-bas au palais, 5c les lettres lui permettent
d’en recevoir un préfent une fois l’an : il y eft
encore dit qu’il a la juftice moyenne & baffe, ôc la
feigneurie cenfuelle fur treize maifons fituées à Notre
Dame des Champs ; au lieu nommé les Mureaux
( proche les Carmélites du fauxbourg faint Jacques )
différens droits. Quand on faifoit un nouveau boucher
en la boucherie du châtelet, le concierge du pa