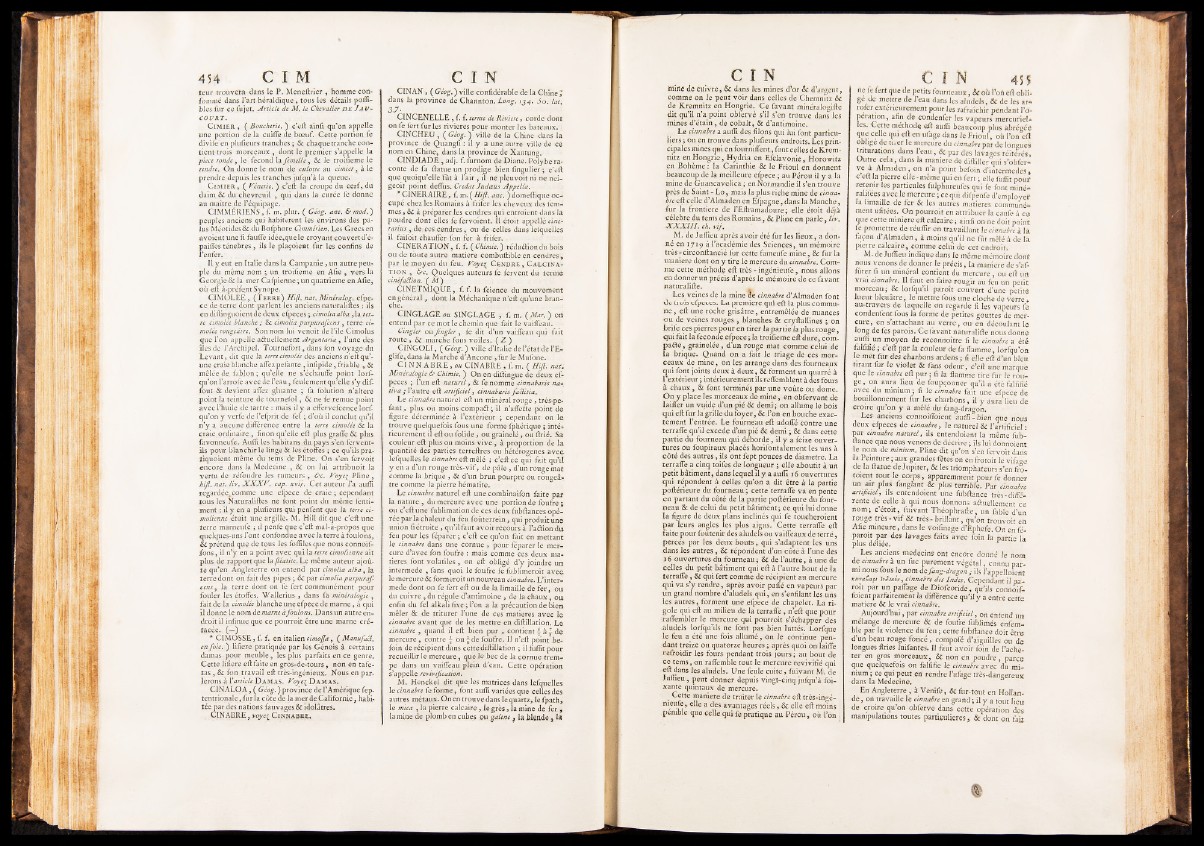
leur trouvera dans le P. Meneftrier , homme consommé
dans l’art héraldique, tous les détails poffi-
blcs fur ce fujet. Article de M. le Chevalier DE Ja v -
COURT.
C iMier , ( Boucherie. ) c’eft ainfi qu’on appelle
une portion de la cuiffe de. boeuf. Cette portion fe
divife en plufieurs tranches ; & chaque tranche contient
trois morceaux , dont le premier s’appelle la
pièce ronde, le fécond la femelle -, 6c le troifieme le
tendre. On donne le nom de culotte au cimier, à le
prendre, depuis les tranches jufqu’à la queue.
C im ie r , (Vénerie. ) ç’eft la croupe du cerf, du
daim 6c du chevreuil , qui dans la curée fe donne
au maître de l’équipage.
CIMMÈRIENS, f. m. plur. ( Géog. anc. & mod. )
peuples anciens qui habitèrent lès environs des palus
M éotides& du Bofphore Cimménen. Les Grecs en
avoient une fi faufle idée,que le croy ant.cou vert d’é-
paifîes ténèbres, ils le plaçoieat fur les confins de
l ’enfer.
Il y eut en Italie dans la Campanie, un autre peuple
du même nom ; un troifieme en Afie , vers la
Géorgie 6c la mer Cafpienne ; un quatrième en Afie,
où eft à-préfçntSynope.
CIMOLÉE, ( T erre) Hiß. nat. Minéralog. efpece
cle-terre dont parlent les anciens naturaliftes : ils
en diftinguoientde deux efpeces \cimohaalba ,1a terre
cirnolee blanche ; 6c cimolia purpurafeens, terre cimolée
rougeâtre. Son nom lui venoit de l’île Cimolus
que l’on appelle actuellement Argentaria,, l’une des
îles de l’Archipel. Tournefort, dans fon .voyage du
Levant, dit que la terrecimolée des anciens n’eft qu’une
craie blanche affezpefante , infipide, friable , &
mêlée de fablon ; qu’elle ne s’échauffe point lorf-
qu’on l’arrofe avec de l’eau, feulement qu’elle s’y dif-
fout & devient affez gluante ; fâ folution n’altere
point la teintiire de tournefol, & ne fe remue point
avec l’huile de tartre : mais il y a effervefeence lorf-
qu’on y verfe de l’efprit de fel ; d’où il conclut qu’il
ji’y a aucune différence entre la terre cimolée 6c la
craie, ordinaire , finon qu’elle eft plus graffe 6c plus
favonneufe. Auffi les habitans du pays s’en fervent-
jls pour blanchir le linge & les étoffes ; ce qu’ils pra-
îiquoient même du tems de Pline. On s’en fervoit
encore dans la Medecine , & on lui attribuoit la
vertu de refondre les tumeurs , &c. Voye^ Pline,
hiß. nat. liv. X X X V . cap. xvij. Cet auteur l’a auffi
regardée^comme une efpece de craie ; cependant
tous les Naturaliftes ne font point du même fenti-
ment : il y en a plufieurs qui penfent que la terre ci-
molienne étoit une argille. M. Hill dit que c’eft Une
terre marneufe ; il penfe que c’eft mal-à-propos que
quelques-uns l’ont confondue avec la terre à foulons,
& prétend que de tous les fofliles que nous connoif-
fons, il n’y en a point avec qui la terre cimolienne ait
plus de rapport que la fiéatite. Le même auteur ajoû-
te qu’en Angleterre on entend par cimolia alba, la
terre dont on fait des pipes ; 6c par cimolia purpurafeens
, la terre dont on fe fert communément pour
fouler les étoffes. "Wàllerius , dans fâ minéralogie ,
fait de la cimolée blanche une efpece de marne, à qui
il donne le nom de marne à foulons. Dans un autre endroit
il infinue que ce pourroit être une marne crétacée.
(—)
* CIMOSSE, f. f. en italien cimqffa, ( Manufact.
en foie.') lifiere pratiquée par les Génois à certains
damas pour meuble, les plus parfaits en ce genre.
Cette lifiere eft faite en gros-de-tours, non en tafe-
tas , 6c fon travail eft très-ingénieux. Nous en parlerons
à l’article DAMAS. Voyt{ DAMAS.
CINALOA, ( Géog. ) province de l’Amérique fep-
tentrionale, fur la côte de la mer de Californie, habitée
par des nations fauvages & idolâtres.
CINABRE , voye{ ClNNABRE,
CINAN, ( Géog.) ville considérable de la Chine ï
dans la province de Channton. Long. 134. 3o. lat.
3 7 - ■
CINCENELLE , f. f. terme de Riviere, corde dont
on fe f'ert fur les rivières pour monter les bateaux.
CINCHEU, ( Géog. ) ville de la Chine dans la
province de Quangfi : il y a une. autre ville de ce
nom en Chine, dans la province de Xantung.
CINDIADE , adj. f. furnom de Dia ne. Polybe raconte
de fa ftatue un prodige bien fingulier ; c’eft
que quoiqu’elle fût à l’air , il ne pleuvoit ni ne nei-
geoit point deffus. Credat Judceus Appella.
* CINERAIRE, f. m. ( Hifi. anc. ) domeftique occupé
chez les Romains à fril'er les cheveux des femmes,
& ,à préparer les cendres qui entroient dans la
poudre dont elles fe fervoient. Il étoit appellé cine-
rarijûs , de;ces cendres, ou de celles dans lefquelles
il faifoit chauffer fon fer à frifer.
CINERATION , f. f. ( Chimie. ) réduttion du bois
ou de toute autre matière combuftible en cendres ,
par le moyen du feu. Voye^ C endre ,: C a l c in a t
io n , Gc. Quelques auteurs fe fervent du terme
cinéfaction. ( M)
CINETMIQUE, f. f. la fcience du mouvement
en général, dont la Méchanique n’eft qu’une branche.
_ -
CINGLAGEoa SINGLAGE , f. m. (Mar.) on
entend par ce mot le chemin que fait le vaiflèau. -
Cingler oxt jîngler , fe dit d’un vaiffeau qui fait
route, 6c.marche fous voiles. ( Z )
CINGOLI, ( Géog. ) ville d’Italie de l’état de l’E-
glife, dans la Marche d’Ancone, fur le Mufone.
C lN N A B R E , ou CINABRE , f. m. ( Hifi. nat:
Minéralogie & Chimie. ) On en diftingue de deux efpeces
l’un eft naturel, & fe nomme cinnabaris nu-
tiva j l’autre eft artificiel, cinnabaris faciitia.
Le cinnabre naturel eft un minéral rouge, très-pe-
fant, plus ou moins compatt ; il n’affette point de
figure déterminée à l’extérièur ; cependant on le
trouve quelquefois fous une forme fphérique ; inté-?
rieurement il eft ou folide, ou grainelé , ou ftrié. Sa
couleur eft plus ou moins v iv e , à proportion de la
quantité des parties terreftres ou hétérogènes avec
lefquelles le cinnabre eft mêlé ; c’eft ce qui fait qu’il
y en a d’un rouge très-vif, de pâle, d’un rouge mat
comme la brique , & d’un brun pourpre ou rougeâ.-,
tre comme la pierre hématite.
Le cinnabre naturel eft une combinaifon faite par
la nature, du mercure avec une portion de foufre j
ou c’eft une fublimation de ces deux fubftances opérée
par la chaleur du feu foûterrein, qui produit une
union fi étroite , qu’il faut avoir recours à l’attiondu
feu pour les féparer ; c’eft ce qu’on fait en mettant
le cinnabre dans une cornue , pour féparer le mercure
d’avec fon foufre : mais comme c es deux matières
font volatiles , on eft obligé d’y joindre un
intermede , fans quoi le foufre fe fublimeroit avec
le mercure 6c formeroit un nouveau cinnabre. L’interr
mede dont on fe fert eft ou de la limaille de fer, ou
du cuivre , du régule d’antimoine , de la chaux, ou
enfin du fel alkali fixe1; l’on a la précaution de bien
mêler & de triturer l’une de ces matières avec le
cinnabre avant que de les mettre en diftillation. Le
cinnabre , quand il eft bien pur , contient | à •£ de
mercure, contre | ou \ de foufre. Il n’eft point be-
foin de récipient dans cette diftillation ; il fuffit pour
recueillir le mercure, quels bec de la cornue trem-?
pe dans un vaiffeau plein d’eau. Cette opération
s’appelle revivification.
M. Henckel dit que les matrices dans lefquelles
le cinnabre fe forme, font auffi variées que celles des
autres métaux. On en trouve dans le quartz, le fpath,
le mica , la pierre calcaire , le grès, la mine de fer.,
lamine de plomb en cubes ou galene , la blende , la
ftiiiie dé cuivré, & dans lés mines d’or & d’arge'nt,
comme on le peut voir dans celles de Chemnitz 6c
de Kremnitz en Hongrie. Ce favant minéralogifte
dit qu’il n’a point obiervé s’il s’en trouve dans les
mines d’étain, de cobalt, & d’antimoine.
Le cinnabre a auffi des filons qui lui font particuliers
; on en trouve dans plufieurs endroits. Les principales
mines qui en fourniffent,, font celles de Kremnitz
en Hongrie, Hydria en Efclavonie, Horowitz
en Bohème : la Carinthie & le Frioul en donnent
beaucoup de la meilleure efpece ; au Pérou il y a la
mine de Guancavelica ; en Normandie il s’en trouve
près de Saint - L o , mais la plus riche mine de cinnabre
eft celle d’Almaden en Elpâgne, dans la Manche,
fur la frontière de PEftramadoure ; elle étoit déjà
célébré du tems des Romains, 6c Pline en parle, liv.
X X X I I I . ch. vif. •
M. de Juffieu après avoir été fur les lieux, a donne
en 1719 à l’académie dès Sciences, un mémoire
très-circonftancié fur cette fameufe mine, & fur la
maniéré dont on y tire le mercure du cinnabre. Comme
cette méthodç eft très - ingénieufe, nous allons
en donner un précis d’après le mémoire de ce favant
naturalifte.
Les veines de la mine aè cinnabre d’Almaden font
de trois efpeces. La première qui eft la plus commune
, eft une roche grisâtre, entremêlée de nuances
Ou de veines rouges , blanches & cryftallines ; on
brife ces pierres pour en tirer la partie la plusrouge,
qui fait la fécondé efpece ; la troifieme eft dure, corn-
pa tte, grainelée, d’un rouge mat comme celui de
la brique. Quand on a fait le triage de ces morceaux
de mine, pii les arrange dans des fourneaux
qui font joints deux à deux, & forment un quarré à
l ’extérieur ; intérieurement ils reffemblént à des fours
à chaux, & font terminés par une voûte ou dôme.
On y place les morceaux de mine, en obfervant de
laiffer un vuide d’un pié 6c demi; on allume le bois
qui eft fur la grille du foyer, 6c ,1’on en bouche éxac- '
tement l’entrée. Le fourneau eft adoffé contre une
terraffe qu’il excede d’un pié & demi ; 6c dans cette
partie du fourneau qui déborde, il y a feize ouvertures
ou foupiraux placés horifontalement les uns à
côté des autres, ils ont fept pouces de diamètre. La
terraffe a cinq toifes de longueur ; elle aboutit à un
petit bâtiment, dans lequel il y a auffi 16 ouvertures
qui répondent à celles qu’on a dit être à la partie
poftérieure du fourneau ; cette terraffe va en pente
en partant du côté de la partie poftérieure du fourneau
& de celui du petit bâtiment; ce qui lui donne
la figure de deux plans inclinés qui fe toucheroient
par leurs angles les plus aigus. Cette terraffe eft
faite pour foûtenir des aludels ou vaiffeaux de terre,
percés par les deux bouts, qui s’adaptent les uns
dans les autres, 6c répondent d’un côté à l’une dés
16 ouvertures du fourneau; & de l’autre, à une de
celles du petit bâtiment qui eft à l’autre bout de la
terraffe, 6c qui fert comme de récipient au mercure
qui va s’y rendre, après avoir paffé en vapeurs par
tin grand nombre d’aludels qui, en s’enfilant les uns
les autres, forment une efpece de chapelet. La rigole
qui eft au milieu de la terraffe, n’eft que pour
Taffembler le mercure qui pourroit s’échapper des
•aludels lorfqu’ils ne font pas bien luttés. Lorfque
le feu a été une fois allumé, on le continue pendant
treize ou quatorze heures ; après quoi on laiffe
refroidir les fours pendant trois jours ; au bout de
ce tems, on raffemble tout le mercure revivifié qui
• eft dans les aludels. Une feule cuite, fuivant M:. de
Juffieu, peut donner depuis vingt-cinq jufqu’à foi-
xante quintaux de mercure.
| Cette maniéré de traiter le cinnabre eft très-ingé-
e^e a des avantages réels, 6c elle eft moins
pemble que celle qui fe pratique au Pérou, où l’on - 1
lie fe fert que de petits fourneau*, & oïi l’oA eft obli.
ge de mettre de l ’eau dans les aludels, & de les ar-
rofer extérieurement pour les rafraîchir pendant l’ô*
peration, afin de condenfer les vapeurs mercuriel*
les. Cette méthode eft aufiî beaucoup plus abrégée
que celle qui eft en ufage dans le Frioul, oii l’on eft
obligé de ti.er le mercure du cinnabre par de longues
triturations dans l’eau, & par des lavages réitérés,
Outre celai dans la maniéré de diftiller qui s’obfer*
v e à Alinaden , on n’a point befoin d’intermedes ,
c eft la pierre elle -même qui en fert ; elle fuffit potif
retenir les particules fulphureüfes qui fe font miné*
raliféês avec le mercure ; ce qui difpenfe d’employef
la limaille de fer & les autres matières .commune^
ment lifitées. On pourroit en attribuer la caufe à ce
que cette minière eft calcaire ; ainfi on ne doit point
le promettre de réüflîr en travaillant 1 e cinnabre.ic là
façon .d’Almadeii, à moins qu’il né; fut mêlé à de là
pierre calcaire, comme celui de cet endroit-,
M. de Juffieu indique dans le même mémedre dont
nous venons de donner le prédis, la maniéré de s’af-
i-’-rer fi un minéral contient du mercure , ou eft un
vrai cinnabre. Il faut en faire rougir au-feu un petit
morceau; U lorlqu’il paroit couvert d’une petite
lueur bleuâtre, le mettre fous une Cloche de verre,
au-trav-ers de laquelle on regarde fl les vapeurs fs
condenfentfous la forme de petites gouttes de mercure,
en s’attachant au verre, ou-en découlant le
long.de fes.parois-; Ce favant naturalifte nous donné
auffi un moyen de reconnoitre fi le cinnabre a été
faftifié ; c’eft par la couleur de fa flamme, lorfqu’on
-le met fur des charbons ardens ; fi elle eft d’un bleu
tirant fur le violet & fans Odeur , c’etî une marqué
:que le cinnabre eft pur ; fi ltf'flamme tire fuir le rou*
g e , on aura lieu ce foûpçonr.e.- qu'il a été ftunné
avec du minium ; fi le cinnabre fait une efpece ce
bouillonnement fur les charbfetVs, il y aura ueti ce
croire qu’on y a mêlé du fang-dragon,
•.ilJteSi.anciens connoifiment auffi - bien que nous
deux efpeces de cinnubU, le n'aturèl & l’artificier,
par cinnabre naturel, ils entendoient la même fufi-
flancé que nous venons de décrire ; ils lui'cfdnnoient
'le nom de minium. Pline dit qu’on s’ en fervoit dans
la Peinture ; aux grandes fêtes on en frotoit le vifaga
de la ftatue de Jupiter, 8c les triomphateurs s’en fro-
-toient tout le corps , apparemment pour fe donner
Un air plus fangtaut & plus terrible. Par cinnabre
artificiel, ils entendoient une fubftance très-différente
de celle à qui nous donnons aÛueliement ce
nom; c’étoit; fuivant Théophrafte-, un fable d’un
rouge t rè s -v if & très - brillant, qu’on rrouvoit eu
Afie mineure, dans le ybifinage d’Ephefe. On en fé-
-paroir par des lavages, faits avec foin la partie la
plus déliée.
Les anciens médecins’ ont encore donné le nom
de cinnabre à un fuc purement végétal, connu parmi
nous fous le nom de fang-dragon ; ils l’appelloient
KivvaCa.pt Ivé'tKov, cinnabre des Indes. Cependant il pa-
roît par un paffage de Diofcoride, qu’ils connoif-
foient parfaitement la différence qu’il y a entre cette
matière & le vrai cinnabre.
Aujourd’hui, par cinnabre artificiel, on entend un
mélange de mercure 6c dè foufre fublimés enfem-
, ble par la violence du feu ; cette fubftance doit être
d’un beau rouge foncé, compofé d’aiguilles ou de
longues ftries luifantes. Il faut avoir foin de l’acheter
en gros morceaux, 6c non en poudre, parce
que quelquefois on falfifie le cinnabre avec du minium
; ce qui peut en rendre l’ufage très-dangereux
dans la Medecine.
En Angleterre, à V enife, & fur-tout en Hollande
, on travaille le cinnabre en grand ; il y a tout lieu
de croire qu’on obferve dans cette opération des
manipulations toutes particulières, & dont on fait
t