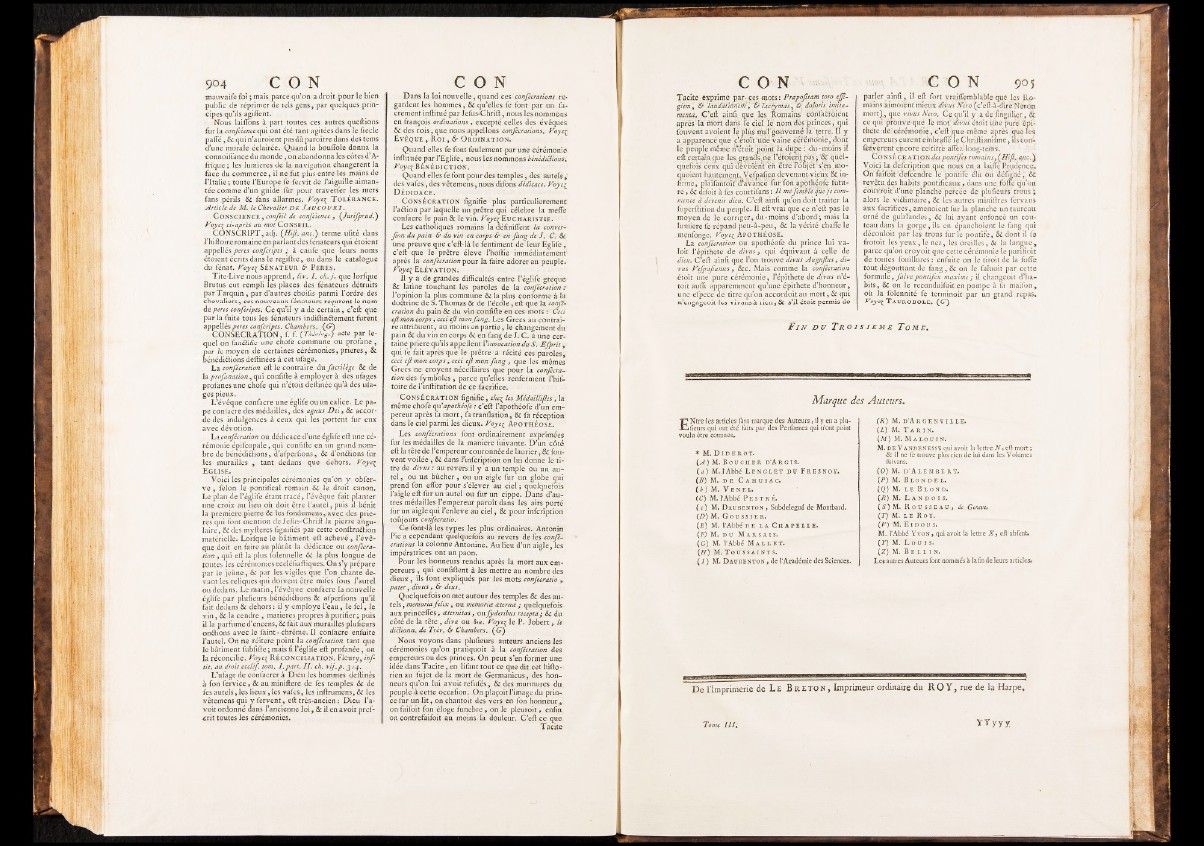
904 C O N
mauvaise foi ; mais parce qu’on a droit pour le bien
public de réprimer de tels gens, par quelques principes
qu’ils agiffent.
Nous lailTons à part toutes, ces autres questions
tfur la confcience qui ont été tant agitées dans le fiecle
paffé, & qui n’auroient pas dû paroître dans des tems
d’une morale éclairée. Quand la bouflole donna la
■ connoiflance du monde, on abandonna les côtes d’A-
ffi'que ; les lumières de la navigation changèrent la
face du commerce, il ne fut plus entre les mains de
l ’Italie ; toute l’Europe fe fervit de l’aiguille aimantée
comme d’un guide fûr pour traverfer les mers
fans périls & fans allarmes. Voye£ T olérance.
Article de M. le Chevalier DE JAV c o u R T .
C onscience, confeil de confcience y ( Jurifprudf
Voye^ ci-après au mot CONSEIL.
CONSCRIPT, adj. (Hijl, anc.') terme ufité dans
l’hiftoire romaine en parlant des fénateurs qui étoient
appellés peres confcripts ; à caufe que leurs noms
étoient écrits dans le regiftre, ©u dans le catalogue
du fénat. Voye^ Sénateur & Peres..
Tite-Live nous apprend, liv. 1. ch.j. que lorfque
Brutus eut rempli les places des fénateurs détruits
parTarquin, par d’autres choilis parmi l’ordre des
chevaliers, ces nouveaux fénateurs reçurent le nom
de peres confcripts. Ce qu’il y a de certain, c’eft que
par la fuite tous les fénateurs indiftinftement furent
appellés peres confcripts. Chambers. (G)
CONSECRATION, C. f. » « « par le-
quel on fanâifie une choie commune ou profane ,
par le moyen de certaines cérémonies, prières, &
bénédiâions deftinées à cet ufage.
La confécration eft le contraire du facrilége & de
la profanation, qui confifte à employer à dès ufages
profanes une chofe qui n’étoit deftinée qu’à des ula-
ges pieux.
L’évêque confacre une églife ou un calice. Le pape
confacre des médailles, des agnus D e i, & accorde
des indulgences à ceux qui les portent fur eux
avec dévotion.
La confécration ou dédicace d’une églife eft une cérémonie
épifcopale, qui confifte en un grand nombre
de bénédictions, d’afperfions, & d’onftions fur
les murailles , tant dedans que dehors. Voyeç
Eglise.
Voici les principales cérémonies qu’on y obfer-
ve , félon le pontifical romain & le droit canon.
Le plan de l’égiife étant tracé, l’évêque fait planter
une croix au lieu où doit être l’autel, puis il bénit
la première pierre 8c les fondemens, avec ftes prières
qui font mention de Jefus-Chrift la pierre angulaire,
&des myfteres lignifiés par cette conftruétion
matérielle. Lorfque le bâtiment eft achevé, l’évêque
doit en faire au plutôt la dédicace ou confécration
, qui eft la plus folennelle & la plus longue de
toutes les cérémonies eccléfiaftiques. On s’y prépare
par le jeûne, & par les vigiles que l’on chante devant
les reliques qui doivent être mifes fous l’autel
ou dedans. Le matin, l’évêque confacre la nouvelle
églife par plufieurs bénédictions & afperfions qu’il
fait dedans & dehors: il y employé l’eau, le fe l, le
v in , & la cendre , matières propres à purifier ; puis
il la parfume d’encens, & fait aux murailles plufieurs
onCtions avec le faint - chrême. Il confacre enfuite
l’autel. On ne réitéré point la confécration tant que
le bâtiment fubfifte ; mais fi l’églife eft profanée, on
la réconcilie. Voye^ Réconciliation. Fleury, in f
tit. au droit ccchf tom. I.part. I I : ch. v ij.p. 314.
L’ufage de confacrer à Dieu les hommes deftinés
à fon fervice, & au miniftere de fes temples & de
fes autels, les lieux, les vafes, les inftrumens, & les
vêtemens qui y fervent, eft très-ancien : Dieu l’a-
voit ordonné dans l’ancienne lo i, & il en avoit pref-
crit toutes les cérémonies.
C O N
Dans la loi nouvelle, quand ces confécrations regardent
les hommes, & qu’elles fe font par un fa-
crement inftitué par Jefus-Chrift, nous les nommons
en françois ordinations , excepté celles des évêques
& des rois, que nous appelions confécrations. Voyeiç.
Evêque , R o i , & Ordination.
Quand elles fe font feulement par une cérémonie
mftituée par l’Eglife, nous les nommons bénédictions.
Voye1 Bénédiction.
Quand elles fe font pour dès temples, des autels *
des vafes, des vêtemens, nous difons dédicace. Voye1
D édidaCe.
C onsécration fignifie plus particulièrement
TaCtion par laquelle un prêtre qui célébré la meffe
confacre le pain& le vin. / ^ ^ E ucharistie.
Les catholiques romains la définiffent la couver-
fion du pain & du vin en corps & en fang de J . C. &
une preuve que c’eft-là le fentiment de leur Eglife,
c’eft que le prêtre éleve l’hoftie immédiatement
après la confécration pour la faire adorer au peuple.
Voye{ Elévation.
Il y a de grandes difficultés entre l’églife greque
& latine touchant les paroles de la confécration :
l ’opinion la plus commune & la plus conforme à la
doCtrine de S. Thomas & de l’école, eft que la confécration
du pain & du vin confifte en ces mots : Ceci
ejl mon corps , ceci ejl mon fang. Les Grecs au contraire
attribuent, au moins en partie, le changement du
pain & du vin en corps &c en fang de J. C. à une certaine
priere qu’ils appellent l’invocation du S. Efprit,
qui fe fait après que le prêtre a récité ces paroles,
ceci ejl mon corps, ceci ejl mon fang, que les mêmes
Grecs ne croyent néceffaires que pour la confécration
des fymboles , parce qu’elles renferment l’hiftoire
de l’inftitution de ce facrifice.
C onsécration fignifie, che1 les Médaillées, la
même chofé qu'apothèofe : c ’eft l’apothéofe d’un empereur
après la mort, fa tranflation, & fa réception
dans le ciel parmi les dieux. Voye{ Apothéose.
Les confécrations font ordinairement exprimées
fur les médailles de la maniéré fuivante. D ’un côté
eft la tête de l’empereur couronnée de laurier, & fou-
vent v oilé e, & dans l’infeription on lui donne le titre
de divus : au revers il y a un temple ou un autel
, ou un bûcher, ou un aigle fur un globe qui
prend fon effor pour s’élever au ciel ; quelquefois
l’aigle eft fur un autel ou fur un cippe. Dans d’autres
médailles l’empereur paroît dans les airs porté
fur un aigle qui l’enleve au ciel, & pour infeription
toûjours confecratio.
Ce font-là les types les plus ordinaires. Antonin
Pie a cependant quelquefois au revers de fes confécrations
la colonne Antonine. Au lieu d’un aigle, les
impératrices ont un paon.
Pour les honneurs rendus après la mort aux empereurs
, qui confiftent à les mettre au nombre des
dieux, ils font expliqués par les mots.confecratio ,
pater, divus , & deus.
Quelquefois on met autour des temples & des autels
, memoria fe lix , ou memoria ceterna ; quelquefois
aux princeflfes , aternitas, ou fyderibus recepta; & du
côté de la tête , diva ou Oe«. Voye^ le P. Jobert, le
diclionn. de Trév. & Chambers. (G)
Nous voyons dans plufieurs auteurs .anciens les
cérémonies qu’on pratiquoit à la confécration des
empereurs ou des princes. On peut s’en former une
idée dans Tac ite, en lifant tout ce que dit cet hifto-
rien au fujet de la mort de Germanicus, des honneurs
qu’on lui avoit refufés, & des murmures du
peuple à cette occafion. On plaçoit l’image du prince
fur un lit , on chantoit des vers en fon honneur,
on faifoit fon éloge funebre , on le pleuroit, enfin
on contrefaifoit au moins la douleur, C ’eft ce que
Tacite
C O N
Taeîte exprime par. ces -niots : Prapoßtam toro tffi-
giem, '& làudationem, tacrymas, & dejoris imita-
menta. C ’eft ainfi..que les Romains fcônfacroiént
aprësTa mort dans.’ le çiêl' le nom dès^rincêîs, qiii
fouvent avoient leplip maTgoùvérné la tferre. Il y
a apparence que ç’étoît cüné vaine cérémonie, dont
lé peuple même n’etôft pojnt la dupe : du- mbins il
eft certain que .le^gïmvfcîïfè ôàs'j & quelquefois
ceux qtii' dévoient ' en être F objet‘ s’èn ,mo-
quoient hautement. Vefpafien devenait vieux & infirme
, plâîfànfôit a avancé'fur fön apipfH^ofe future
, & difoit à fes courtifans : I l mè femtffeqûe j e commence
à devenir dieu. C ’eft ainfi qu’on doit traiter la
fuperftition du peuple. Il eft vrai que ce n’eft pas le
moyen de le corriger, du-moins d’abord; mais la
lumière fe répand peu-à-peu, & la vérité chaffe le
. menfonge. Voye%_ Apothéose.
La confécration ou apothéofe du prince lui va-
loit l’épithete de divus, qui équivaut à celle de
dieu. C’eft ainfi que l’on trouve divus Auguflus, divus
Vefpafianus, & c . Mais comme la confécration
étoit une pure cérémonie, l’épithete de dj-vus n’étoit
aufîi apparemment qu’une épithete d’honneur,
line efpece de titre qu’on accordoit au mort, & qui
n’engageoit les vivans à rien ; & s’il étoit permis de
C O N 905
parler ainfi, il eft fort vraififemblable que les Romains
aimoiënt mieux divus Nèro (c’eft-à-diré Néron
mort),, que vivus Nero. Ce. qu’il y a defingitlier, &
ce qUi jiPôiive'que le mot'’ divus étoit imé pure épithète
rdé; cérémonie, c’eft .que même après ;qùe les
empereurs eurent embrafle le Chriftiannme, ils corf-
fibÉvèrent epeore cekitrb afle?J iong-terns.
C Ô NS É ÇR ATIQ.N des pontifes romains.3 ( Hift, ajic. )
Voici k.,defcription.que nous en. a laiffé prudence.
On fâifôit ;defcendfe lé pôritifè élu ôü àéfigné ; 8t
revêtu 4qs habits pontificaux, dans une.folle qu’on
côuvrÔi't’d’ùnè planche percée de plüfiêürs ’ frôüs ,
alors le viétimaire, & les autres miniftres fer vans
aux facrifices, amenoient fur la planche un taureau
orné de guirlandes, & lui ayant enfoncé un couteau
dans la gorge, ils en épanchoient le fang qui
découloit par les trous fur le pontife, & dont il fe
frotoit les yeux, le nez, les oreilles, & la langue,
parce qu’on croyoit que cette cérémonie le purifioit
de toutes fouillures : enfuite on le tiroit de la foffe
tout dégouttant de fang , & on le faluoit par cette
formule, falve pontifex maxime ; il changeoit d’habits,
& on le reconduifoit en pompe à fa maifon,
où la folennité fe terminoit par un grand repas.
Voyei TaurÔBOLE. (G)
F i n d u T r o i s i è m e T o m e .
Marque des Auteurs.
ENtre -les articles fans marque des Auteurs, il y en a plufieurs
qui ont été faits par des Perfonnes qui n’ont point
voulu être connues.
*M . D id e r o t .
(A ) M. Bo u c h e r d'A r g ï s.
( a ) M. l'Abbé L e n g l e t du F r e s n o y .
(R) M. D E C A H U S A C.
(b ) M. V e n e i .
. (C) M.l’Abbé P e s t r é .
( c ) M. Daubenton , Subdelegué de Montbard.
(D) M. G o u s s ie r .
(£) M. l’Abbé de l a C h a p e l l e .
{F) M. du M a r s a ï s .
(G) M. l’Abbé Ma l l e t .
{H) M. T o u s s a in t s .
( I ) M. Daubenton , de l’Académie des Sciences.
(K) M. d’A r g e n v il l e .
\l ) M. T a r i n .
{M)M. Ma lo u in .
M. de Vandenesse qui avoit la lettre N , eft mort;
& il ne fe trouve plus rien de lui dans les Volumes
fiüvans.
(O) M. d’A lemb e rt.
(P) M. B l o n d e l .
(Q) M. l e B l o n d .
(Æ) M. L a n d o 1 s.
( S) M. R o u s s e a u , de Geneyè.
(T) M. le Roy.
( r ) M. E id o u s .
M. l’Abbé Y von, qui avoit la lettre X , eft abfent;
(T) M. L'o u 1 s.
(Z) M. B E L L I N.
Les autres Auteurs font nommés à la fin de leurs articles«
De l’Imprimerie de L e B r e t o n , Imprimeur ordinaire du R O Y , rue de la Harpe,
Tome I I là Y Y y y y .