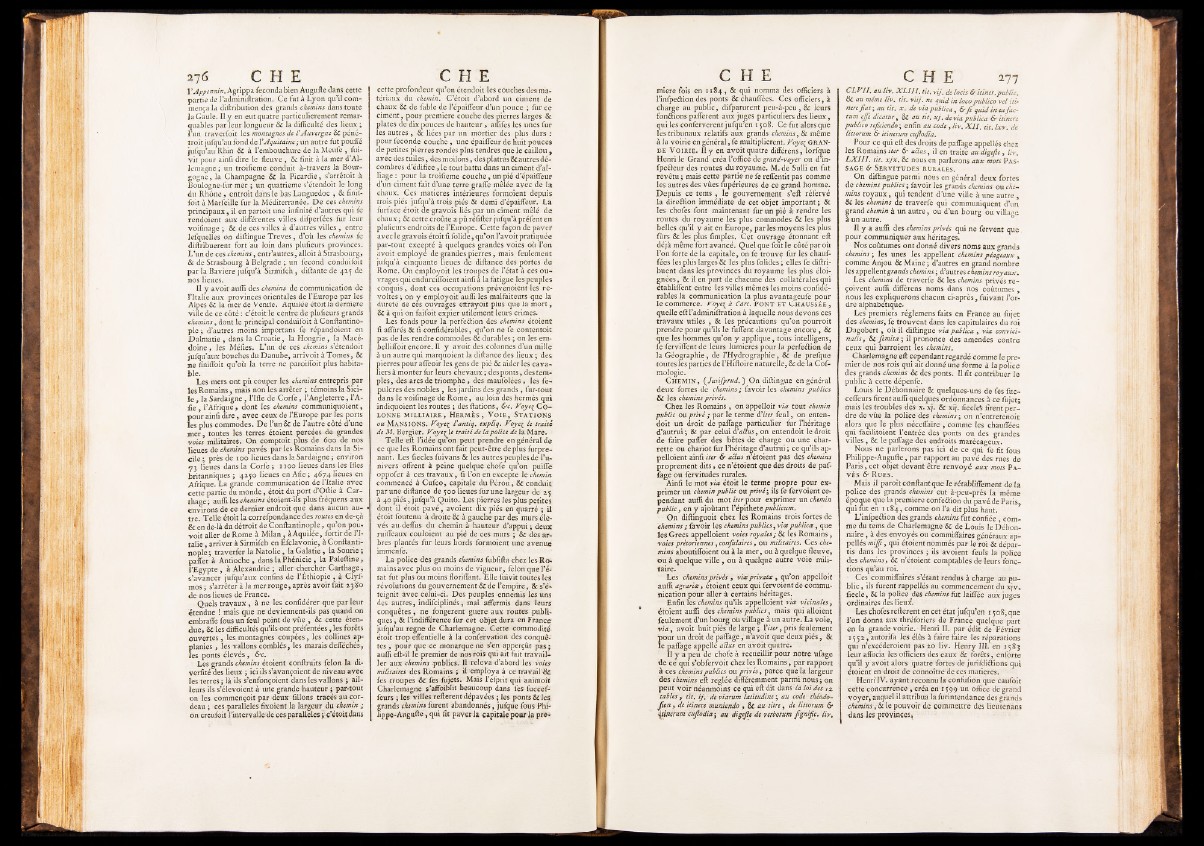
YAppennin. Agrippa féconda bien Augufte dans cette
partie de l ’adminifiration. Ce fut à Lyon qu’il commença
la diftribution des grands chemins dans toute
la Gaule. Il y en eut quatre particulièrement remarquables
par leur longueur ôc la difficulté des lieux ;
l’un traverfoit les montagnes de C Auvergne ÔC péné-
troit jufqu’au fond de l’Aquitaine ; un autre fut pouffé
jufqu’au Rhin ôc à l’embouchure de la Meufe , fui-
v it pour ainli dire le fleuve , ôc finit à la mer d’Allemagne
; un troifieme conduit à-travers la Bourgogne,
la Champagne ôc la Picardie, s’arrêtoit à
Boulogne-fur mer ; un quatrième s’étendoit le long
du Rhône , entroit dans le bas Languedoc , & finil-
foit à Marfeille fur la Méditerranée. De ces chemins
principaux, il en partoit une infinité d’autres qui fe
rendoient aux différentes villes difperfées fur leur
voifinage ; ôc de ces villes à d’autres villes , entre
lefquelles on diftingue T reves, d’où les chemins fe
diftribuerent fort au loin dans plufieurs provinces.
L ’un de ces chemins, entr’autres, alloit à Strasbourg,
& de Strasbourg à Belgrade ; un fécond conduifoit
par la Bavière jufqu’à Sirmil'ch, diûante de 415 de
nos lieues.
Il y avoit auffi des chemins de communication de
l’Italie aux provinces orientales de l’Europe par les
Alpes ôc la mer de Venife. Aquilée étoitla derniere '
ville de ce côté : c’étoitle centre de plufieurs grands
chemins, dont le principal conduifoit à Conftantino-
ple ; d’autres moins importans fe répandoient en
Dalmatie , dans la Croatie, la Hongrie, la Macédoine
, les Méfies. L’un de ces chemins s’étendoit
jufqu’aux bouches du Danube, arrivoit à Tomes, &
ne finiffoit qu’où la terre ne paroiffoit plus habitable
.L
es mers ont pu couper les chemins entrepris par
les Romains, mais non les arrêter ; témoins la Sicile
, la Sardaigne, l’Ifle de C o rfe, l’Angleterre, l’A-
fie l’Afrique, dont les chemins communiquoient,
pour ainfi dire, avec ceux de l’Europe par les ports
les plus commodes. D e l’un & de l’autre côté d’une
mer, toutes les terres étoient percées de grandes
voies militaires. On comptoit plus de 600 de nos
lieues de chemins pavés par les Romains dans la Si-,
c ile ; près de 100 lieues dans la Sardaigne ; environ
73 lieues dans la Corfe ; 1100 lieues dans.les Ifles
britanniques ; 4250 lieues en Afîe; 4674 lieues en
Afrique. La grande communication de l’Italie avec
cette partie du monde, étoit du port d’Oftie à Carthage
; auffi les chemins étoient-ils plus fréquens aux
environs de ce dernier endroit que dans aucun autre.
Telle étoit la correfpondance des routes en de-çà
& en de-là du détroit de Confiantinople, qu’on pourvoit
aller de Rome à Milan, à Aquilée, fortirde l’Italie
, arriver à Sirmifeh en Efdavonie, à Conftanti-
nople ; traverfer la Natolie, la Galatie, lu Sourie ;
paffer à Antioche , dans la Phénicie, la Paleftine,
l ’Egyp te, à Alexandrie ; aller chercher Carthage,
s’avancer jufqu’aux confins de l’Éthiopie , à Clyf-
mos ; s’arrêter à la mer rouge, après avoir fait 2380
de nos lieues de France.
Quels travaux, à ne les confidérer que par leur
étendue ! mais que ne deviennent-ils pas quand on
embraffe fous un feul point de vue , ôc cette étendue,
ôc les difficultés qu’ils ont préfentées, les forêts
ouvertes, les montagnes coupées, les collines ap-
planies , les vallons comblés , les marais defféchés,
les ponts élevés, &c.
Les grands chemins étoient conftruits félon la di-
verfité des lieux ; ici ils s’avançoient de niveau avec
les terres ; là ils s’enfonçoient dans les vallons ; ailleurs
ils s’élevoient à une grande hauteur ; par-tout
on les commençoit par deux filions tracés au cordeau
; ces parallèles fixoient la largeur du chemin ;
on crcufoit l ’intervalle de ces parallèles j c ’étoitdans
cette profondeur qu’on étendoit les couches des matériaux
du chemin. C ’étoit d’abord un ciment de
chaux ôc de fable de l’épaiffeur d’un pouce ; fur ce
ciment, pour première couche des pierres larges &
plates de dix pouces de hauteur, affifes les unes fur
les autres , & liées par un mortier des plus durs :
pour fécondé couche, une épaiffeur de huit pouces
de petites pierres rondes plus tendres que le caillou ,
avec des tuiles, des moilons, des platras ôc autres décombres
d’édifice, le tout battu dans un ciment d’alliage
: pour la troifieme couche, un pié d’épaiffeur
d’un ciment fait d’une terre graffe mêlée avec de la
chaux. Ces matières intérieures formoient depuis
trois piés jufqu’à trois piés & demi d’épaiffeur. La
furface étoit de gravois liés par un ciment mêlé de
chaux ; ôc cette croûte a pû réfifter jufqu’à préfent en
plufieurs endroits de l’Europe. Cette façon de paver
avec le gravois étoit fi folide, qu’on l’avoit pratiquée
par-tout excepté à quelques grandes voies où l’on
avoit employé de grandes pierres, mais feulement
jufqu’à cinquante lieues de diftance des portes de
Rome. On employoit les troupes de l’état à ces ouvrages
qui endurciffoient ainfi à la fatigue les peuples
conquis, dont ces occupations prévenoient les révoltés
; on y employoit auffi les malfaiteurs que la
dureté de ces ouvrages effrayoit plus que la mort,
ôc à qui on faifoit expier utilement leurs crimes.
Les fonds pour la perfection des chemins étoient
fi affiirés & fi confidérables, qu’on ne fe contentoit
pas de les rendre commodes ôc durables ; on les em-
belliffoit encore. Il y avoit des colonnes d’un mille
à un autre qui marquoient la diftance des lieux ; des
pierres pour affeoir les gens de pié ôc aider les cavaliers
à monter fur leurs chevaux ; des ponts, des temples,
des arcs de triomphe, des maufolées, les fe-
pulcres des nobles , les jardins des grands , fur-tout
dans le voifinage de Rome, au loin des hermès qui
indiquoient les routes ; des Rations, &c. Voye^ C olonne
m il l ià ir e , He rm è s , V o ie , St a t io n s
ou MANSIONS. Foye^ l'antiq. expliq. Foye[ le traite
de M. Bergier. Voyt{ le traité de la police de la Mare.
Telle eft l’idée qu’on peut prendre en général de
ce que les Romains ont fait peut-être de plus furpre-
nant. Les fiecles fuivans & les autres peuples de l’univers
offrent à peine quelque chofe qu’on puiffe
oppofer à ces travaux, fi l’on en excepte le chemin
commencé à Cufco, capitale du Pérou, ôc conduit
par une diftance de 500 lieues fur une largeur de 25
à 40 piés, jufqu’à Quito. Les pierres les plus petites
dont il étoit pa vé, avoient dix piés en quarré ; il
étoit foutenu à droite ôc à gauche par des murs élevés
au-deffus du chemin à hauteur d’appui ; deux
ruiffeaux couloient au pié de ces murs ; ôc dès arbres
plantés fur leurs bords formoient une avenue
immenfe.
La police des grands chemins fubfifta chez les Romains
avec plus ou moins de vigueur, félon que l’état
fut plus ou moins floriffant. Elle fuivit toutes les
révolutions du gouvernement & de l’empire, & s’éteignit
avec celui-ci. Des peuples ennemis les uns
des autres, indifciplinés, mal affermis dans leurs
conquêtes, ne fongerent guère aux routes publia
ques, & l’indifférence fur cet objet dura en France'
jufqu’au régné de Charlemagne.- Cette commodité
étoit trop effentielle à la confervation des conquêtes
, pour que ce monarque ne s’en apperçût pas;
auffi eft-il le premier de nos rois qui ait fait travailler
aux chemins publics.’ Il releva d’abord les voies
militaires des Romains ; il employa à ce travailôc.
fes troupes ôc fes fujets. Mais l’efprit qui animoit
Charlemagne s ’affoiblit beaucoup dans fes fuccef-
feurs ; les villes refterent dépavées ; les ponts & les
grands chemins furent abandonnés, jufque fous Philippe
Augufte , qui fit paver la capitale pour la premiere
fois en 1 18 4 , & qui nomma des officiers à
l’infpeftion des ponts ôc chauffées. Ces officiers, à
charge au public, difparurent peu-à-peu , ôc leurs
fondions pafferent aux juges particuliers des lieux,
qui les conferverent jufqu’en 1508. Ce fut alors que
les tribunaux relatifs aux grands chemins, & même
à la voirie en général, fe multiplièrent. Foye[ grande
V o irie. Il y en avoit quatre différens, lorfque
Henri le Grand créa l’office de grand-voyer ou d’in-
fpe&eur des routes du royaume. M.de Suffi en fut
revêtu ; mais cette partie ne fe reffentit pas comme
les autres des vues fupérieures de ce grand homme.
Depuis ce tems , le gouvernement s’eft réfervé
la direûion immédiate de cet objet important ; &
les chofes font maintenant fur un pié à rendre les
routes du royaume les plus commodes ôc les plus
belles qu’il y ait en Europe, par les moyens les plus
fûrs ôc les plus fimples. Cet ouvrage étonnant eft
déjà même fort avancé. Quel que foit le côté par où
l’on forte de la capitale, on fe trouve fur les chauffées
les pliis larges ôc les plus folides ; elles fe diftri-
buent dans les provinces du royaume les plus éloignées
, & il en part de chacune des collatérales qui
établiffent entre les villes mêmes les moins confiaé-
rables la communication la plus avantageufe pour
le commerce. Foye^ à Üart. Po n t et C haussée ,
quelle eft l’adminiftration à laquelle nous devons ces
travaux utiles , & les précautions qu’on pourroit
prendre pour qu’ils le fuffent davantage encore, ôc
que les hommes qu’on y applique., tous intelligens,
fe ferviffent de leurs lumières pour la perfection de
la Géographie, de l’Hydrographie, & de prefque
toutes les parties de l’Hiftoire naturelle, ôc de la Cof-
mologie.
C h em in , ( Jurifprud. ) On diftingue en général
deux fortes de chemins ; favoir les chemins publics
& les chemins privés.
Chez les Romains , on appelloit via tout chemin
public ou privé ; par le terme d’iter feul, on enten-
doit un droit de paffage particulier fur l’héritage
d’autrui; & par celui d1 aclus, on entendoit le droit
de faire paffer des bêtes de charge ou une charrette
ou chariot fur l’héritage d’autrui ; ce qu’ ils appelloient
ainfi iter & aclus n’étoient pas des chemins
proprement dits , ce n’étoient que des droits de paffage
ou fervitudes rurales.
Ainfi le mot via étoit le terme propre pour exprimer
un chemin public ou privé ; ils fe fer voient cependant
auffi du mot iter pour exprimer un chemin
public, en y ajoûtant l’épithete publicum.
On diftinguoit chez les Romains trois fortes de
chemins ; favoir les chemins publics, vice publica, que
les Grecs appelloient voies royales; ôc les Romains,
voies prétoriennes, confulaires , ou militaires. Ces chemins
aboutiffoient ou à la mer, ou à quelque fleuve,
ou à quelque v ille , ou à quelque autre voie militaire.
Les chemins privés , vice privâtes , qu’on appelloit
auffi agrarice , étoient ceux qui fervoient de communication
pour aller à certains héritages.
Enfin les chemins qu’ils appelloient vice vicinales,
étoient auffi des chemins publics, mais qui alloient
feulement d’un bourg oü village à un autre. La voie,
via, avoit huit piés de large ; 1’iter, pris feulement
pour un droit de paffage, n’avoit que deux piés, &
le paffage appelle aclus en avoit quatrè.
Il y a peu de chofe à reciieillir pour notre ufage
de ce qui s’obfervoit chez les Romains, par rapport
à ces chemins publics ou privés, parce que la largeur
des chemins eft réglée différemment parmi nous ; on
peut voir néanmoins ce qui eft dit dans la loi des 12.
tables , tit. ij. de viarum latitudine ; au code théodo-
Jîen , de itiner.e muniendo , & au titre, de littorum &
ÿtinerum cujlodia; au digejle de verborum Jîgnific, liv.
CLFII. au liv. X L III. tit. vij. de locis & itiner.public.
& au même liv. tit. viij. ne quid in loco publico vel iti-
nere fiat; au tit. x . de via publica, <S* Ji quid in ea factum
ejfe dicatur, ôc au tit. x j . de via publica & itinere
publico reficiendo; enfin au code,liv, X I I . tit. bcv. de
littorum & itinerum cujlodia.
Pour ce qui eft des droits de paffage appellés chez
les Romains iter 6* aclus, il en traite au digejle, liv.
L X I I I . tit. x jx . ôc nous en parlerons aux mots Passage
& Serv itudes rurales.
On diftingue parmi nous en général deux fortes
de chemins publics ; favoir les grands chemins ou chemins
royaux, qui tendent d’une ville à une autre,
& les chemins de traverfe qui communiquent d’un
grand chemin à un autre, ou d’un bourg ou village
à un autre.
Il y a auffi des chemins privés qui ne fervent que
pour communiquer aux héritages.
Nos coutumes ont donné divers noms aux grands
chemins ; les unes les appellent chemins péageaux ,
comme Anjou ôc Maine ; d’autres en grand nombre
les appellent grandi chemins ; d’autres chemins royaux.
Les chemins de traverfe ôc les chemins privés reçoivent
auffi différens noms dans nos coutumes ,
nous les expliquerons chacun ci-après, fuivant l’ordre
alphabétique.
Les premiers réglemens faits en France au fujet
des chemins, fe trouvent dans les capitulaires du roi
Dagobert, où il diftingue via publica , via convici-
nalis, & femita ; il prononce des amendes contre
ceux qui barroient les chemins.
Charlemagne eft cependant regardé comme le premier
de nos rois qui ait donné une forme à la police
des grands chemins & des ponts. II fit contribuer le
public à cette dépenfe.
Louis le Débonnaire & quelques-uns de fes fuc-
ceffeurs firent auffi quelques ordonnances à ce fujet;
mais les troubles des x. xj. & xij. fieeleS firent perdre
de vûe la police des chemins ; on n’entretenoit
alors que le plus néceffaire , comme les chauffées
qui facilitoient l’entrée des ponts ou des grandes
villes, ôc le paffage des endroits marécageux.
Nous ne parlerons pas ici de ce qui fe fit fous
Philippe-Augufte, par rapport au pavé des rues de
Paris, cet objet devant être renvoyé aux mots Pa vés
& Rues.
Mais il paroît confiant que le rétabliffement de là
police des grands chemins eut à-peu-près la même
époque que la première confettion du pavé de Paris,
qui fut en 1 184, comme on l’a dit plus haut.
L’infpedion des grands chemins fut confiée , comme
du tems de Charlemagne ôc de Louis le Débonnaire
, à des envoyés ou commiffaires généraux appellés
mijfi, qui étoient nommés par le roi & départis
dans les provinces ; ils avoient feuls la police
des chemins, Ôc n’étoient comptables de leurs fonctions
qu’au roi.
* Ces commiffaires s’étant rendus à charge au public
, ils furent rappellés au commencement du x jv .
fiecle, ôc la police des chemins fut laiffée aux juges
ordinaires des Iieujf.
Les chofes refterent en cet état jufqu’en 1508, que
l’on donna aux thréforiers de France quelque part
en la grande voirie. Henri II. par édit de Février
1552, autorifa les élûs à faire faire les réparations
qui n’excéderoient pas zo liv. Henry III. en 1583
leur affocia les officiers des eaux ôc forêts, enforte
qu’il y avoit alors quatre fortes de jurifdiôions qui
étoient en droit de connoître de ces matières.
Henri'IV. ayant reconnu la confufion que caufoit
cette concurrence , créa en 1599 un office de grand
voyer; auquel il attribua la fùrintendance des grands
chemins idc le pouvoir de commettre des lieùtcnans
dans les provinces.