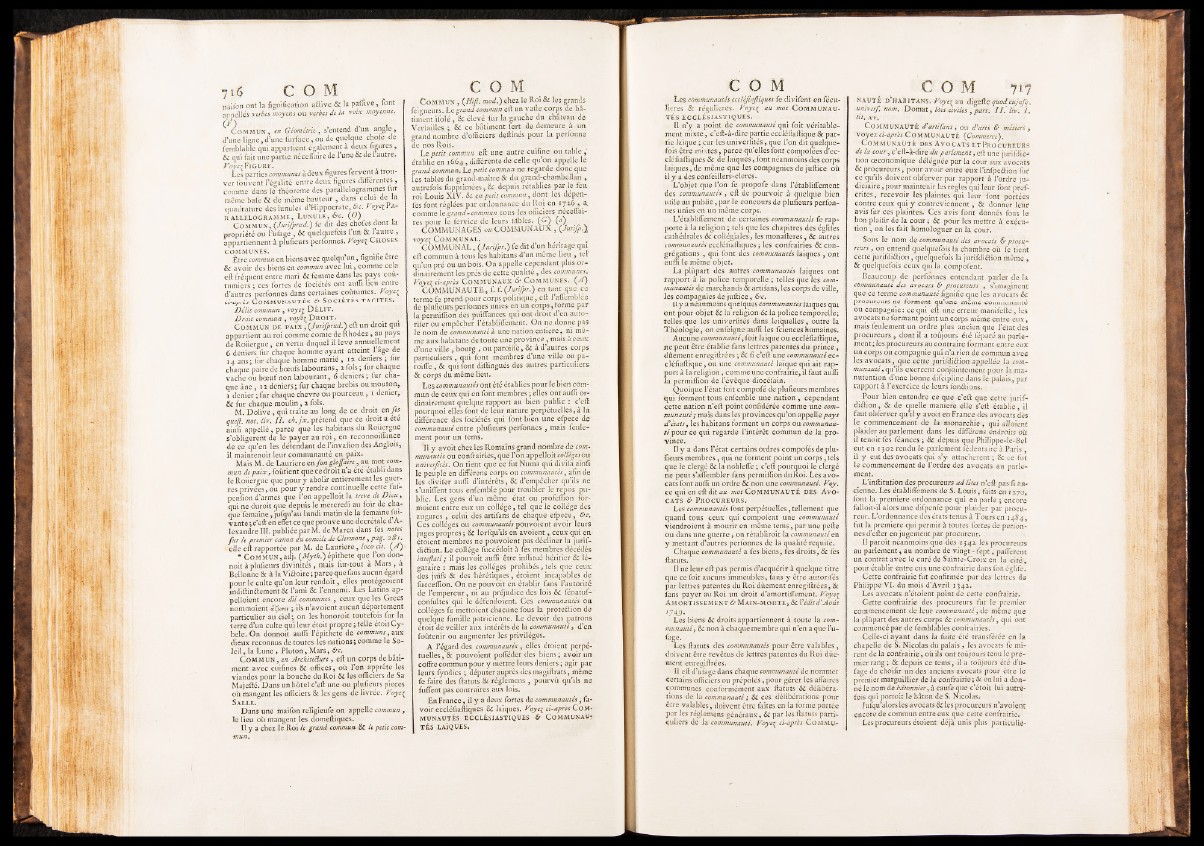
naifon ont la lignification aftive & la paflîve, font
appellés verbes moyens ou verbes de la voix moyenne.
( F ) , ,
C ommun, en Géométrie, s’entend d’un angle,
d’une ligne, d’une furface, ou de quelque chofe de
femblable qui appartient également à deux figures ,
& qui fait une partie néceffaire de l’une & de 1 autre.
Foyei Figure.
Les parties communes à deux figures fervent a trouver
fouvent l’égalité entre deux figures differentes,
comme dans le théorème des parallélogrammes fur
même bafe & de même hauteur , dans celui de la
quadrature des lunules d’Hippocrate, &c. Voyeurk*
R ALLELOGRAMME, LUNULE* & c. (O)
C ommun, (Jurifprud.) fe dit des chofes dont la
propriété ou l’ufage , & quelquefois l’un & l’autre ,
appartiennent à plufieurs perfonnes. Foyei Choses
COMMUNES. 5 A
Être commun en biens avec quelqu’un, figmfie etre
& avoir des biens en commun avec lui, comme cela
eft fréquent entre mari & femme dans les pays coutumiers
; ces fortes de fociétés ont aufli lieu entre
d’autres perfonnes dans certaines coutumes. Voyc{
ci-après COMMUNAUTÉS & SOCIÉTÉS TACITES*
Délit commun , voyez Dél it.
Droit commun , voye%_ DROIT.
C ommun de paix , ( Jurifprud.) eft un droit qui
appartient au roi comme comte de Rhodez, au pays
de Roiiergue, en vertu duquel il leve annuellement
6 deniers fur chaque homme ayant atteint l’âge de
3 4 ans; fur chaque homme marié , 12 deniers ; fur
chaque paire de boeufs labourans, 2 fols ; fur chaque
vache ou boeuf non labourant, 6 deniers ; fur chaque
âne , 12 deniers ; fur chaque brebis ou mouton,
1 denier ; fur chaque chevre ou pourceau, 1 denier,
& fur chaque moulin, 2 fols.
M. D o live , qui traite au long de ce droit en fes
quefi. not. liv. IL ch.jx. prétend que Ce droit a été
ainfi appellé, parce que les habitans du Roiiergue
s’obligèrent de le payer au r o i , en reconnoiffance
de ce qu’en les défendant de l’invafion des Anglois,
il maintenoit leur communauté en paix.
Mais M. de Lauriere en fon glojfaire, au mot commun
de paix , foûtient que ce droit n’a été établi dans
le Roiiergue que pour y abolir entièrement les guerres
privées, ou pour y rendre continuelle cette fuf-.
penfion d’armes que l’on appelloit la trêve de Dieu ,
qui ne duroit que depuis le mercredi au foir de chaque
femaine, jufqu’au lundi matin de la femaine fui-
vante ; c’eft en effet ce que prouve une decrétale d’Alexandre
III. publiée par M. de Marca dans fes notes
Jur le premier canon du concile de Clermont, pag. 281.
| elle eft rapportée par M. de Lauriere, loco cit. (A ) •
* Commun, adj. (Myth.)épithete que l’on don-
noit à plufieurs divinités, mais fur-tout à Mars , à
Bellonne & à la Viûoire ; parce que fans aucun égard
pour le culte qu’on leur rendoit, elles protégeoient
indiftinftement & l’ami & l’ennemi. Les Latins appelaient
encore dii communes , ceux que les Grecs
nommoient uifavoi ; ils n’avoient aucun departement
particulier au ciel ; on les honoroit toutefois -fur la
terre d’un cuite qui leur étoit propre ; telle etoit Cy-
bele. On donnoit aufli l’épithete de communs, aux
dieux reconnus de toutes les nations ; comme le Soleil
, la Lune, Pluton, Mars, &c.
Commun, en Architecture , eft un corps de bâtiment
avec cùifines & offices, où l’on apprête les
viandes pour la bouche du Roi & les officiers de Sa
Majefté. Dans un hôtel c’eft une ou plufieurs pièces
où mangent les officiers & les gens de livrée. Foye%_
Salle.
Dans une maifon religieufe on appelle commun,
le lieu où mangent les domeftiques.
Il y a chez le Roi le grand commun &C le petit commun.
C ommun , (JK/Î. mod.) chez le Roi & les grands
fei«meurs. Le grand commun eft un vafte corps de bâtiment
ifo lé , 6c élevé fur la gauche du château dé
Verfailles ; & ce bâtiment fort de demeure à un
grand nombre d’officiers deftines pour la perfonne
de nos Rois. ‘ ’
Le petit commun eft Une autre çuifine oii table
établie en 1664, différente de celle qu’on appelle le
grand commun. Le petit commun ne regarde donc que
les tables du grand-maître & du grand-chambellan ,
autrefois iiipprimées, 6c depuis rétablies par le feu
roi Louis XIV. 6c ce petit commun, dont les dépen-
fes font réglées par ordonnance du Roi en 1726 , a.
comme le grand-commun tous les officiers necefîai-
res pour le,fervice de leurs tables. (G ) (<*)
COMMUNAGES ou COMMUNAUX, ( Jurifp
voyeç C o m m u n a l . , . ,
COMMUNAL, (Jurifpr.) fe dit d’un héritage qui
eft commun à tous les habitans d’un meme lieu , te?
qu’un pré ou un bois. On appelle cependant plus Ordinairement
les prés de cette qualité, des communes.
F o y e i ci-après C O M M U N A U X & COMMUNES. |4)
COMMUNAUTÉ, f. t\ (Jurifpr.) en tant que ce
terme fe prend pour corps politique, eft l’affemblée
de plufieurs perfonnes unies en un corps, forme par
la permiffion des puiflances qui ont droit d’en auto-
rifer ou empêcher l’établiffement. On ne donne pas
le nom de communauté à une nation entière, ni meme
aux habitans de toute une province, mais à ceux
d’une ville , bourg , ou paroifïè, & à d’autres corps
particuliers , qui font membres d’une ville ou pa-
roiffe , & qui font diftingués des autres particuliers-
& corps du même lieu.
Les communautés ont été établies pour le bien commun
de ceux qui en font membres ; elles ont aufli ordinairement
quelque rapport au bien publie-: c’eft
pourquoi elles font de leur nature perpétuelles, à la
différence des fociétés qui font bien une efpece de
communauté entre plufieurs perfonnes , mais feulement
pour un tems.
Il y avoit chez les Romains grand nombre de communautés
ou confrairies, que l’on appelloit collèges ou
univerfités. On tient que ce fut Numa qui divifa ainfi
le peuple en différens corps ou communautés, afin de
les divifer aufli d’intérêts, & d’empêcher qu’ils ne
s’uniffent tous enfemble pour troubler le repos public.
Les gens d’un même état ou profeflion for-
moient entre eux un collège, tel que le collège des
augures , celui des artifans de chaque efpece, &c.
Ces collèges ou communautés pouvoient avoir leurs
juges propres ; 6c lorfqu’ils en avoient, ceux qui en-
étoient membres ne pouvoient pas décliner la jurif-
didion. Le collège fuccédoit à fes membres décédés
intefiati ; il pouvoit aufli être inftitué héritier 6c légataire
: mais les collèges prohibés, tels que ceux
des juifs & des hérétiques, étoient incapables de
fucceflion. On ne pouvoit en établir fans l’autorité
de l’empereur, ni au préjudice des lois &: fénatuf-
confultes qui le défendoient. Ces communautés, ou
collèges fe mettoient chacune fous la protedion de
quelque famille patricienne. Le devoir des patrons
etoit de veiller aux intérêts de la communauté, d’en
fôûtenir ou augmenter les privilèges.
A l’égard des communautés , elles étoient perpétuelles
, & pouvoient pofféder des biens ; avoir un
coffre commun pour y mettre leurs deniers ; agir par
leurs fyndics ; députer auprès des magiftrats, même
fe faire des ftatuts & réglemens , pourvu qu’ils ne
fuffent pas contraires aux lois.
En France, il y a deux fortes de communautés, fa-
voir eccléfiaftiques 6c laïques. Foye%_ ci-après C o m m
u n a u t é s ECCLÉSIASTIQUES & COMMU^AU?
TÉS LAÏQUES.
Lés c'ôrtimunautés eccléfiaftiques fe diviient en fécii-
îieres & régulières. Foye^ au mot C om m un au t
é s ECCLÉSIASTIQUES.
Il n’y a point de communauté qui foit véritâble-
inent mixte, c’eft-à-dire partie eccléfiaftique & partie
laïque ; car les univerfités * que l’on dit quelquefois
être mixtes, parce qu’elles font compofees d’ec-
cléfiaftiqués 6c de laïques, font néanmoins des corps
laïques, de même que les compagnies de juftice où
il y a des cônfeillers-clercs.
L’objet que l’on fe propofe dans l’établiflement
des communautés , eft de pourvoir à quelque bien
utile au public, par le concours de plufieurs perfonnes
unies en un même corps.
L’établiflement de certaines communautés fe rapporte
à la religion ; tels que les chapitres des églifes
cathédrales & collégiales, les monafteres, 6c autres
communautés eccléfiaftiques ; les confrairies &C congrégations
, qui font des communautés laïques , ont
aufli le même objet.
La plupart des autres communautés laïques ont
rapport à la police temporelle ; telles que les communautés
de marchands & artifans, les corps de ville,
les compagnies de juftice, &c.
Il y a néanmoins quelques communautés laïques qui
ont pour objet 6c la religion 6c la police temporelle;
telles que les univerfités dans lesquelles, outre la
Théologie, on enfeigne aufli les feiences humaines.
Aucune communauté, foit laïque ou eccléfiaftique,
ne peut être établie fans lettres patentes du prince,
dûement enregiftrées ; 6c fi c’eft une communauté eccléfiaftique
, ou une communauté laïque qui ait rapport
à la religion, comme une confrairie, il faut aufli
la permiffion de l’évêque diocéfain.
Quoique l’état foit compofé de plufieurs membres
qui forment tous enfemble une nation , cependant
cette nation n’eft point confidérée comme une communauté
; mais dans les provinces qu’on appelle pays
d'états, les habitans forment un corps ou communauté
pour ce qui regarde l’intérêt commun de la province.
Il y a dans l’état certains ordres compofés de plu-
lieurs membres, qui ne forment point un corps, tels
que le clergé 6c la noblefle ; c’eft pourquoi le clergé
ne peut s’aflembler fans permiffion du Roi. Les avocats
font aufli un ordre & non une communauté. Foy.
ce qui en eft dit au mot C ommunauté des Avocats
& Procureurs.
Les communautés font perpétuelles, tellement que
quand tous ceux qui compofent une communauté
viendroient à mourir en même tems, par une pefte
ou dans une guerre, on rétabliroit la communauté en
y mettant d’autres perfonnes de la qualité requife.
Chaque communauté a fes biens, fes droits, 6c fes
ftatuts.
Il ne leur eft pas permis d’acquérir à quelque titre
que ce foit aupuns immeubles, fans y être autorifés
par lettres patentes du Roi dûement enregiftrées, &
fans payer au Roi un droit d’amortiflement. Foyeç
Amortissement & Main-morte, & l'éditd'Août
• 7 4 9 - . , ' V -
Les biens & droits appartiennent à toute la communauté,
6c non à chaque membre qui n’en a que l’u-
fage.
Les ftatuts des communautés pour être valables ,
doivent être revêtus de lettres patentes du Roi dûé-
ment enregiftrées.
Il eft d’ufage dans chaque communauté de nommer
Certains officiers ou prépofés, pour gérer les affaires
communes conformément aux ftatuts 6c délibérations
de la communauté ; & ces délibérations pour
être valables, doivent être faites en la forme portée
par les réglemens généraux, & par les ftatuts particuliers
de la communauté. Foye£ ci-après C ommu-
C O M 717
NAÜTE D’H AB I TANS * Foye^QM digefte quod cujufq,
univerf. nom. Domat, lois civiles , part. I l ’, liv, /.
tit. xv.
C ommun auté d?artifans , Ôu d'arts & métiers 3
Voyez ci-après COMMUNAUTÉ (Commerce),
C om m un au té des A v o c a t s e t Procureurs
de la cour, c ’eft-à-dire du parlement, eft une jurifdicj
tion oecQriomique déléguée par la cour aux avocats
& procureurs, pour avoir entre eux l’infpeftion fui*
ce qu’ils doivent obferver par rapport à l’ordre judiciaire
, pour maintenir les réglés qui leur font pref-
crités,. recevoir les plaintes qui leur font portées
contre ceux qui y Contreviennent, & donner leur
avis fur ces plaintes. Cé s avis font donnés fous le
bon plaifir de la cour ; & pour les mettre à exécution
, on les fait homologuer en là cour.
Sous le nom de communauté des avocats & procu*
reurs , on entend quelquefois la chambre où fe tient
cette jurifdiftion, quelquefois la jurifdi&ion même ,
& quelquefois ceux qui la compofent.
Beaucoup de perfonnes entendant parler de la
communauté des avocats & procureurs , s’imaginent
que ce terme communauté lignifie que les avocats &
procureurs ne forment qu’une meme communauté
ou compagnie : ce qui eft une erreur manifefte, les
avocats ne formant point un corps même entre eux,
mais feulement un ordre plus ancien que l’état des
procureurs , dont il a toujours été féparé au parlement;
les procureurs au contraire formant entre eux
un corps ou compagnie qui n’a rien de commun avec
les avocats, que cette jurifdiétion appellée la communauté
, qu’ils exercent conjointement pour la manutention
d’une bonne difeipline dans le palais, par
rapport à l’exercice de leurs-fondions.
Pour bien entendre ce que c’eft que cette jurif-
diâion, & de quelle maniéré elle s’eft établie, il
faut obferver qu’il y avoit en France des avocats dès
le commencement de la monarchie, qui alloienf
plaider au parlement dans les différens endroits oit
il tenoit fes féances ; & depuis que Philippe-le-Bel
eut en 1302 rendu le parlement lédentaire à Paris ,
il y eut des avocats qui s’y attachèrent ; & ce fut
le commencement de l’ordre des avocats au parlement.
L ’inftitution des procureurs ad lues n’eft pas fi ancienne.
Les établiffemens de S. Louis, faits en 12jô i
font la première ordonnance qui en parle ; encore
falloit-il alors une difpenfe pour plaider par procureur.
L’ordonnance des états tenus à Tours en 1484 ,
fut la première qui permit à toutes fortes de perfonnes
d’efter en jugement par procureur.
Il paroît néanmoins que dès 1342 les procureurs
au parlement, au nombre de vingt - fept, pafferent
un contrat avec le curé de Sainte-Croix en la cité,
pour établir entre eux une confrairie dans fon églife*
Cette confrairie fut confirmée par des lettres de
Philippe’VI. du mois d’Avril 1342.
Les avocats n’étoient point de cette confrairie.
Cette Confrairie des procureurs fut le premier
commencement de leur communauté, de même que
la plupart des autres corps & communautés, qui ont
commencé par de femblables confrairies.
Celle-ci ayant dans la fuite été transférée en la
chapelle de S. Nicolas du palais, les avocats fe mirent
de la confrairie, où ils ont toujours tenu le premier
rang ; & depuis ce tems, il a toujours été d’ufage
de choifir un des anciens avocats pour être le
premier marguillier de la confrairie; & on lui a donné
le nom de bâtonnier, à caufe que c’étoit lui autrefois
qui portoit le bâton de S. Nicolas^
Juiqu’alors les avocats & les procureurs n’avoient
encore de commun entre eux que cette confrairie.
Les procureurs étoient déjà unis plus particulie