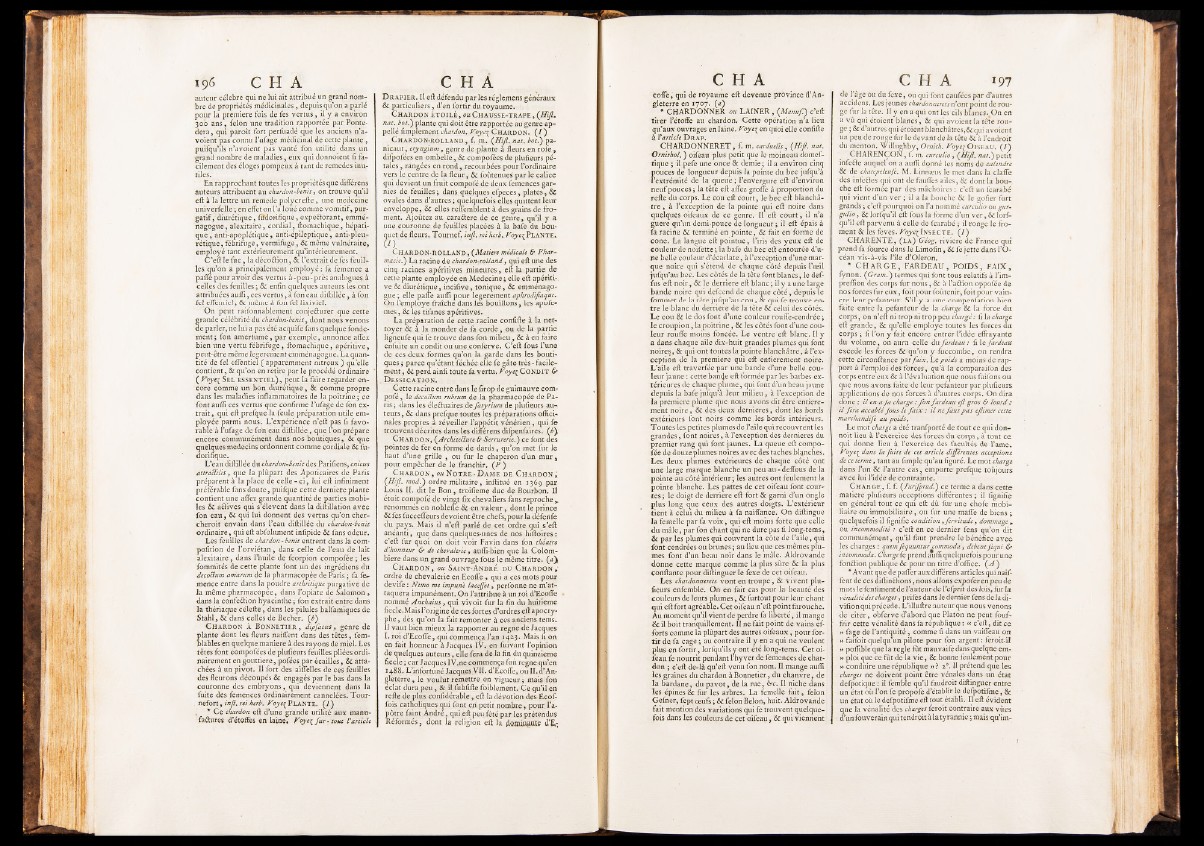
auteur célébré qui ne lui ait attribué un grand nombre
de propriétés médicinales, depuis qu’on a parlé
pour la première fois de fes vertus, il y a environ
30b ans , félon une tradition rapportée par Ponte-
dera, qui paroît fort perfuadé que les anciens n’a-
voient pas connu l’ufage médicinal de cette plante,
ptiïfdu’ils n’a voient pas vanté fon utilité dans un
grand nombre de maladies, eux qui donnoient li facilement
des éloges pompeux à tant de remedes inutiles.
En rapprochant toutes les propriétés que différens
auteurs attribuent au chardon-benit, on trouve qu’il
eft à la lettre un remede polycrefte, une medecine
univerfelle ; en effet on l ’âloiié comme vomitif, purgatif,
diurétique, fifdowfique, expe&orant, emmé-
nagogue, alexitaire, cordial, ftomachique, hépatique
, anti-apoplétique, anti-épileptique, anti-pleu-
rétiqtie, fébrifuge, vermifuge, 6c même vulnéraire,
employé tant extérieurement qu’intérieurement.
C ’eft le fù c , la decottion, & l’extrait de,fes feuilles
qu’dn a principalement employé : fa femence a
paffé pour avoir des vertus à-peu-près analogues à
celles des. feuilles ; & enfin quelques auteurs les ont
attribuées aufli, ces vertus, à fon eau diftillée, à fon
fel effentiel, & même à fon fel lixiviel.
On peut raifonnablement conjeôurer que cette
grande célébrité du chardon-benit, dont nous venons
de parler, ne lui a pas été acquiféfans quelque fondement
; fon amertume, par exemple, annonce affez
bien une vertu fébrifuge, ftomachique, apéritive,
peut-être même legerement emménagogue.La quantité
de fel effentiel ( apparemment nitreux ) qu’elle
contient, & qu’on en retire par le procédé ordinaire
( Foye{ Sel essentiel),, peut la faire regarder encore
comme un bon diurétique, & comme propre
dans les maladies inflammatoires de la poitrine ; ce
font aufii ces vertus que confirme l ’ufage de fon extrait,
qui eft prefque la feule préparation utile employée
parmi nous. L’expérience n’eft pas fi favorable
à l ’ufage de fo'n eau diftillée, que l’on prépare
encore communément dans nos boutiques, & que
quelques médecins ordonnent comme cordiale 6c fu-
dorifique.
L ’eau diftillée du chardon-benit des Parifiens, cnicus
attraclilis, que la plupart des Apoticaires de Paris
préparent à la place de celle - c i , lui eft infiniment
préférable fans doute, puifque cette derniere plante
contient une affez grande quantité de parties mobiles
& aftives qui s’élèvent dans la diftillation avec
fon eau , 8c qui lui donnent des vertus qu’on cher-
cheroit envain dans l’eau diftillée du chardon-benit
ordinaire, qui eft abfolumenf infipide & fans odeur.
Les feuilles de chardon-benit entrent dans la com-
pofition de l’orviétan, dans celle de l’eau de lait
alexitaire, dans l’huile de fcorpion compofée ; les
fommités de cette plante font un des ingrédiens du
decoclum amarum de la pharmacopée de Paris ; fa fer
mence entre dans la poudre arthritique purgative de
la même pharmacopée, dans l’opiate de Salomon,
dans la confection hyacinthe ; fon extrait entre dans
la thériaque célefte, dans les pilules balfamiques de
Stahl, 6c dans celles de Becher. ('b)
C hardon à Bo n n e t ier , dipfacus, genre de
plante dont les fleurs naiffent dans des têtes, fem-
blables en quelque maniéré à des rayons de miel. Les
têtes font compofées de plufieurs feuilles pliées ordinairement
en gouttière, pofées par écailles, & attachées
à un pivot. Il fort des aiffelles de ces feuilles
des fleurons découpés 6c engagés par le bas dans la
couronne des embryons, qui deviennent dans la
fuite des femences ordinairement cannelées. Tour-
nefort, inft. rei herb. Foye^ Plante. ( 7 )
. * Ce chardon eft d’une grande utilité aux manufactures
d’étoffes en laine, Foye{ fur-tout Varticle
D rap ier. Il eft défendu par les réglemens généraux
6c particuliers, d’en fortir du royaume. •,
C hardon é t o il é , ouC hausse- tr a p e , (Hift,
nat. bot.') plante qui doit être rapportée au genre appelle
Amplement chardon. Voye^ C hardon. (/ )
C hardon-ro l l an d , f. m. (Hift. nat. bot.) panicaut
, eryngium, genre de plante à fleurs en rofe ,
difpofées en ombelle, 6c compofées de plusieurs pétales,
rangées en rond, recourbées pour l’ordinaire
vers le centre de la fleur, 6c foûtenues par le calice
qui devient un fruit compofé de deux femences garnies
de feuilles; dans quelques efpeces, plates, 6c
ovales dans d’autres ; quelquefois elles quittent leur
enveloppe, 6c elles reffemblent à des grains de froment.
Ajoûtez au caraCtere de ce genre, qu’il y a
une couronne de feuilles placées à la bafe du bouquet
de fleurs. Tournef. inft. rei herb. Foyer Plante.
c ' ) ’ " ............ ■
CHARDON-ROLLAND, {Matière médicale & Pharmacie.)
La racine de chardon-rolland , qui eft une des
cinq racines apéritives mineures, eft la partie de
cette plante employée en Medecine ; elle eft apériti-,
ve 6c diurétique, incifive, tonique, 6c emménago-
gue ; elle paffe aufli pour legerement aphrodifiaque.
On l’employe fraîche dans les bouillons, les apofe-,
mes, 6c les tifanes apéritives.
La préparation de cette racine confifte à la nettoyer
& à la monder de fa corde, ou de la partie
ligneufe qui fe trouve dans fon milieu, & à en faire
enfuite un condit ou une çonferve. C ’eft fous l’une
de ces deux, formes qu’on la garde dans les boutiques;
parce qu’étant fléchée elle fe gâte très - facilement
, 6c perd ainfi toute fa vertu. Foye^ C o n d it &
, D e s s ic a t io n .
Cette racine entre dans le firop de guimauve compofé
, le decoclum rubrum de la pharmacopée de Paris
; dans les éle&uaires de fatyrium de plufieurs auteurs,
& dans prefque toutes les préparations officinales
propres à réveiller l’appétit vénérien, qui fe
trouvent décrites dans les différens difpenfaires. (Æ)
C hardon, (Architecture & Serrurerie.) ce font des
pointes de fer en forme de dards, qu’on met fur le
haut d’une grille , ou fur le chaperon d’un mur,
pour empêcher de le franchir. (P )
C h a rd o n , ou No t r e -D ame de C h a r d o n ,'
(.Hift. mod.) ordre militaire, inftitué en 1369 par
Louis, II. dit le Bon, troifieme duc de Bourbon. Il
étoit compofé de vingt fix chevaliers fans reproche >
renommés en noblefl'e 6c en valeur, dont le prince
& fe s fucceffeurs dévoient être chefs,pour la défenfe
du pays. Mais il n’eft parié de cet ordre qui s’eft:
anéanti, que dans quelques-unes de nos hiftoires :
c’eft fur quoi on doit voir Favin dans fon théâtre
dlhonneur & de chevalerie, aufli-bien que la Colom-
biere dans un grand ouvrage fous le même titre. ( a)
C h a r d o n , ou Sa in t -André du C h a r d o n , 1
ordre de chevalerie en Ecoffe, qui a ces mots pour
devife : Nemo me impuni làceffet, perfonne ne m’attaquera
impunément. On l’attribue à un roi d’Ecoffe
nommé Anchaius, qui viyoit fur la fin du huitième
fiecle.Mais l’origine de ces fortes d’ordres eft apocryphe,
dès qu’on la fait remonter à ces anciens tems.
Il vaut bien mieux la rapporter au régné de Jacques
I. roi d’Ecoffe, qui commença l’an 1413. Mais fi on
en fait honneur à Jacques IV. en fuivant l’opinion
de quelques auteurs, elle fera de la fin du quinzième
fiecle ; car Jacques IV.ne commença fon régné qu’en
148,8. L’infortuné Jacques VII. d’Ecoffe, ou II.d’An-
gléterre, le voulut remettre en vigueur; mais fon
éclat dura peu, & il fubfifte foiblement. Çe qu’il en
refte de plus confidérable, eft la dévotion des EcofT
fois catholiques qui font ejn petit nombre, pour;l’apôtre
faint André, qui eft peu fêté par les prétendus
Réformés, dont la religion eft la dominante d’E*
icoffe, qui de royaume eft devenue province d’Angleterre
en 1707. (a)
* CHARDONNER ou LAINER, (Manuf.) c^eft
tirer l’étoffe au chardon. Cette opération n’a lieii
qu’aux ouvrages en laine. Foye^ en qiioi elle confifte
à l’article Drap.
CHARDONNERET, f. m. carduelis, (Hift. nat.
Ornithol. ) oifeau plus petit que le moineau aomef-
tique ; il pefe une once & demie; il a environ cinq
pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu’à
l’extrémité de la queue ; l’envergure eft d’environ
neuf pouces ; la tête eft affez groffe à proportion du
refte du corps. Le cou eft court, le bec eft blanchâtre
, à l’exception de la pointe qui eft noire dans
quelques oifeaux de ce genre. Il eft court, il n’a
guere qu’un demi-pouce de longueur ; il eft épais à
fa racine 6c terminé en pointe, 6c fait en forme de
cône. La langue eft pointue, l’iris des yeux eft de
couleur de noifette ; la bafe du bec eft entourée d’une
belle couleur d’écarlate, à l’exception d’une marque
noire qui s’étend de chaque côté depuis l’oeil
jufqu’au bec. Les côtés de la tête font blancs; le def-
fus eft noir, 6c le derrière eft blanc ; il y a une large
bande noire qui defcend de chaque côté, depuis le
fommet de la tête jufqu’au cou , & qui fe trouve entre
le blanc du derrière de la tête 6c celui des côtés.
Le cou 6c le dos font d’une couleur rouffe-cendrée ;
le croupion, la poitrine, 6c les côtés font d’une couleur
rouffe moins foncée. Le ventre eft blanc. Il y
a dans chaque aîle dix-huit grandes plumes qui font
noires, & qui ont toutes la pointe blanchâtre, à l’exception
de la première qui eft entièrement noire.
L ’aîle eft traverfée par une bande d’une belle couleur
jaune : cette bancje eft formée par les barbes extérieures
de chaque plume, qui font d’un beau jaune
depuis la bafe jufqu’à leur milieu, à l’exception de
la première plume que nous avons dit être entièrement
noire, 6c des deux dernieres, dont les bords
extérieurs font noirs comme.les bords intérieurs.
Toutes les petites plumes de l’aîle qui recouvrent les
grandes, font noires, à l’exception des dernieres du
premier rang qui font jaunes. La queue eft compofée
de douze plumes noires avec des taches blanches.
Les deux plumes extérieures de chaque côté ont
une large marque blanche un peu au - deffous de la
pointe au côté intérieur; les autres ont feulement la
pointe blanche. Les pattes de cet oifeau font courtes
; le doigt de derrière eft fort & garni d’un ongle
plus long que ceux des autres doigts. L’extérieur
tient à celui du milieu à fa naiffance. On diftingue
la femelle par fa v o ix , qui eft moins forte que celle
du mâle, par fon chant qui ne dure pas fi long-tems,
& par les plumes qui couvrent la côte de l’aîle, qui
font cendrées ou brunes ; au lieu que ces mêmes plumes
font d’un beau noir dans le mâle. Aldrovande
donne cette marque comme la plus sure 6c la plus
confiante pour diftinguer le fexe de cet oifeau.
Les chardonnerets vont en troupe, & vivent plufieurs
enfemble. On en fait cas pour la beauté des
couleurs de leurs plumes, 6c furtout pour leur chant
qui eft fort agréable. Cet oifeau n’eft point farouche.
Au moment qu’il vient de perdre fa liberté ; ilimange
6c il boit tranquillement. Il ne fait point de vains efforts
comme la plupart des autres oifeaux, pour for-
tir de fa cage ; au contraire il y en a qui ne veulent
plus en fortir , lorfqu’ils y ont été long-tems. Cet oifeau
fe nourrit pendant l’hy ver de femences de chardon
; c’eft de-là qu’eft venu fon nom. Il mange aufli
les graines du chardon à Bonnetier, du chanvre, de
la bardane, du pavot, de la rue, 6*c. Il niche dans
les épines 6c fur les arbres. La femelle fa it , félon
Gefner, fept oeufs ; 6c félon Belon, huit. Aldrovande
fait mention des variations qui fe trouvent quelquefois
dans les couleurs de cet oifeau, 6c qui viennent
de l’âge ou dit fexe, où qui font caufées par d’autres
accidens. Les jeunes chardonnerets n’ont point de rouge
fur la tête. Il y en a qui ont les cils blancs.^On en
a vît qui étoient blancs, & qui avoient la tête rouge
; 6c d’autres qui étoient blanchâtres,& qui avoient
un peu de rouge fur le devant de la tête 6c à l’endroit
du menton. "Willughby, Ornith. Foyei O iseau, (ƒ)
CHARENÇON, f m, curculio, (Hift. nat.) petit
infe&e auquel on a aufli donné les noms de calendre
& de chatepeleufe. M. Linnæus le met dans la claffe
des infe&es qui ont de fauffes ailes, 6c dont la bouche
éft formée par des mâchoires : c’eft un fearabé
qui vient d’un ver ; il a la bouche 6c le gofier fort
grands ; c’eft pourquoi on l’a nommé curculio ou gur-
gulio, 8c lorfqu’il eft fous la forme d’un v e r , 6c lorf-
qu’il eft parvenu à celle de fearabé ; il ronge le froment
& les feves. Foye^In se c te . (/ )
CHARENTE, ( la) Géog. rivière de France qui
prend fa fource dans le Limofin, & fe jette dans l’Océan
vis-à-vis l’île d’Oleron.
* C H A R G E , FARDEAU , POIDS, FA IX ,
fynon. (Gram. ) termes qui font tous relatifs à l’im-
preflion des corps fur nous, 6c à l’aftion oppofée de
nos forces fur eux, foit pour foûtenir, foit pour vaincre
leur pefanteur. S’il y a une compenfation bien
faite entre la pefanteur de la charge 6c la force du
corps, on n’eft ni trop ni trop peu chargé: fi la charge
eft grande, 6c qu’elle employé toutes les forces dit
corps ; fi l’on y fait encore entrer l’idée effrayante
du volume, on aura celle du fardeau : fi le fardeau
excede les forces & qu’on y fuccombe, on rendra
cette circonftance par faix. Le poids a moins de rapport
à l’emploi’des forces, qu’à la comparaifon des
corps entre eux 6c à dévaluation que nous faifons ou
que nous avons faite de leur pefanteur par plufieurs
applications de nos forces à d’autres corps. On dira
donc : i l en a Ja charge : fon fardeau eft gros & lourd ;
i l fera accablé fous le fa ix ; i l ne faut pas eftimer cette
marcliandife au poids.
Le mot charge a été tranfporté de fout ce qui don-
noit lieu à l’exercice des forces du corps, à tout ce
qui donne lieu à l’exercice des facultés de dame.
Fyye{ dans la fuite de cet article différentes acceptions
de ce terme , tant au fimple qu’au figuré. L e mot charge
dans l’un & l’autre cas, emporte prefque toujours
avec lui l’idée de contrainte.
C harge , f. f. (Jurifprud.) ce terme a dans cette
matière plufieurs acceptions différentes ; il lignifie
en général tout ce qui eft dû fur une chofe mobi-
liaire ou immobiliaire , 011 fur une maffe de biens ;
quelquefois il fignifie condition ,fervitude , dommage ,
ou incommodité : c’eft en ce dernier fens qu’on dit
communément,-qu’il faut prendre le bénénee avec
les charges : quem fequuntur commoda, debent fequi &
incommoda. Charge fe prend aufli quelquefois pour une
fonéiioh publique 6c pour un titre d’office. ( A )
* Avant que de paffer aux différens articles qui naiffent
de ces diftinéHons, nous allons expofer en peu de
mots le fentiment de l’auteur de l’elprit des lois, fur la
vénalité des charges, prifes dans le dernier fens de la di-
vifion qui précédé. L’illuftre auteur que nous venons
de citer, obferve d’abord que Platon ne peut fouf-
frir cette vénalité dans fa république : « c’eft, dit ce.
» fage de l’antiquité, comme fi dans un vaiffeau on
» faifoit quelqu’un pilote pour fon argent : feroit-il
» poflible que la réglé fût mauvaife dans quelqne em-
>t ploi que ce fût de la v ie , 6c bonne feulement pour
» conduire une république » ? z°. II prétend que les
charges ne doivent point être vénales dans un état
defpotique : il femble qu’il faudroit diftinguer entre
un état où l’on fe propofe d’établir le defpotifme, &
un état où le defpotifme eft tout établi. Il eft évident
que la vénalité des charges feroit contraire aux vûes
d’unfouverainquitendrpitàlatyrannie ; mais qu’im