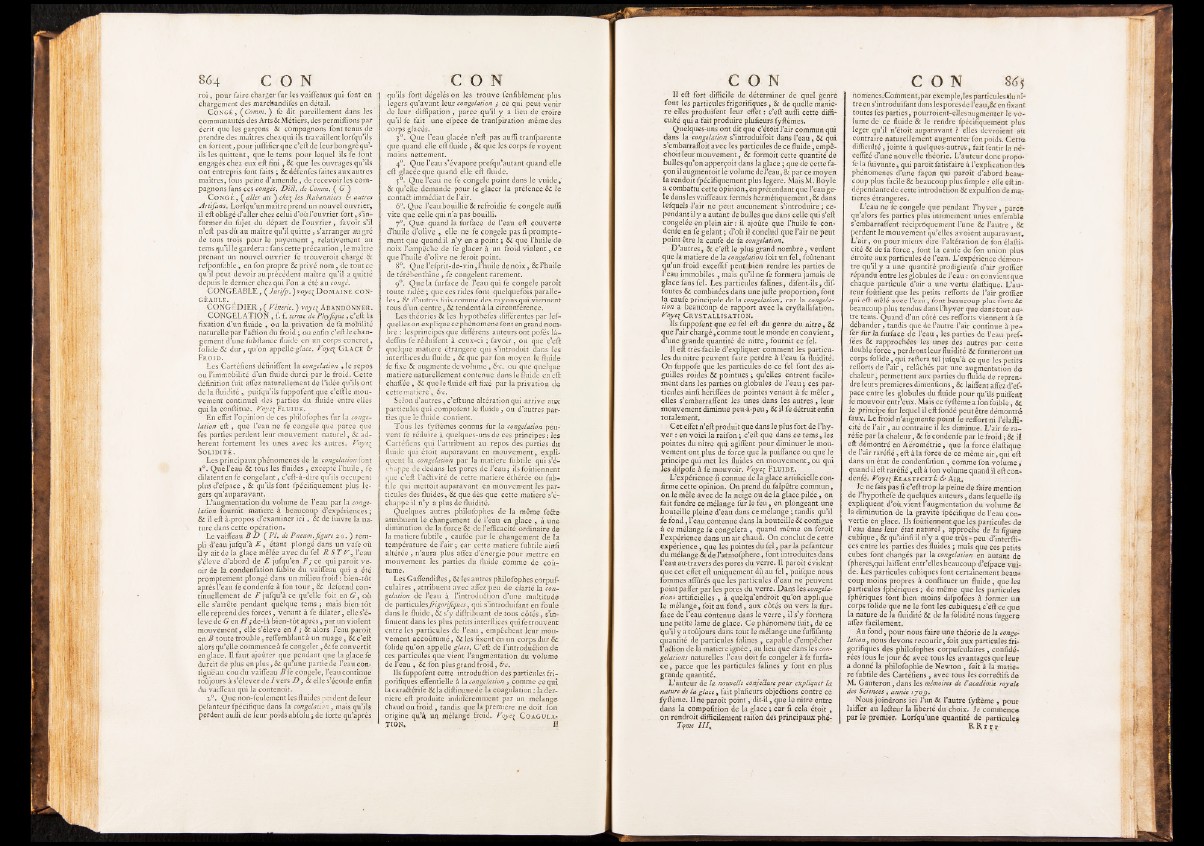
ro i, pour faire charger fur les vaiffeaux qui font en
chargement des marchandifes en détail.
C onge, (Comm. ) fe dit pareillement dans les
communautés des Arts & Métiers, des permiflions par
écrit que les garçons & compagnons font tenus de
prendre des .maîtres chez qui ils travaillent lorfqu’ils
en fortent, pour juftifier que c’eft de leur hon gre qu’ils
les quittent, que le tems pour lequel ils fe font
engagés chez eux eft fini , 6c que les ouvrages qu’ils
ont entrepris font faits ; 6c dérenfes faites aux autres
maîtres, fous peine d’amende, de recevoir les compagnons
fans ces conges. Dict. de Comm. ( G ) C O N G É , ( aller au ) che%_ les Rubanniers & autres
Aitifans. Lorfqu’un maître prend un nouvel ouvrier,
il eft obligé d’aller chez celui d’oit l’ouvrier fort, s’informer
du fujet du départ de l’ouvrier, favoir s’il
n’eft pas dû au maître qu’il quitte, s’arranger au gré
de tous trois pour le payement , relativement au
tems qu’il le gardera : fans cette précaution ,1e maître
prenant un nouvel ouvrier fe trouveroit chargé &
refponfable, en fon propre 6c privé nom, de tout ce
qu’il peut devoir au précédent maître qu’il a quitté
depuis le dernier chez qui l’on a été au conge.
CONGÉABLE, (Jurifp.)voyeiD omaine congé
able.
CONGÉDIER, ( Vénerie. ) voyei Abandonner.
CONGELATION, f. f. terme de Phyjîque, c’eft la
fixation d’un fluide , ou la privation de fa mobilité
naturelle par l’a&ion du froid ; ou enfin c’eft le changement
d’une fubftance fluide en un corps concret,
folide 6c dur, qu’on appelle- glace. Vsyeç G LACE &
Froid.
Les Cartéfiens définiffent la congélation , le repos
ou l’immobilité d’un fluide durci par le froid. Cette
définition fuit affez naturellement de l’idée qu’ils ont
delà fluidité , puifqu’ils fuppofent que c’eft le mouvement
continuel des parties du fluide entre elles
qui la conftitue. Voye^ Fluide.
En effet l’opinion de ces philofophes fur la congélation
eft , que l’eau ne fe congele que parce que
fes parties perdent leur mouvement naturel, 6c adhèrent
fortement les unes avec les autres. Voye^
Solidité.
Les principaux phénomènes de- la congélation font
i° . Que l’eau 6c tous les fluides , excepté l’huile, fe
dilatentenfe congelant, c’eft-à-dire qu’ils occupent
plus d’efpace , & qu’ils font fpécifiquement plus légers
qu’auparavant.
L’augmentation du volume de l’eau par la congélation
fournit matière à beaucoup d’expériences ;
6c il eft à-propos d’examiner ici , & de fuivre la nature
dans cette opération.
Le vaiffeau B D (PI. de Pneum.figure zo . ) rempli
d’eau jufqu’à E , étant plongé dans un vafe oit
il y ait de la glace mêlée avec du fel R S T V , l’eau
s’élève d’abord de E jufqu’en F ; ce qui paroît venir
de la condenfation fubite du vaiffeau qui a été
promptement plongé dans un milieu froid : bien-tôt
après l’eau fe condenfe à fon tou r, & defeend continuellement
de F1 jufqu’à ce qu’elle foit en G , où
elle s’arrête pendant quelque tems ; mais bien tôt
elle reprend des forces, venant à fe dilater, elle s’élève
de G en H ; de-là bien-tôt après, par un violent
mouvement, elle s’élève en / ; & alors l’eau paroît
en B toute trouble, reffemblant à un nuage, 6c c’eft
alors qu’elle commence à fe congeler, & fe convertit
en glace. Il faut ajoûter que pendant que la glace fe
durcit de plus en plus, & qu’une partie de l’eau contiguë
au cou du vaiffeau B fe congele, l’eau continue
toujours à s’élever de ƒ vers D , & elle s’écoule enfin
du vaiffeau qui la contenoit.
z°. Que non-feulement les fluides perdent de leur
pefanteur fpécifique dans la congélation, mais qu’ils
perdent aufli de leur poids abfolu ; de forte qu’après
qu’ils font dégelés on les trouve fenfiblement plus
légers qu’avant leur congélation ,• ce qui peut venir
de leur diflipation, parce qu’il y a lieu de croire
qu’il fe fait une efpece de tranfpiration même des
côrps glacés.
3°. Que l’eau glacée n’eft pas aufli tranfparente
que quand elle eft fluide , 6c que les corps fe voyent
moins nettement.
4°. Que l’eau s’évapore prefqu’autant quand elle
eft glacée que quand elle eft fluide.
5°. Que l’eau ne fe congele point dans le vuide,'
& qu’elle demande pour fe glacer la préfence & le
contaél immédiat de l’air.
6°. Que l’eau bouillie & refroidie fe congele aufli
vîte que celle qui n’a pas 'bouilli.
7°. Que quand la furface de l’eau eft couverte
d’huile d’olive , elle ne fe congele pas fi promptement
que quand il n’y en a point ; 6c que l’huile de
noix l’empêche de fe glacer à un froid violent, ce
que l’huile d’olive ne reroit point.
8°. Que l’efprit-de-vin, l ’huile de noix, 6c l’huile
de térébenthine, fe congèlent rarement.
9°. Que la furface de l’eau qui fe congele paroît
toute ridée ; que ces rides font quelquefois parallèles
, 6c d’autres fois comme des rayons qui viennent
tous d’un centre, & tendent à la circonférence.
Les théories & les hypothefes différentes par lesquelles
on explique ce phénomène font en grand nombre
: les principes que différens auteurs ont pofés là-
defliis fe réduifent à ceux-ci ; favoir, ou que c’eft
quelque matière étrangère qui s’introduit dans les
interftices du fluide , 6c que par fon moyen le fluide
fe fixe & augmente de volume, &c. ou que quelque
matière naturellement contenue dans le fluide en eft
chaffée, 6c que le fluide eft fixé par la privation de
cette matière, &c.
Selon d’autres , c’eft une altération qui arrive, aux
particules qui compofent le fluide , ou d’autres parties
que le fluide contient.
Tous les fyftèmes connus fur la congélation peuvent
fe réduire à quelques-uns de ces principes : les
Cartéfiens qui l’attribuent au repos des parties du
fluide qui étoit auparavant en mouvement, expliquent
la congélation par la matière fubtile qui s’échappe
de dedans les pores de l’eau ; ils foûtiennent
que c’eft l’aélivité de cette matière éthérée ou fubtile
qui mettoit auparavant en mouvement les particules
des fluides, 6c que dès que çette matière s’é-,
chappe il n’y a plus de fluidité.
Quelques autres philofophes de la même feûe
attribuent le changement de l’eau en glace , à une
diminution de la force & de l’efficacité ordinaire de
la matière fubtile , caufée par le changement de la
température de l’air ; car cette matière fubtile ainfi
altérée , n’aura plus affez d’énergie pour mettre en
mouvement les parties du fluide comme de coutume.
Les Gaffendiftes, 6c les autres philofophes corpuf-
culaires , attribuent avec affez peu de clarté la congélation
de l’eau à l’introdu&ion d’une multitude
de particules frigorifiques, qui s’introduifant en foule
dans le fluide, 6c s’y diftribuant de tous côtés, s’in-
finuent dans les plus petits interftices quife trouvent
entre les particules de l’eau , empêchent leur mouvement
accoutumé, 6c les fixent en un corps dur &
folide qu’on appelle glace. C ’eft de l’introduélion de
ces particules que vient l’augmentation du volume
de l’eau , 6c fon plus grand froid, &c.
Ils fuppofent cette introdufrion des particules frigorifiques
effentielle à la congélation , comme ce qui
lacaraâérife & la diftinguede la coagulation :1adernière
eft produite indifféremment par un mélange
chaud ou froid, tandis que la première ne doit fon
origine qu’à, un mélange froid. Voye^ C oagulat
io n , il
11 eft fort difficile de déterminer de quel genre
font les particules frigorifiques, & de quelle maniéré
elles produifent leur effet : c’eft aufli cette difficulté
qui a fait produire plufieurs fyftèmes.
Quelques-uns ont dit que c’étôit l’air commun qui
dans la congélation s’introduifoit dans l’eau, 6c qui
s’embarraffoit avec les particules de ce fluide, empê-
choit leur mouvement, 6c formoit cette quantité de
bulles qu’on apperçoit dans la glace ; que de cette façon
il augmentoit le volume de l’eau, & par ce moyen
la rendoit fpécifiquement plus legere. Mais M. Boy le
a combattu cette opinion, en prétendant que l’eau ge-
le dans les vaiffeaux fermés hermétiquement ,& dans
lefquels l’air ne peut aucunement s’introduire ; ce*-
pendant il y a autant d‘e bulles que dans celle qui s’eft
■ congelée en plein air : il ajoûte que l’huile le con-
denfe en fe gelant ; d’où il conclud que l’air ne peut
point être la caufe de fa congélation.
D ’autres, & c ’eft le plus grand nombre, veulent
que la matière de la congélation foit un fel, foûtenant
qu’un froid exceflîf peut bien rendre les parties de
l’eau immobiles , màis qu’il ne fe formera jamais de
glace fans fel. Les particules falines, difent-ils, dif-
foutes 6c combinées dans une jufte proportion, font
la caufe principale de la congélation, car la congélation
a beaucoup de rapport avec la cryftallifation.
Voye^ Crystallisation.
Ils fuppofent que ce fel eft du genre du nitre, &
que l’air chargé, comme tout le monde en convient,
d’une grande quantité de nitre, fournit ce fel.
Il eft très-facile d’expliquer comment les particules
du nitre peuvent faire perdre à l’eau fa fluidité.
On fuppofe que les particules de ce fel font des aiguilles
roides & pointues ; qu’elles entrent facilement
dans les parties ou globules de l’eau ; ces particules
ainfi hériffées de pointes venant à fe mêler,
elles s’embarraffent les unes dans les autres , leur
mouvement diminue peu-à-peu, & il fe détruit enfin
totalement.
Cet effet n’eft produit que dans le plus fort de l’hy-
v er : en voici la raifon ; c’eft que dans ce tems, les
pointes du nitre qui agiffent pour diminuer le mouvement
ont plus de force que la puiffance ou que le
principe qui met les fluides en mouvement, ou qui
les difpofe à fe mouvoir. Voye^ Fluide.
L’expérience fi connue de la glace artificielle confirme
cette opinion. On prend du falpêtre commun,
on le mêle avec de la neige ou de la glace p ilée, on
fait fondre ce mélange fur le feu , en plongeant une
bouteille pleine d’eau dans ce mélange ; tandis qu’il
fe fond, l’eau contenue dans la bouteille 6c contiguë
à ce mélange fe congèlera , quand même on feroit
l ’expérience dans un air chaud. On conclut de cette
expérience, que les pointes du fe l, par la pefanteur
du mélange & de l’atmofphere, font introduites dans
l’eau au-travers des pores du verre. Il paroît évident
que cet effet eft uniquement dû au fe l, puifque nous
fommes affûrés que les particules d’eau ne peuvent
point paffer par les pores du verre. Dans les congélations
artificielles , à quelqu’endroit qu’on applique
le mélange, foit au fond, aux côtés ou vers la fur-
face de l’eau contenue dans le v erre, ils ’y formera
une petite lame de glace. Ce phénomène fuit, de ce
qu’il y a toûjours dans tout le mélange une fuffifante
quantité de particules falines , capable d’empêcher
l ’aftion de la matière ignée, au lieu que dans les congélations
naturelles l’eau doit fè congeler à fa furface
, parce que les particules falines y font en plus
grande quantité.
L’auteur de la nouvelle conjecture pour expliquet la
nature de la glace, fait plufieurs objeélions contre'ce
fyftème. Ilne paroît point, dit-il, que le nitre entre
dans la compofition de la glace ; car fi cela é to it ,
on rendroit difficilement raifon des principaux phé-
Tçme I I I s
nomërtes.Comment,par exemple,les particuîestlu nitre
en s’introduifant dans les pores de l’eau ,& en fixa n£
toutes fes parties, pourroient-ellesaugmenter le volume
de ce fluide & le rendre fpécifiquement plus
léger qu’il n’étoit auparavant ? elles devraient au
contraire naturellement augmenter fon poids. Cette
difficulté, jointe à quelques-autres, fait fentir la né-
ceflité d’une nouvelle théorie. L’auteur donc propose
la fuivante, qui paroît fatisfaire à l’explication des
phénomènes d’une façon qui paroît d’abord beaucoup
plus facile 6c beaucoup plus fimple : elle eft indépendante
de cette introduction 6c expulfion de matières
étrangères.
L’eau ne fe congele que pendant l’hy v er , parce
qu’alors fes parties plus intimement unies enfemble
s’embarraffent réciproquement l’une 6c l’autre , 6c
perdent le mouvement qu’elles avoient auparavant.
L’air, ou pour mieux dire l’altération de ion élafti-
cité 6c de fa force, font la caufe de fon union plus
étroite aux particules de l’eau. L’expérience démontre
qu’il y a une quantité prodigieufe d’air groffiet
répandu entre les globules de l’eau : on convient que
chaque particule d’air a une vertu élaftique. L’auteur
foûtient que les petits refforts de l’air groffier
qui eft mêlé avec l ’eau, font beaucoup plus forts 6c
beaucoup plus tendus dans l’hy ver que dans tout autre
tems. Quand d’un côté ces refforts viennent à fe
débander , tandis que de l’autre l’air continue à peler
fur la furface de l’eau , les parties de l’eau pref-
fées 6c rapprochées les unes des autres par cette
double force, perdront leur fluidité & formeront un
corps folide, qui reliera tel jufqu’à ce que les petits
refîorts de l’a ir , relâchés par une augmentation de
chaleur, permettent aux parties du fluide de reprendre
leurs premières dimertfions, 6c laiffent affez d’efpace
entre les globules du fluide pour qu’ils puiffent
fie mouvoir entr’eux. Mais ce fyftème a fon foible, &
le principe fur lequel il eft fondé peut être démontré
faux. Le froid n’augmente point le reffort ni l’élafti-
cité de l’a ir , au contraire il les diminue. L’air fe raréfie
par la chaleur, & fe condenfe par le froid ; 6c il
eft démontré en Aërométrie, que la force élaftique
de l’air raréfié, eft à la force de ce même air, qui eft
dans un état de condenfation , comme fon volume %
quand il eft raréfié, eft à fon volume quand il eft con-,
denfé. Voyez Élasticité & Air.
Jë ne fais pas fi c’eft trop la peine de faire mention
de l’hypothefé de quelques auteurs, dans lequelle ils
expliquent d’où^vient l’augmentation du volume 6c
la diminution de la gravité fpécifique de l’eau convertie
en glace. Ils foûtiennent que les particules de
l’eau dans leur état naturel, approche de la figure
cubique, & qu’ainfi il n’y a que très - peu d’interlK-
ces entre les parties des fluides ; mais que ces petits
cubes font changés par la congélation en autant de
fpheres,qui laiffent entr’elles beaucoup d’efpace vui-
de. Les particules cubiques font certainement beau**
coup moins propres à conftituer un fluide, que les
particules fphériques ; de même que les particules
lphériques font bien moins difpofées à former un
corps folide que ne le font les cubiques; c’eft ce que
la nature de la fluidité 6c de la folidité nous fuggere
affez facilement.
Au fond, pour nous faire une théorie de la congélation
, nous devons recourir, foit aux particules frigorifiques
des philofophes corpufculaires, confidé-
rées fous le jour & avec tous les avantages que leur
a donné la philofophie de Newton , foit à la matière
fubtile des Cartéfiens , avec tous les corre&ifs de
M. Gauteron, dans les mémoires de l'académie royale
des Sciences , année tyog.
Nous joindrons ici l’un & l’autre fyftème , pour
laiffer au lefteur la liberté du choix. Je commence
par le premier. Lorfqu’une quantité de particules
R R r tt_