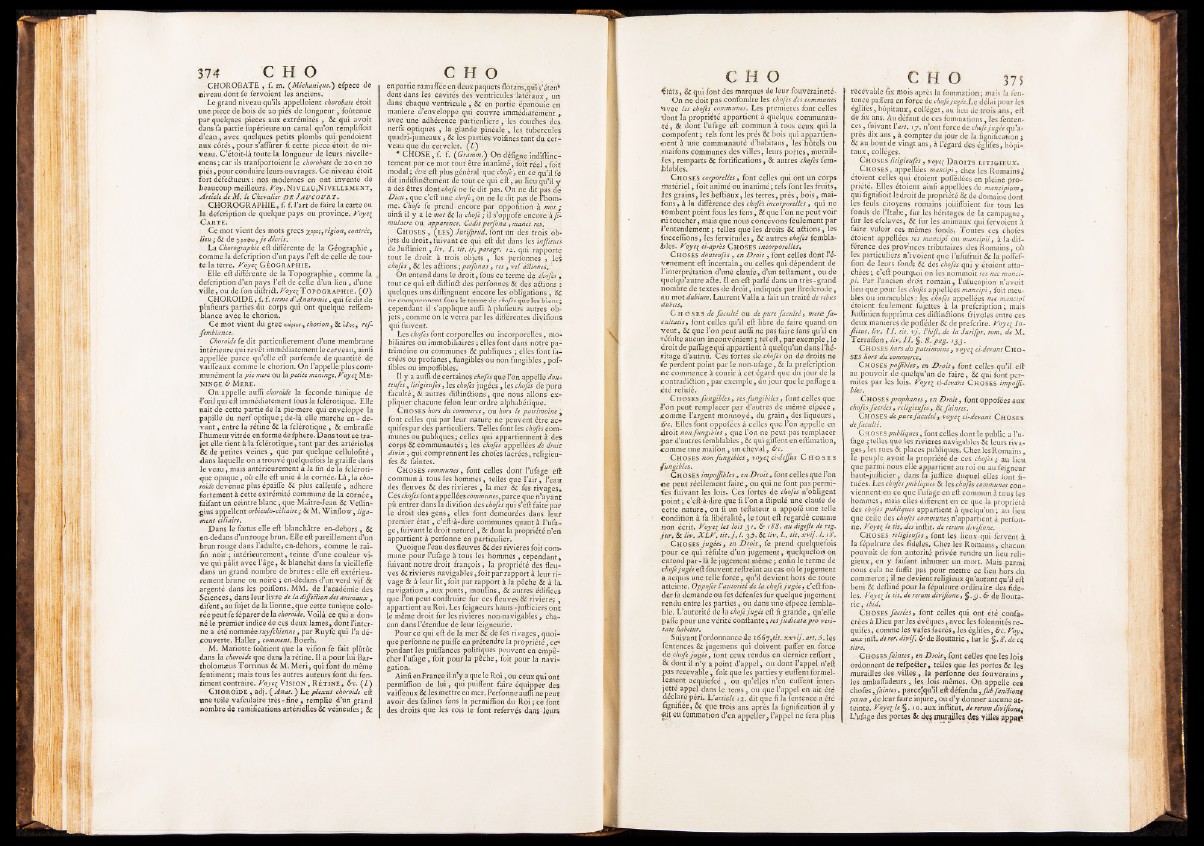
CHOROBATE , f. m. (Méchanique.) efpece de
«iveau dont fe fervoient les anciens.
Le grand niveau qu’ils appelloient chorobate étoit
une piece de bois de zo piés de longueur, foutenue
par quelques pièces aux extrémités , 8c qui avoit
dans fa partie fupérieure un canal qu’on rempliffoit
d ’eàu., avec quelques petits plombs qui pendoient
aux côtés, pour s’aflurer li cette piece étoit de ni-?
veau.. C ’étoit-là toute la longueur de leurs nivelle-
«nens ; car ils tranfportoient le chorobate de zo en zo
piés, pour conduire leurs ouvrages. Ce niveau étoit
fort défeûueux : nos modernes en ont inventé de
beaucoup meilleurs. Voy. Ni v e au ,Nivellement,
Article de M. le Chevalier DE JAU COURT.
CHOROGRAPHIE, f. f. l’art de faire la carte ou
la defeription de quelque pays ou province. Voye^
C a r t e .
Ce mot vient des mots grecs x°P°b région, contrée,
lieu ^ 8c de ypa.<ça>, je décris; . ,
La Chorographie eft différente de la Géographie ,
tomme la defeription d’un pays l’eft dé celle de toute
la terre. Voye^ G éo g ra ph ie.
- Elle eft différente de la Topographie, comme la
defeription d’un pays l’eft de celle d’un lieu, d’une
v ille , ou de fon diftrift. /^qycçToPOGRAPHiE. (O)
CHOROÏDE, f .f . terme d'Anatomie, qui fe dit de
plufieurs parties du corps qui ont quelque reffem-
blance avèc le chorion.
Ce mot vient du grec nùpiov, chorion, & ilNoç, ref-
femblance.
Choroïde fe dit particulièrement d’une membrane
intérieure qui revêt immédiatement le cerveau, ainfi
appellée parce qu’elle eft parfemée de quantité de
vaiffeaux comme le chorion. On l ’appelle plus communément
la pie-mere ou la petite méningé. Voyeç MENINGE
6* Mere.
On appelle auffi choroïde la fécondé tunique de
l ’oeil qui eft immédiatement fous la felérotique. Elle
naît de cette partie de la pie-mere qui enveloppe la
papille du nerf optique ; de-là elle marche en - devant
, entre la rétine 8c la felérotique , & embraffe
l’humeur vitrée en forme de fphere. Dans tout ce trajet
elle tient à la felérotique, tant par des artérioles
8c de petites veines , que par quelque cellulofité ,
dans laquelle on a trouvé quelquefois la graiffe dans
le veau, mais antérieurement à la fin de la felérotique
opaque, où elle eft unie à la cornée. L à ,la choroïde
devenue plus épaiffe 8c plus calleufe, adhéré
fortement à cette extrémité commune de la cornée,
faifant un ceintre blanc, que Maître-Jean 8c Veflin-
igius appellent orbiculo- ciliaire ; & M. "Winflow, ligament
ciliaire.
Dans le foetus elle eft blanchâtre en-dehors , &
en-dedans d’uni rouge brun. Elle eft pareillement d’un
brun rouge dans l’adulte, en-dehors, comme le rai-
fin noir ; intérieurement, teinte d’une couleur viv
e qui pâlit avec l’âge, & blanchit dans la vieilleffe
dans un grand nombre de brutes : elle eft extérieurement
brune ou noire ; en-dedans d’un verd v i f &
argenté dans les poiffons. MM. de l’académie des
Sciences, dans leur livre de la diffeclion des animaux ,
difent, au fujet de la lionne,que cette tunique colorée
peut fe féparer de la choroïde. Voilà ce qui a donné
le premier indice de ces deux lames, dont l’interne
a été nommée ruyfchienne, par Ruyfc qui l’a découverte.
Haller, comment. Boerh.
M. Mariotte foûtient que la vifion fe fait plutôt
dans la choroïde que dans la rétine. Il a pour lui Bar-
tholomæus Tornnus 8c M. M eri, qui font du même
fentiment; mais tous les autres auteurs font du fen-
îimentcontraire. Voye[ Vis io n , Ré t in e , & c. (L)
C horoïde , adj. ( Anat. ) Le plexus choroïde eft ,
une toile vafculaire très - fine , remplie d’un grand
nombre de ramifications artérielles 8c veineufes ; 8c
en partie ramaffée en deux paquets flotaris^qùï s’éten*
dent dans les cavités des ventricules ‘latéraux, un
dans chaque ventricule , 8c en partie épanouie en
maniéré d’enveloppe qui couvre immédiatement
avec une adhérence particulière, les couches des
nerfs optiques , la glande pinéale , lès tubercules
quadri-jumeaux , 8c les parties voifines tant du cerveau
que du cervelet. (L)
* CHOSE, f. f. (Gramm.y On défighe indiftinc-
tement par ce mot tout être inanimé,Toit réel | foit
modal ; être eft plus général quê chofe, ën ce qu’il fe
dit indiftinftement de tout cë qui e ft , au lieu qu’il y
a des êtres dont;chofene fe dit pas. On né dit pas de
Dieu, que c’eft une chofe; on ne le dit pas de l’honv»
me. Chofe fe prend encore par oppontion à mot.;
ainfi il y a le mot & la chofe ; il s’oppofe encore â fi-
mulacre ou apparence. Càdit perfona, nïanet res.
CHOSES;, ( les) Jurijpriid. font un des trois"6b<-
jets du d roit, fuivant ce qui eft dit dans les infiituts
de Juftinien , liv. I . tit. ij.paragr; iz . qui rapporte
tout le droit à trois objets , les perfonnes , des
chofes, & les a étions; perfonas , res , velàcliones;'
On entend dans le droit, fous ce terme de chofes ,
tout ce qui eft diftiiift des perfonnës & des aétions î
quelques uns diftinguent encore les obligations , 8t
ne comprennent fous le terme de chofes que les biens;
cependant il s’applique auffi à plufieurs autres objets
, comme on le verra par les différentes divifion».
qui fuivent.
Les chofes font corporelles ou incorporelles, mo-
biliaires ou immobiliaires ; elles font dans notre patrimoine
ou communes 8c publiques ; elles font facrées
ou profanes, ftingibles ou non fungibles, pof-
fibles ou impoffibles.
Il y a auffi de certaines chofes que l’on appelle dou-
teufes, litigieufes, les chofes jugées , les.chofes de pure
faculté, & autres diftinétions, que nous allons expliquer
chacune félon leur ordre alphabétique.
CHOSES hors du commerce, ou hors le patrimoine ;
font celles qui par leur nature ne peuvent être ac*
quifes par des particuliers. Telles font les chofes communes
ou publiques ; celles qui appartiennent à des
corps & communautés ; les chofes appellées de droit
divin, qui comprennent les chofes facrées, religieu-
fes & faintes.
C hoses communes, font celles dont I’ufage eft
commun à tous les hommes, telles que l’a ir , l’eau
des fleuves 8c des rivières , la mer 8c fes rivages;
Ces chofes font appellées communes^ parce que n’ayant
pû entrer dans la divifion des chofes qui s’eft faite par
le droit des gens, elles font demeurées dans leur
premier é ta t , c’eft-à-dire communes quant à l ’ufa-
ge, fuivant le droit naturel, & dont la propriété n’eri
appartient à perfonne en particulier.
Quoique l’eau des fleuves 8c des rivières foit commune
pour l’ufage à tous les hommes , cependant,
fuivant notre droit françois, la propriété des fleuves
8c rivières navigables, foit par rapport à leur rif
vage & à leur l it , foit par rapport à la pêche & à la
navigation , aux ponts, moulins, & autres édifices
que l’on peut conftruire fur ces fleuves & rivières ,
appartient au Roi. Les feigneurs hauts - jufticiers ont
le même droit fur les rivières non-navigables , chacun
dans l’étendue de leur feigneurie.
Pour ce qui eft de la mer 8c de fes rivages, quoique
perfonne ne puiffe en prétendre la propriété, ce^
pendant les puiffances politiques peuvent en empêcher
l’ufage, foit pour la pêche, foit pour la navigation.
Ainfi en France il n’y a que le R o i, ou ceux qui ont
permiffion de lu i , qui puiffent faire équipper des
vaiffeaux 8c les mettre en mer. Perfonne auffi ne peut
avoir des falines fans la permiffion du Roi ; ce font
des droits que les rois fe font refervés dans leurs
^êtàïs, 8c tjuî font des marques de leur fouVôraineté.
On ne doit pas confondre les chofes des communes
‘avec les chofes communes. Les premières font celles
•dont la propriété appartient à quelque communauté
5 & dont l’ufage eft commun à tous ceux qui la
.tompofent ; tels font les prés & bois qui appartien-
aicnt à une communauté d’habitans, IeSnôteT$ ou
^naifons communes des villes, leurs portes, muraille
s , remparts 8c fortifications, & autres chofes fem-
blables.
C hoses corporelles -, font celles qui ont urt corps
matériel, foit animé ou inanimé ; tels font les fruits,
Jes grains, les beftiaux, les terres, prés, b ois, mai-
fons, à la différence des chofes incorporelles , qui ne
tombent point fous les fens, Si que l’on ne peut voir
ni toucher, mais que nous concevons feulement par
l’entendement ; telles que les droits 8c aftions, les
fucceffions, les fervitudes, 8c autres chofes fembla-
i>les. Voye^ ci-après C hoses incorporelles.
C hoses douteufes -, en Droit, font celles dont l’é-
venement eft incertain, bu celles qui dépendent de
l ’interprétation d’une claufe, d’un teftament , ou de
quelqu’autre a£e. Il en eft parlé dans un très-grand
nombre de textes de droit, indiqués par Brederode,
au mot dubium. Laurent Valla a fait un traité de rebus
dubiis-.
C h o s e s de faculté Ou de pure faculté , tneroe fit*
cultatis, font celles qu’il eft libre de faire quand on
v eu t, & que l’on peut auffi ne pas faire fans qu’il en
réfulte aucun inconvénient ; tel eft, par exemple, le
droit de paffage qui appartient à quelqu’un dans l’héritage
d’autrui. Ces fortes de chofes ou de droits ne
fe perdent point par le non-ufage, & la prefeription
ne commence à courir à cet égard que du jour de la
jcontradi&ion, par exemple, du jour que le paffage a
été refufé.
C h oses fungibles , res fungibiles , font celles que
Ton peut remplacer par d’autres de même efpece ,
jcomme l’argent monnoyé, du grain, des liqueurs,
&c. Elles font oppofées à celles que l’on appelle en
.droit nonfungibles, que l’on ne peut pas remplacer
par d’autres femblables, 8c qui giflent en eftimation,
•comme une maifon, un.cheval, &c.
C hoses non fungibles , voyez ci-deffus CH OSE S
fungibles.
CHOSES impoffibles, en Droit, font celles que l’on
c e peut réellement faire, ou qui ne font pas permi-
fes fuivant les lois. Ces fortes de chofes n’obligent
point ; c’eft-à-dire que fi l’on a ftipulé une claufe de
cette nature, ou fi un teftateur a appofé une telle
condition à fa libéralité, le tout eft regardé comme
non écrit. Voyei les lois 31. & 18B.au digejle de reg.
jur. & liv. X LV . t it .j. i. 36. 8c liv. L . tit. xvij. 1. 18.
C hoses jugées, en Droite fe prend quelquefois
pour ce qui réfulte d’un jugement, 'quelquefois on
entend p ar-là le jugement même ; enfin le terme de
chofe jugée eft fouvent reftreint au cas où le jugement
a acquis une telle force, qu’il devient hors de toute
atteinte. Oppofer Üautorité de la chofe jugée, c’eft fbn- .
der fa demande ou fes défenfes fur quelque jugement
rendu entre les parties, ou dans une efpece fembla-
ble. L’autorité de la chofe jugée eft fi grande, qu’elle
pafîe pour une vérité confiante ; res judicata pro veri-
tate habetur.
Suivant l’ofdonnance de 166’j,tit.x xv ij. art. 6. les
fentences 8c jugemens qui doivent paffer en. force
de chofe jugée, font ceux rendus en dernier reffort,
& dont U n’y a point d’appel, ou dont l’appel n’eft
pas recevable, foit que les parties y euffent formellement
açquiefçé , ou qu’effes n’en euffent inter*
jetté appel dans le tems, ou que l’appel en ait été
déclaré péri. L 'article 12. dit que fi la fentenee a été
lignifiée, & quç trois ans après la fignification il y
«lit eu fommation d’en appeller, l’appel ne fera plus
rècevabie fix mois après la fommation; mais la fen-
tence paffera en force de chofejugée .Le délai pour les
eglifes, hôpitaux, collèges, au lieu de trois ans, eft
de fix ans. Au défaut de ces fomraations, les fentences
, fuivant l’art, ly. n’ont force 8e chofe jugée qu’a-
près dix ans , à compter du jour de la fignification ;
& au bout de vingt ans, à l’égard des églifes, hôpitaux,
collèges^
C hoses litigieufes, voye( D ro its l it ig ie u x .
| C h o s e s , appellées mancipi, chez les Romains *
etoïent celles qui étoient poffédées en pleine propriété.
Elles étoient ainfi appellées de mancipium,
qui fignifioit le droit de propriété 8c de domaine dont
les feuls citoyens romains joiiiffoient fur tous les
fonds de l’Italie, fur les héritages de la campagne,
fur les efclaves, 8c fur les animaux qui fervoient à
faire valoir ces mêmes fonds. Toutes ces chofes
étoient appellées res mancipi ou mancipii, à la différence
des provinces tributaires des Romains, où
les particuliers n’zvoient que l ’ufufruit & la poffef-
fion de leurs fond} 8c des chofes qui y étoient attachées
; c’eft pourquoi on les nommoit res nec mancipi.
Par l’ancien droit romain, l’ufucapion n’avoit
lieu que pour les chofes appellées mancipi, foit meubles
ou immeubles : les chofes appellées nec mancipi
étoient feulement fujettes à la prefeription; mais
Juftinien fupprima ces diftinéfions frivoles entre ces
deux maniérés de pofféder & de preferire. Voye^ In-
jlitut. liv. I I . tit. vj. rhift. de la Jurifpr, rom. de M.
Terraffon, liv. I I . § . 8. pag. 133.
C hoses hors du patrimoine , voye£ ci-devant CHOSES
hors du commerce.
C hoses poffibles, en Droite font celles qu’il eft
au pouvoir de quelqu’un de faire, 8c qui font per-
mifes par les lois* Voye£ ci-devant C hoses impofji-
bU$.
C hoses propka/ies, en Droit, font oppofées aux
chofes facrées , religieufes , 8c faintes.
CHOSES de pure faculté y voye^ ci-devant C hoses
defaculté.
C hoses publiques, font celles dont le public a l’ufage
; telles que les rivières navigables 8c leurs rivages,
les rues & places publiques. Chez les Romains,
le peuple ayoit la propriété de ces chofes ; au lieu
que parmi nous elle appartient au roi ou au feigneur
haut-jufticier, dans la juftice duquel elles font fi-
tuées. Les chofes publiques & les chofes communes conviennent
en ce que i’ufage en eft commun à tous les
hommes, mais elles different en ce que la propriété
des chofes publiques appartient à quelqu’un; au lieu
que celle des chofes communes, n’appartient à perfonne.
V9ye£ le tit. des inftit. de rerum divifione.
' C hoses religieufes, font les lieux qui fervent à
la fépulture des fideles. Chez les Romains, chacun
pouvoit de fon autorité privée rendre un lieu religieux,
en y faifant inhumer un mort. Mais parmi
nous cela ne fuffit pas pour mettre ce lieu hors du
commerce ; il ne devient religieux qu’aurant qu’il eft
béni 8c deftiné pour la fépulture ordinaire des fidèles.
Voye{ le tit, de rerum divifione, § . $ .& de Bouta-
r ic j ib'td.
C hoses facrées, font celles qui ont été confa-
crées à Dieu par les évêques, avec les folennités re-
quifes, comme les vafes facrés, les églifes, &c. Foyc
aux inft. de rer. divif. & de Boutaric, fur le § . 8. de c\
titre.
C hoses faintes, en Droit; font celles que les lois
ordonnent de refpeâer, telles que les portes 8c les
murailles des villes , la perfonne des fouverains ,
les ambaffadeurs, les lois mêmes. On appelle ceg
chofes, faintes, parce'qu’il eft défendu ,fub fanclioni
pcenoe, de leur faire injure, ou d’y donner aucune atteinte.
Voye{ le § . 10. aux inftitut. de rerum divifionel
L’ufage des portes & murailles des villes appaè