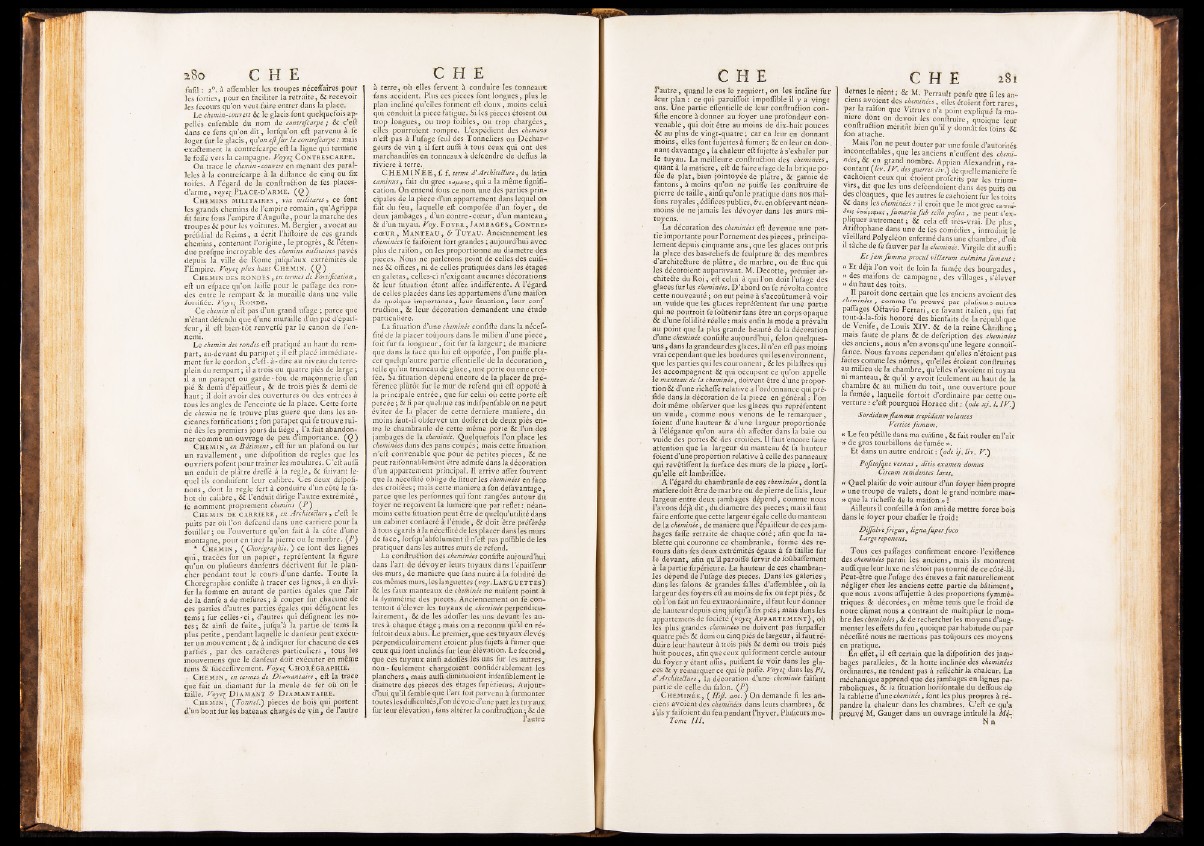
fufil : 2°. à affembler les troupes néceffaires pour
les forties, pour en faciliter la retraite, & recevoir
les fecours qu’on veut faire entrer dans la place.
Le chemin-couvert & le glacis font quelquefois app
e lé s enfemble du nom de contrefcarpe ; & c’eft
dans ce fens qu’on dit, lorfqu’on eft parvenu à fe
loger fur le glacis, qu’on efifur la contrefcarpe : mais
exactement la contrefcarpe eft la ligne qui termine
le fôffé vers la campagne. Voye^ C o ntr escarpe.
On trace le chemin - couvert en menant des parallèles
à la contrefcarpe à la diftance de cinq ou fix
toifes. A l’égard de la conftru&ion de fes places-
d’arme, Pl a c e -d’armE. (Q )
C hemins mil itaire s , vice militares, ce font
les grands chemins de l’empire romain, qu’Agrippa
fit faire fous l’empire d’Augufte, pour la marche des
troupes & pour les voitures. M. Bergier, avocat au
préfidial de Reims, a écrit l’hiftoire de cès grands
chemins, contenant l’origine, le progrès, & l’étendue
prefque incroyable des chemins militaires pavés
depuis la ville de Rome jufqu’aux extrémités de
l ’Empire. Voye^plus haut C hemin. (Q )
CHEMIN des rondes , en termes de Fortification,
eft un efpace qu’on laiffe pour le paffage des rondes
entre le rempart & la muraille dans une ville
fortifiée. Voye^ R onde.
Ce chemin n’ eft pas d’un grand ufage ; parce que
n’étant défendu que d’une muraille d’un pié d’épaif-
feur, il eft bien-tôt renverfé par le canon de l’ennemi.
Le chemin des rondes eft pratiqué au haut du rempart,
au-devant du parapet ; il eft placé immédiatement
fur le cordon, c’eft- à-dire au niveau du terre-
plein du rempart ; il a trois ou quatre piés de large ;
il a. un parapet ou garde - fou de maçonnerie d’un
pié & demi d’épaiffeur, & de trois piés & demi de
haut ; il'doit avoir des ouvertures ou des entrées à
tous les angles de l’enceinte de la place. Cette forte
de chemin ne fe trouve plus guere que dans les anciennes
fortifications ; fon parapet qui fe trouve ruiné
dès les premiers jours du liège, l’a fait abandonner
comme un ouvrage de peu d’importance. (Q )
C hemin , en Bâtiment, eft fur un plafond ou fur
un ravallement, une difpofition de réglés que les
ouvriers pofent pour traîner les moulures. C ’eft auffi
un enduit de plâtre drelTé à la réglé, & fuivant lequel
ils conduifent leur calibre. Ces deux dil'pofi-
tions, dont la réglé fert à conduire d’un côté le fa-
bot du calibre, & l’enduit dirige l’autre extrémité,
fe nomment proprement chemins (P )
C hemin de ca r r iè r e , en Architecture, c’eft le
puits par où l’on defcend dans une carrière pour la
fouiller; ou l’ouverture qu’on fait à la côte d’une
montagne, pour en tirer la pierre ou le marbre. (P )
* C hemin , ( Chorégraphie. ) ce font des lignes
qui, tracées fur un papier, repréfentent la figure
qu’un ou plufieurs danfeurs décrivent fur le plancher
pendant tout le cours-d’une danfe. Toute la
Chorégraphie confifte à tracer ces lignes, à en divi-
fer la fomme en autant de parties, égales que l’air
de la danfe a de mefures ; à couper fur chacune de
ces parties d’autres parties égales qui déiignent les
tems; fur celles*ci, d’autres qui défigrient les note
s ; & ainfi de fuite, jufqu’à la partie de'teins la
plus petite, pendant laquelle, le danfeur peut exécuter
un mouvement ; & à indiquer fur chacune de ces
partiès , par des cara&eres particuliers , tous les
mo.uvemens que le danfeur doit exécuter en même
tems & Tùcceffivement. Foyeç C horégraphie..
• C h em in , en termes-de Diamantaire, eft la trace
que fait un diamant fur la meule de fer où ori le
taille. Foyei P iam ant & D iam an t a ir e .
C hemin , ( Tonnel.) pièces de bois qui portent
d’un bout fur les bateaux chargés de v in , de l’autre
à terre, où elles fervent à conduire les tonAêau*
Tans accident. Plus ces pièces font longues, plus le
plan incliné qu’elles forment eft doux, moins celui
qui conduit la piece fatigue. Si les pièces étoient ou
trop longues, ou trop foibles, ou trop chargées,
elles pourroient rompre. L’expédient des chemins
n’eft pas à l’ufage feul des Tonneliers ou Déchar-“
geurs de vin ; il fert aufiî à tous ceux qui ont des
marchandifes en tonneaux à defcendre de deffus la
riviere à terre.
CH EM IN É E , f. f. terme d’Architecture, du latin
caminuSy fait du grec netpjm, qui a la même lignification,
On entend fous ce nom une des parties principales
de la piece d’un appartement dans lequel on
fait du feu, laquelle eft compofée d’un foy er, de
deux jambages, d’un contre - coeur, d’un manteau,
& d’un tuyau. Foy. Fo y e r , Jam b a g e s , C ontrecoe
u r , Ma n t e a u , & T u yau . Anciennement les
cheminées fe faifoient fort grandes ; aujourd’hui avec
plus de raifon, on les proportionne au diamètre des
pièces. Nous ne parlerons point de celles des cuifi-i
nés & offices, ni de celles pratiquées dans les étages
en galetas, celles-ci n’exigeant aucunes décorations
& leur fituation étant affez indifférente. A l’égard
de celles placées dans les appartemens d’une maifon
de quelque importance, leur fituation, leur conf-
truâion, & leur décoration demandent une étude
particulière.
La fituation d’une cheminée confifte dans la nécef-
fité de la placer toujours dans le milieu d’une piece,
fbit fur fa longueur, foit fur fa largeur; de maniéré
que dans la face qui lui eft oppofée, l’on jHuffe placer
quelqu’autre partie effentielle’ dé la décoration ,
telle qu’un trumeau de glace, une porte ou une croi-
fée. Sa fituation dépend encore de la placer de préférence
plùtôt fur le mur de refend qui eft oppofé à
la principale entrée, que fur celui où cette porte eft
percée ; Si fi par quelque cas indifpenfable on ne peut
éviter de ia placer de cette derniere maniéré, du
moins faut-il ôbferver un dofferet de deux piés entre
le chambranle de Cette même porte & l’un des
jambages de la cheminée. Quelquefois l’on place les
cheminées dans dés pans coupés ; mais cette fituation
n’eft convenable que pour de petites pièces, & ne
peut raifonnablement être admife dans la décoration
d’un appartement principal. Il arrive affez fouvent
que la nécefîité oblige de fituer les cheminées en face
des croifées ; mais cette maniéré a fon defavantage ,
parce que les perfonnes qui font rangées autour du
foyer ne reçoivent là lumière que par reflet : néanmoins
cette fituation peut être de quelqu’utilité dans
un cabinet confacré à l’étude, ôr doit être préférée
à tous égards à la nécèfîité de les placer dans les murs
de face, lorfqu’abfolument il n’eft pas pofîible de les
pratiquer dans les autres murs de refend.
La conftruftion des cheminées confifte aujourd’hui
dans l’art de dévoyer leurs tuyaux dans l’épaiffeur
des murs, de maniéré que fans nuire à lafolidité de
ces. mêmes murs, les languettes (voy. L a n g u e t t e s )
& les faux manteaux de cheminée ne nuifent point à
la fymmétrie des pièces* Anciennement on fe con-
tentoit d’élever les tuyaux de cheminée perpendiculairement,
& de les adoffer les uns devant les autres
à chaque étage ; mais on a reconnu qii’il en ré-
fultoit deux abus. Le premier, que ces tuyaux élevés'
perpendiculairement étoient plus füjets à fumer que
ceux qui font inclinés fur leur élévation. Le fécond,
que ces tuyaux ainfi adoffés les uns fur les autres,
non - feulement chargeaient cônfidérablement. les
planchers , mais auffi diminuoient infenfiblement le
diamètre des pièces des étages fupérieurs; Aujourd’hui
qu’il femble que l’art foit parvenu à furmonter
toutes les difficultés,l’on dévoie d’une part les tuyaux,
fur leur élévation, fans altérer la conftruétion ; & de
l’autre
1*autre, quand le cas le requiert, on les incline fur
leur plan : ce qui paroiffoit impoflïble il y a vingt
•ans. Une partie effentielle de leur conftruûion confifte
encore à donner au foyer une profondeur convenable,
qui doit être au moins de dix-huit pouces
•& au plus de vingt-quatre ; car en leur en donnant
moins, elles font fujettes à fumer ; & en leur en don-.
riant davantage, la chaleur eft fujette à s’exhaler par
le tuyau. La meilleure conftrmftion des cheminées,
quant à la matière, eft de faire ufage de la brique po-
fée de plat, bien jointoyée de plâtre, & garnie de
fantons, à moins qu’on ne puiffe les conftruire de
pierre de taille, ainfi qu’on le pratique dans nos mai-
ions royales, édifices publics, &c. enobfervant néanmoins
de ne jamais les dévoyer dans les murs mitoyens.
La décoration des cheminées eft devenue une partie
importante pour l’ornement des pièces, principalement
depuis cinquante ans, que les glaces ont pris
la place des bas-reliefs de fculpture & des membres
d’archite&ure de plâtre, de marbre, ou de ftuc qui
les décoroient auparavant. M. D ecotte, premier architecte
du R o i, eft celui à qui l’on doit l’ufage des
glaces fur les cheminées. D ’abord on fe révolta contre
cette nouveauté ; on eut peine à s’accoutumer à voir
un vuide que les glaces repréfentent fur une partie
qui ne pourroit fe foûtenir fans être un corps opaque
& d’une folidité réelle : mais enfin la mode a prévalu
au point que la plus grande beauté de la décoration
d’une cheminée confifte aujourd’hui, félon quelques-
uns , dans la grandeur des glaces. Il n’en eft pas moins
vrai cependant que les bordures qui les environnent,
que les parties qui les couronnent, & les pilaftres qui
les accompagnent & qui occupent ce qu’on appelle
le manteau de la cheminée, doivent être d’une proportion
& d’une richeffe relative à l’ordonnance quipré-
fide dans la décoration de la piece en général : l’on
doit même ôbferver que les glaces qui repréfentent
un vuide, comme nous venons de le remarquer,
foient d’une hauteur & d’une largeur proportionée
à l’élégance qu’on aura dû affe&er dans la baie ou
vuide des portes Sc des croifées. Il faut(encore faire
attention que la largeur du manteau & fa hauteur
foient d’une proportion relative à celle des panneaux
qui revêtiffent la furface des murs de la piece, lorf-
qu’elle eft lambriffée.
A l’égard du chambranle de ces cheminées, dont la
matière doit être de marbre ou de pierre de liais, leur
largeur entre deux jambages dépend, comme nous
l’avons déjà dit , du diamètre des pièces ; mais il faut
faire enforte que cette largeur égale celle du manteau
de la cheminée, de maniéré que l’épaiffeur de ces jambages
faffe retraite de chaque côté; afin que la tablette
qui couronne ce chambranle, forme des retours
dans Tes deux extrémités égaux à fa faillie fur
le devant, afin qu’ilparoiffe fervir de loûbaffement
à la partie fupérieure. La hauteur de .ces chambranles
dépend de l’ufage des pièces. Dans les galeries ;
dans les falons & grandes folles d’affemblée, où la
largeur des foyers eft au moins de fix ou fept piés, &
où l’on fait uni feu extraordinaire, il faut leur donner
de hauteur depuis cinq jufqu’à fix piés ; mais dansles
appartemens de fociété (voye^ A ppartement) , où
les plus grandes c/ieminees ne doivent pas furpaffer
quatre.piés & demi ou cinq piés de largeur, il faut réduire
leur hauteur à trois piés & demi ou trois piés
huit pouces, afin que ceux qui forment cercle autour
du foyer y étant affis, puiftènt fe voir dans les glaces
& y remarquer ce qui fe paffe. Foyei dans les PI.
dé Architecture y la décoration d’une cheminée faifont
partie de celle du falon. (P)
C heminée , ( Hifi. anc.) On demande fi les anciens
avoient des cheminées dans leurs chambres, &
s’ils y faifoient du feu pendant l’hy ver, Plufieurs mo-
Tome I I I ,
detnes le nient ; & M. Perrault penfe que fi les an*
ciens avoient des cheminées, elles étoient fort rares,
par la raifon que Vitruve n’a point expliqué la ma-
niern ° n ^ VOlt.Ies conftruire, quoique leur
conltrudtion méritât bien qu’il y donnât fes foins &C
fon attache.
Mais 1 on ne peut douter par une foule d’autorités
mconteftables, que les anciens n’euffent des cheminées,
& en grand nombre. Appian Alexandrin, racontant
(hv. IF . des guerres civ.) de quellemaniere fe
cachoient ceux qui etoient profcrits par les triumvirs,
dit que les uns defcendoient dans des puits ou
des cloaques, que les autres fe cachoient fur les toits
& dans les cheminées : il croit que le mot grec v-a-wd*
JV/f v7rupotfua.ç, fumaria fub tecto pofita, ne peut s’expliquer
autrement ; & cela eft très-vrai. De plus,
Ariftophane dans une de fes comédies, introduit le
vieillard Polycléon enfermé dans une chambre, d’où
il tâche de fe fouver par la cheminée. Virgile dit auffi :
Et jamfumma procul villarum culmina fumant ;
« Et déjà l’on voit de loin la fumée des bourgades,
» des maifons de campagne, des villages, s’élever
» du haut des toits.
Il paroît donc certain que les anciens avoient des
cheminées , comme l’a prouvé par plufieurs autres
paffages Oétavio Ferrari, ce fovant italien, qui fut
tout-à-la-fois honoré des bienfaits de la république
de Venife, de Louis XIV. & de la reine Chriftine ;
mais faute de plans & de defc.ription des cheminées
des anciens, nous n’en avons qu’une legere connoif-
fance. Nous favons cependant qu’elles n’étoient pas
faites comme les nôtres, qu’elles étoient conftruites
au milieu de la chambre, qu’elles n’avoient ni tuyau
ni manteau, & qu’il y avoit feulement au haut de la
chambre & au milieu du toit, une ouverture pour
la fumée ; laquelle fortoit d’ordinaire par cette ouverture
: c’eft pourquoi Horace dit : (ode x j. /. IF.')
Sordidum flammce trépidant volantes
Fertice fumum.
« Le feu pétille dans ma cuifine, & fait rouler enl’aif
•» de gros tourbillons de fumée ».
Et dans un autre endroit : (ode ij. liv. F.)
Pojîtofque vernas , ditis examen domus
Circum renidentes lares.
« Quel plaifir de voir autour d’un foyer bien propre
» une troupe de valets, dont lè grandhotnbre mar-
» que la richeffe de la maifon »{ -
Ailleurs il confeille à fon ami de mettre force bois
dans le foyer pour chaffer le froid :
Dijfolve frigus, ligna fuper foco
Large reponens.
Tous ces paffages confirment encore- l’exiftence
des cheminées parmi les anciens, mais ils montrent
auffi que leur luxe ne s’étoit pas tourné de ce côté-là.
Peut-être que l’ufoge des étuves a fait naturellement
négliger chez les anciens cette partie du bâtiment,
que nous avons affujettie à des proportions fymmé-
triques & décorées, en même terris que le froid de
notre climat nous a contraint de multiplier le nombre
des cheminées y & de rechercher les moyens d’augmenter
les effets du feu, quoique par habitude ou par
néceffité nous ne mettions pas toujours ces moyens
eii pratique.
En effet, il eft certain que la difpofition des jambages
parallèles, & la hotte inclinée des cheminées
ordinaires, ne tendent pas à réfléchir la chaleur. La
méchanique apprend que des jambages en lignes paraboliques,
& la fituation horifontale du deffous de
la tablette d’une cheminée, font les plus propres à répandre
la chaleur dans les chambres. C ’eft ce qu’a
prouvé M. Gauger dans un ouvrage intitulé la Mç