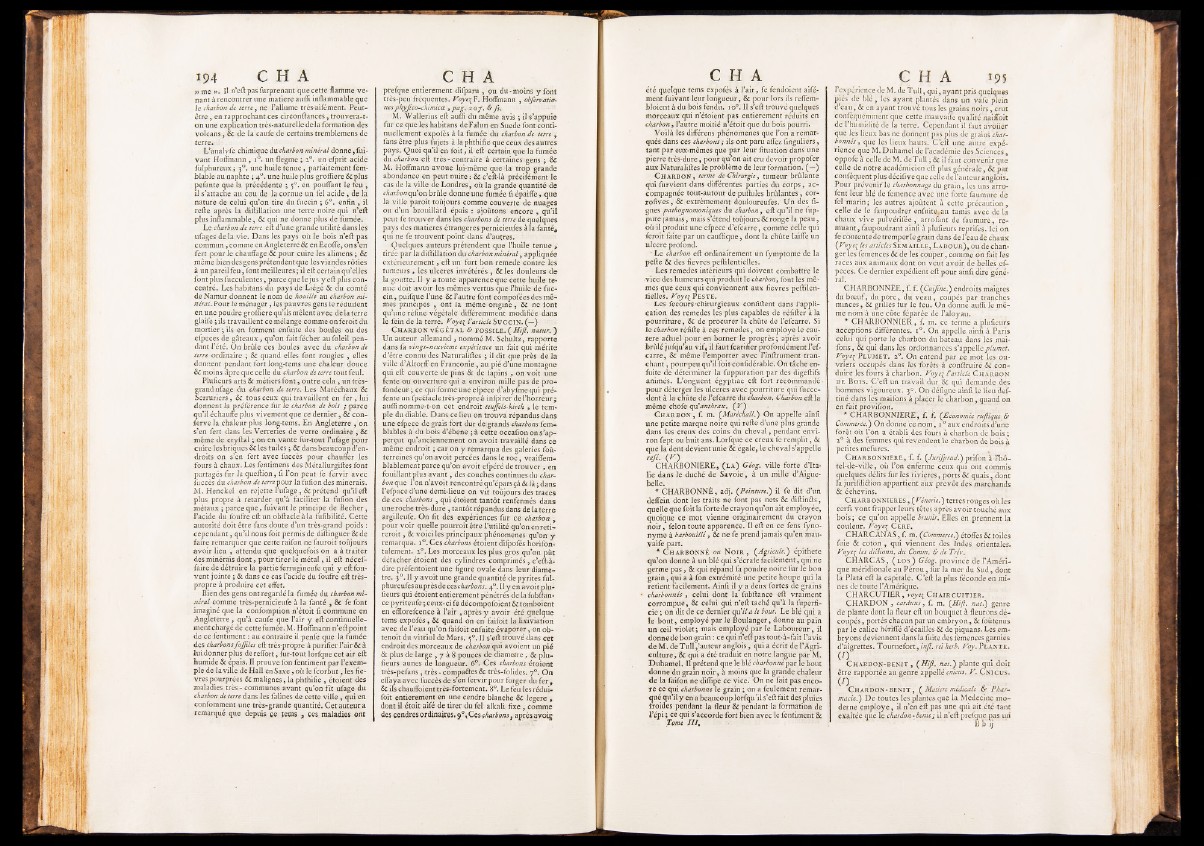
» me ». Il n’eft pas furprenant q«e cette flamme venant
à rencontrer une matière auffi inflammable que
le charbon de terre, ne l’allume très-aifément. Peut-
être , en rapprochant ces circonftances, trouvera-t-
on une explication très-naturelle delà formation des
volcans, 6c de la caufe de certains tremblemens de
terre. -
L’analyfe chimique du charbon minéral donne, fui-
vant Hoffmann, i°. un flegme ; z°. un efprit acide
fulphureux ; 30. une huile tenue, parfaitement fem-
blable au naphte ; 40. une huile plus grofliere & plus
pefante que la précédente ; 50. en pouffant le fe u ,
il s’attache au cou de la cornue un fel acide, de la
nature de celui qu’on tire du fuccin ; 6°. enfin , il
refte après la diftillation une terre noire qui n’eft
plus inflammable, &c qui ne donne plus de fumée.
Le charbon de terre eft d’une grande utilité dans les
ufages de kt.vie. Dans les pays oit le bois n’eft pas
commun, comme en Angleterre & enEcoffe, on s’en
fert pour le chauffage & pour cuire les alimens ; &
même bien des gens prétendent que les viandes rôties
à un pareil feu, font meilleures ; il eft certain qu’elles
font plus fucculentes, parce que le jus y eft plus concentré.
Les habitans du pays de Liège & du comté
de Namur donnent le nom de houille au charbon minéral.
Pour le ménager, les pauvres gens le réduifent
en une poudre grofliere qu’ils mêlent avec de la terre
glaife ; ils travaillent ce mélange comme onferoit du
mortier ; ils en forment enfuite des boules ou des
efpeces de gâteaux, qu’on fait fécher au foleil pendant
l’été. On brûle ces boules avec du charbon de
terre ordinaire ; & quand elles font rougies , elles
donnent pendant fort long-tems une chaleur douce
& moins âpre que celle du charbon de terre tout feul.
Plufieurs arts & métiers font, outre cela , un très-
grand ufage du charbon de terre. Les Maréchaux &
Serruriers, & tous ceux qui travaillent en fer , lui
donnent la préférence fur le charbon de bois ; parce
qu’il échauffe plus vivement que ce dernier, & con-
ferve la chaleur plus long-tems. En Angleterre , on
s’en fert dans les Verreries de verre ordinaire , &
même de cryftal ; on en vante fur-tout l’ufage pouf
cuire les briques & les tuiles ; & dans beaucoup d’endroits
on s’en fert avec fuccès pour chauffer les
fours à chaux. Les fentimens des Métallurgiftes font
partagés fur la queftion, fi l’on peut fe fervir avec
fuccès du charbon de terre pour la fufion des minerais.
M. Henckel en rejette l’ufage, & prétend qu’il eft
plus propre à retarder qu’à faciliter la fufion des
métaux ; parce que, fuivant le principe de Becher,
l’acide du foufre eft un obftacle à la fufibilité. Cette
autorité doit être fans doute d’un très-grand poids :
cependant, qu’il nous foit permis de diftinguer & de
faire remarquer que cette raifon ne fauroit toujours
avoir lieu , attendu que quelquefois on a à traiter
des minérais dont, pour tirer le m étal, il eft nécef-
faire.de détruire la partie ferrugineufe qui y eft fou-
vent jointe ; & dans ce cas l’acide du foufre eft très-
propre à produire cet effet.
Bien des gens ont regardé la fumée du charbon minéral
comme très-pernicieufe à la fanté , & fe font
imaginé que la confomption n’étoit fi commune en
Angleterre , qu’à caufe que l’air y eft continuellement
chargé de cette fumée. M. Hoffmann n’eft point
de ce fentiment : au contraire il penfe que la fumée
des charbonsfojjiles eft très-propre à purifier l’air & à
lui donner plus dereffort, fur-tout lorfque cet air eft
humide & épais. Il prouve fon fentiment par l’exemple
de la ville de Hall en Saxe, où le feorbut, les fièvres
pourprées & maligne?, la phthifie , étoient des
maladies très - communes avant qu’on fît ufage du
charbon de terre dans les falines de cette ville , qui en
confomment une très-grande quantité. Cet auteur a
remarqué que depuis, ce fems , ces maladies ont
prefque entièrement difparu , pu du - moins y font
très-peu fréquentes. Voyefp. Hoffmann , obfervatio-
nes phyfico-chimicce. , pag.-zoy. & fs.
M. "Wallerius eft aufli du même avis ; il s’appuie
fur ce que les habitans deFalun en Suède font continuellement
expofés à la fumée du charbon de terre ,
fans être plus l'ujets à la phthifie que ceux des autres
pays. Quoi qu’il en foit, il eft certain que la fumée
du charbon eft très - contraire à certaines gens ; &
M. Hoffmann avoue lui-même que- la trop grande
abondance en peut nuire : & c’eft-là précisément le
cas de la ville de Londres, où la grande quantité de
charbon qu’on brûle donne une fumée fi épaifîe, que
la ville paroît toûjours comme couverte de nuages
ou d’un brouillàrd épais : ajoûtons encore , qu’il
peut fe trouver dans les charbons de terre As quelques
pays des matières étrangères pernicieufes à la fanté»
qui ne fe trouvent point dans d’autres. ;
Quelques auteurs prétendent que l’huile tenue »
tirée par la diftillation du charbon minéral, appliquée
extérieurement, eft un fort bon remede contre les
tumeurs , les ulcérés invétérés , & les douleurs de
la goutte. Il y a toute apparence que cette huile tenue
doit avoir les mêmes vertus que l’huile de fuccin
, puifque l’une & l’autre font compofées des mêmes
principes , ont la même origine , & ne font
qu’une réfine végétale différemment modifiée dans
le fein de la terre. Voye% T article S u c c iN .(—)
C harbon v é g é t a l & fossile. ( Hiß. natur. )
Un auteur allemand , nommé M. Schultz, rapporte
dans fa vingt-neuvieme expérience un fait qui mérite
d’être connu des Naturaliftes ; il dit que près de la
ville d’Altorff en Franconie, au pié d’une montagne
qui eft couverte de pins & de fapins * on voit une
fente ou ouverture qui a environ mille pas de profondeur
; ce qui forme une efpece d’abyfme qui préfente
un fpeâacle très-propre à infpirer de l’horreur;
auffi nomme-t-on cet endroit teuffels-kirch , le temple
du diable. Dans ce lieu on trouva répandus dans
une efpece de grais fort dur de grands charbons tem-
blables à du bois d’ébene ; à cëtte occafionons’ap-
perçut qu’anciennement on avoit travaillé dans ce
même endroit ; car on y remarqua des galeries foû-
terreines qu’on avoit percées dans le ro c , vraiffem-
blablement parce qu’on avoit efpéré de trouver , en
fouillant plus avan t, des couches continues du charbon
que l ’on n’avoit rencontré qu’épars çà & là ; dans
l’efpace d’une demi-lieue on vit toûjours des traces
de ces charbons , qui étoient tantôt renfermés dans
une roche très-dure , tantôt répandus dans de la terre
argilleufe. On fit des expériences fur ce charbon ,
pour voir quelle pourroitêtre l ’utilité qu’on en reti-
reroit, & voici les principaux phénomènes qu’on y
remarqua. i° . Ces charbons étoient difpofés horifon-
talement. i° . Les morceaux les plus gros qu’on pût
détâcher étoient des cylindres comprimés,. c’eft-à-
dire préferitoient une figure ovale dans leur diamètre.
30. Il y avoit une grande quantité de pyrites ful-
phureufes auprès de ces charbons. 40. Il y en a voit plufieurs
qui étoient entièrement pénétrés de la fubftan-
ce pyriteufe ; ceux-ci fe décompofoient &tomboient
en efflorefcence à l’air , après y avoir été quelque
tems expofés, & quand on en faifoit la lixiviation
avec de l’eau qu’on faifoit enfuite évaporer, on ob-
tenoit du vitriol de Mars. Il s’eft trouvé dans cet
endroit des morceaux de charbon qui avoient un pié
& plus de large , 7 à 8 pouces de diamètre, & plufieurs
aunes de longueur. 6°. Ces charbons étoient
très-pefans , très - compares & très-folides. 70. On
eflayaavec fuccès de s’en fervir pour forger du fer,
& ils chauffoient très-fortement. 8°. Le feu les rédui-
foit entièrement en une cendre blanche & legere ,
dont il étoit aifé de tirer du fel alkali, fixe , comme
des çendres ordinaires. 9°tCes charbons, après avoiç
été quelque tems expofés à l’air, fe fendoient aifé-
ment fuivant leur longueur, & pour lors ils reffem-
bloient à du bois fendu. io°. Il s’eft trouvé quelques
morceaux qui n’étoient pas entièrement réduits en
charbon y l’autre moitié n’étoit que du bois pourri.
Voilà les différens phénomènes que l’on a remarqués
dans ces charbons; ils ont paru affez finguliers,
tant par eux-mêmes que par leur fituation dans une
pierre très-dure, pour qu’on ait cru devoir propofer
aux Naturaliftes le problème de leur formation. (—)
C h a r bo n , terme de Chirurgie y tumeur brûlante
qui fur vient dans différentes parties du corps » accompagnée
tout-autour de puftules brûlantes, cor-
rpfives, & extrêmement douloureufes. Un des lignes
pathognomoniques du charbon, eft qu’il ne fup-
pure jamais, mais s’étend toûjours & ronge la peau,
où il produit une efpece d’efearre, comme celle qui
feroit faite par un cauftique, dont la chûte laifle un
ulcéré profond.
• Le charbon eft ordinairement un fymptome de la
pefte & des fievres peftilentielles.
Les remedes intérieurs qui doivent combattre le
•vice des humeurs qui produit le charbon, font les mêmes
que ceux qui conviennent aux fievres peftilentielles.
Voye^ Pest é. .
Les fecours •chirurgicaux confident dans l ’application
des remedes les plus Capables dé réfifter à la
pourriture, & de procurer la chûte de l’efearre. Si
le charbon réfifte à- ces remedes, on employé le cautère
attuelpour en borner le progrès ; après avoir
brûlé jufqu’au vif* il faut fearifier profondément l’efearre,
& même l’emporter avec l’infirument tranchant
, pour-peu qu’il foit- confidérable. On tâche en-
fuite de déterminer la fuppuration par des digéftifs
animés. L’onguent égyptiac eft fort recommande •
pour déterger les ulcérés avec pourriture qui fucce-
dent à la enute de l’efearre du charbon. Charbon eft la
même chofe qu’anthrax. (T )
C h a r b o n , f. m. (Maréchall.) On appelle ainfi
une petite marque noire qui refte d’une plus grande
dans les creux des coins du cheval » pendant environ
fept ou huit ans. Lorfque ce creux fe remplit, &
que la dent devient unie & égale, le cheval s’appelle
rafé. (V )
CHARBONIERE, ( l a ) Géog. ville forte d’Italie
dans le duché de Savoie, à un mille d’Aigue-
belle.
* CHARBONNÉ, adj. (Peinture.') il fe dit d’un
deffein dont les traits ne font pas nets & diftintts,
quelle que foit la forte de crayon qu’on ait employ ée,
quoique ce mot vienne originairement du crayon
noir, félon toute apparence. Il eft en ce fens fyno-
nyme à barbouillé, & ne fe prend jamais qu’en mau-
.vaife part.
* C harbonné ou No ir , (.Agricult.) épithete
qu’on donne à un blé qui s’écrale facilement, qui ne
germe pas, & qui répand fa pOudre noire fur le bon
grain, qui a à fon extrémité une petite houpe qui la
retient facilement. Ainfi il y a deux fortes de grains
charbonnés, celui dont la fubftance eft vraiment
corrompue, & celui qui n’eft taché qu’à la fuperfi-
cie ; on dit de ce dernier qu’// a le bout. Le blé qui a
le bout, employé par le Boulanger, donne au pain
un oeil violet ; mais employé par le Laboureur, il
donne de bon grain : ce qui n’eft pas tout-à-fait l’avis
de M. de Tull,'auteur anglois, qui a écrit de l’Agriculture,
& qui a été traduit en notre langue par M.
Duhamel. Il prétend que le blé charbonné par le bout
donne du grain noir, à moins que la grande chaleur
de la faifon ne diffipe ce vice. On ne fait pas encore
ce qui charbonné le grain ; on a feulement remarqué
qu’il y en a beaucoup lorfqu ’il s’eft fait des pluies
froides pendant la fleur & pendant-la formation de
l’épi ; ce qui s’accorde fort bien avec le fentiment &
Tçme I I I ,
l’expérience de M. de T u ll, qui, ayant pris quelques
pies de b lé , les ayant plantés dans un vafe plein
d’eau, & en ayant trouvé tous les grains noirs, crut
confécjùemment que cette mauyail'e qualité naiffoit
de l’humidité de la terre. Cependant il faut aVoiier
que les lieux bas ne donnent pas plus de grains charbonnés,
que les lieux hauts. C ’en une autre expérience
que M. Duhamel de l’académie des Sciences,
oppofe à celle de M. deTull ; & il faut convenir que
celle de notre académicien eft plus générale , & par
conféquent plus décifive que celle de l’auteur anglois.
Pour prévenir le charbonnage du grain, les uns arro-
fent leur blé de femence avec une forte faumure de
fel ■ 'marin; les autres ajoutent à cette précaution ,
celle de le faupoudrer enfuit^au tamis avec de l*i
chaux vive pulvérifée , arrofânt de faumure, remuant,
faupoudrant ainfi à plufieurs reprifes. Ici on
fe contente de tremper le grain dans d e l’eaudè chaux
('Voyt{ les articles Sem a ille, L abour) , ou de changer
les feniences & de les couper, comme on fait les
races aux animaux dont on veut avoir de belles efpeces.
Ce dernier expédient eft pour ainfi dire géné-
râk
CHARBONNÉE, f. f. ( Cuifine.) endroits maigres
du boeuf, du porc, du v eau , coupés par tranches
minces, & grillés fur le feu. On donne auffi le même
nom à une côte fèpàrée de l’aloyau.
* CHARBONNIER, f. m. cê terme a plufieurs
acceptions différentes. i° . On appelle ainfi à Paris
celui qui porte le charbon du bateau dans les p\ai-
fons, & qui dans les ordonnances s’appelle plumet.
Fbyeç 'Plum et. x°. On entend par ce mot Je.s ouvriers
occupés dans les forêts à conftruiré & conduire
les fours à charbon. Voyeç l'article C harbon
de Bo is . C ’eft un travail dur & qui demande des
hommes vigoureux. 30. On défigne ainfi le lieu destiné
d(ans les maifons à placer le charbqn, quand on
en fait provifion.
* CHARBONNIERE, f. f. (Economie rtißique &
Commerce.) On donne ce,nom , 10 aux endroits d’une
forêt où l’on a établi des fours.à charbon de bois ;
20 à des femmes qui revendent le charbon de bois à
petites mefures.
CHARBONNIERE, f. f. (Jurifprud.) prifon à-l’hô-
tel-de-ville, où l’on enferme ceux qui ont commis
quelques délits fur les rivières, ports & quais, dont
la jurifdiftion appartient aux prévôt des marchands
& échevins.
CHARBONNIERES, (Vénerie.) terres rouges où les
cerfs vont frapper leurs têtes après avoir touché aux
bois ; ce qu’on appelle brunir. Elles en prennent la
couleur. Voyeç C erf.
CHARCÀNAS, f. m. (Commerce.) étoffes & toiles
foie & coton , qui viennent des Indes orientales.
Voyeç les diclionn. du Comm. & de Trév.
CH ARC AS, ( l o s ) Géog. province de l’Amérique
méridionale au Pérou, fur la mer du Sud, dont
la Plata eft la capitale. C ’eft la plus féconde en mines
de toute l’Amérique.
CHARCUTIER, vàye^ C h a ir c u it ie r .
CHARDON, carduus, f. m. (Hiß. nat.) genre
de plante dont la fleur eft un bouquet à fleurons découpés
, portés chacun par un embryon, & foutenus
par le calice hériffé d’écailles & de piquans. Les embryons
deviennent dans la fuite des femences garnies
d’aigrettes. Tournefort,/«/?. reiherb. Voy. Plan t e . co , ■ C hardon-b e n it , (Hiß. nat.) plante qui doit
être rapportée au genre appelle cnicus.V , C n icus . co H ,. ^ CHARDON-BENIT, (Matière medicale & Pharmacie!)
De toutes les plantes que la Medecine moderne
employé, il n’en eft pas une qui ait été tant
exaltée que le chardon-benit; il n’eft prefque pas un
' ' _ ...... B !■ i).......