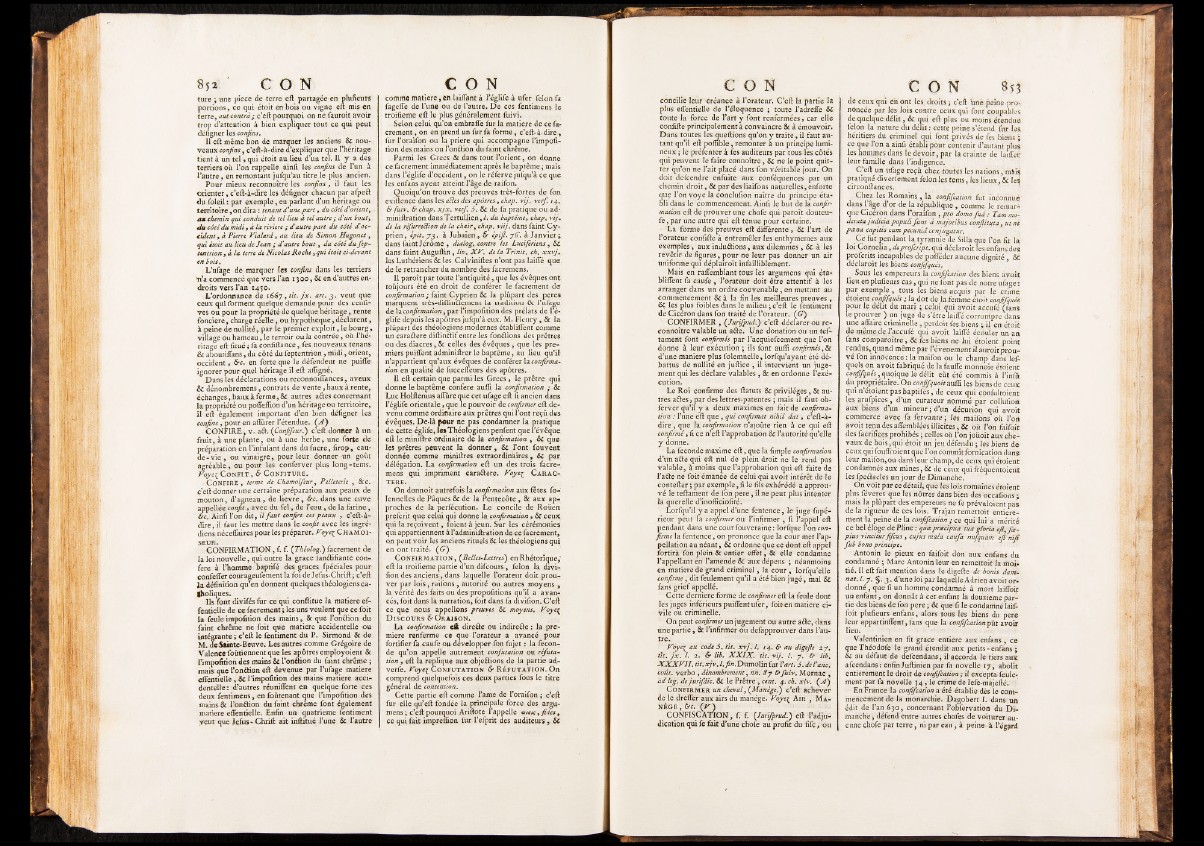
ture ; une piece de terre eft partagée en plufieurs
portions, ce qui étoit en bois ou vigne eft mis èn
terre, aut contra; c’eft pourquoi on ne fauroit avoir
trop d’attention à bien expliquer tout ce qui peut
déligner les confias.
Il eft même bon de marquer les anciens ôc nouveaux
confins y c’eft-à-dire d’expliquer que l’héritage
tient à un t e l, qui étoit au lieu d’un tel. Il y a des
terriers oh l’on rappelle ainfi les confins de l’un à
l ’autre, en remontant jufqu’au titre le plus ancien.
Pour mieux reconnoître les confins, il faut les
orienter, c’eft-à-dire les défigner chacun par afpeft
du foleil: par exemple, en parlant d’un héritage ou
territoire, on dira : tenant d’une part, du côté d’orientt
eut chemin qui conduit de tel lieu à tel autre ; d'un bout,
du côté du midi , à la riviere ; d’autre part du côté d oc-
cident > à Pierre Vialard, au lieu de Simon Hugonet ,
qui étoit au lieu de Jean ; d’autre bout, du côté du fep-
ttntrion , à la terre de Nicolas Roche, qui étoit ci-devant
en bois.
L’ufage de marquer les confins dans les terriers
•n’ a commencé que vers l’an 13 00, ôc en d’autres endroits
vers l’an 1450.
L’ordonnance de 1667, tit. j x . art. 3 . veut que
ceux qui forment quelque demande pour des cenfi-
ves ou pour la propriété de quelque héritage, rente
foncière, charge réelle, ou hypotheque, déclarent,
à peine de nullité, par le premier exploit, le bourg,
village ou hameau, le terroir ou la contrée, où l’héritage
eft fitué ; fa confiftance, fes nouveaux tenans
& aboutiffans, du coté du feptentrion , midi, orient,
occident, &c. en forte que le défendeur ne puifle
ignorer pour quel héritage il eft afligné.
Dans les déclarations ou reconnoiffances, aveux
& dénombremens, contrats de vente, baux à rente,
échanges,. baux à ferme, 5c autres aftes concernant
la propriété ou poffeflion d’un héritage ou territoire,
il eft également important d’en bien défigner les
confins, pour en affûrer l’étendue. (A')
CONFIRE, y ..tâ . (Confifeur.’) c’eft donner à un
fruit, à une plante, ou à une herbe, une forte de
préparation en l’infufant dans du fucre, firop, eau-
d e -v ie , ou vinaigre, pour leur donner un goût
agréable, ou pour les conferver plus long-tems.
F o y ei C o n f it , & C onfiture.
CO NF IR E , terme de Chamoifeur, Pelleterie , &c.
c’eft donner une certaine préparation aux peaux de .
mouton , d’agneau , de lievre , ôfc. dans une .cuve
appellée confit., avec du fe l, de l’eau , de la farine,
&c. Ainfi l’on dit, il faut confire ces peaux , c’eft-à-
dire il faut les mettre dans le confit avec les ingré-
diens néceflaires pour les préparer. Foye^ C h am o i-
s e u r .
CONFIRMATION , f . f. (Théolog.) facrement de
la loi nouvelle, qui.outre la grâce lan&ifiante conféré
à l’homme baptifé des grâces fpéciales pour
confeffer courageufement la foi de Jefus-Chrift ; c’eft
la définition qu’en donnent quelques théologiens catholiques.
Ils font divifés fur ce qui conftitue la matière ef-
fentielle de ce facrement ; les uns veulent que ce foit
la feule impofition des mains, & que l’ondion du
faint chrême ne foit que matière accidentelle ou
intégrante ; c’eft le fentiment du P. Sirmond & de
M. de Sainte-Beuve. Les autres comme Grégoire de
Valence foûtiennent que les apôtres employoient &
l’impofition des mains ôc l’ondion du faint chrême ;
mais que L’ondion eft devenue par l’ufage matière
effentielle , ôc l ’impofition des mains matière accidentelle:
d’autres réunifient en quelque forte ces
deux fentimens, en foutenant que l’impofition des
mains & l ’ondion du faint chrême font également
matière effentielle. Enfin un quatrième lèntiment
veut que Jefus- Chrift ait inftitué l’une & l’autre
Comme matière, en laiffânt à l’églife à ufer félon fa
fageffe de l’une ou de l’autre. De ces fentimens le
troifieme eft le plus généralement fuivi.
Selon celui qu’on embraffe fur la matière de ce fa-
Crement, on en prend un fur fa forme, c’eft-à-dire,
fur l’oraifon ou la priere qui accompagne l’impofi-
tion des,mains ou l’ondion du faint chrême.
Parmi les Grecs & dans tout l’orient, on donne
ce facrement immédiatement après le baptême ; mais
dans l’églife d’occident, on le réferve jufqu’à ce que
les enfans ayent atteint Page de raifon.
Quoiqu’on trouve des preuves très-fortes de fon
exiftence dans les actes des apôtres, chàp. vij, verf. 14.
& fuiv, & chap. x jx . verf. 5. ôc de fa pratique ou ad-
miniftration dans Tertullien, l. du baptême, chap, vij.
de la rèfurrection de la chair, chap. viij. dans faint Gy-
prien, épit. y 3. à Jubaïen, & èpijl, y G. à Janvier;
dans faint Jérôme , dialog. contre les Lucifériens, 5c
dans faint Auguftin, liv. X F . de lu Triait, ch. xxvj.
les Luthériens 5c les Calviniftes n’ont pas laiffé que
de le retrancher du nombre des facremens.
Il paroît par toute, l’antiquité, que les évêques ont
toujours été en droit de conférer le facrement de
confirmation; faint Cyprien ôc la plupart des peres
marquent très-diftin&ement la tradition ôc l’ufage
de la confirmation, ■ pat l ’impofition des prélats de l’églife
depuis les apôtres jufqu’à eux. M. Fleury, & la
plupart des théologiens modernes établiffent comme
un cara&ere diftinftif entre les fondions des prêtres
ou des diacres, & celles des évêques, que les premiers
puiffent adminiftrer le baptême, au lieu qu’il
n’appartient qu’ aux évêques de conférer la confirmation
en qualité de fucceffeurs des apôtres.
Il eft certain que parmi les Grecs, le prêtre qui
donne le baptême conféré aufti la confirmation ; &
Luc Holftenius affûre que Cet ufage eft fi ancien dans
l’églife orientale, que le pouvoir de confirmer eft devenu
comme ordinaire aux prêtres qui l’ont reçu des
évêques. De-là pour ne pas condamner la pratique
de cette églife, les Théologiens penfent que l’évêque
eft le miniftre ordinaire de la confirmation , ôc que
les prêtres peuvent la donner, ôc .l’ont fouvent
donnée comme miniftres extraordinaires, ôc par
délégation. La confirmation eft un des trois facre-
m,ens qui impriment caraûere. Foye^ Caractère.
On donnoit autrefois la confirmation aux fêtes fo-
lennelles de Pâques ôc de la Pentecôte , & aux approches
de la perfécution. Le concile de Roüen
preferit que celui qui donne la confirmation, 5c ceux
qui la reçoivent, loient à jeun. Sur les cérémonies
qui appartiennent à l’adminifiration de ce facrement,
on peut voir les anciens rituels 5c les théologiens qui
en ont traité. (G)
Confirmation, (Belles-Lettres) en Rhétorique,’
eft la troifieme partie d’un difeours y félon la divi-
fion des anciens, dans laquelle l’orateur doit prouver
par lois, raifons , autorité ou autres moyens ,
la vérité des faits ou des propofitions qu’il a avancés,
foit dans la narration, foit dans fa divifion. C ’eft
ce que nous appelions preuves ôc moyens. Foye^
Discours 6* Oraison.
La confirmation eft direâe ou indireûe : la première
renferme ce que l’orateur a avancé pour
fortifier fa caufe ou développer fon fujet : la fecon-r
de qu’on appelle autrement confutation ou réfutation
, eft la répliqué aux objeâions de la partie ad-
verfe. Foyt{ Confutation 6* Réfutation. On
comprend quelquefois ces deux parties fous le titre
général de contention.
Cette partie eft comme l’ame de l’oraifon ; c’eft
fur elle qu’eft fondée la principale force des argu-
mens ; ç’eft pourquoi Ariftote l’appelle tntic, fides ,
ce qui fait impreifion fur l’efprit des auditeurs, 5c
concilie leur ^créance à l’orateur. C ’eft la partie la
plus effentielle de l’éloquence ; toute l’adreffe 5c
toute la force de l’art y font renfermées, car elle
confifte principalement à convaincre & à émouvoir.
Dans toutes les queftions qu’on y traite, il faut autant
qu’il eft poffible, remonter a un principe lumi-
nèux ; le préfenter à fes auditeurs par tous les côtés
qui peuvent le faire eonnoître, 5c ne le point quitter
qu’on ne l’ait placé dans fon véritable jour. On
doit defeendre enfuite aux conféquences par un
chemin droit, 5c par des liaifons naturelles , enforte
que l’on voye la conclufion naître du principe établi
dans le commencement. Ainfi le but de la confirmation
eft de prouver unç chofe qui paroît douteu-
fe , par une autre qui eft tenue pour certaine.
■ La forme des preuves eft différente, ôc l’art de
F orateur confifte à entremêler les enthymemes aux
exemples, aux induâions, aux dilemmes , 5c à les
revêtir* de figures, pour ne leur pas donner un air
uniforme qui déplairoit infailliblement.
Mais en raffemblant tous lés argumens qui étà-?
bliffent fa caufe , l’orateur doit être attentif à les
arranger dans un ordre convenable, en mettant au
Commencement ôc à la fin lés meilleures preuves ,
ôç les plus foibles dans le milieu ; c’eft le fentiment
de Cicéron dans fon traité de l’orateur. (G)
CONFIRMER , ( Jurifpud.) c’eft déclarer on re-
eonnoître valable un afte. Une donation Ou un tef-
tament font confirmés par l ’aequiefcement que l’on
donne à leur exécution ; ils font aufti confirmés, &
d’une maniéré plus folemnelle, lorfqu’ayant été débattus
de nullité en juftice , il intervient un jugement
qui les déclare valables, & en ordonne l’exécution.
Le Roi confirme des ftatuts 5c privilèges, & autres
aftes, par des lettres-patentes ; mais il faut ob-
ferver qu’il y a deux maximes en fait de confirmation
: l’une eft que, qui confirmai nihil dat, c’eft-à-
dire , que la confirmation n’ajoûte rien à ce- qui eft
confirmé, fi ce n’eft l’approbation ôc l’autorité qu’elle
y donne.
La fécondé maxime eft, que la fimple confirmation
d’un a&e qui eft nul de plein droit ne le rend pas
valable, à moins que l’approbation qui eft faite de
l’a&e ne foit émanee de celui qui avoit intérêt de le
contefter ; par exemple, fi le fils exhérédé a approuv
é le teftament de fon pere, il ne peut plus intenter
la querelle d’inofficiofiré.
‘ Lorfqu’il y a appel d’une fentence, le juge fupé-
rieur pëutTa confirmer ou l’infirmer , fi l’appel eft
pendant dans une courfouveraine: lorfque l’on confirme
la fentence, on prononce que la cour met l’appellation
au néant, 5c ordonne que ce dont eft appel
îbrtira fon plein & entier effet, & elle condamne
l’appellant en l’amende ôc aux dépens ; néanmoins
en matierë de grand criminel, la cour , lorfqu’elle
confirme, dit feulement qu’il a été bien jugé, mal Ôc
fans grief appellé.
Cette derniere forme de confirmer eft la feule dont
les juges inférieurs puiffent ufer, foit en matière civile
ou criminelle.
On peut confirmer un jugement ou autre a£te, dans
une partie, Ôc l ’infirmer ou defapprouver dans l’autre.,
Foye^ au code S . tit. xvj. I. 14. & au digefle ày.
tit. j x . I. Z. & lib. X X IX . tit. vij. I. y. & lib.
X X X FH . tit. xjv. l.fin. Dumofin fur l'art. 5. de l'anc;
coût, verbo, dénombrement, nn, 8y &fuiv. Mornac ,
ad leg. de jurifdic. ôc le Prêtre , cent. 4. ch. xlv. (A')
C onfirmer un cheval y (Manège.) c’eft achever
de le dreffer aux airs du manège. Foye^ Air , Manège
, 6‘c. ( V )
CONFISCATION, f. f. (Jurifprud.) eft l’adjudication
qui fe fait d’une choie au profit du fife , ou
dê ceux qui en ont les. droits ; c’eft \mè peine prononcée
par les lois contre ceux qui font coupables
de quelque délit, 5c qui eft plus ou moins étendue
félon la nature du défit : cette peine s’étend fur les
héritiers dû criminel qui font privés de Ces biens ;
ce que l’on a ainfi établi pour contenir d’autant plus
les hommes dans le devoir , par la crainte de laiffef
leur famille dans l’indigehee.
C ’eft un ufage reçu chez toutes les nations, mài$
pratiqué diverlement félon les tems | les fieux, ôc le^
çirçonftances.
Chez les Romains , là confifcation fut inconnue
dans l_âgje d or de la république , comme le remar-î
que CicérOn dans l’oraifon , pro domofuâ : Tammo-
derata judicia populi funt à majoribus confiituta, ut ne
pcena capitis cum pecunuî conjugàtur.
Çé fut pendant la tyrannie de Siila que l’on fit là
loi Cornelia, deprofeript, qui déclaroit les enfans des
proferits incapables de pafféder aucune dignité , &
déclaroit les biens confifqués.
Sous les empereurs la confifedtion des biens avoit
lieu en plufieurs cas, qui ne font pas de notre ufage :
par exemple , tous les biens acquis par le crime
etoient confifqués ; la dot de la femme étoit cçnfifquéê
pour le défit du mari ; celui qui avoit accufé (fans
le prouver ) un juge de s’être laiffé corroiûpre dans
une affaire criminelle, perdoit fes biens ; il. en étoit
de même deTaccufé qui avoit laiffé écouler un an
fans comparoître, 5c fes biens, ne lui étoient point
rendus, quand même par l’évenement il aiiroitprou-
vé fon innocence: la maifon ou le champ dans lef-
quels on avoit fabriqué de la fauffe monnoie étoient
confifqués ,, quoique le délit eût été commis à l’infû
du propriétaire. On confifqùoit aufli les biens de ceux
qui n’étoiènt pas baptifés, de ceux qui çortfultoient
!®.§ ârufpices, d’un curateur nommé par collufion
aux biens d’un mineur ; d’un déçurion qui avoit
commerce avec fa fervante ; les maifons pù l’ort
avoit tenu dçs affemblées illicites, 5c où l’on faifqit
des façrifiççs prohibés ; celles où l’on jôfipit aux chevaux
de bQi$,qui étoit un jeu défendu ; les biens dé
ceux qui fouffroient que l’on commît fornication dans
leur maifon, ou dans leur champ, de ceux qui étoient
condamnés aux mines, ôc de ceux qui fréquentoient
les fpeâacles. un jour de Dimanche.
On voit par ce détail, que les lois romaines étoient
plus féveres que les nôtres dans bien des occafions ;
mais la plûpart des empereurs ne fe prévaloient pas
de la rigueur de ces lois. Trajan remettoit entièrement
la peine de la confifcation ; ce qui lui a mérité
ce bel éloge de Pline : quoeproecipua tua glària cjl, fee-
pius vincifur fifeus , cujus mala caùfà nüfquam efi nifi
fub bono principe.
Antonin le pieux eh faifoit don aux enfans du
condamné ; Marc Antonin leur en remettoit la moi»
tié. Il eft fait mention dans le digefte -de bonis dam*.
nat. l. -y. § . 3 . d’une loi par laquelle Adrien avoit ordonné
, que fi un homme condamné à mort laillbit
un enfant, on donnât à cet enfant la douzième partie
des biens de fon pere ; 5c que fi le condamné laif»
foit plufieurs enfans, alors tous les biens du pere
leur appartinffent, fans que la confifcation put avoir
lieu.
Valentinien en fit grâce entière aux enfans , ce
queThéodofe le grand étendis aux petits - enfans ;
ôc au défaut de defeendans, il'accorda le tiers aux
afeendans : enfin Juftinien par fa novelle 1 7 , abolit
entièrement le droit de confifcation ; il excepta feulement
par fà novelle 34 , le crime de lefe-màjefté. H
En France la confifcation a eti établie dès le commencement
de la monarchie. Dagobert I. dans un
édit de l’an 630, concernant l’obfervation du D imanche,
défend entre autres choies de voiturer aucune
chofe par terre, ni par eau, à peine à l’égard