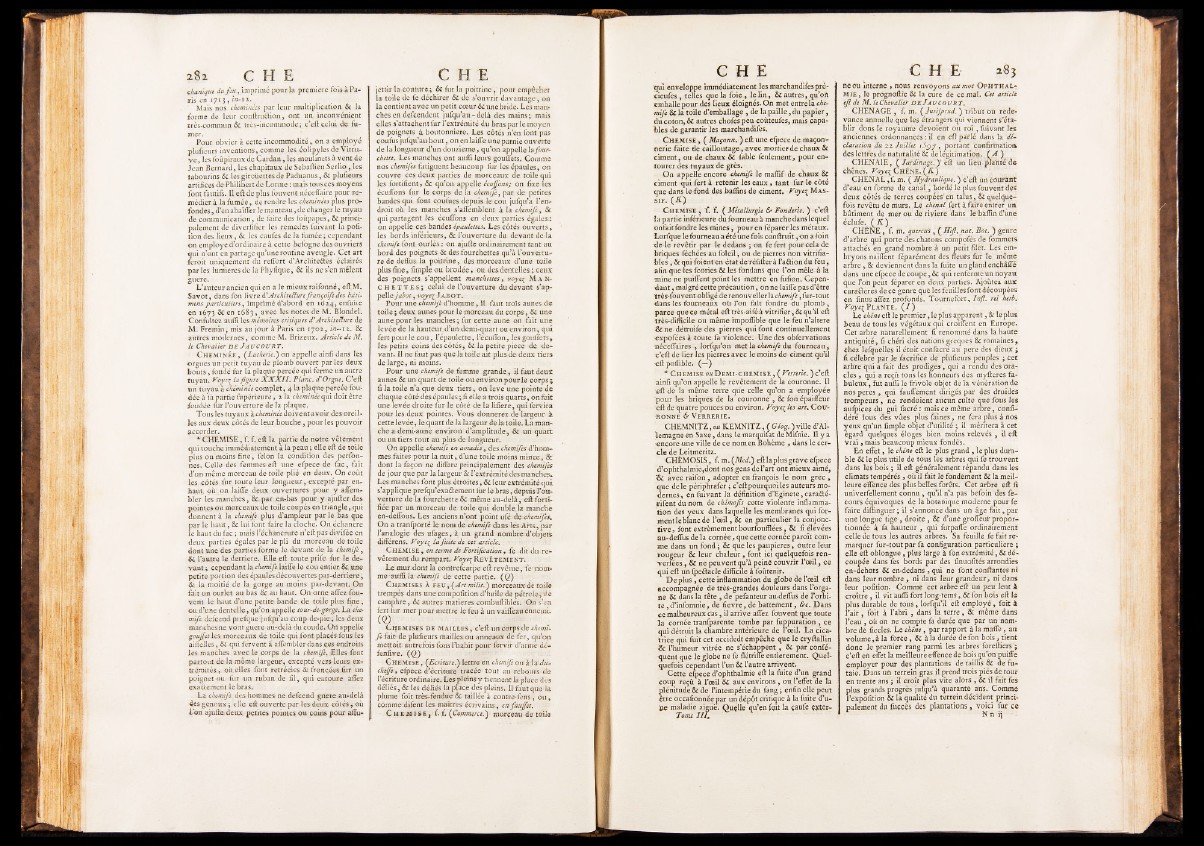
chanique du feu , imprimé pour la première fois à Paris
en 1713, in-iz.
Mais nos cheminées par leur multiplication & la
forme de leur conftru&ion, ont un, inconvénient
très-commun & très-incommode; c’eft celui die fumer.
Pour obvier à cette incommodité , on a employé
plufieurs inventions, comme les, éolipyles de Vitru-
v e , les foûpiraux de Cardan, les moulinets à vent de
Jean Bernard, les cbapitaux de Sebaftien Serlio, les
tabourins 8c les girouettes de Paduanus, 8c plufieurs
artifices de Philibert de Lorme : mais tous ces moyens
font fautifs. Il eft de plus, fouvent néceflaire pour remédier
à la fumée, de rendre les cheminées plus profondes
, d’en abaifler le manteau, de changer le tuyau
de communication, de faire des foûpapes, & principalement
de diverfifier les remedes fuivant la pofi-
tion des lieux, & les caufes de la fumée ; cependant
on employé d’ordinaire à cette befogne des ouvriers
qui n’ont en partage qu’une routine aveugle. Cet art
feroit uniquement du reflort d’Architectes éclairés
par les lumières de la Phyfique, 8c ils ne s’en mêlent
guere.
L’auteur ancien qui en a le mieux raifonné, eftM.
Savot, dans fon livre d’Architecturefrançoife des bâti-
mens particuliers, imprimé d’abord en 1624, enluite
en 1673 & en 1683, avec les notes de M. Blondel.
Confultez aufii les mémoires critiques d'Architecture de
M. Fremin , mis au jour à-Paris en 1702, in - 12. &
autres modernes ,- comme M. Brizeux. Article de M.
le Chevalier d e JAUCOURT.
C heminée , (Lutherie.) on appelle ainfi dans les
orgues un petit tuyau de plomb ouvert par les deux
bouts, foudé fur la plaque percée qui ferme un autre
tuyau. Voys^ la figure X X X.II. Plane. d'Orgue. C ’eft
un tuyau à cheminée complet, 4 la plaque percée fou-
dée à fa partie fupérieure, 2 la cheminée qui doit être
fondée fur l’ouverture delà plaque.
Tous les tuyaux Acheminée doivent avoir des oreilles
aux deux côtés de leur bouche, pour les pouvoir
accorder*
*" CHEMISE, f. f. eft la partie de notre vêtement
qui touche immédiatement à la peau ; elle eft de toile
plus ou moins fine, félon la condition des perfon-
nes. Celle des femmes eft une efpece de fae, fait
d’un même morceau de toile plié en deux. On coût
les .cptés fur toute leur longueur, excepté par enr
haut, où; on: laiffe deux, ouvertures pour y aflem-
bler les manches, par ,en-bas pour y ajufter des
pointes ou morceaux de toile coupés en triangle, qui
donnent à la chemife plus d’ampleur par le bas que
par le haut, 8c lui font faire la cloche. Qn échancre
le haut du fac ; mais l’échancrure n’eft pas divifée en
deux parties égales par le pli du morééau de toile
dont une des parties forme le devant de la chemife,
8c l’autre le derrière. Elle eft toute prifè: fur le devant;
cependant la chemife laiffe le cou entier & u n e
petite portion des épaules-découvertes par-derriere,
de la moitié de la gorge au moins par-devant, On
fait un ourlet au bas 8c au haut. On orne: allez-fou-
vent le haut d’une petite bande de toile plus fine,
ou d’une dentelle, qu’on, appelle tour-dergorge, La .cher
mifa defeend pre.fque;jufqu’au coup-de-pie-.; les,deux
manche&ne vont guere au-delà du coude._Ori appelle
goujfet les morceaux fie toile qui font placés,fous, les
aiflelles, 8c qui fervent à alfembler dans ,çes endroits
les manches, avec le corps dè la chemife, Elles .font
partout de la-même largeur, excepté vers'leurs, ex-
tiémités, où. elles font rétrécies & froncées. fur Un
poignet ou fur un ruban de.fil, qui entoure allez
exaâement le bras.
La chemife. des hommes- ne defeend guere au-delà
dès genoux elle, eft ouverte par les,deux côtés;où
io n ajulxc deux, petites pointes ou coins pour alfujettir
la couture ; & fur la poitrine, pour empêcher
la toile de fe déchirer & de s’ouvrir davantage, on
la contient avec un petit coeur & une bride. Les manches
en defeendent jusqu’au - delà des mains ; mais
elles s’attachent fur l’extrémité du bras parle moyen
de poignets à, boutonnière. Les côtés n’en font pas
coufus jufqu’au bout, on entaille une parnie ouverte
de la longueur d’un douzième, qu’on appelle fourchette,
Les manches ont aufii leurs gouffets. Comme
nos chemifes fatiguent beaucoup fur les épaules, on
couvre ces deux parties de morceaux de toile qiti
les fortifient, 8c qu’on appelle écuJJ'ons; on fixe les
.édifions fur le corps de la chemife, par de petites
bandes qui font çoufues depuis le cou jufqu’a l’enr
droit où; les manches s’affemblent. à la chemife., 8c
qui partagent les édifions en deux parties égales.":
on appelle ces bandes épaulettes. Les côtés, ouverts,
les bords inférieurs, 8c l’ouverture du devant de la
chemife font ourlés : on ajufte ordinairement tant au
bord des poignets & des fourchettes qu’à l’ouverture
de deffus, la poitrine, des morceaux d’une toile
plus fine, fimple ou brodée, ou des dentelles.; ceux
des poignets s’appellent manchettes,. voye^ M a n c
h e t t e s ; celui de l’ouverture du devant s’ap-
pellejabot^yoye^ JABOT.
Pour une chemife d’homme, il faut trois aunes de
toile ; deux aunes pour le morceau du corps, 8c une
aune pour les manches ; fur eette aune on fait une
levée de la hauteur, d’un demi-quart ou environ , qui
fert pour le cou , l’épaulette, l’écuffon, lesgouffets,
les petits coins des côtés,. 8c la petite pièce de devant.
Il ne faut pas que là toile ait plus de deux tiers
de large, ni moins.
Pour une chemife de femme grande, il faut deux
aunes 8c un quart de toile ou environ pour le corps ;
fi la toile n’a que deux tiers, o n le v e une pointe de
chaque côté des épaules;, fi elle à trois quarts, onfait
une levée droite fur le côté de la lifiere, qui fervira
pour les deux pointes. Vous donnerez de largeur à
cettelevée, le quart de la largeur de la toile. La manche
a demi-aune environ d’amplitude, & un quart
ou un tiers tout au plus de longueur.
On appelle chemife en amadis, des. chemifes d’hommes
faites pour la nuit, d’une toile moins mince, &
dont la façon ne différé principalement des chemifes
de jour que par la largeur & l ’extrémité des manches.
Les manches font plus étroites, 8c leur extrémité qui
s’applique prefqu’exaélément fur le bras, depuis l’ouverture
de la fourchette & même au-delà, eft fprtt-
fiée par un morceau de toile qui double,la manche
en-deffous. Les anciens n’ont point uffrè&yçkemifes.
On a tranfporté le nom de chemife dans les Arts., par
l’analogie des ufages , à; un grand nombjced’objets
différens. Voyeç la fuite, de cet .article. ••
C hemise , en terme de Fortification, fe dit du revêtement
du rempart.. Voye^ Rev êtem en t .
Le mur.dont la contrefcarpe eft revêtue , ie r;nomr
me-aufii Wchemife de cette partie. (Q)
Chemises. À feu A n milit.') morceaux dé toile
trempés dans une compofition d’huile de pétrole,'de
camphre, 8c autres matières combuftibles. ’On stea
fert-lùr mer pour mettre le feu à un vaiffeau ènnemi.
m I
C hemises de mailles ,■ c’eft un corps.de chemife.
fait dè plufieurs mailles ou anneaux de fer, qu-’on
mettoit autrefois fous l’habit pour fervir d’arme dc-
fenfive. (Q)
C hemise , (Ecrituref) lettre en chemife ou àdiidu-
chtffe, efpece d’écriture tracée tout au rebours-de
l’écriture ordinaire. Les pleins y tiennent la place des
déliés, & les déliés la place des pleins, I|faut que la
plume foit très-fendue 8c taillée à contre-fens-; o u ,
comme difent les maîtres’écrivains, ertfdujfet.
C HE-Mi s e 3^ f. f, (Copwierceé) morceau de toile
qui enveloppe immédiatement lesmarchandifesprè-
cieufes, telles que la fo ie , le lin , 8c autres, qu’oft
emballe.pour des lieux éloignés. On met entrela chemife
& la toile d’emballage , de la pa ille , du p ap ier,
du coton, & autres chofes peu coûteufes, mais c apables
de garantir les marchandifes.
C hemisé , ( Maçonn. ) eft une efpece de maçonnerie
faite de cailloutage, avec mortier de chaux &
ciment, ou de chaux &c fable feulement> pour entourer
des tuyaux de grès.
On appelle encore chemife le maffif de chaux &
ciment qui fert à retenir les e au x , tant fur le côté
que dans le-fond des baflins de ciment. Voye^ Massif.
(JC)
C hemïS'E-, f. f. ( Métallurgie & Fohderie. ) c’eft
la partie inférieure du fourneau à manche dans lequel
onfait fondre les mines , pour en féparer les métaux.
Lorfque le fourneau a été une fois conftruit ,o n afoin
■ de le revêtir par le dedans ; on fe fert pour cela de
briques féohées -au foleil, ou de pierres non vitrifia-
-bles , & qui foient en état deréfifter à l’aétion du feu ,
afin que-les feories & les fondans que l’on mêle -à la
mine ne puiffent point les mettre en fufion. Cependant
, malgré cette précaution, on ne laiffe pas d’être
très-fouvent obligé de renouveller la ckemife, fur-tout
dans les fourneaux o ù l’on fait fondre du plomb,
parce que ce métal eft très-aifé à vitrifier-, & qu’il eft
très-difficile ou même rmpoflible que le feu n’altere
& ne - détruife des pierres qui font continuellement
expofées à toute fa violence. Une des obfervations
■ néceffaires , lorfqu’on met la chemife du fourneau,
c ’eft de lier les pierres avec le moins de ciment qu’il
■ eftpofîible. (—)
* C h em is e ouD em i-c h eMi s e , ( Verrerie. ) c’ eft
ainfi qu’on appelle le revêtement de la couronne. 11
eft dè la même terre que celle qu’on a employée
pour le s briques de la couronne , & fon épaiffeur
eft de quatre pouces ou environ. Voyelles C ouro
n n e 6 *V e'r r e r ie .
CHEMNITZ, ou KEMNITZ R ( Géog. ) ville d’Allemagne
en S a x e , dans le marquifat de Mifnie. Il y a
^encore une ville de ce nom en Bohème , dans le cerc
le de Leitmeritz.
CHÊMÔSrS , f. m. (Med.') eft la.plus grave efpece
d’ophthalmie,dont nos gens de l’art ont mieux aimé,
■8c avec ra ifon , adopter en françois le nom grée ,
que d ele périphrafer ; c’eft pourquoi les auteurs mod
ern es, en fuivant la définition d’Eginete, caraêté-
yifent du nom de chémojis cette violente inflammation
des yeux dans laquelle les membranes qui forment
le blanc de l’oe il, & en particulier la conjonct
iv e , font extrêmement bourfoufflées, & fi élevées
au-deffus de la cornée, que cette cornée paroît comme
dans un fond ; & que les paupières, outre leur
rougeur 8c leur chaleur, font ici quelquefois renversées
, & ne peuvent qu’à peiné couvrir l*oeil, c e
qui eft un fpeétacle difficile à loûtenir.
De plus , cette inflammation du globe de l’oeil eft
accompagnée de très-grandes douleurs dans l’organe
& dans la tête , de pefanteur au-deffus de l’orbite
, d’infomnie, de fievre, de battement, &c. Dans
ce malheureux cas, il arrive affez foüvent que toute
la cornée tranfparente tombe par fuppuration , ce
qui détruit la chambre antérieure de l’oeil. La cicatrice
qui fuit cet accidedt empêche que le cryftallin
8c l’humeur vitrée ne s’échappent , & par çonfé-
quent que le globe ne fe flétriffe entièrement. Quelquefois
cependant l’un & l’autre arrivent.
Cette efpece d’ophthalmie eft la fuite d’un grand
coup reçû à l’oeil 8c aux environs, ou l’effet de la
plénitude & de l’intempérie du fang ; enfin elle peut
être occasionnée par un dépôt critique à la fuite d’u-
üe maladie aiguë. Quelle qu’en foit la çaiifo çxter-
7om IIl.
fieoü interne , nous renvoyons au mot O ph t h AL*
mie , le prognoftre & la cure de ce mal. Cet article
éjl de M. le Chevalier, D E J A u t o u k t .
CHÈNAGE , f. m. ( Jurijprud. ) tribut ôü redevance
annuelle que les étrangers qui viennent s’établir
dons le royaume dévoient ôu roi , ‘fuiviah't les
anciennes ordonnances : il en eft paflé dans là déclaration
du xx Juillet i i ÿ j , portant confirmation
des lettres de naturalité 8c dé légitimafion.. ( A )
CHENAIE, ( Jardinageif eft un lieu juanté de
chêiies. Voye{ C H ên)e. ‘( E ) .
CHENAL ,f. m. f Hydraulique. ) c’eft un côUrànt
d’eau en forme de canal., bordé le plus fouvent des
deux côtés de terres coûpées:en talus, 8c quelquefois
revêtu de murs. Lç chenaf fert à faire entrer urt
bâtiment de mer ou de riviere dans le bâffinü’urie
éclufe.^ ( K. )
CHÊNE, f. rti. quercus , ( Hifi.nat. Pot. ) genre
d’arbre qui porte des chatons compofés de fommets
attachés en grand nombre à un petit filet. Les embryons
naiffent féparémeht des fleuïs fur le même
arbre , & deviennent dans la fuite un gland enchâffé
dans une efpece de coupe, 8c qui renfermé un noyau
que l’on peut féparer en deux parties. Ajoutez aux
carafteres de ce genre què les feuilles forit découpées
en finus affez profonds. TOurnefort, Infi. rei herb.
Voye{ Plan t e . ( / )
Le chêne eft le premier, lé plus apparent, & le plus
beau de tous les végétaux qui croiffent en Europe.
Cét arbre naturellement fi renommé dans la haute
antiquité, fi chéri des nations greques & romaines,
Chez lefquelles il ctoit cônfâcré aii pere des dieux ;
fi célébré par le facrifice de plufieurs peuples ; cet
àrbre qui a fait des prodiges, qui a rendu des oracles
, qui a reçu tous les honneurs des myfteres fa-
buléùx, fut aufii le frivole objet de la vénération de
nos perès , qui fauffement dirigés par dés druides
trompeurs , né rendoient aucun culte que fous leS
aufpices du. gui facré : mais ce même arbre, confi-
déré fous des vues plus faines, né fera plus à rtos
yeux qu’un fimple objet d’utilité ; il méritera à cet
égard quelques éloges bien moins "relevés , il eft
Vrai, mais beaucoup mieux fondés.
En effet, lé chêne eft le plus grand, le plus durable
& le plus utije dè tôùs lès arbres qui fe trouvent
dans les bois ; il eft généralèment répandu dans les
cliifiàts tempérés , où il fait lé fondement & là meilleure
eflènee dès plus belles forêts. Cét arbre eft fi
iiniverfellement connu, qü’il n’â pas befoin des fe-
cours équivbquès de la botanique moderne pour fe
faire diftinguer ; il s’annonce dans un âge fa it , par
une longue tige-, droite , 8c d’une groffèuï proportionnée
à & hauteur , qüi furpaffe ordinairement
celle de tous les autres arbres. Sa feuille fe fait remarquer
fur-tout par fa configuration particulière ;
elle eft ôblongue, plus large à fon extrémité, 8c découpée
dans fes bords par des finuofités arrondies
en-dehors & en-dedans , qui ne font confiantes ni
dans leur nombre , ni dans leur grandeur, ni dans
leur pofitiôn. Comme cet arbre efi un peu lent à
croître, il vit aufii fort Iông-tems,, & fon bois eft le
plus durable de tous, lorfqu’il èft employé, foit à
l’a i t , foit à l’abri , dans la terre, & même dans
l’êau , où on ne compte fa durée que par un nombre
dè fiecles. Lé chêne , par rapport à la maffe, an
volume, à la force, 8c à la durée dè fon bois, tient
donc le prertiier rang parmi les arbres foreftiers';
c’eft en effet la meilleure effence de bois qu’on puiffe
employer pour des plantations de taillis^ 8c de futaie.
Dans un terrein gras ii prend trois pies dè tour
en trente ans ; il croît plus vite alôrs , &: il fait fes
plus grands progrès jufqu’à quarante ans. Comme
Texpôfition & là qualité du terrein décident principalement
du fuccès des plantations, Voici fur ce
N n ij