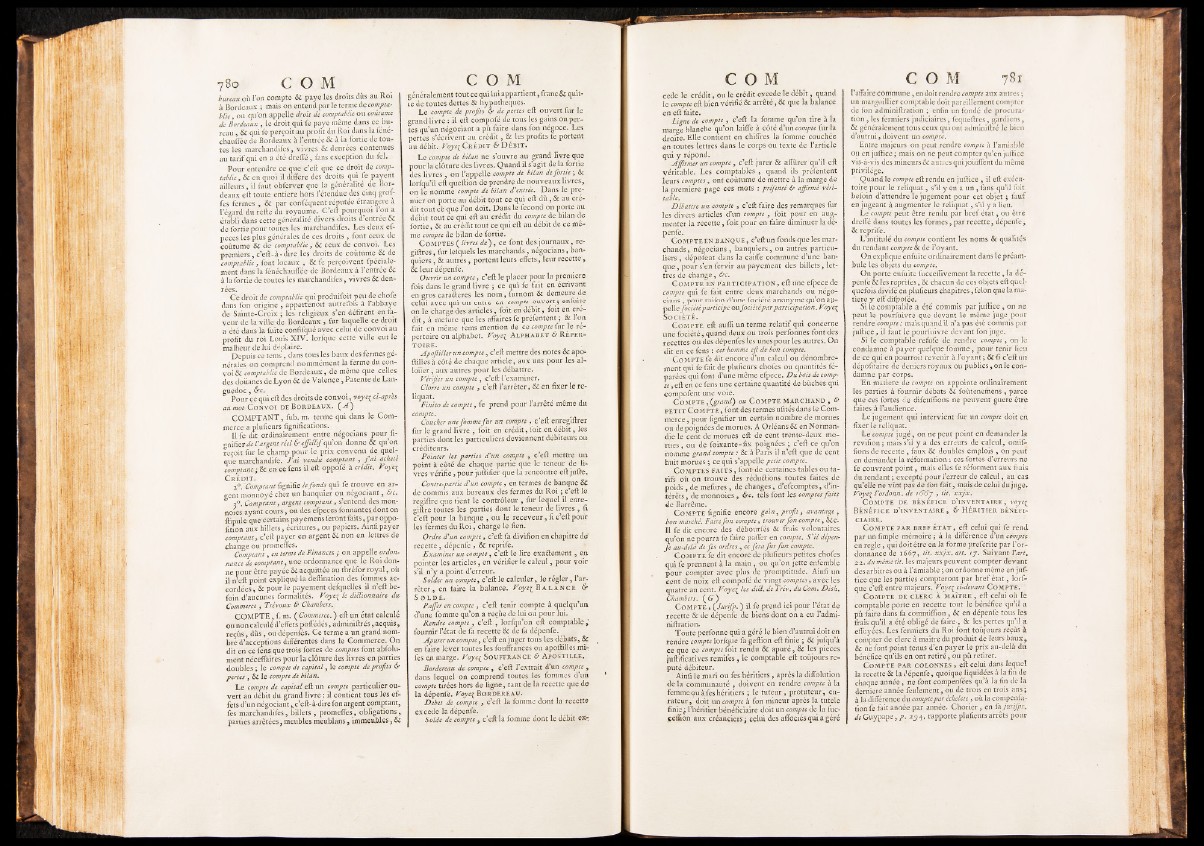
780 C O M
bureau où l’on compte 8c paye les droits dûs au Roi
à Bordeaux ; mais on entend par le terme de compta-
blic y ou qu’on appelle droit de comptablie ou coutume
de Bordeaux , le droit qui fe paye même dans ce bureau
, 8c qui fe perçoit au profit du Roi dans la féne-
chauffée de Bordeaux à l’entrée 8c à la fortie de tour
tes les marchandifes, vivres 8c denrees contenues
au tarif qui en a été dreffe, fans exception du fèl.
Pour entendre ce que e’eft que ce droit de comptablie
, & en quoi il différé des droits qui fe payent
ailleurs, il faut obferver que la généralité de Bordeaux
eft toute entière hors l’étendue des cinq grof- :
fes fermes , 8c par conféquent réputée étrangère à
l’égard du relie du royaume. C ’eft pourquoi l’pn a
établi dans cette généralité divers droits d’entrée 8c
de fortie pour toutes les marchandifes. Les deux ef-
peces les plus générales de ces droits , font ceux de
coûtume 8c de comptablie , 8c ceux de convoi. Les
premiers, c’eft-à-dire les droits de coutume & de
comptablie , font locaux , 8c fe perçoivent fpéciale-
ment dans la fénéchauffée de Bordeaux à l’entrée ôc
à la fortie de toutes les marchandifes, vivres 8c den-
rées.
Ce droit de comptablie qui produifoit peu de chofe
dans fon origine , appartenoit autrefois a 1 abbaye
de Sainte-Croix ; les religieux s’en défirent en faveur
de la ville de Bordeaux , fur laquelle ce droit
a été dans la fuite confifqué avec celui de convoi au
profit du roi Louis XIV. lorfque cette ville eut le
malheur de lui déplaire. ,
Depuis ce tems, dans tous les baux des fermes générales.
on comprend nommément hi ferme du convoi
& comptablie de Bordeaux, de même que celles
des doiianes de Lyon & de V alence, Patente de Languedoc,
&c.
Pour ce qui eft des droits de convoi, voye^ a-après
au mot C o n vo i de Bordeaux. ( A )
COMPTANT, fub. m. terme qui dans le Commerce
a plufieurs lignifications.
Il fe dit ordinairement entre négocians pour lignifier
de l'argent réel 6* effectif qu’on donne & qu’on
reçoit fur le champ pour le prix convenu de quelque
marchandife. J'ai vendu comptant , j ai acheté
comptant; 8c en ce fens il eft oppofé à crédit. Vofe^
C r é d it .
10 .'Comptant fignifie le fonds qui fe trouve en argent
monnoyé chez un banquier ou négociant, 6rc.
?°. Comptant, argent comptant, s’entend des mond
e s ayant cours, ou des efpeces fonnante^ dont on
ftipule que’certains payemens feront faits, par opposition
aux billets, écritures, ou papiers. Ainfi payer
comptant, c’eft payer en argent 8c non en lettres de
change ou promenés. ■
Comptant, en terme dé Finances ; on appelle ordonnance
de comptant, une ordonnance que le Roi donne
pour être payée Sc acquittée au thréfor royal, où
il n’eft point expliqué la deftination des fommes accordées
, & pour le payement defquelles il n’eft be-
foin d’aucunes formalités. Voye{ le dictionnaire du
Commerce , Trévoux & Chambers.
COMPTE, f. m. ( Commerce. ) eft un état calculé
ou non calculé d’effets poffédés, adminiftrés, acquis,
reçus, dûs, oit dépenfés. Ce terme a un grand nombre
d’acceptions différentes dans le Commerce. On
dit en ce fens que trois fortes de comptes font abfolu-
mënt néceflaires pour la clôture des livres en parties
doubles ; le compte de capital, le compte de profits &
pertes , 8c le compte de bilan.
Le compte de capital eft un compte particulier ouvert
au débit du grand livre : il contient tous les effets
d’un négociant %c’eft-à-dire fon argent comptant,
fes marchandifes, billets , promeffes, obligations,
parties arrêtées,meubles meublans, immeubles, 8c
C O M
généralement tout ce qui lui appartient, franc 8c quitte
de toutes dettes & hypotheques.
Le compte de profits & de pertes eft ouvert fur le
grand livre : il eft compofé de tous les gains ou pertes
qu’un négociant a pû faire dans fon négoce. Les
pertes s’écrivent au crédit, & les profits fe portent
au débit* Voye\_ Crédit & D ébit.
Le compte de bilan ne s’ouvre au grand livre que
pour la clôture des livres. Quand il s[agit de la fortie
des livres , on l’appelle compte de bilan de fortie ; &
lorfqu’il eft queftion de prendre de nouveaux livres,
on le nomme compte de bilan d'entrée. Dans le premier
on porte au débit tout ce qui eft dû , & au crédit
tout cfe que l’on doit. Dans le fécond on porte au
débit tout ce qui eft au crédit du compte de bilan de
fortie, & au crédit tout ce qui eft au débit de ce même
compte de bilan de fortie.
C omptes ( livres de ) , ce font des journaux, re-
giftres, fur lefquels les marchands, négocians, banquiers
, & autres, portent leurs effets, leur recette,
8c leur dépenfe. .
Ouvrir un compte, c’eft le placer pour la première
fois dans le grand livre ; ce qui fe fait en écrivant
en gros caractères les nom, furnom & demeure de
celui avec qui on entre en compte ouvert ; enfuite
on le charge des articles, foit en débit, foit en credit
, à mefure que les affaires fe prél’entent ; & l’on
fait en même tems mention de ce compte fur le repertoire
ou alphabet. Voye^ Alphabet & Répertoire.
Apojlillerun compte, c’eft mettre des notes 8c apo-
ftilles à côté de chaque article, aux uns pour les allouer
, aux autres pour les débattre.
Vérifier un compte , c’eft l’examiner.
Clorre un compte , c’eft l’arrêter, 8c en fixer le reliquat.
Finito de compte, fe prend pour l’arrêté même du
compte. {
Coucher une fomme fur un compte , c ’eft enregiftrer
fur le grand livre , foit en crédit, foit en débit, les
parties dont les particuliers deviennent débiteurs ou
créditeurs.
Pointer les parties d'un compte , c ’eft mettre un
point à côté de chaque partie que le teneur de lèvres
v érifie, pour juftifier que la rencontre eft jufte.
Contre-partie d'un compte , en termes de banque &
de commis aux bureaux des fermes du Roi ; c’eft le
regiftre que tient le contrôleur , fur lequel il enre-
giftre toutes les parties dont le teneur de livres , fi
c’eft pour la banque , ou le receveur, fi c’eft pour
les fermes du R o i, charge lè fien.
Ordre d'un compte , c’eft fa divifion en chapitre de
recette, dépenfe , 8c reprife.
Examiner un compte, c’eft le lire exa&ement, en
pointer les articles, en vérifier le calcul, pour voir
s’il n’y a point d’erreur.
Solder un compte, c’eft le calculer, le régler, l’arrêter
, en faire la balance. Voye1 Ba l a n c e &
S o l d e .
Paffer en compte , c’eft tenir compte à quelqu’un
d’une fomme qu’on a reçûe de lui ou pour lui.
Rendre compte, c’eft , lorfqu’on eft comptable
fournir l’état de fa recette 8c de fa dépenfe.
Apurer un compte, c’eft en juger tous les débats, &
en faire lever toutes les fouffrances ou apoftilles mi-,
fes en marge. Voye{ Souffrance & Apostille.
Bordereau de compte , c’eft l’extrait d’un compte ,
dans lequel on comprend toutes les fommes d’un
compte tirées hors de ligne, tant de la recette que dç
la dépenfe. Voyeç Bordereau.
Debet de compte , c’eft la fomme dont la recette
excede la dépenfe.
Solde de compte, c’eft la fomme dont lç débit ex-
C O M
cede le crédit, ou le crédit excede le débit, quand
le compte eût bien vérifié 8c arrêté, 8c que la balance
en eft faite.
Ligne de compte , c’eft la fomme qu’on tire à la
marge blanche qu’on laiffe à côté d’un compte fur la
droite. Elle contient en chiffres la fomme couchée
en toutes lettres dans le corps ou texte de l’article
qui y répond.
Affirmer un compte , c’eft jurer & affûrer qu’il eft
véritable. Les comptables , quand ils préfentent
leurs comptes, ont coûtume de mettre à la marge de
la première page ces mots : préfenté & affirmé véritable.
Débattre un compte , c’eft faire des remarques fur
les divers articles d’un compte , foitspour en augmenter
la recette, foit pour en faire diminuer la dépenfe,
C ojvipte En b a n q u e , c’eft un fonds que les marchands
, ' négocians, banquiers, ou autres particuliers
, dépofent dans la caiffe commune d’une banque
, pour s’en fervir au payement des billets, lettres
de change, &c.
C om p te en p a r t ic ip a t io n , eft une efpece de
compte qui fe fait entre deux marchands ou négocians
, pour raifon d’une fociété anonyme qu’on appelle
fociété participe oufociété par participation. V?ye%
So c ié t é .
C om p te eft: aufli un terme relatif qui concerne
une fociété, quand deux ou trois perfonnes font des
recettes ou des dépenfés les unes pour les autres. On
dit en ce fens : cet homme eji de bon compte.
C om pte fe dit encore d’un calcul ou dénombrement
qui fe fait de plufieurs chofes ou quantités fé-
parées qui font d’une même efpece. Du bois de compte
, eft en ce fens une certaine quantité de bûches qui
compofent une voie.
C om pte yfgrand) ou C om p te march an d , &
p e t it C om p te , font des termes ufités dans le Commerce
, pour fignifier un certain nombre de morues
ou dé poignées de morues. A Orléans 8c en Normandie
le cent de morues eft de cent trente-deux morues
, ou de foixante-fix poignées ; c’eft ce qu’on
homme grand compte ; 8c à Paris il n’eft que de cent
huit morues ; ce qui s’appelle petit compte.
C omptes fa it s , font de certaines tables ou tarifs
où on trouve des rédu&ions toutes faites de
poids , de mefures, de changes, d’efeomptes, d’intérêts,
de monnoies , &c. tels font les comptes faits
de Barrême.
C om pte fignifie encore gain, profit, avantage ,
bon marché. Faire fon compte, trouver fon compte, 8cc.
Il fe dit encore des débourfés 8c frais volontaires
qu’on ne pourra fe faire paffer en compte. S 'il dépenfe
au-delà de fes ordres, ce fera fur fon compte.
C om pte fe dit encore de plufieurs petites chofes
qui fe prennent à la main, ou qu’on jette enfemble
pour compter avec plus de promptitude. Ainfi un
cent de noix eft compofé de vingt comptes, avec les
quatre aù cent. Voyeç les dicl. de Trév. du Corn. Disk.
Chambers. ( (r )
C om pte ,(Jurifp. ) il fe prend ici pour l’état de
recette 8c de dépenfe de biens dont on a eu l’admi-
niftration.
Toute perfonne qui a géré le bien d’autrui doit en
rendre compte lorfque fa geftion eft finie ; 8c jufqu’à
ce que ce compte foit rendu 8c apuré, 8c les pièces
juftificatives remifes, le comptable eft toûjours réputé
débiteur.
Ainfi le mari ou fes héritiers, après la diffolution
de la communauté , doivent en rendre compte à la
femme qu à fes héritiers ; le tuteur, protutéur , curateur
, doit un compte à fon mineur après la tutele
finie j l’héritier bénéficiaire doit un compte de la fuc-
çeffion aux créanciers j celui des affociés qui a géré
C O M 781
l’affaire commune, en doit rendre compte aux autres ;
un marguillier comptable doit pareillement compter
de fon adminiftration ; enfin un fondé de procuration
, les fermiers judiciaires, fequeftres, gardiens,
8c généralement tous ceux qui ont adminiftré le bien
d’autrui, doivent un compte.
Entre majeurs on peut rendre compte à l’amiable
ou en juftice ; mais on ne peut compter qu’en juftice
vis-à-vis des mineurs & autres qui joiiiffent du même
privilège.
Quand le compte eft rendu en juftice , il eft exécutoire
pour le reliquat, s’il y en a un , fans qu’il foit
befoin d’attendre le jugement pour cet objet ; fauf
en jugeant à augmenter le reliquat, s’il y a lieu.
Le compte peut être rendu par bref é ta t, ou être
dreffé dans toutes les formes, par recette, dépenfe,
8c reprife.
L’intitulé du compte contient les noms 8c qualités
du rendant compte 8c de i’oyant.
On explique enfuite ordinairement dans le préambule
les objets du compte.
On porte enfuite fucceflivement la recette, la dépenfe
8c les reprifes, 8c chacun de ces objets eft quelquefois
divifé en plufieurs chapitres, félon que la matière
y eft difpofée.
Si le comptable a été commis par juftice , on ne
peut le pourfuivre que devant le même juge pour
rendre compte : mais quand il n’ a pas été commis par
juftice , il faut le pourfuivre devant fon juge.
Si le comptable refufe de rendre compte, on le
condamne à payer quelque fomme, pour tenir lieu
de ce qui en pourroit revenir à l’oyant ; 8cfi c’eft un
dépôfitaire de deniers royaux ou publics, on le condamne,
par corps.
En matière de compte on appointe ordinairement
les parties à fournir débats 8c foûtenemens , parce
que ces fortes de difcüfixons ne peuvent guere être
faites à l’audience.
Le jugement qui intervient fur un compte doit en
fixer le reliquat.
Le compte jugé, on ne peut point en demander la
revifion; mais s’il y a des erreurs de calcul, omif-
fions de recette , faux 8c doubles emplois , ôn peut
en demander la réformation : ces fortes d’erreurs ne
fe couvrent point, mais elles fe réforment aux frais
du rendant ; excepté pour l’erreur de calcul, au cas
qu’elle ne vînt pas de fon fait, mais de celui du juge.
Voyêrff'ordonn. de i'ooy , tit. xxjx.
C om p te de bénéfice d’ in v en t a ir e , voye%
Bénéfice d’in v en t a ir e , & Héritier bénéfi-
c ia îr e .
C om pte par bref é t a t , eft celui qui fe rend
par un .fimple mémoire ; à la différence d’un compte
en réglé, qui doit être en la forme preferite par l’ordonnance
de 1667, tit. xxjx. art. iy. Suivant l'art,
22. du même tit. les majeurs peuvent compter devant
des arbitres ou à l’amiable ; on ordonne même en justice
que les parties compteront par bref é ta t, lorfque
c’eft entre majeurs. Voye^ ci-devant C om pte.
C ompte de clerc à maître , eft celui où le
comptable porte en recette tout le bénéfice qu’il a
pû faire dans fa commiflion , 8c en dépenfe tous les
frais qu’il a été obligé de faire-, & les pertes qu’il a
effuyees. Les fermiers du Roi font toûjours reçûs à
compter de clerc à maître du produit de leurs baux ,
& ne font point tenus d’en payer le prix au-delà du
bénéfice qu’ils en ont retiré, ou pû retirer.
C om pte par colonnes , eft celui dans lequel
la recette 8t la dépenfe, quoique liquidées à la fin de
chaque année, ne font compenfées qu’à la fin de la
derniere année feulement, ou de trois en trois ans ;
à la différence du compte par échelete, où la compenfa-
tion fe fait année par année. Chorier , en fa jurifpr.
de G uy pape, p. 294, rapporte plufieurs arrêts pour