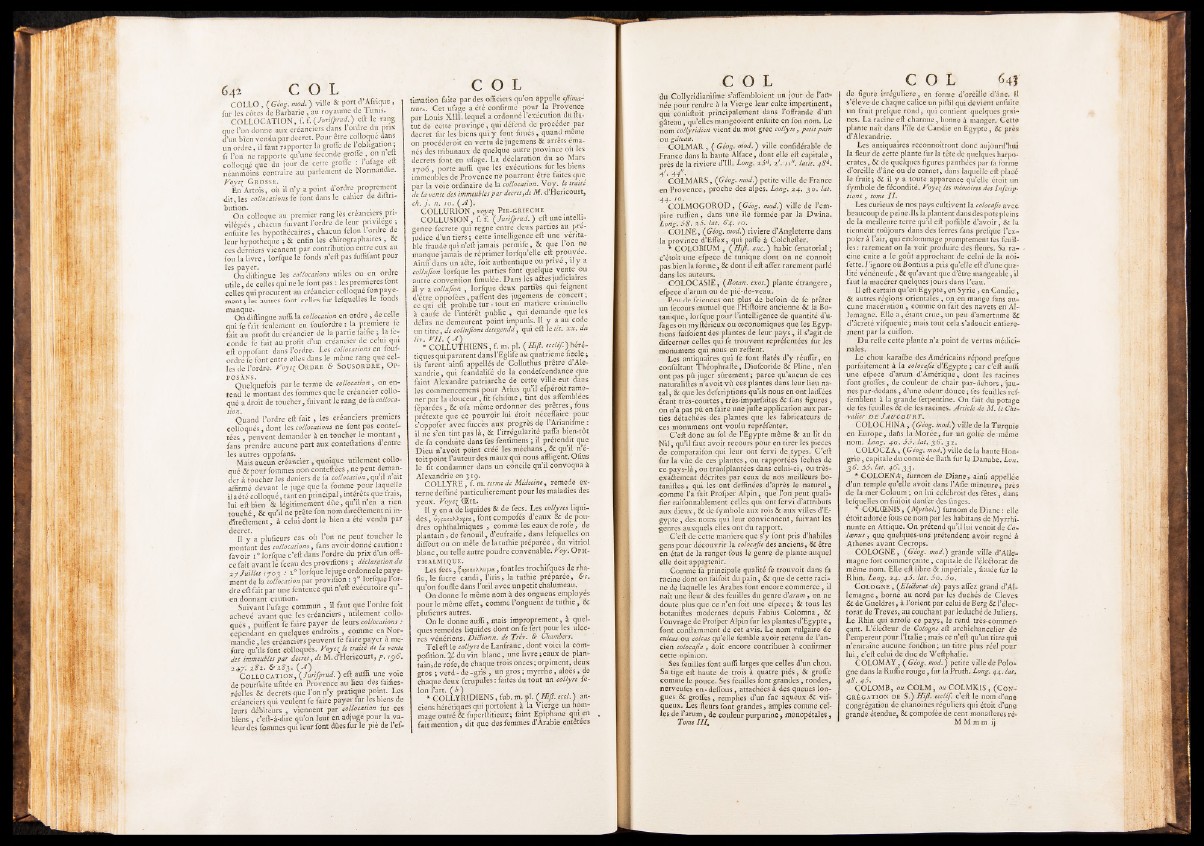
6 4 2 C O L
C O L LO , (Géog. nmd.) ville & port d’Afrique,
fur les côtes de Barbarie , au royaume de Tunis.
CO L LOCA TION , f. £.{Jurifprud.) eft le rang
que l’on donne aux créanciers dans 1 ordre du prix
d’un bien vendu par decret. Pour être colloque dans
un o rd re , il faut rapporter la groffe de l’obligation ;
fi l’on ne rapporte qu’une fécondé g roffe, <?n n e .
colloqué que du jour de cette groue : 1 utage e
néanmoins contraire au parlement de Normandie.
Voyez Grosse.
En Artois, où il n’y a point d’ordre proprement
d it, les collocations fe font dans le cahier de diitri-
bution. _ ,
On colloque au premier rang lès créanciers privilégiés
, chacun fuivant l’ordre de leur privilège ,
enfuite les hypothécaires, chacun félon l’ordre de
leur hypotheque ; & enfin les chirographaires , &
ces derniers viennent par contribution entre eux au
fou la liv re , lorfque le fonds n’eft pas fuffifant pour
les payer. . . . 1
On diftingue les collocations utiles ou en ordre
utile , de celles qui ne le font pas : les premières font
celles qui procurent au créancier colloqué fon payement;
les autres font" celles fur lefquelles le fonds
manque. . I ,,
On diftingue auffi la collocation en ordre , de celle
qui fp fait feulement en foufordre : la première fe
fait au profit du créancier dé la partie faifie ; la fécondé
fe fait au profit d’un créancier de celui qui
eft oppofant dans l’ordre. Les collocations en foui-
ordre fe font entre elles dans le meme rang que celles
de l’ordre. Voye{ Ordre & Sousordre, Op-
posàns. '
Quelquefois par le terme de collocation, on en-
tend le montant des fommes que le créancier cOllo- "
que a droit de toucher, filivant le rang.de f a Mlocn-
tion.
Quand l’ordre eft fait , les créanciers premiers
colloqués, dont les collocations ne font pas contef-
tées , peuvent demander à en toucher le montant,
fans prendre aucune part aux conteftations d entre
les autres oppofans. _
Mais aucun créancier , quoique utilement collo-
. qué & pour fommeS non conteftées, ne peut demander
k toucher les deniers de fa collocation, qu’il n ait
affirmé devant le juge que la fomme. pour laquelle, j
ila été colloqué, tant en principal, intérêts que frais,
lui eft bien & légitimement dûe, qu’il n’en a rien
touché & qu’il ne prête fon nom direftement ni m-
<Kre£iement, à celui d o n tlp bien a été vendu par
decret.
Il y a plufieurs cas où l’on ne peut toucher le
montant des collocations, fans avoir donne caution.
fa voir i ° lorfque c ’eft dans l’ordre du prix d’un office
fait avant le fceau des provifions ; déclaration du
z j Juillet 1-102, I 20 lorfque le juge ordonne le payement
de la collocation par proyifion : 3 ^lorfque l’ordre
eft fait par une fentence qui n eft executoire qu -
en donnant caution. .
Suivant l’ufage commun , il faut que 1 ordre foit
achevé avant que les créanciers, utilement colloqués
, puiffent fe faire payer de leurs collocations :
cependant en quelques endroits , comme en Normandie
, les créanciers peuvent fe faire j>ayer a me-
fure qu’ils font cblloqüés. Voye%_ le traite de la vente
des immeubles par decret, de M.d’H ericourt, p. 196.
& 283. {A )
C o l l o c a t i o n , ( Jurifprud. ) eft auffi une voie
de poürfuite ufitée en Provence au lieu des faifies-
réelles & decrets que l’on n’.y pratique point. Les
créanciers qui veulent fe taire payer fur les biens de
leurs débiteurs , viennent par collocation fur ces
biens , c’eft-à-dire qù’on leur en adjuge pour la valeur
des femmes qui leur font dues fur le pie de 1 ef-
C O L
timation faite par des officiers qu’on appelle ejlima-
teurs. Cet ufage a été confirmé pour la Provence
par Louis X III. lequel a ordonné l’exécution du fta-
tut de cette province, qui défend de procéder j>ar
decret fur les biens qui y font fitués , quand meme
on procéderoit en vertu de jugemens & arrêts émanés
des tribunaux de quelque autre province où les
decrets font en ufage. L a déclaration du 20 Mars
1706 , porte auffi que les executions fur lesbiens
immeubles de P rovence ne pourront etre faites qim
par la voie ordinaire de la collocation. Voy. le traite
de la vente des immeubles par decret3de M. d Hericourt,
ch. j . n. 10. {A ) .
CO L LU R IO N , voyei Pie-grieche
C O L LU S IO N , f. f. ( Jurifprud. ) eft uneintelh-
gence fecrete qui régné entre deux parties au préjudice
d’un tiers ; cette intelligence eft une véritable
fraude qui n’eft jamais permife, & que l’on ne
manque jamais de réprimer lorsqu'elle eft prouvée.
Ainfi dans un afte, foit authentique ou p riv e , u y a
collujion lorfque les parties font quelque vente ou
autre convention fimulée. Dans les aétes judiciaires
i l y a collujion , lorfque deux parties qui feignent
d’être oppofées, paffent des jugemens de concert ;
ce qui eft prohibé fur - tout en matière criminelle
à caufe de l’intérêt public , qui demande que les
délits ne demeurent point impunis. Il y a au code
un titre, de collujione detegendâ, qui eft le tit. xx. du
lïv. VII. {A ) , ,
* COL LUTHIENS, f. m. pl. ( Hijl. ecclef. ) hérétiques
qui parurent dansl’Eglife au quatrième fiecle ;
ils furent ainfi appellés de Colluthus prêtre d’Alexandrie,
qui feandalifé de la condefcendance que
Paint Alexandre patriarche de cette ville eut dans
les commencemens pour Arius qu’il efperoit ramener
par la douceur, fit fchifme, tint des affemblées
féparées , & ofa même ordonner des prêtres, fous
prétexte que ce pouvoir lui etoit neceffaire pour
s ’oppofer avec fuccès aux progrès de l’Arianilme :
il ne s’en tint pas là , & l’irrégularité paffa bien-tôt
de fa conduite dans fes fentimens ; il prétendit que
Dieu n’ avoit point créé les mechans, & qu il ne-
toit point l’auteur des maux qui nous affligent. Ofius
le fit condamner dans un concile qu’il convoqua à
Alexandrie en 319.
C O L L Y R E , f. m. terme de Médecine, remede externe
deftiné particulièrement pour les maladies des
yeux. Voye^ OEil. .
Il y en a de liquides & de fecs. Les collyres liquid
e s , vVp«°xx«p<*,fontcompofés d’eaux & de poudres
ophthalmiques , comme les eaux de rofe , de
plantain, de fenouil, d’eufraife, dans lefquelles on
diffout ou on mêle de latuthie préparée, du vitriol
blanc, ou telle autre poudre convenable. V>y. O ph-
THALMIQUE. <
Les fe c s , ^nponoxxapia. , font les trochifcjues de rha-
fis , le fucre candi, l’ir is , la tuthie préparée, &c.
qu’on fouffle dans l’oeil avec un petit chalumeau.
On donne le même nom à des onguens employés
pour le même effet, comme l’onguent de tuthie, ôc
plufieurs autres.
On le donne auffi, mais improprement, à quelques
remedes liquides dont on fe fert pour les ulcérés
vénériens. Dictionn. de Trev. & Chambers.
Te l eft le collyre de Lanfranc, dont voici la composition.
i f du vin blanc, une livre ; eaux de plantain,
de rofe,d e chaque trois onces;orpiment, deux
gros ; verd- d e-gris , un gros ; myrrhe, alo ë s, de
chaque deux fcrupules : faites du tout un collyre félon
l’art. ( b )
* COLLYRIDIENS, fub. m. pl. ( Hijl. ccd. ) anciens
hérétiques qui portaient à la Vierge un hommage
outré & fuperftitieux ; faint Epiphane qui en
fait mention, dit que des femmes d’Arabie entêtees
C O L
du Collyrxdianifme s’affembloient un jour de I’ait-
née pour rendre à la Vierge leur culte impertinent,
qui cônfiftoit principalement dans l’offrande d ’un
gâteau, qu’elles mangèoient enfuite en fon nom. Le
nom collyridien vient du mot grec collyre , petit pain
ou gâteau.
COLM A R , ( Géog. rtiod.j ville confidérable de
France dans la haute Alface, dont elle eft capitale ,
près de la riviere d’Ill. Long. z5d. z'. 11". latït. 48*.
4 '. 4 4 " ’
COLM A RS, {Géog. mod.) petite ville de France
en Provence, proche des alpes. Long. z4. g o. lat.
4 4 . io.~r :
COLM OGO RO D , {Géog. mod.) ville de l’empire
ruffien, dans une île formée par la Dwina.
Long. 58. z5. lat. €4. 10.
CO LN E , {Géog. mod.) riviere d’Angleterre dans
la province d’ Effex, qui paffe à Colcheftér.
* COLOBIUM , {Hijl. anc.') habit fenatorial;
c’était une efpece- de tunique dont on ne connoît
pas bien la forme, & dont il eft affez rarement parlé
dans les auteurs.
COLO CASIE , {Botan. exot.) plante étrangère,
efpece d’arum ou de pié-de-veau.
Peu- de fciences ont plus de befoin de fe prêter
un fecours mutuel que l’Hiftoire ancienne & la Botanique,
lorfque pour l’intelligence de quantité d’u-
fages ou myftérieux ou oeconomiques que les Egyptiens
faifoient des plantes de leur p a y s , il s’agit de
difeerner celles qui fe trouvent reprefentées fur les
monumens qui nous en reftent.
Les antiquaires qui fe font datés d’y réuffir, en
confultant Théophrafte, Diofcoride & Pline, n’en
ont pas pû juger sûrement ; parce qu’aucun de ces
naturaliftes n’avoit vu ces plantes dans leur lieu nat
a l , & que les deferiptions qu’ils nous en ont laiffées
«tan t très-courtes, très-imparfaites & fans figures ,
on n’a pas pû en faire une jufte application aux parties
détachées des plantes que les fabricateurs de
ces monumens ont voulu repréfenter,
C ’eft donc au fol de l’Egypte même & au lit du
N il , qu’il faut avoir recours pour en tirer les pièces
de comparaifon qui leur ont fervi de,types. C ’eft
fur la vûe de ces plantes, ou rapportées feches de
ce pav s-là, ou tranfplantées dans celui-ci, ou très-
exa&ément décrites par ceux de nos meilleurs bo-
taniftes, qui les ont deffinées d’après le naturel,
-comme l’a fait Profper Alpin, que l’on peut qualifier
raifonnablement celles qui ont fervi d’attributs
aux dieux, & de fymbole aux rois & aux v illes d’Egypte
, des noms qui leur conviennent, fuivant les
genres auxquels elles ont du rapport.
C ’eft de cette maniéré que s’y font pris d’habiles
gens pour découvrir la colocajieA.es anciens, & être
en état de la ranger fous le genre de plante auquel
elle doit appartenir.
Comme fa principale qualité fe trouvoit dans fa
racine dont on faifoit du p ain, & que de cette racine
de laquelle les Arabes font encore commerce, il
naît une fleur & des feuilles du genre d'arum, on ne
doute plus que ce n’en foit une efpece; & tous les
botaniftes modernes depuis Fabius Colomna, &
l’ouvrage de Profper Alpin fur les plantes d’E gy pte ,
font conftamment de cet avis. L e nom vulgaire de
çulcas ou colcas qu’elle femble avoir retenu de l’ancien
colocajia, doit encore contribuer à confirmer
cette opinion.
Ses feuilles font auffi larges que celles d’un chou.
Sa tige eft haute de trois à quatre p ie s , & groffe
comme le pouce. Ses feuilles font g randes, rondes ,
nerveufes en-deffous, attachées à des queues longues
& groffes, remplies d’un fuc aqueux .& vif-
queux. Les fleurs font grandes, amples comme celles
de l’arum, de couleur purpurine , monopétales,
Tome ƒƒƒ.
C O L f>4%
de figuré irrégulière, en forme d’orèiile d’âne. Il
s’élève de chaque calice un piftil qui devient enfuite
un fruit prefque rond, qui contient quelques graines.
La racine eft charnue, bonne à manger. Cette
plante naît dans l’île de Candie en Egypte, & près
d’Alexandrie.
Les antiquaires reconnoîtront donc aujourd’hui
la fleur de cette plante fur la tête de quelques harpo-*
crates, & de quelques figures panthées par fa forme
d’oreille d’âne ou de cornet, dans laquelle eft placé
le fruit; & il y a toute apparence qu’elle étoit un
fymbole de fécondité. V?yei les mémoires des lnfcrip-
tions , tome Th
Les curieux de nos pàys cultivent la colocàjie avec
beaucoup de peine.Ils la plantent dans des pots pleins
de la meilleure terre qu’il eft poffible d’a v o ir, & la
tiennent toûjours dans des ferres fans prefqiie l’ex-
pofer à l’air, qui endommage promptement lès feuille
s: rarement on la voit produire dès fleuts. Sa racine
cuite a le goût approchant de celui de la noi-
fette. J ’ignore où Bontius a pris qu’elle eft d’une qualité
vénéneufe, & qu’avant que d’être m angeable, il
faut la macérer quelques jours dans l’eau.
Il eft certain qu’en E gy pte, en S y r ie , en C andie,
& autres régions orientales , on en mange fans aucune
macération, comme on fait des navets en Allemagne.
Elle a , étant crue, un peu d’amertume &
d’âcreté vifqueufe ; mais tout cela s ’adoucit entièrement
par la cuiffon.
D u refte cette plante n’a point de vertus médicinales.
L e chou karaïbe des Américains répond prefque
parfaitement à la colocafie d’Egypte ; car c ’eft aufli
une efpece d’arum d’Amérique, dont les racines
font groffes, de couleur de chair par-dehors, fau nes
par-dedans, d’une odeur douce ; fes feuilles ref-
femblent à la grande ferpentine. On fait dû potage
de fes feuilles & de fes racines. Article de M. Le Chevalier
DE J a UCOURT.
COLOCHINA, {Géog. hiod.) ville de la Turquie
en Europe, dafts la Morée:, fur un golfe de même
nom. Long. 4 0 . 5}5 .viat. g(y. g z .
CO LO C ZA , {Géog. modi) ville de la haute Hon-<
g rie , capitale du comté de Bath fur le Danube. Lon.
55. lat. 4G. g g .
* COLOENA, furnom de Diane, ainfi appellée
d’un temple qu’elle a voit dans l’Afie mineure, près
de la mer Coloum ; on lui célébroit des fê te s, dans
lefquelles on faifoit danfer des finges.
* COLOEN1S, {Mytkol.') furnom de D iane ; elle
étoit adorée fous ce nom par les habitans de Myrrhi-
nunte en Attique. On prétend qu’il lui venoit de Cm-
loenus t que quelques-uns prétendent avoir régné à
Athènes avant Cecrops.
COLO G NE, {Géog. mod.) gràndé ville d’Allemagne
fort commerçante, capitale de l’éleélorat de
même nom. Elle eft libre & impériale, fituée fur le
Rhin. Long. Z4. 4 5 . lat. 5o . 5 o,,
C ologne, {Electorat de) pays affez grand d’Allemagne
, borné au nord par les duchés de Cleves
& de Gueldres, à l’orient par celui de Berg & l’électorat
de Treves, au couchant par le duché de Juliers.
L e Rhin qui arrofe ce p ay s* le rend très-commerçant.
L ’élefteur de Cologne eft archichancelier de
l’empereur pour l’Italie ; mais ce n’eft qu’un titre qui
n’entraîne aucune fonétion ; un titre plus réel pour
lu i, c’eft celui de duc de Weftphalie,
COLOMAY, ( Géog. mod. ) petite ville de Polo*
gne dans la Ruffie rouge, fur la Pruth. Long. 44. U t.
4 8 .4 5 . .
COLOMB, ou C O LM , ou CO LM K IS , (Congrégation
de S .) Hiß. eccléf. c’eft le nom d’une
congrégation de chanoines réguliers qui étoit d’une
grande étendue, &: compofée de cent monafteres ré*
M M m m ij