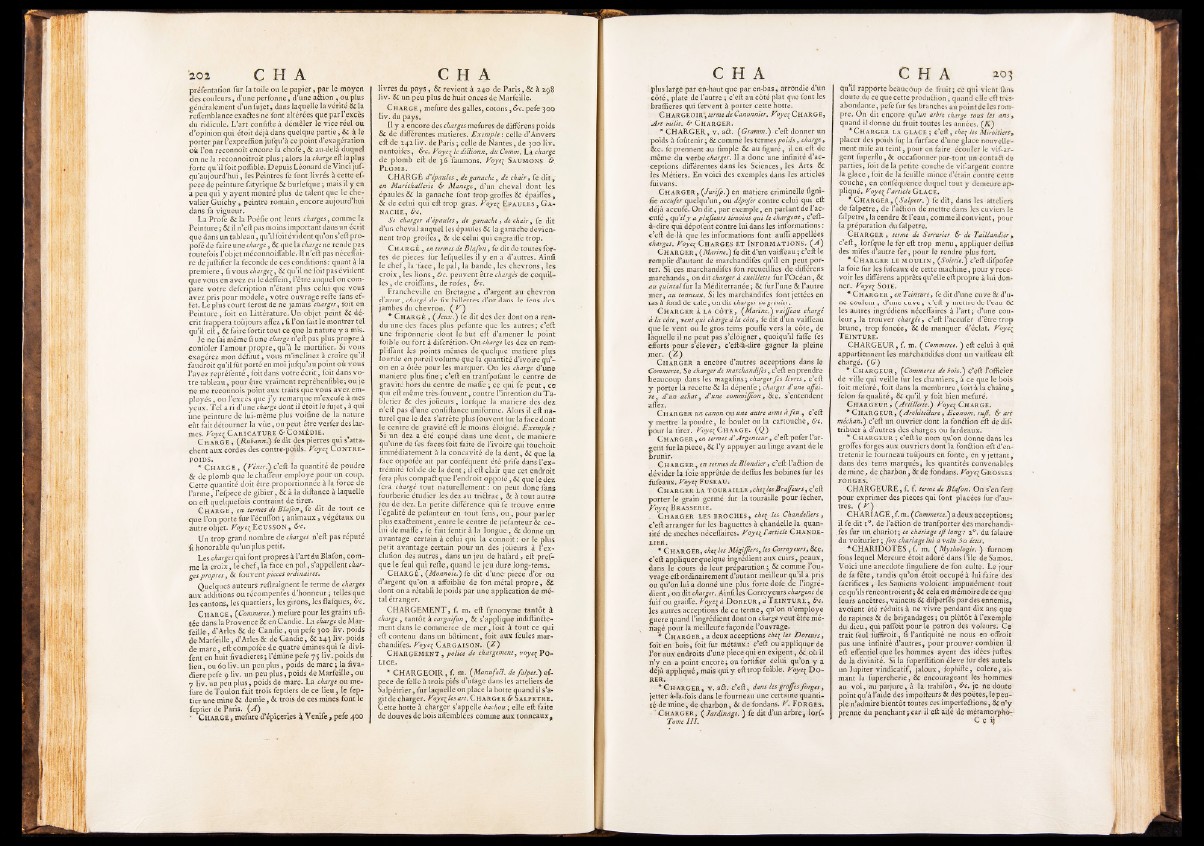
préfentation fur la toile ou le papier, par le moyen
des couleurs, d’une perfonne, d’une aûion , ou plus
généralement d’un fujet, dans laquelle la vérité & la
reffemblance exaltes ne font altérées que par l’excès
du ridicule. L ’art confifte à démêler le vice réel ou
d ’opinion qui étoit déjà dans quelque partie, & à le
porter par l’expreffion jufqu’à ce point d’exagération
oit l’on reconnoît encore la chofe, & au-delà duquel
on ne la reconnoîtroit plus ; alors la charge eft la plus
forte qu’il foit poffible. Depuis Léonard de Vinci juf-
qu’aujourd’hui, les Peintres fe font livrés à cette ef-
pece de peinture fatyrique & burlefque ; mais il y en
a peu qui y ayent montré plus de talent que le chevalier
G uichy, peintre romain, encore aujourd’hui
dans fa vigueur.
La Profe &c la Poéfie ont leurs charges, comme la
Peinture ; & il n’ell pas moins important dans un écrit
que dans un tableau, qu’il foit évident qu’on s’eft pro-
pofé de faire une charge, & que la charge ne rende pas
toutefois l’objet méconnoiffable. Il n'eft pas néceffai-
re de juftifier la fécondé de ces conditions : quant à la
première, fi vous ch a rg e& qu’il ne foit pas évident
que vous en avez eu le deffein, l’être auquel on compare
votre defeription n’étant plus celui que vous
avez pris pour modèle, votre ouvrage refte fans effet.
Le plus court feroit de ne jamais charger, foit en
Peinture, foit en Littérature. Un objet peint & décrit
frappera toujours affez, fi l’on fait le montrer tel
qu’il e ft , & faire fortir tout ce que la nature y a mis.
Je ne fai même fi une charge n’eft pas plus propre à
confoler l’amour propre, qu’à le mortifier. Si vous
exagérez mon défaut, vous m’inclinez à croire qu’il
faudroit qu’il fût porté en moi jufqu’au point où vous
l’avez repréfenté, foit dans votre écrit, foit dans vo tre
tableau, pour être vraiment repréhenfible; ou je
ne me reconnois point aux traits que vous avez employés
, ou l’excès que j ’y remarque m’exeufe à mes
yeux. Tel a ri d’une charge dont il étoit le fujet, à qui
une peinture de lui-même plus voifinè de la nature
eût fait détourner la vu e , ou peut être verfer des larmes.
Voye^ C a r ic a t u r e 6* C omed ie.
C h a r g e , (Rubann;) fedit des pierres qui s’attachent
aux cordes des contre-poïâs. Voye^ C o ntr e-
POIDS. I ,
* C harge, {Véner.) c’eft la quantité de poudre
6 de plomb que le chaffeur employé pour un coup.
Cette quantité doit être proportionnée à la force de
l’arme, l’efpece de gibier, & à la diftance à laquelle
on eft quelquefois contraint de tirer.
C h a r g e , en termes de Blafon, (e dit de tout ce
que l’on porte fur l’écuffon ; animaux , végétaux ou
autre objet. Voye{É c u s s o n , & c.
Un trop grand nombre de charges n’eft pas réputé
fi honorable qu’un plus petit.
Les charges qui font propres à l’art du Blafon, comme
la croix, le chef, la face en pal,; s’appellent charges
propres y & fouvent pièces ordinaires.
Quelques auteurs reftraignent le terme de charges
auxadditions ou récompenfes d’honneur ; telles que
les cantons, les quartiers, les girons, les flafques, &c.
C harge , {Commerce.') mefure pour les grains ufi-
tée dans la Provence & en Candie. La charge de Mar-
feille, d’Arles & de Candie, quipefe 300 liv. poids
de Marfeille, d’Arles & de Candie, & 243 liv. poids
de marc, eft compofée de quatre émines qui fe divi-
fent en huit fivadieres; l’émine pefe 75 liv. poids du
lieu , ou 60 liv. un peu plus, poids de marc ; la fiva-
diere pefe 9 liv. un peu plus, poids, de Marfeille, ou
7 liv. un peu p lus, poids de marc. La charge ou mefure
de Toulon fait trois feptiers de ce lieu , le fep-
tier une mine & demie, & trois de ces mines font le
feptier de Paris. (A )
• C harge , mefure d’épiceries à Y enife> pefe 400
livres du pa ys , & revient à 240 de Paris, & à 298
liv . & un peu plus de huit onces de Marfeille.
C harge , mefure des galles, cotons, &c. pefe 300
liv. du pays.
Il y a encore des charges mefures de différens poids
& de différentes matières. Exemple : celle d’Anvers
eft de 242 liv. de Paris ; celle de Nantes, de 300 liv .
nantoifes, &c. Voyeç le dictionn. du Comm. La charge
de plomb eft de 36 faumons. Voye{ Saumons &.
Plom b .
CHARGE d,'épaules, de ganache, de chair, fe dit,
en Maréchallerie & Manege, d’un cheval dont les
épaules & la ganache font trop greffes & épaiffes ,
& de celui qui eft trop gras. Voyeç Epaules , G a n
a ch e , &c.
Se charger d'épaules, de ganache, de chair, fe dit
d’un cheval auquel les épaules ôc la ganache deviennent
trop groffes, & de celui qui engrailfe trop.
C h a r g é , en termes de Blafon, fe dit de toutes fortes
de pièces fur lefquelles il y en a d’autres. Ainfi
le chef, la 'face, le pal, la bande, les chevrons, les
cro ix, les lions, &c. peuvent être chargés de coquilles
, de croiffans, de rofes, &c.
Francheville en Bretagne, d’argent au chevron
d’azur, chargé de fix billettes d’or dans le fens des
jambes du chevron. ( V )
* C h argé , {Jeux.) fe dit des dez dont on a rendu
une des faces plus pefante que les autres ; c’eft
une friponnerie dont le but eft d’amener le point
foible ou fort à diferétion. On charge les dez en rem-
pliffant les points mêmes de quelque matière plus
lourde en pareil volume que la quantité d’ivoire qu’on
en a ôtée pour les marquer. On les charge d’une
maniéré plus fine ; c’eft en tranfpofant le centre de
gravité hors du centre de maffe ; ce qui fe peut, ce
qui eft même très-fouvent, contre l’intention du Ta-
bletier & des joueurs, lorfque la matière des dez
n’eft pas d’une confiftance uniforme. Alors il eft naturel
que le dez s’arrête plus fouvent fur la face dont
le centre de gravité eft le moins éloigné. Exemple :
Si un dez a été coupé dans une dent, de maniéré
qu’une de fes faces foit faite de l’ivoire qui touchoit
immédiatement à la concavité de la dent, & que la
face oppofée ait par conléquent été prife dans l’extrémité
folide de la dent ; iî eft clair que cet endroit
fera plus compaft que l’endroit oppofe, & que le dez
fera chargé tout naturellement : on peut donc fans
fourberie étudier les dez au triâ ra c , & à tout autre
jeu de dez. La petite différence qui fe trouve entre
l’égalité de pefanteur en tout fens, o u , pour parler
plus exactement, entre le centre de pefanteur & celui
de maffe, fe fait fentir à la longue, & donne un
avantage certain à celui qui la connoît : or le plus
petit avantage certain pour un des joueurs à l’ex-
clufion des autres, dans un jeu de hafard, eft prelr
que le feul qui refte, quand le jeu dure long-tems.
C hargé , {Monnoie.) fe dit d’une1 piece d’or ou
d’argent qu’on a affoiblie de fon métal propre, &c
dont on a rétabli le poids par une application de métal
étranger.
CHARGEMENT, f. m. eft fynonyme tantôt à
charge, tantôt à cargaifon, & s’applique indiftinâe-
ment dans le commerce de mer, foit à tout ce qui
eft contenu dans un bâtiment, foit aux feules mar-
chandifes. Voye^ CARGAISON.. {Z )
C h a rg em en t , police de chargement, voye^ POLICE.
* CHARGEOIR, f. m. {Manufact. de falpet.) ef-
pece de Telle à trois piés d’ufage dans les atteliers de
Salpétrier, fur laquelle on place la hotte quand il s’agit
de charger. Voyelles art. C harger & Salpêtre.
Cette hotte à charger s’appelle bachou ; elle eft faite
de douves de bois affemblées comme aux tonneaux,
plus large par en-haut que par en-bas, arrondie d’un
-côté, plate de l’autre ; c’eft au côté plat que font les
■ braflieres qui fervent à porter cette hotte.
CHARGEOIR* terme de Canonnier. Voye^ CHARGE,
Art milit. & CHARGER.
* CHARGER, v . ad. {Gramm.) c’eft donner un
poids à foûtenir ; & comme les termes poids, charge,
&c. fe prennent au fimple & au figuré, il en eft de
même du verbe charger. Il a donc une infinité d’acceptions
différentes dans les Sciences, les Arts &
les Métiers. En voici des exemples dans les articles
fui vans.
C h a r g e r , {Jurifp.) en matière criminelle figrti*-
fie accufer quelqu’un, ou dépofer contre celui qui eft
déjà accufe. On dit, par exemple, en parlant de 1 ac-
eufé , qu 'ily a plujieurs témoins qui le chargent, c’eft-
à-dire qui dépofent contre lui dans les informations :
c’eft de-là que les informations font aufli appellées
charges. Voye{ CHARGES ET INFORMATIONS. {A )
C harger , {Marine.) fe dit d’un vaiffeau ; c’eft le
remplir d’autant de marchandifes qu’il en peut porter;
Si ces marchandifes fon recueillies de différens
marchands, on dit charger à cueillette fur l’Océan, &
au quintal fur la Méditerranée ; & fur f une & l’autre
mer, au tonneau. Si les marchandifes font jettées en
tas à fond de ca le, on dit charger en grenier.
CHARGER À la CÔTE, {Marine.) vaijfeau chargé
à là côte, vent qui charge à la côte , fe dit d’un vaiffeau
que le vent ou le gros tems pouffe vers la côte, de
laquelle il ne peut pas s’éloigner, quoiqu’il faffe fes
efforts pour s’élever, c’eft-à*dire gagner la pleine
^ner. ( Z )
C harger a encore d’autres acceptions dans le
Commerce. Se charger de marchandifes y c’eft en prendre
beaucoup dans les magafins ; charger fes livres, c’eft
y porter là recette & la dépenfe ; charger d'une affaire
y d'un achat y d'une commijjîon, &c. s’entendent
affez.
CHARGER un canon ou une autre arme à f e u , c’eft
y mettre la poudre, lé boulet ou là Caftouché, &c.
pouf la tirer. Voye[C h a r g e . (Q)
C harger , en termes d'Argenteur, c’ eft pofer l’argent
fur la pièce, & l’y appuyer au linge avant de le
brunir.
C h a r g er , en termes de Blondier, c’eft l’achon de
dévider la foie apprêtée de deffus les bobines fur les
fufeaux. Voye^FvSEAU.
C harger la tour a ille , che^les Braffeurs, c’eft
porter le grain germé fur la touraille pour fécher,
/Pbyeç Brasserie.
_ CHARGER LES BROCHES, che{ les Chandeliers ,
c’eft arranger fur les baguettes à chandelle la quantité
de meches néceffaires. Voye1 C article C handelie
r ,
* C harger, che^les MégiJJiers, les Corroyeurs, & c,
c’eft appliquerquelque ingrédient aux cuirs, peaux,
dans le cours de leur préparation ; & comme i’ou-
vrage eft ordinairement d’autant meilleur qu’il a pris
ou qu’on lui a donné une plus forte dofe de l’ingre-
dient > on dit charger. Ainfi les Corroy eurs chargent de
fuif ou graiffe. Voye^à D o reur, « T e in tu r e , &c.
les autres acceptions de ce terme, qu’on n’employe
guere quand l’ingrédient dont on charge veut être ménagé
pour la meilleure façon de l’ouvrage.
* C harger , a deux acceptions chei les Doreurs,
foit en bois, foit fur métaux : c’eft ou appliquer de
l’or aux endroits d’une piece qui en exigent, ôc.oii il
n’y en a point encore ; ou fortifier celui qu’on y a
déjà appliqué, mais qui y eft trop foiblô. Voye[ D orer.
* C h a r g e r , v . aft. c’eft, dans les groffes forges,
jetter à-la-fois dans le fourneau une certaine quantité
de mine, de charbon, & de fondans. V , Fo r g e s .
’ C harger, ( Jardinage. ) fe dit d’un arbre, lorf-
Tome I II.
quM rapporte beàücôup de fruit; cë qhi vient fiths
doute de ce que cette production j quand elle eft très-
abondante , pefe fur fes branches aü point de les rompre.
On dit encore qu 'un arbre charge tous les ans,
quand il donne dit friiit toutes les années, {K)
* C harger la glace ; e’eft, che[ lès Miroitiers,
placer des poids fuj: la furface d’une glace nouvelle*-
ment mife au teint, pour en faire écouler le Vif-argent
fuperflu, & occafionnér par-toiit un contait de
parties, foit de la petite couche de vif-argertt contre
la glace, foit de la feuille mince d’étàin contre cette
couche, en conféquertce duquel tout y demeure appliqué.
Voyè^l'article G LACE.
* C harger , {Salpetr. ) fe dit, dans les attelierâ
de falpetre, de l’aîtiôn de mettre dans les cuviers lé
falpetre, la cendre & l’eau, comme il convient, pour
la préparation du falpetre.
C h a r g e r , terme de Serrurier & de Taillandier,
c’eft, lorfque le fer eft trop menu, appliquer deffus
des mifes d’autre fer, pour le rendre plus fort.
* C harger le m o u l in , {Soierie.) c’eft difpofer
la foie fur les fufeaux de cette machine, pour y recevoir
les différens apprêts qu’elle eft propre à lui doii*
nef. VoyeçSÔiÉ.
* C harger , en Teinture, fe dit d’une cuve & d’u*
ne couleur ; d’une cu v e , c’eft y mettre de l’eau &C
les autres ingrédiens néceffaires à l ’art; d’une couleur,
la trouver chargée, c’eft l’accüfer d’être trop
brune, trop foncée, & de manquer d’éclat. Voye£
T einture.
CHARGEUR, f. m. ( Commerce. ) eft celui à qui.
appartiennent les marchandifes dont un vaiffeau eft
chargé. {G)
* C hargeu r, {Commercé de bois.) c’eft l’officier
de ville qui veillé (ilr les chantiers, à ce que le bois
foit mefuré, foit dans la membrure, foit à la chaîne ,
félon fa qualité, & qu’il y foit bien mefuré,
C hargeur , {Artillerie.) Voye[ C harge.
* CHARGEUR, {Architecture, Econom-, ruft. & art
méchan.) c'eft un ouvrier dont la foiifllon eft de distribuer
à d’autres des charges ou fardeaux.
* C hargeur ; c’eft le nom qu’on donne dans les
groffes forges aux ouvriers dont la fonâion eft d’entretenir
le fourneau toujours en fonte, en y jettant,
dans des tems marqués, les quantités convenables
déminé, de charbon, & de fondans. VoyeiGrosses
forgesY^ f
CHARGEURÉ, f. f. terme de Blafon. On s’en fert
pour exprimer des pièces qui font placées fur d’autres.
( V )
CHARI AGÉ, f. m. {Commerce.) a deux acceptions;
il fe dit i° . de l’allion de ttahfporter des marchandises
fur un chariot; ce chariage eft long: 20. du falaire
du voiturier ; fon chariage lui a valu. So écus.
*CHARIDOTÈS, f. m. ( Mythologie. ) furnom
fous lequel Mercure étoit adoré dans Hie de Samos.
Voici une anecdote finguliere de fon culte. Le jour
de fa fê te , tandis qu’on étoit occupé à lui faire des
facrifices | les Samiens voloient impunément tout
ce qu’ils rencontroient ; & cela en mémoire de ce'que
leurs ancêtres, vaincus & difperfés par des ennemis,
avoient été réduits à ne vivre pendant dix ans que
de rapines & de brigandages ; ou plutôt à l’exemple
du dieu, qui paffoit pour le patron des Voleurs. Ce
trait feul fuffiroit, fi l’antiquité né nous en offroit
pas une infinité d’autres, pour prouver combien il
eft effentieLque les hommes ayent des idées juftes
de la divinité. Si la fuperftition élevé fur des autels
un Jupiter vindicatif, jaloux, fophifte, colere; aimant
la fupercherie, & encourageant les hommes
au v o l, au parjure, à la trahifon, &c. je ne doute
point qu’à l’aide des impofteurs & des poètes,le peuple
n’admire bientôt toutes ces imperle&ions, & n’y
prenne du penchant ; car il eft ailé de métamorphor