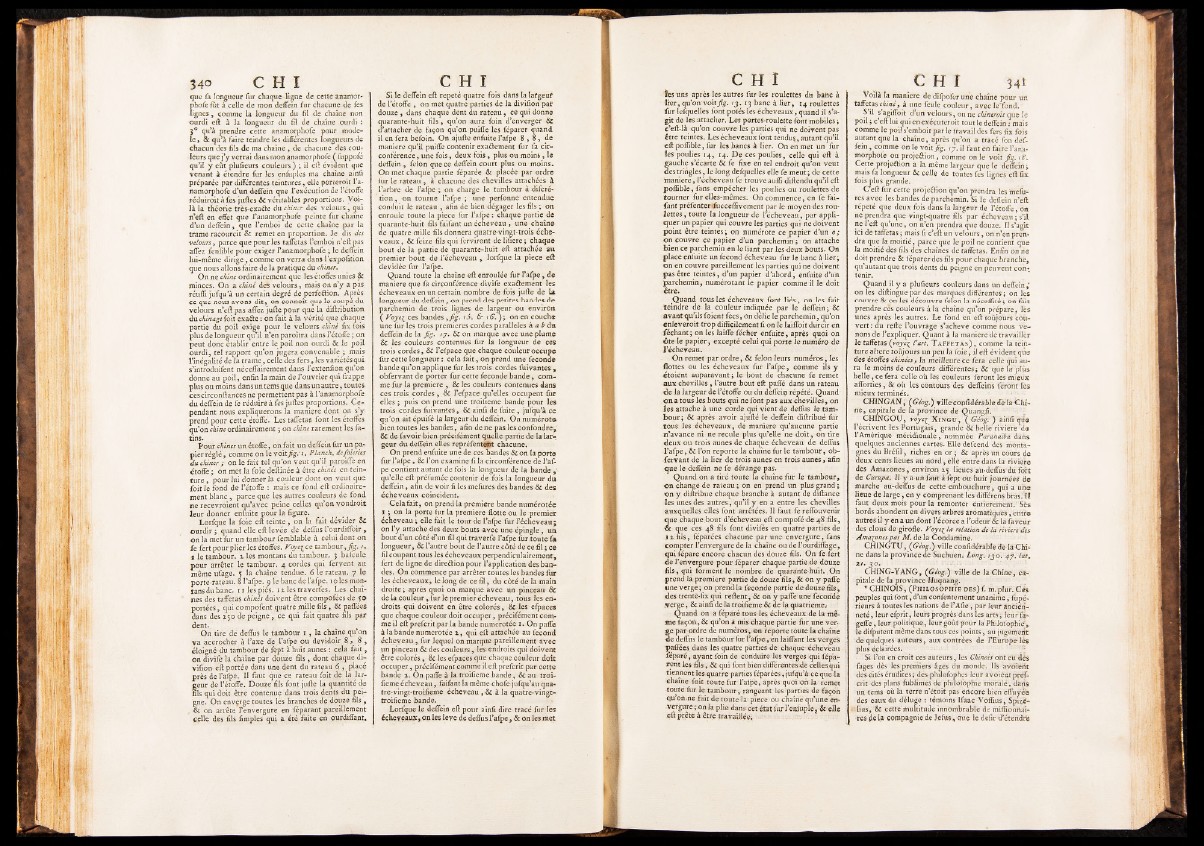
que fa longueur fur chaque ligne de cette anamorphofe
fut à celle de mon deffein fur chacune de fes
lignes, comme la longueur du fil de chaîne non
ourdi eft à la longueur du fil de chaîne ourdi :
3° qu’à prendre cette anamorphofe pour modèl
e , & qu’à faire teindre les différentes longueurs de
chacun des fils de ma chaîne, de chacune des couleurs
que j’y verrai dans mon anamorphofe ( fuppol'é
qu’il y eût pluficurs couleurs ) ; il eft évident que
venant à étendre fur les enfuples ma chaîne ainfi
préparée par différentes teintures, elle porteroit Fa-
namorphofe d’un deffein que l’exécution de l’ctoffe
réduiroit à fes juftes & véritables proportions. Voilà
la théorie très-exaôe du chiner des velours, qui
n’eft en effet que l’anamorphofe peinte fur chaîne
d’un deffein, que Femboi de cette chaîne par la
trame racourcit & remet en proportion. Je dis des
velours, parce que pour les taffetas Femboi n’eft pas
affez fenfible pour exiger l’anamorphofe ; le deflein
lui-même dirige, comme on verra dans l ’expofition
que nous allons faire de la pratique du chiner.
On ne chine ordinairement que les étoffes unies &
minces. On a chiné des velours., mais on n’y a pas
réufli jufqu’à un certain degré de perfeâion. Après
ce que nous avons dit, on connoît que le coupé du
velours n’eft pas affez jufte pour que la diftribution
du chinage foit exafte : on fait à la vérité que chaque
partie du poil exige pour le velours chiné fix fois
plus de longueur qu’il n’en paroîtra dans l’étoffe ; on
peut donc établir entre le poil non ourdi & le poil
ourdi, tel rapport qu’on jugera convenable ; mais
l’inégalité de la trame, celle des fers, les variétés qui
s’introduifent néceffairement dans Fextenfion qu’on
donne au poil, enfin la main de l’ouvrier qui frappe
plus ou moins dansuntemsque dans un autre, toutes
cescirconftances ne permettent pas à l ’anamorphofe
du deffein de fe réduire à fes juftes proportions. Cependant
nous expliquerons la manière dont oit s’y
prend pour cette étoffé. Les taffetas font les étoffes
qu’on chine ordinairement ; on chine rarement les fa-
tins. - ' *
Pour chiner un étoffe, on fait un deffein fur un papier
réglé, comme on le voit fig: i . Planch. dejoieries
du chiner ; on le fait tel qu’on veut qu’il paroiffe en
étoffe ; on met la foie deftinée à être chinée en teinture
, pour lui donner la couleur dont on veut que
foit le fond de l’étoffe : mais ce fond eft ordinairement
blanc, parce que les autres couleurs de fond
ne recevroient qu’avec peine celles qu’on voudroit
leur donner enluite pour la figure.
Lorfque la foie eft teinte, on la fait dévider &
ourdir ; quand elle eft levée de deffus l’ourdiffoir,
on la met fur un tambour femblable à celui dont on
fe fert pour plier les étoffes. Vyyeçce tambour ,fig. /.
x le tambour. z les montans du tambour. 3 bafcule
pour arrêter le tambour. 4 cordes qui fervent au
même ufage. ç la chaîne tendue. 6 le rateau. 7 le
porte-rateau. 8 l ’aipe. o le banc de l’afpe. 10 les montans
du banc. 11 les pies, i z lestraverfes. Les chaînes
des taffetas chinés doivent être compofées de 50
portées, qui compofent quatre mille fils, & paffées
dans des Z50 de peigne, ce qui fait quatre fils par
dent.J * ,
On tire dé deffus le tambour 1 , la chaîne qu on
va accrocher à l’axe de l’afpe pu dévidoir 8 , 8 ,
éloigné du tambour de iept à huit aunes : cela fa it ,
on divife la chaîne par douze fils , dont chaque di-
vifion eft portée dans une dent du rateau 6 , place
près de l’afpe. Il faut que ce rateau foit de la largeur
de l’étoffe. Douze fils font jufte la quantité de
fils qui doit être contenue dans trois dents du peigne.
On envçrge toutes lès branches de douze fils ,
I & on arrête l’envergure en féparant pareillement
celle des fils fimples qui a été faite en ourdiffant.
Si le deffein eft répété quatre fois dans la Iafgeuf
de l’étoffe , on met quatre parties de la divifion pat
douze , dans chaque dent du rateau, ce qui donne
quarante-huit fils , qu’on aura foin d’enverger &c
d’attacher de façon qu’on puifle les féparer quand
il en fera befoin. On ajufte enfuite l’afpe 8 , 8 , de
maniéré qu’il puiffe contenir exa&ement fur fa circonférence
, une fois, deux fois, plus ou moins, le
deffein , félon que ce deffein court plus ou moins.
On met chaque partie féparée & placée par ordre
fur, le rateau , à chacune des chevilles attachées à
l ’arbre de l’afpe ; on charge le tambour à diferé-
tion , on tourne l’afpe ; une perfonne entendue
conduit le rateau , afin de bien dégager les fils ; on
enroule toute la piece fur l’afpe : chaque partie de
quarante-huit fils faifant un écheveau, une chaîne
de quatre mille fils donnera quatre-vingt-trois éche-
veau x, & feize fils qui ferviront de lifiere ; chaque
bout de la partie de quarante-huit eft attachée au
premier bout de l’écheveau , lorfque la piece eft
devidée fur l’afpe.
Quand toute la chaîne eft enroulée fur l’afpe, de
maniéré que fa circonférence divife exaâement les
écheveaux en un certain nombre de fois jufte de la
longueur du deffein, on prend des petites bandes de
parchemin de trois lignes de largeur ou environ
( Voye[ ces bandes , fig. iS■. 6• 16. ) ; on en couche
une fur les trois premières cordes parallèles à a b du
deffein de la jig. 17. & on marque avec une plume
& les couleurs contenues fur la longueur de ces
trois cordes, & l’efpace que chaque couleur occupe
fur cette longueur : cela fa it, on prend une fécondé
bande qu’on applique fur les trois: cordes fui vantes ,
obfervant de porter fur cette fécondé bande, comme
fur la première & les couleurs contenues dans
ces trois cordes , & l’efpace qu’elles occupent fur
elles ; puis on prend une troifieme bande pour les
trois cordes fuivantes, & ainfi de fuite , jufqu’à ce
qu’on ait épuifé la largeur du deffein. On numérota
bien toutes les bandes, afin de ne pas les confondre,1,
ôc de favoir bien précifément quelle partie de la largeur
du deffein elles repréfente&t chacune.
On prend enfuite une de ces bandes & on la port©
fur l’afpe, & l’on examine fi la circonférence de l’af*
pe contient autant de fois la longueur de la bande
qu’elle eft préfumée contenir de fois la longueur du
deffein, afin de voir fi les mefures des bandes & des
écheveaux coincident.
Cela fait, on prend la première bande numérotée
1 ; on la porte fur la première flotte ou le premier
écheveau ; elle fait le tour de l’afpe fur l’écheveau;
on l’y attache des deux bouts avec une épingle, un
bout d’un côté d’un fil qui traverfe l’afpe fur toute fa
longueur, & l’autre bout de l’autre côté de ce fil ; ce
fil coupant tous les écheveaux perpendiculairement,
fert de ligne de dire&ion pour l’application des bandes.
On commence par arrêter toutes les bandes fur
les écheveaux, le long de ce fil, du côté de la main
droite ; après quoi on marque avec un pinceau &
de la couleur, fur le premier écheveau, tous les endroits
qui doivent en être colorés, & les efpaces
que chaque couleur doit occuper, précifément çom-
me il eft preferit par la bande numérotée 1.- On paffe
à la bande numérotée z , qui eft attachée au fécond
écheveau fur lequel on marque pareillement avec
un pinceau & des couleurs, les endroits qui doivent
être colorés, & les efpaces que chaque couleur doit
occuper, précifément comme il eft preferit par cette
bande 1. On paffe à la troifieme bande, & au troifieme
écheveau, faifant la même chofe jufqu’au qua-
tre-vingt-troifieme écheveau , & à la quatre-vingt-
troifieme bande.
Lorfque le deffein eft pour ainfi dire tracé fur les
écheveau*, on les leye de deffus l’afpe, & on les met
lès uns après les autres fur les roulettes du bahc à
lier, qu’on voit fig. 13. 13 banc à lier, 14 roulettes
fur lelquelles font pôles les écheveaux, quand il s’agit
de les attacher. Les portes-roulette font mobiles ;
c’eft-là qu’on couvre les parties qui ne doivent pas
être teintes. Les écheveaux font tendu$, autant qu?il
eft pofîible, fur les bancs à lier. On en met un fur
les poulies 14, 14. D e ces poulies, celle qui eft à
gauche s’écarte & fe fixe en tel endroit qu’on veut
des tringles, le long defquelles elle fe meut; de cette
ïnaniere, l’écheveau fe trouve aufli diftendu qu’il eft
poffible, fans empêcher les poulies ou roulettes de
tourner fur elles-mêmes. On commence, en fe faifant
préfentertfucceffivement par le moyen des roulettes
, toute la longueur de l’écheveau, par appliquer
un papier qui couvre les parties qui ne doivent
point être teintes; on numérote ce papier d’un o;
on couvre ce papier d’un parchemin ; on attache
bien ce parchemin en le liant par les deux bouts. On
place enfuite un fécond écheveau fur le banc à lier;
on en couvre pareillement les parties qui ne doivent
pas être teintes, d’un papier d ’abord, enfuite d’un
parchemin, numérotant le papier comme il le doit
être.
Quand tous les écheveaux font liés, on les fait
teindre de la couleur indiquée par le deffein ; &
avant qu’ils foient fecs, on délie le parchemin, qu’on
enleveroit trop difficilement fi on le laiffoit durcir en
féchant ; on les laiffe fécher enfuite, après quoi on
ôte le papier, excepté celui qui porte le numéro de
l’écheveau.
On remet par ordre, & félon leurs numéros ; les
flottes ou les écheveaux fur l’afpe, comme ils y
étoient auparavant ; le bout de chacune fe remet
aux chevilles, l’autre bout eft paffé dans un rateau
de la largeur de l’étoffe ou du deffeiç répété. Quand
on a tous les bouts qui ne font pas aux chevilles, on
les attache à une corde qui vient de deffus le tambour;
& après avoir ajufté le deffein diftribué fur
tous les écheveaux, de maniéré qu’aucune partie
n’avance ni ne recule plus qu’elle ne doit, on tire
deux ou trois aunes de chaque écheveau de deffus
l’afpe, l’on reporte la chaîne fur le tambour, obfervant
de la lier de trois aunes en trois aunes , afin
que le deffein ne fe dérange pas.
Quand, on a tiré .toute la chaîne fur le tambôur,
on change de rateau; on en prend un plus grand;
on y diftribué chaque branche à autant de difiance
les unes des autres, qu’il y en a entre les chevilles
auxquelles elles font .arrêtées* Il faut fereffouvenir
que chaque .bout d’écheveau eft compofé de 48 fils,
& que ces 48 fils font divifés en quatre parties de
1 z nls, féparées chacune par une envergure, fans
compter l ’envergure de la chaîne ou de Fourdiffage,
qui fépare encore chacun dès douze fils. On fe fert
de l ’envergure pour féparer chaque partie :de douze
fils, qui forment, le nombre de quara’nte-huit.. On
prend la première partie de douze fils, & on y paffe
«ne verge; on prend la fécondé partie de douze fils ;
des trentè-fix qui reftent, & on y paffe une féconde
y e rge, & ainfi de la troifieme & ae la quatrième*
Quand on a féparé tous-les écheveaux. de la même
façon, & qu’on à mis chaque partie ftir une ver*-
ge par ordre de numéros, on reporte toute la chaîne
de deffus le tambour fur Faipe, en laiffant les vérge's
paffées dans les quatre parties de chaqueéchévèau
féparé, ayant foin de conduire.Ies verges qui fép'a-
rent les fils , & qui font bien différentes-de celles.qui
tiennent les quatre parties féparées, jufqu’à cequela
chaîne foit toute fur Fafpè; après quoi'xjn la remet
toute fur le. tambour y rangeant les parties de façon
qu on-ne fait de toute là piece >ôu chaîne qu’une err-
vergure ; on la plie dans cet état fur Fenfuple, & elle
eft prête à être travaillée; Wfâ
Voilà la maniéré de dîfpofer une chaîne pour uii
taffetas chine, à une feule couleur, avec lefond.
S il s agiffoit d’un velours, on ne chineroit que le
poil ; c’eft lui qui en exécuteroit tout le deffein : mais
comme le poils’emboit parle travail des fers fix fois
autant que la chaîne, après qu’on a tracé fon deffein,
comme on le voit fig. 17. il faut en faire l’ana-
morphofe ou projeôion, comme on le voit fig. 18.
Cette ptojeôion a la même largeur que le deffeiri ;
mais fa longueur & celle de toutes fes lignes eft fix
fois plus grande.
C ’eft fur cette proje&ion qu’ôri prendra les htefu-
res avec les bandes de parchemin. Si le deffein n’eft
répété que deux fois dans la largeur de l’étoffe, on
ne prendra que vingt-quatre fils par écheveau ; s’il
ne Feft qu’une, on n’en prendra que douze. II s’agit
ici de taffetas ; mais fi c’eft un velours, on n’en prendra
que la moitié, parce que le poil ne contient que
la moitié des fils des chaînes de taffetas. Enfin ôn rie
doit prendre & féparer des fils pour chaque branche,
qu’autant que trois dents du peigne en peuvent contenir.
Quand il y a plufieurs couleurs dans un deffein
on les diftingue par des marques différentes ; on les
couvre & on les découvre félon la néceffité ; on fait
prendre ces couleurs à la chaîne qu’on préparé, lès
unes après les autres. Le fond en eft toujours coù.-
vert: du refte l’ouvrage s’âcheve comme nous Venons
de l’expliquer. Quant à la maniéré dé travailler
le taffetas (voye^ l'art. T a f feta s ) , comme la teinture
altéré toujours un peu la foie, il eft évident qüe
des étoffes chinées, la meilleurece fera celle qui aura
le moins de couleurs differentes; & qué là plus
belle,, ce fera celle où lé^ couleurs feront lés mievix
afforties, & où lés contours des deffeins feront les
mieux terminés.
CHINGAN, ([Géog.) villeconfidérable dè la Chi-
rié, capitale de la province de Quangfi.
CHINGOU, voyeç X in gu , ( J àififi qtj©
l’écrivent les Portugais, grande & belle rivière d®
l’Amérique méridionale, nommée Paràhdiba dans
quelques anciennes cartes. Elle defeend dés montagnes
du Bréfil, riches en or ; & après un cours de
deux cents liëues au nord, éllè entre dans la rivière
des Amazones, environ z 5 lieues aii-déffüs'dit Fort
de Curupa\ I l'y a-un fauïà feptou huit journées de
marche au-deffus de cetté embouchure, qui a une
lieue de large, en y comprenant les différens bras.'î!
faut deux mois pour la reinoritér éritiérèment.' Sès
bords abondent en divers arbres aromatiques ».entre
autres il y en a un dont l ’écoree a l’odeiif & là faveur
des clous de girofle. Voye^ là relation de là rivière des
Amazones par M. de la Condamine.
CHINGTU, ([Géog.) ville éonfiderablë dé la Chine
dans la province de Suchuen. Long. (3 0. 47. lat.
x i. 30. -
CHING-YANG, (Géog.) ville de là Chine, capitale
de la province Huqüang.
* CHINOIS; (Philosophie des) f. m.pfur. Cés
peuples qui fônt , d’un confentement unanifrie,-fûp.é-
rieurs à toutes les nations dé l’Afie, par leur ancienneté,
leur efprit, leursprogrès dans les arts; leùrTai
geffe, leurpolitique, leur goût pour laPhilofophie',
le difputent même dans tOüs:Êésrpoirits-, au jiigémerft
de quelques auteurs, aux contrées de l’Eurbpe lès
plus éclairées.
Si Fon en croit ces auteürs, les Chinois ont eU dès
fages dès les premiers âgés du monde. Ils avdiëdt
des cités érudites; des philofophes leur avoiènt.preferit
des plans fublimes de philolbphie morale y dans
un tems où la terre n’étbit pas encore bien effuye©
des eaiix du déluge : témoins Ifaac Voffiùs; Spiz'é-
| lins', & cette multitude innombrable de miffionnai-
•res (le la compagnie de Jelus-, que le defîr d’étëndré