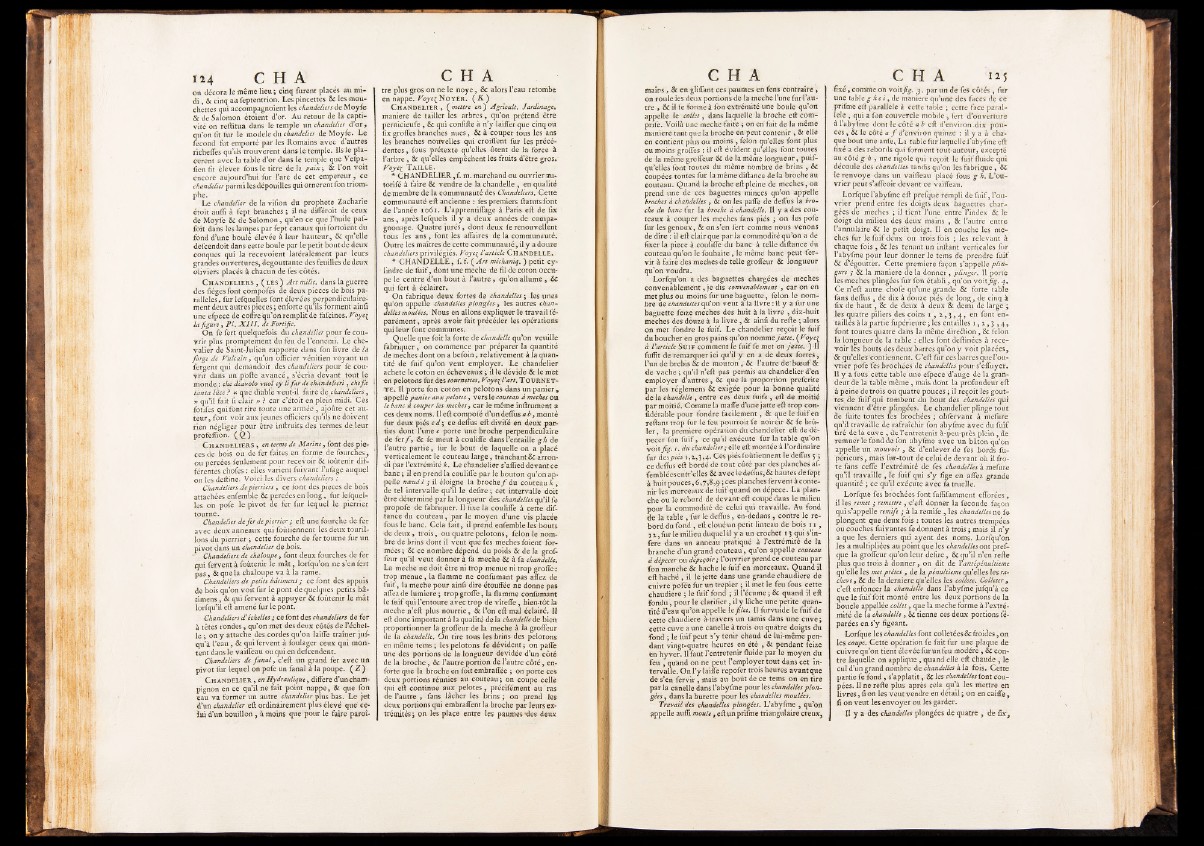
on décora le même lieu ; cinq furent placés au midi
, & cinq au feptentrion. Les pincettes 6c les mou-
chettes qui accompagnoient les chandeliers de Moyfe
& de Salomon ctoient d’or. Au retour de la captivité
on reftitua dans le temple un chandelier d’o r ,
qu’on fit lur le modèle du chandelier de Moyfe. Le
fécond fut emporté par les Romains avec d’autres
richeffes qu’ils trouvèrent dans le temple. Ils le placèrent
avec la table d’or dans le temple que Vefpa*
lien fît élever fous le titre de la paix ; & l’on voit
encore aujourd’hui fur l’arc de cet empereur, ce
chandelier parmi les dépouilles qui ornèrent fon triomphe.
Le chandelier de la vifion du prophète Zacharie
étoit aufîi à fept branches ; il ne differoit de ceux
de Moyfe & de Salomon, qu’en ce que l’huile paf-
foit dans les lampes par fept canaux qui fortoiéht du
fond d’une boule élevée à leur hauteur, 6c qu’elle
defeendoit dans cette boule par le petit bout de deux
conques qui la recevoient latéralement par leurs
grandes ouvertures, dégouttante des feuilles dé deux
oliviers placés à chacun de fes côtés.
C handeliers , ( les ) Art milit. dans la guerre
des fiéges font cOmpofês de deux pièces de bois parallèles,
fur lefquelles font élevées perpendiculairement
deux autres pièces ; enforte qu’ils forment ainfi
une efpece de coffre qu’on remplit de fafeines. Voye{
la figuré y PI. X I I I . de Fortifie.
On fe fert quelquefois du chandelier pour fe couvrir
plus promptement du feu de l ’ennemi. Le chevalier
de Saint-Julien rapporté dans fon livre de la
Jorge de Vulcain, qu’un officier vénitien voyant Un
fergent qui demandoit des chandeliers pour fe couvrir
dans un pOiftë avancé, s’écria devant tout le
monde.: che diavolo vuot cy li farde chandelie'ri, chef a
tanta luce ? « qiié diable veut-il faire àe chandeliers,
» qu’il fait fi clair » ? car c’etoit en plein midi. Cès
fotifes qui font rire toute une armée , âjôute cet auteur
, font voir âux jeunes officiers qu’ils ne doivent
rien négliger pour être inftruits des terines de leur
profefîion. ( Q ) .
C handeliers , en terme.de Marine? font des pièces
de bois où de fer faites, en forme de fourches,
pu percées feulement pour recevoir 6c ïoûienir différentes
chofes : elles varient fuivant l’ufage auquel
on les deftïne. Voici les divers chandeliers :
Chandeliers de pierriers, ce font des pièces de bois
attachées enfemble 6c percées en long, fur lefquelles
on pofe le pivot de fer fur lequel le pierrier
tourne.
Chandelier de fer de pierrier ; eft une fourche de fer
avec deux anneaux qui foùtiennent les deux tourillons
du pierrier ; cette fourche de fer tourne fur un
pivot dans un chandelier de bois.
Chandeliers de chaloupe , font deux fourches de fer
qui fervent à foûtenir le mât, lorfqu’on ne s’en fert
pas, & que la chaloupe va à la rame.
Chandeliers de petits bâtimens ; ce font des appuis
de bois qu’on voit fur le pont de quelques petits bâtimens
, & qui fervent à appuyer 6c foûtenir le mât
îorfqu’il eft amené fur le pont.
Chandeliers d'échelles ; cé font des chandeliers de fer
à têtes rondes, qu’on met des deux côtés de l’échelle
; on y attache des cordes qu’on laiffe traîner juf-
qu’à l’eau, & qui fervent à foulager ceux qui montent
dans le vaiffeau ou qui en descendent.
Chandeliers de fanal, c’eft un grand fer avec un
pivot fur lequel on pofe un fanal à la poupe. ( Z )
C handelier , en Hydraulique, différé d’un champignon
en ce qu’il ne fait point nappe, & que fon
eau va former un autre chandelier plus bas. Le jet
d’un chandelier eft ordinairement plus élevé que celui
d’un bouillon, à moins que pour le faire paroître
plus gros on ne le n oyé, 6c alors l’eau retombe
en nappe. Voye^N o y e r . ( X )
C han d e l ier , ( mettre en') Agricult. Jardinage»
maniéré de tailler les arbres, qu’on prétend être
pernicieufe , 6c qui confifte à n’y laiffer que cinq ou
iix groffes branches nues, & à couper tous les ans
lès branches nouvelles qui croiffent fur les précédentes
, fous prétexte qu’elies ôtent de la force à
l’arbre, & qu’elles empêchent les fruits d’être gros*
V iy e ç T a ille.
* CHANDELIER, f. m. marchand ou ouvriermi*-
torifé à faire 6c vendre de la chandelle , en qualité
de membre de la communauté des Chandeliers. Cette
communauté eft ancienne : fes premiers ftatuts font
de l’année 1061. L’apprentiffage à Paris eft de fix
ans, après lefquels il y a deux années de compa-
gnonage. Quatre jurés, dont deux fe renouvellent
tous les ans , font les affaires de la communauté.
Outre les maîtres de cette communauté, il y a douze
chandeliers privilégiés. Voyeç l'article C handelle.
* CHANDELLE, f. f. ( Art méchaniq. ) petit cylindre
de fuif, dont une meche de fil de coton occupe
le centre d’un bout à l’autre, qu’on allume, 6c
qui fert à éclairer.
On fabrique deux fortes de chandelles ; les unes
qu’on appelle chandelles plongées, les autres chandelles
moulées. Nous en allons expliquer le travail fé-
parément, après avoir fait précéder les opérations
qui leur font communes.
Quelle que foit la forte de chandelle qu’On veuille
fabriquer, on commence par préparer la quantité
de meches dont on a befoin, relativement à la quantité
de fuif qu’on veut employer. Le chandelier
acheté le coton en écheveaux ; il le dévide & le met
■ en pelotons füÉ des tour nettes. Voye\Vart. T OURNE T-
t e » Il porte fon Cotôn en pelotons dans un panier,
appellé panier aux pelotes, vers le couteau à meches ou
le banc à couper les meches, Car le même inftrument a
ces deux noms. Il eft compofé d’un deffus a b, monté
fur deux piés cd\ ce deffus eft divifé en deux parties
dont l’une c porte Une broche perpendiculaire
de fe r / , & fe meut à couliffe dans l’entaille g h de
l’autre partie , fur le bout de laquelle on a placé
verticalement le couteau large , tranchant &C. arrondi
par l’extrémité k. Le chandelier s’affied devant ce
banc ; il en prend la couliffe par le bouton qu’on appelle
noeud L ; il éloigne la broche ƒ du couteau k ,
de tel intervalle qu’il le defire ; cet intervalle doit
être déterminé par la longueur des chandelles qu’il fe
propofe de fabriquer. Il fixe la couliffe à cette diftance
du couteau , par le moyen d’une vis placée
fous le banc. Cela fait, il prend enfemble les bouts
de deux, trois, ou quatre pelotons, félon le nombre
de brins dont il veut que fes meches foient formées
; & ce nombre dépend du poids & de la grof-
feur qu’il veut donner à fa meche & à fa chandelle.
La meche ne doit être ni trop menue ni trop groffec
trop menue, la flamme ne confumant pas affez de
fuif, la meche pour ainfi dire étouffée ne donne pas
affez de lumière ; trop groffe, la flamme confumant
le fuif qui l’entoure avec trop de v îteffe, bien-tôt la
meche n’eft plus nourrie, & l’on eft mal éclairé. Il
eft donc important à la qualité de la chandelle de bien
proportionner la groffeur de la meche à la groffeur
de la chandelle. On tire tous les brins des pelotons
en même tems ; les pelotons fe dévident; on paffe
une des portions de la longueur devidée d’un côté
de la broche, 6c l’autre portion de l’autre cô té, en-
forte que la broche en foit embraffée ; on porte ces
deux portions réunies au couteau ; on coupe celle
qui eft continue aux pelotes, précifément au ras
de l’autre , fans lâcher les brins ; on prend les
deux portions qui embraffent la broche par leurs extrémités
; on les place entre les paumes *des deux
mains, & en gliffant ces paumes en fens contraire,
on roule les deux portions de la meche Tune fur l’autre
, & il le forme à fon extrémité une boule qu’on
appelle le collet, dans laquelle la broche eft com-
prife. Voilà une meche faite ; on en' fait de la même
maniéré tant que la broche empeut contenir , & elle
en contient plus ou moins , félon qu’elles font plus
ou moins groffes : il eft évident qu’elles font toutes
de la même groffeur 6c de la même longueur, puisqu'elles
font toutes du même nombre de brins , &C
coupées toutes fur la même diftance de iâ broche au
couteau. Quand la broche eft pleine de meches, on
prend une de ces baguettes minces qu’on appelle ;
broches à chahdellts , & on les paffe de deffus la bro- .
che du banc fur la broche à chandelle. Il y a des côü- ;
teaux à couper les meches fans piés ; on les pofe
fur les genoux, & on s’en fert comme nous venons
de dire : il eft clair que par la commodité qu’on a de
fixer la piece à couliffe du banc à telle diftance du
couteau qu’on le fouhaite, le même banc peut fer-
vir à faire des meches de telle groffeur & longueur
qu’on voudra.
Lorfqu’on a des baguettes chargées de meches
convenablement, je dis convenablement , car on en
met plus ou moins fur une baguette, félon le nombre
de chandelles qu’on veut à la livre : il y a fur une
baguette feize meches des huit à la livre , dix-huit
fnecheS des douze à la liv re , & ainfi du refte ; alors
on met fondre le fuif. Le chandelier reçoit le fuif
du boucher en gros pains qu’on nomme jatte. ( Voye?
à l'article Suif comment le fuif fe met en jatte. ) Il
fuffit de remarquer ici qu’il y en a de deux fortes-, |
l’un de brebis & de mouton , & l’autre debûeuf &
de vache; qu’ il n’eft pas permis au chandelier d’en
employer d’autres, 6c que là proportion preferite
par les réglemens & exigée pour la bonne qualité
de la chandelle , entre ces deux fûifs , eft de moitié
par moitié. Comme la maffe d’une jatte eft trop con-
fidérable pour fondre facilement, & que le fuif en
reftant trop fur le feu pourvoit fe noircir & fe brûler
, la première opération du chandelier eft de dépecer
fon fu if , ce qu’il exécute fur la table qu’on
voit fig. /. du chandelier;ehe eft montée à l’ordinaire
fur des pi« 1,1,3,4. Ges piés f oùtiennent le deffus 5 ;
t e deffus eft bordé de tout côté par des planches af-
femblées entr’elles 6c avec le deffus, 6c hautes dé fept
à huit pouces, 6,7,8,9 ; ces planches fervent à contenir
les morceaux de ltiif quand on dépece. La planche
ou le rebord de devanfeft coupe dans le milieu
pour la commodité de celui qui travaille. Au fond
de la table , fur le deffus, en-dedans, contre le rebord
du fon d , eft cloué un petit linteau de bois 1 1 ,
1 i , fur le milieu duquel il y a un crochet 13 qui s’in-
fere dans un anneau pratiqué à l’extrémité de la
branche d’un grand couteau, qu’ôn appelle couteau
à dépecer oïl depeqoir ; l’ouvrier prend ce couteau par
fon manche & hache le fuif en morceaux. Quand il
eft haché , il le jette dans une grande chaudière de
cuivre pofée fur un ïrepier ; il met le feu fous cette
chaudière ; le fuif fond ; il l’écume ; & quand il eft
fondu , pour le clarifier, il y lâche une petite quantité
d’eau qu’ôn appelle le filet. Il furvuide le fuif de
cette chaudière à-travers un tamis dans une cuve ;
cette cuve a une canelle à trois ou quatre doigts du
fond ; le fuif peut s’y tenir chaud de lui-même pendant
vingt-quatre heures en été , & pendant feize
èn hyver. Il faut l’entretenir fluide par le moyen du
feu , quand on ne peut l’employer tout dans cet intervalle.
On l’y laiffe repofer trois heures avant que
de s’en fervir , mais au bout de ce tems on en tire
par la canelle dans Tabyfine pour les chandelles plongées
, dans la burette pour les chandelles moulées.
Travail des chandelles plongées. L’abyfme , qu’on
appelle aufli moule, eft un prifme triangulaire creux,
fixé, comme on voitfig. g. par un de fes cô té s, fur
une table g h e i , de maniéré qu’une des faces de ce
prifme eft parallèle à cette table ; cette face parallèle
, qui a fon couvercle mobile , fert d’ouverture
à l’abyfme dont le côté a b eft d’environ ..dix pouces
, 6c le côté a f d’environ quinze : il y a à chaque
bout une anfes La tablé fur laqucllei’abyfme eft
fixé a des rebords qui forment tout-autour, excepté
au côté g h , une rigole qui reçoit le fuif fluide qui
découlé des Chandelles Tandis qu’on les fabrique , &
le renvoyé dans un vaiflèau placé fous g h. L ’ouvrier
peut s’affeoir devant ce vaiffeau.
Lorfquel’abyfme eft prefquê rempli de fuif, l’ouvrier
prend entre fes doigts deux baguettes chargées
de meches ; il tient l’unè entre l’index & le
doigt du milieu des deux mains , & l’autre entre
l’annulaire & le petit doigt. Il en couche les meches
fur le fuif deux Oit trois fois ; les relevant à
chaque fois , & les tenant un inftànt verticales fur
l’abyfme pour leur donner le tems de prendre fuif
& d’égouttèr. Cette première façon s’appelle plin-
güre ; 6c la maniéré de la donner , pLinger. Il porte
les-meches pli'ngéesfiïr fo'n établi, qû’on \6\tfig. 4.
Ce .n’eft autre chôfe qu’une grande 6c forte table
fans deffus , de dix à douze piés de long, de cinq à
fix de h a u t, 6c de deux à deux & demi dé large ;
les quatre piliers des coins 1 , Z , 3 ,4 , en font entaillés
à la partie ftipérieurë ; les entailles 1 , 1 , 3 » 4 »
font toutes quatre dans la même direâion , 6c félon
la longueur de la table : elles font deftinées à recevoir
lès bouts des deux barres qu’on y voit placées,
& qu’elles contiennent. C ’eft fur cés barres quel’oii-
vrier pofe fës brochées de chandelles pour s’effuyer.
Il y a fous, cette table une efpece d’auge de la grandeur
dè la table même, mais doht la profondeur eft
à peine de trois ou quatre pouces ; il reçoit les gout-
tesi de fuif qui tombent du bout des chandelles qui
Viennent d’être plingées. Le chandelier plinge tout
de fuite toutes fes brochées ; obfèrvant à mefure
qu’il travaille ae rafraîchir fon abyfme avec du fuif
nré delà cuve , de l’entretenir à-peu-près plein , de
remuer le fond de fon abyfme avec un bâton qu’on
appelle un mouvoir , & d’enlever de fes bords fu-
périeufs, mais fur-tout de celui de devant où il fro-
te fans ceffe l’extrémité de fes chandelles k mefure
qu’il travaille , le fuif qui s*y fige en affez grande
quantité ; ce qu’il exécute avec fa truelle.
Lorfque fes brochées font fuffifamment efforées,
il les remet ; remettre , c’eft donner la fécondé façon
qui s’appelle remife ; à la remife , les chandelles ne f©
plongent que deux fois : toutes les autres trempées
ou couches fuivantes fe donnent à trois ; mais il n’y
a que les derniers qui ayent des noms. Lorfqu’on
les a multipliées au point que les chandelles ont pref-
que la groffeur qu’on leur defire, & qu’il n’en refte
plus que trois à donner, on dit de h antépénultième
qu’elle les met prêtes de la pénultième qu’elles les ra~
cheve , & de la derniere qu’elles les collete. Colleter ,
c’eft enfoncer la chandelle dans i ’abylme.jufqu’à ce
que le fuif foit monté entre les deux portions de la
houcle appellée collet, que la meche forme à l’extrémité
de la chandelle , 6c tienne ces deux portions fé-
parées en s’y figeant.
Lorfque les chandelles font colletées & froides, on
les coupe. Cette opération fe fait fur une plaque de
cuivre qu’on tient élevée fur un feu modère , 6c contre
laquelle on applique , quand elle eft chaude , le
cul d’un grand nombre de chandelles à la fois. Cette
partie fe fond , s’applatit les chandelles font coupées.
Il ne refte plus après cela qu’à les mettre en
livres, fi on les veut vendre en détail ; on en caiffe ,
li on veut les envoyer ou les garder.
Il y a dès chandelles plongées de quatre , de fix,