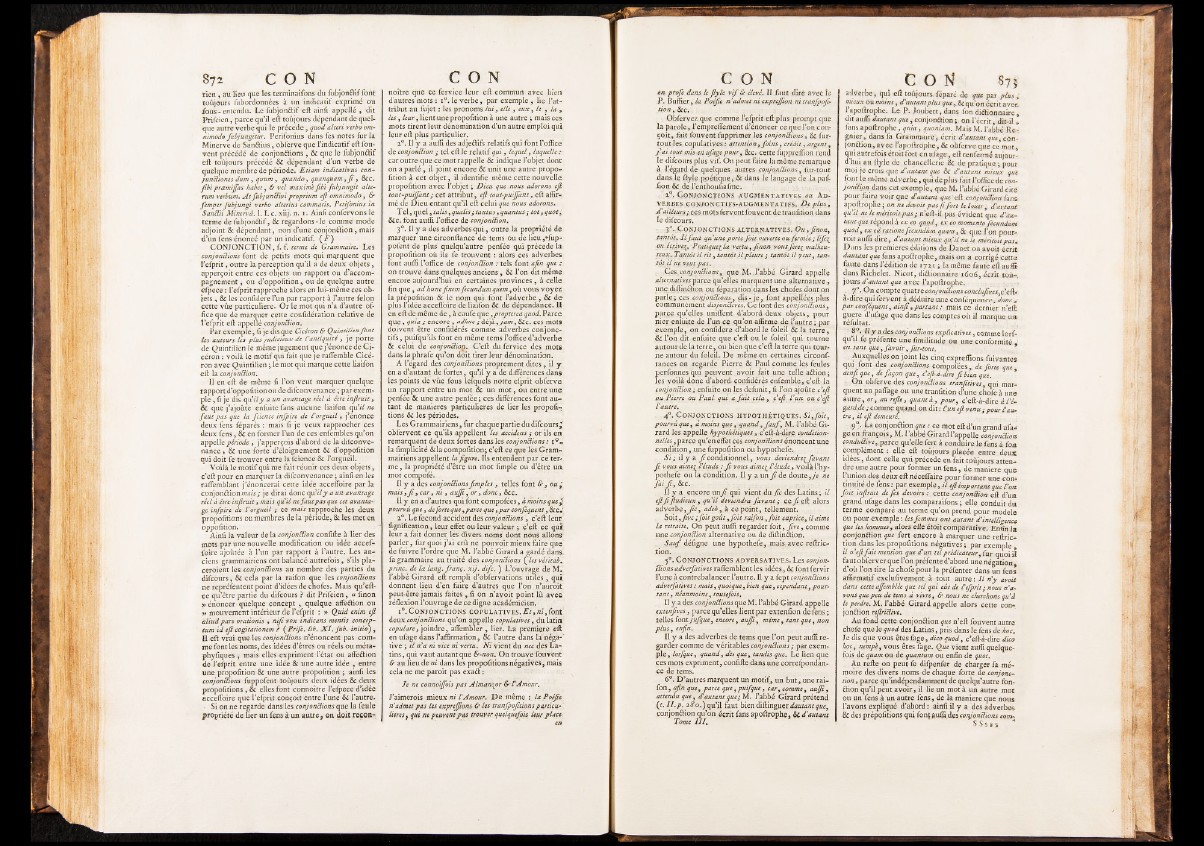
rien , au lieu que les terminaifons du fubjonCtif font
toûjours fubordonnées à un indicatif exprimé ou
Tous-entendu. Le fubjonCtif eft ainfi appelle , dit
Prifcien, parce qu’il eft toujours dépendant de quel*
que autre verbe qui le précédé, quod alteri verbo om-
nimodo fubjungitur. Perifonius dans fes notes fur la
Minerve de SanCtius, obferve que l’indicatif eft fou-
vent précédé de conjonctions, & que le fubjonCtif
eft toûjours précédé & dépendant d’un verbe de
quelque membre de période. Etiam indicaùvus con-
junctioncs dum, quum , quando, quanquam , f i » &c»
fibi pramijfas habet, & vel maximb Jibi fubjungit alte-
rum vcrbum. Atfubjunctivi proprium eft omnimodo , &
femper J'ubjungi verbo alterius commatis. Perifonius in
Sanclii Minervâ. 1. 1. c. xiij. n. 1. Ainfi confervons le
terme de fubjonCtif, & regardons-le comme mode
adjoint & dépendant, non d’une conjonction, mais
d’un fens énoncé par un indicatif, ( E )
CONJONCTION, f. f. terme de Grammaire. Les
conjonctions {ont de petits mots qui marquent que
l ’efprit, outre la perception qu’il a de deux objets,
apperçoit entre ces objets un rapport ou d’accompagnement
, ou d’oppofition, ou de quelque autre
efpece : l’efprit rapproche alors en lui-même ces objets
, & les confidere l’un par rapport à l’autre félon
cette vue particulière. Or le mot qui n’a d’autre office
que de marquer cette confidération relative de
l ’efprit eft appellé conjonction.
Par exemple, fi je dis que Cicéron & Quintilien font
■ les auteurs Les plus judicieux de 1’antiquité , je porte
de Quintilien le même jugement que j’énonce de Ci*
céron : voilà le motif qui fait que je raflëmble Cicéron
avec Quintilien ; le mot qui marque cette liaifon
eft la conjonction.
Il en eft de même fi l’on veut marquer quelque
rapport d’oppofition où de difconvenance ; par exemple
, fi je dis qu’i/<y a un avantage réel à être infruit,
& que j’ajoute enfuite fans aucune liaifon qu’/ï ne
faut pas que la fcience infpire de l'orgueil, j’énonce
deux fens féparés : mais fi je veux rapprocher ces
deux fens, & en former l’un de ces enfembles qu’on
appelle période , j’apperçois d’abord de la difconvenance
, & une forte d’éloignement èc d’oppofition
qui doit fe trouver entre la lcience Sc l’orgueil.
Voilà le motif qui me fait réunir ces deux objets,
c’eft pour en marquer la difconvenance ; ainfi en les
raflemblant j ’énoncerai cette idée accefloire par la
conjonction mais ƒ je dirai donc qu'ily a un avantage
réel à être infruit, mais qu’il ne faut pas que cet avantage
infpire de l'orgueil ; ce mais rapproche les deux
propofitions ou membres de la période, & les met en
oppofition.
Ainfi la valeur de la conjonction confifte à lier des
mots par une nouvelle modification ou idée accef-
foire ajoutée à l ’un par rapport à l’autre. Les anciens
grammairiens ont balancé autrefois, s’ils pla-
ceroient les conjonctions au nombre des parties du
difcours, & cela par la raifon que les conjonctions
ne représentent point d’idées de cnofes. Mais qu’eft-
ce qu’être partie du difcours ? dit Prifcien, « finon
» énoncer quelque concept , quelque affeCtion ou
» motivement intérieur de l’efprit : » Quid enim e f
aliud pars oratïonis , nift vox indicans mentis concep-
tum id eft cogitationem ? ( Prifc.lib. X l.fu b . initio'),
11 eft vrai que les conjonctions n’énoncent pas comme
font les noms, des idées d’êtres ou réels ou méta-
phyfiques , mais elles expriment l’état ou affeCtion
de l’efprit. entre une idée & une autre idée , entre
une propofition & une autre propofition ; ainfi les
conjonctions fuppofent toûjours deux idées & deux
propofitions, & elles font connoître l’efpece d’idée
accefloire que l ’efprit conçoit entre l’une & l’autre.
- Si on ne regarde dans'.les conjonctions que la feule
propriété de lier un fens à un autre, on doit reçonnoître
que ce fervice leur eft commun avec bien
d’autres mots : i° . le verbe, par exemple , lie l’attribut
au fujet : les pronoms lui, elle , eux, le , la ,
les, leur, lient une propofition à une autre ; mais ces
mots tirent leur dénomination d’un autre emploi qui
leur eft plus particulier.
z°. Il y a aufli des adjeCtifs relatifs qui font l’office
de conjonction ; tel eft le relatif qui, lequel, laquelle ;
car outre que ce mot rappelle & indique l’objet dont
on a parlé, il joint encore & unit une autre propofition
à cet objet, il identifie même cette nouvelle
propofition avec l’objet ; Dieu que nous adorons e f
tout-puiffant; cet attribut, eft tout-puijfant, eft affirmé
de Dieu entant qu’il eft celui que nous adorons.
T e l, quel, talis, qualis; tantus, quant us ; tôt, quotÇ
& c. font aufli l’office de conjonction.
30. Il y a des adverbes q ui, outre la propriété de
marquer une circonftance de tems ou de lieu,»fuppofent
de plus' quelqu’autre penfée qui précédé la
propofition oii ils fe trouvent : alors ces adverbes
font aufli l’office de conjonction : tels font afin que :
on trouve dans quelques anciens, & l’on dit même
encore aujourd’hui en certaines provinces, à celle
fin que, ad hune finem fecundum quem, où vous voyez
la prépofition & le nom qui font l’adverbe, & de
plus l’idée accefloire de liaifon & de dépendance. Il
en eft de même d e, à caufe que ,propterea quod. Parce
que , quia ; encore , adhuc ; déjà , jam , & c . ces mots
doivent être confidérés comme adverbes conjonctifs
, puifqu’ils font en même tems l’office d’adverbe
& celui de conjonction. C’eft du fervice des mots
dans la phrafe qu’on doit tirer leur dénomination.
A l’égard des conjonctions proprement d ites, il y
en a d’autant de fortes, qu’il y a de différences dans
les points de vûe fous lefquels notre efprit obferve
un rapport entre un mot & un mot, ou entre une
penfée & une autre penfée ; ces différences font autant
de maniérés particulières de lier les propofitions
& les périodes.
Les Grammairiens, fur chaque partie du difcours^
obfervent ce qu’ils appellent les accidens ; or ils en
remarquent de deux fortes dans les conjonctions :
la fimplicité &la compofition; c’eft ce que les Grammairiens
appellent la figure. Ils entendent par ce terme
, la propriété d’être un mot fimple ou d’être un.
mot compofé.
Il y a des conjonctions fimples , telles font & , ou J
mais »fi y car y ni , auffi, or, donc» & c .
Il y en a d’autres qui font compofées, à moins que }
pourvu, que , de forte que y par ce que, par conféquent, &c.'
. . 20. Le fécond accident des conjonctions , c’eft leur,
lignification, leur effet ou leur valeur ; c’eft ce qui
leur a fait donner les divers noms dont nous allons
parler, fur quoi j’ai crû ne pouvoir mieux faire que
de fuivre l’ordre que M. l’abbé Girard a gardé dansi
fa grammaire au traité des conjonctions ( les véritab.
princ. de la lang. franç. xij. dife. ) L’ouvrage de M.
l’abbé Girard eft rempli d’obfervations utiles , qui
donnent lieu d’en faire d’autres que l’on n’aurôit
peut-être jamais faites , fi on n’a voit point iû avec
réflexion l’ouvrage de ce digne académicien.
i°. C onjonctions co pu la t iv e s . Et,_hi,(ont
deux conjonctions qu’on appelle copulatives, du latin
copulare, joindre, aflembler, lier. Là première eft
en ufage dans l’affirmation, &: l’autre dans la néga-'
tive ; il n'a ni vice ni vertu. Ni vient du nec des Latins,
qui vaut autant que &-non. On trouve fôuVent
& au lieu de ni dans les propofitions négatives, mais
cela ne me paroît pas exaCt :
Je ne connoiffois pas Almari^or & C Amour.
J’aimerois mieux ni l'Amour. De même : laPoéfic
n'admet pas les expreffions & les tranfpofitiqns particu- '
litres j qui ne peuvent pas trouver quelquefois lepj place
en
in ptofe dans le flyle v if & élevé.. Il faut dirè avec îe
P. Buffier, la Poéfie n'admet ni exprejfion ni tranfpojù-
ùon, &c. .
Obfervezque comme l’efprit eft;plus prompt que
la parole j l’empreflement d’énoncer ce quel’on conçoit,
fait fouve nt fupprimer les conjonctions, furtout
lçs. copulatives : ajtentiçn foins , crédit, argent,
j 'a i tout mis en ufage pour, &ç. cette fuppreiîion rend
le difcours plus vif. On peut faire la même remarqu®
à l’égard de quelques, autres*conjonctions, fur-tout
-dans le ftyje poétique ,-»& dans le langage de la pafi
fion & de l’enthoufiafme.
i° . C o njonctions a u gm en ta t iv e s ou Ad-
.VERBES CONJONCTIESrAUGMENTATIFSk De plus ,
À'ailleurs;.ces mots fervent fouyent de tranfition dans
le difcours.
f. •:3i°f.JÇONJONCTlONS ALTERNATIVES. Ô l l , finon,
Sqntôt.llfaut çqu'une. pofte f oit ouverte op. ferméej life\
PU écrive^. Pratique.£ la. vertu yfinon vous fere^ malheureux.
Tantôt il rit, tantôt il pleure ; tantôt, il peut, tantôt
j l pj, Veut pas,
■ .Cespoqjonçtiops, que M ..l’abbé Girard appelle
alternatives parce qu’elles marquent une alternative ,
une diftinârion ou réparation dans les chçfes donfcpn
parie,; çes conjonctions, dis r je,, font appèllées plus
communément disjonctives. Ce font des conjonctions,
parce qu’elles unifient d’abord deux objets , pour
nier;enluite-4e. l’un ce qu’on affirme de l’autre; par
exemple, on confidere d’abord le foleil & la terre,
& l’on dit enfuite que c’eft ou: le foleil qui tourne
autpur d.e la terre, ou bien que c’eft la terre qui tourne
autour du foleil. De même en certaines cirçonf-
ta.nces on regarde Pierre & Paul comme les feules
perfonnes qui peuvent avoir fait une telle aftion ;
les voilà donc d’abord confidérés enfemble, ç’eft la
conjonction ; enfuite on les defunit, fi l’on ajoûte c'efi
ou Pierre ou Paul qui a fait cela, c’efi l'un qu c'efi
Vautre.
4°. C onjonctions h y po th é t iq u e s .S i,fo it ,
pourvu que, à moins que, quand, fau f, M. l’abbé G irard
les appelle hypothétiques, c’eft-à-dire conditionnelles
, parce qu’en effet ces conjonctions énoncent une
condition, une fuppofition ou hypothefe..
Si ; il y a ^conditionnel, vous deviendrez f ayant
f i vous aimez L’étude : f i vous aimez C étude, voilà l’hy-
pothefe ou la condition. Il y a un f i de doute ,je ne
fai f i , &c.
Il y a encore un f i qui vient du fie des Latins ; -il
eft fiftudieux , qu’i l deviendra f avant ; ce_/?eft alors
adverbe , f i c , adeb, à ce point, tellement.
Soit yfive ; foit goût ,foit raifon ,foit caprice, il aime
la retraite. On peut aufli regarder foit, five , comme
«ne conjonction alternative ou de diftinaion.
, Sauf défigne une hypothefe, mais.avec reftric-
ftion.
50. C onjonctions ad versatives. Les conjonctions
adverfatives raffembl.ent les idées, & font fervir
l ’une à contrebalancer l’autre. Il y a fept conjonctions
adverfatives : mais, quoique, bien que, cependant, pourtant
, néanmoins, toutefois.
Il y a des conjonctions que M. l’abbé Girard appelle
extenfives , parce qu’elles lient par extenfion de fens ;
telles font jufque, encore, auffi, même, tant que, non
plus, enfin.
Il y a des adverbes de tems que l’on peut aufli regarder
comme de véritables conjonctions ; par exemple
, lorfque, quand, dès que, tandis que. Le lien que
ces mots expriment, confifte dans une correfpondan-
ce de tems.
6°. D ’autres marquent un motif, un but, une raifon,
afin que, parce que,puifque, car, comme, auffi,
attendu que, etautant que; M. l’abbé Girard prétend
( t.I I .p . 3.8o.-) qu’il faut bien ààftmgutTdautant que,
çonjonûion qu’on écrit fans apoftrophe, U d'autant
Tome I I I ,
adyerbe; qui eft toujours.-féparé de que par plus ;
mieux ou moins, d autant plus que, & qu’on écrit avec
1 apoftrophe. Le P; Joubert,dans fon diélionnaire ,
dit auffi dautant que ; coiijondian ;: on l’écrit dit-il »
fans apoftrophe, quia, quoniam. Mais M. l’abbé Régnier,
dans fa Grammaire,.écrit d'autant que, con-
jonârion; avec l’apoftrophe, & obfer.ve que ce mot;
qui autrefois étoitfort en ufage, eft renfermé aujourd’hui
au flyle de chancellerie & de, pratique ; pour
moi je crois que d'autant que & d'autant mieux qui.
fout le même, adverbe, qui de pliis fait l’office de con-
J°nMiop■ dan§:.cet exemple, que M .i’abbé Girard cité
pour faire vojr que eVautant que ' eft conjonction fans
apoftropKe ; on ne devoit pas f i fort lt loütr, cCavtant
qu'il ne le méritoiepas; n’eft-il pas évident que d'autant.
que répond à ex eo quçtd, ex èo moments) fecundum
quod, ex eq ratione feCundum quam, &- queTon-pour-
roit auffi dire, d'autant mieux qufU m le méritoit pasi
Dans les premières.éditions de Danet on avoit écrit
dautant que fans apoftrophe, mais on a corrigé cette
faute dans l’édition de 1721 ;.lamême fauté eft auffi
dans Riçhelet. Nicot, dictionnaire 1606, écrit toû-*,
jours d'autant que avec i ’apoftrophe.
- : On compte quatreçonjqhçlipns cônclufiyes.,çjçÇt*
à-dire qui fervent à déduire unç çonféquence, donc ^
par conféquent, ainfi, partant: mais ce dernier n’eft
guere d’ufage que dans les comptes où il marque un>
réfultat.
' 8 ° . Il y a des conjonctions explicatives, comme lorf*
qu il fe prefente une ûmilitude ou une conformité 1
en. tant que, f avoir, fur-tout.
Auxquelles on joint les cinq expreffions fuivantes
qui font des xonjonÜions compofées , de forte que ,
ainfi que, de façon que, c’eft-à-dire f i bien que..
On obferve des conjonctions, tranfitives, qui marquent
un pairage ou une tranfition d’une chofe à une
autre, or, au refie, quanta,. pour, c’eft à-dire 4 /V-
gardde;comme quand on dit : Vun eft venu;pour Vau*
tre, il eft demeure.
■9°. La conjonction qüe c ce mot eft d’un grand ufage
en françojs, M. l ’abbé Girard l’appelle conjonction
çonduclive, parce qu’elle fert à conduire le fejjs à fon
complément : elle eft toûjours placée entre deux
idées, dont celle qui précédé en fait toujours, attendre
une autre pour former un fens, de maniéré que
l’union des deux eft nécelfaire pour former une corn
tinuité de fens : par exemple, i l eft important que l'on
foit inftruit de fies devoirs : cette conjonction eft d’un
grand ufage dans les comparaifons ; elle conduit du
terme comparé au terme qu’on prend pour modèle
ou pour exemple : les femmes ont autant d'intelligence
que les hommes, alors elle étoit comparative. Enfin la
conjonction que fert encore à marquer une reftric-
tion dans les propofitions négatives ; par exemple ;
il n eft fait mention que d'un tel prédicateur, fur quoi il
faut obferver que l’on.préfe.nte d’abord une négation;
d’où l’on tire la chofe pour la préfenter dans un fens
affirmatif exclufivement. à tout autre : Il n’y avoit
dans cette affemblèe que tel qui eût de Vefprit; nous n'a-
vous que peu de tems à vivre, & nous ne cherchoàs qu’à
le perdre. M. l’abbé Girard appelle alors cette conjonction
refiriclive.
Au fond cette conjonction que n’eft fouvent autre
chofe que le quod des Latins, pris dans le fens de hoc.
Je dis que vous êtes fage, dico quod, c’eft-à-dire dico
hoc , nempè, vous êtes lage. Que vient auffi quelquefois
de quam ou de quantum ou enfin de quot.
Au refte on peut.fe difpenfer de charger fa mémoire
des divers noms de chaque forte de conjonction,
parce qu’indépendamment de quelqu’autre fonction
qu’il peut avoir, il lie un mot à un autre mot
ou un fens à un autre fens, de la maniéré que nous
l’avons expliqué d’abord : ainfi il y a des adverbes
& des prépofitions qui fon{ gulR des conjonctions corn*