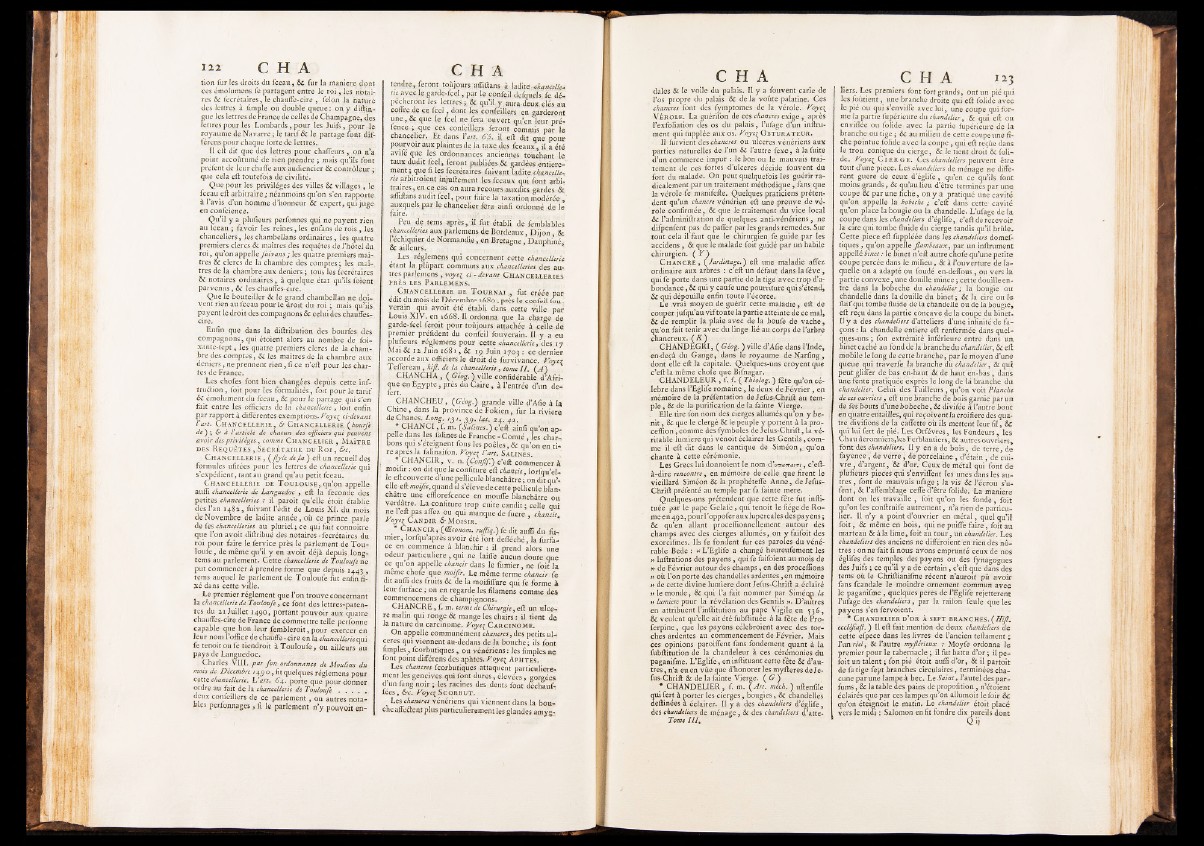
tion fur les droits du fceau, & fur la mapieçe dont-
ces émolumens fe partagent entre le r o i , Içs nptai-
res & fecrétaires, le chauffe-cire , félon la nature
des lettres à fimple ou double queue-: ou y diftin-
gue les lettres de France de celles de Champagne, des
lettres pour les Lombards, pour les Juifs , pour le
royaume de Navarre ; le tarif & le partage font dif-
férens pour chaque forte de lettres.
Il eft dit que des lettres pour chaffeurs,, on. n’a
point accoûtumé de rien prendre ; mais qu’ils font
préfent de leur chaffe aux audiencier & contrôleur ;
que cela eft toutefois de civilité.
Que pour les privilèges des villes & villages , le
fceau eft arbitraire ; néanmoins qu’on s’en rapporte,
à l’avis d’un homme d’honneur & expert, qui juge
en confcience.
Qu’il y a plufieurs perfonnes qui ne payent rien
au fceau ; favoir les reines, les enfans de rois , les
chanceliers, les chambellans ordinaires, les quatre
premiers clercs & maîtres des requêtes de l’hôtel du
roi, qu’on appelle J'uivans ; \ qs quatre premiers maîtres
& clercs de la chambre dès comptes ; les maîtres
de la chambre aux deniers ; tous les fecrétaires
& notaires ordinaires, à quelque état qu’ils foient
parvenus, & les chauffes-cire.
Que le bouteiller & le grand chambellan ne doivent
rien au fceau pour le droit du roi ; mais qu’ils
payent le droit des compagnons & celui des chauffes-
cirè.
Enfin que dans la diftribution des bourfes, des
compagnons, qui étoient alors au nombre de foi-
xante-lept, les quatre premiers clercs de la chambre
des comptes, & les maîtres de la chambre aux
deniers, ne prennent rien, fi ce n’eft pour les chartes
de France.
Les chofes font bien changées depuis cette inf-
truttion, foit pour les formalites,. foit pour le tarif
& émolument du fceau, & pour le partage qui s’en
fait entre les officiers de la chancellerie , foit enfin
par rapport à différentes exemptions. Voyez ci-devant
l'art. C h a n c e l le r ie , <S* C hancellerie..(kourfe
de') ; & à Varticle de chacun des officiers qui peuvent
avoir desprivilèges, comme CHANCELIER , MaÎTRE
des R equêtes , Secrét air e du Ro i , &c.
,r C hancellerie , (flylç de La ) eft un recueil des
formules ufitées pour les lettres de chancellerie qui
s’expédient, tant au grand qu’au petit fceau.
C hancellerie de T o u lo use, qu’on appelle
aufli chancellerie de Languedoc , eft la fécondé des
petites chancelleries : il paroît qu’elle étoit établie
dès l’an 1481, fuivant l’édit de Louis XI. du mois
de Novembre de ladite année, où ce prince parle
de fes chancelleries au pluriel ; ce qui fait eonnoître
que l’on avoit diftribué des notaires - fecrétaires du
roi pour faire le fervice près le parlement de Tou-
loufe, de même qu’il y en avoit déjà depuis long-
tems au parlement. Cette chancellerie de Touloufe ne
put commencer à prendre forme que depuis 1443 ,
tems auquel le parlement de Touloufe fut enfin fixé
dans cette ville.
Le premier réglement que l’on trouve concernant
la chancellerie de Touloufe , ce font des lettres-patentes
du 21 Juillet 149°» portant pouvoir aux quatre
chauffes-cire de France de commettre telle perfonne
capable que bon leur fembleroit, pour exercer en
leur nom l’office de chauffe -cire en la chancellerie qui
fe tenoit ou fe tiendroit à Touloufe, ou ailleurs au
pays de Languedoc.
Charles VIII. par fon. ordonnance de Moulins du
mois de Décembre 14^0, fit quelques réglemens pour
cette chancellerie. L'art. 64. porte que pour donner
ordre au fait de h chancellerie de Touloufe
deux confeillers de ce parlement, ou autres notables
perfonnagesfi le parlement n’y pouvoit entendre,
feront toujours -gflift-ajiSr.L ladite. nfartfüle*
rie .ayecle garde-fçel, par le çpnfqil dgfquelsTe dépêcheront
les lettres & c^u’ilr y.avjra deux, clés au
coffre,de ce fe e l, dont les confeillers eu garderont
une, & que le feel ne fera'ouvert qu’en leur présence
; que ces conièiliçr^ feront çommis par le
chancelier. Et dans l’nrt. ■ <5^4,. U eft dit que pour
pourvoir aux plaintes d é jà taxe des fceaux, il a été
avife que les ordonnances anciennes touchant le
taux dudit feel', feront publiées.8ç gardées entière-'
ment ; que fi les fecrétaires ftfiyantlaflite çkançelle^
rie arbitroient injuftement les ieçaux qui font arfiir
traites, en cq cas on a iua recours .auxdfts gardes &
affiftàns audit feel, pour faire la taxation modérée ,
I auxquels par le chgnc.elier lèra ainfi ordonné de le
! faire.
Peu ;dç tems après, \l fut établi de femblabjes
; chancelleries aux parlçmens de Bordeaux, Q ijo n , &
j l’échiquier de Normandie., en B retagne, Dauphiné.
& ailleurs.
Les réglemens qui concernent cette chppçpllene
étant la piûpart communs aux chancelleries des au-
tres parîemens , voyez çi,T devant.CHANCELLERIES
j PRÉS LES PaRLEMENS.
■' C hancellerie de T o u r n a i ,, fut créée par
édit du mois de Décembre 1680 i près le confeil fou-
verain qui avoit été établi dans cette ville par
Louis XIV. en 1668. Il ordonna que la charge de
; garde-fçel feroit pour toujours; attachée à celle dé
premier préfident du confeil fouyerain. Il y a eu
plufieurs réglemens pour cette chancellerie ,d e s 17
Mai & 12 Juin 1681, & 19. Juin 1703 : ce dernier
accorde aux officiers le droit de Survivance. Voyez
Teffereau , hiß. de la chancellerie , tome I I . (A )
^HANCHA , ( Gèog. )y\\\e confidérable d’Afrique
en Egypte -, près du Ca ire, à l’entrée d’un de-
fer t.
ÇHANCHEU, ( Gèog.) grande ville d’Afie à la
Chine, dans la province de Fokien, fur la riyiere
de Chanes, Long. 13 1. Ut. 24. 42. :
* CH A N C I, f. m. (Salines.) c’eft ainfi qu’on appelle
dans les falinesde F ran che-C omté, les char-
bons cjui s’éteignent fous les p o ê le s, & qu’on en tire
apres la falinaifon. Voyez r art' S a l in e s ., '
* CHANCIR, v . n. (Çonfif) c’eft commencer à
moifir :-on dit que la confiture eft chancie, lorsqu’elle
eft couverte d’une pellicule blanchâtre ; on dit qu’-
elle-eft moifie, quand il s’élève de cette pellicule blanchâtre
une efflorefcence en mouffe blanchâtre 011
verdâtre. La confiture trop cuite candit ; celle qui
ne l’eft pas allez ou qui manque de fucre , chancir.
Voyez C anDIR & MOISIR.
* C hancir ,((Econom. rufiqé){e dit auffi du fumier,
Iorfqu’après avoir été fort defféché, la furfa-
ce en commence à blanchir : il prend alors une
odeur particuliere , qui ne laiffe aucun doute que
ceA qu on appelle chancir dans le fumier, ne foit la
même chofe qué moißr. Le même terme chancir fe
dit auffi des fruits & de la moififfure qui fe forme à
leur furface ; .on en regarde les filamens comme des
commencemens de champignons.
CHANCRE, f. m. terme de Chirurgie, eft un ulcéré
malin qui ronge & mange les chairs : il tient de
la nature du carcinome. Voyez C a r cin om e .
On appelle communément chancres, des petits ulcérés
qui viennent au-dedans de la bouche ; ils font
fimples, feorbutiques , ou vénériens : les fimples ne
font point différens des aphtes.-^oyeç A phtes.
Les chancres feorbutiques attaquent particulièrement
les gencives qui font dures, élevées > gorgées
d’un fang noir ; les racines des dents font déchauf-,
fées, &c. Voyez SCORBUT.
Les chancres vénériens qui viennent dans la bouche
affe&ent plus particulièrement les glandes amygdales
& le voile du palais. Il y a fouvent carie de
l’os propre du palais & de la voûte palatine. Ces
chancres (ont des fymptomes de la vérole. Voyez
V érole. La guérifon de ces chancres exige , après
l’exfoliation des os du palais, l’ufage d’un infiniment
qui lùpplée aux os. Voyez Obtu r a t eu r .
Il furvient des chancres ou ulcérés ,vénériens aux
parties naturelles de l’un & l’autre (exe, à la fuite
d’un commerce impur : le bon ou le mauvais traitement
de ces fortes d’ulceres décide fouvent du
fort du malade. On peut quelquefois les guérir radicalement
par un traitement méthodique,. fa ns que
la vérole.fe manifefte. Quelques praticiens prétendent
qu’un chancre vénérien eft une preuve de vérole
confirmée, & que le traitement du vice local
& l’adminiftration de quelques anti-vénériens , ne
difpenfent pas de palier par les grands remedes. Sur
tout cela il faut que le chirurgien fe. guide par les
accidens, & que le malade foit guidé par un habile
chirurgien. ( T-)
C h a n c r e , ( Jardinage.) eft une maladie allez
ordinaire aux arbres : c’eft un défaut dans la fè v e ,
qui fe porte dans une partie de la tige avec trop d’ar
bondance, & qui y caufe une pourriture qui s’étend,
& qui dépouille enfin toute l’écorCe.
Le .vrai moyen de guérir cette maladie, eft de
couper jufqu’au v if toute la partie atteinte de ce mal,
& de remplir la plaie avec de la boufe de vache,
qu’on fait tenir avec du linge lié au corps de l’arbre
chancreux. ( K )
CHANDEGRI, ( Géog. ) ville d’Afie dans l ’Inde,
en-deçà du Gange, dans le royaume de Narfing,
dont elle eft la capitale. Quelques-uns crôyent que
c’eft la même chofe que Bifnagar.
CHANDELEUR , f.. f. ( Théolog.,) fête qu’on, célébré
dans l’Eglife romaine, le deux de Février, en
mémoire de la préfentation de Jefus-.Chrift àu temple
, & de la purification de la fainte Vierge.
. Elle tire fon nom des cierges allumés qu’on y bénit
, & que le clergé & le peuple y portent à la pro-
ceffion, comme des fymboles de JelusrChrift, la véritable
lumière qui venoit éclairer les Gentils, comme
il eft dit dans le cantique de Siméon qu’on
chante à cette cérémonie. .
Les Grecs lui donnoient le nom d Wa7r«tm, c’eft-
à-dire rencontre, en mémoire de celle que firent le
vieillard Siméon & la prophéteffe Anne, de Jefusr
Chrift préfenté au temple par fa fainte mere.
Quelques-uns prétendent que cette fête fut infti-
tuée par le pape Gelafe, qui tenoit le fiége de Rome
en 492, pour l ’oppofer auxlupercales des payens ;
& qu’en allant proceffionnellement autour des
champs avec des cierges allumés, on y faifoit des
exorcifmes. Ils fe fondent fur ces paroles du vénérable
Bede : « L ’Eglife a changé heureufement les
» luftrations des payens, qui fe faifoient au mois de
» de Février autour des champs, en des proceffions
» où l’on porte des chandelles ardentes, en mémoire
» de cette divine lumière dont Jefus-Chrift a éclairé
» le monde, & qui l’a fait nommer par Siméqn la
» lumière pour la .révélation des Gentils ». D ’autres
en attribuent l’inftitution au pape Vigile en 536,
& veulent qu’elle ait été fubftituee à la fête de Pro-
ferpine, que les payens célebroient avec des torches
ardentes au commencement de Février. Mais
ces opinions paroiffent fans fondement quant à la
fubftitution de la Chandeleur à ces cérémonies du
paganifme. L’Eglife, en inftituant cette fête & d’autres
, n’a eu en vue que d’honorer les myfteres de Jefus
Chrift & de la fainte Vierge. ( G )
* CHANDELIER, f. m. (Art. méch. ) uftenfile
qui fert à porter les cierges, bougies, & chandelles
deftinées a éclairer. Il y a des chandeliers d’églife,
des chandeliers de ménage, & des chandeliers d’atte-
Torne III,
lièrs. Les premiers font fort grands, ont un pié qui
lès foutient, une branche droite qui eft folide avec
le pie ou qui s’enviffe avec lui, une coupe qui forme
la partie fupérieure du chandelier, & qui eft ou
enviffée ou folide avec la partie fupérieure de la
branche ou tige ; & au milieu de cette coupe une fiche
pointue folide avec la coupe, qui eft reçûe dans
le trou conique du cierge, & le tient droit & foli-
de. Voyez GI ER GE. Ces chandeliers peuvent être
tout d’une pièce. Les chandeliers de ménage ne different
guere de ceux d eglife, qu’en ce qu’ils font
moins grands, & qu’au lieu d’être termines par une
coupe & par une fiché, on y a pratiqué une cavité
qu’on appelle la bobeche ; c’eft dans cette- cavité
qu’on place la bougie ou la chandelle. L’ufage de la
coupe dans les chandeliers d’églife, c’eft de recevoir
la cire qui tombe fluide du cierge tandis qu’il brûle.
Cette piece eft fuppléée dans les chandeliers domef-
tiques, qu’on appelle flambeaux, par un inftrument
appellé binet : le binet n’eft autre chofe qu’une petite
coupe percée dans le milieu , & à l’ouverture de laquelle
on a adapté ou foudé en-deffp.us, pu vers la
partie convexe, une douille mince ; cette douille entre
dans la bobeche du chandelier ; la bougie ou
chandelle dans la douille du binet ; & la cire ou le
fuif qui tombe fluide de la chandelle ou de la bougie,
eft reçu dans la partie concave de la coupé du binet.
Il y a des chandeliers d’atteliers d’une infinité de façons
: la chandelle entière eft renfermée dans quelques
uns ; fon extrémité inférieure entre dans un
binet caché au fond de la branche du chandelier, & eft
mobile le long de cette branche, par Je moyen d’une
queue qui tra verfeja branche dû chandelier, & qui
peut gliffer de bas en-haut & de haut en-bas, dans
une fente pratiquée exprès le long de’la tranche du
chandelier. Celui des Tailleurs ., qu’on voit Planche
de ces ouvriers , eft liné branche de bois garnie par un
de fes bouts d’une bobeche, & divifée à l’autre bout
en quatre entailles, qui reçoivent la croifiere des quatre
diyifiôns de la caffette où ils mettent leur fil, Sc
qiulüïfert de pié. Les Orfèvres, les Fondeurs, les
Chauderonnier s,les Ferblantiers, & autres ouvriers,
font des chandeliers. Il y en a de bois-,- de terre, de
fayence5,' de ve r re , de porcelaine , d’étain , de cuivre
, d’argent, & d’qiV Ceux de métal qui font de
plufieiirs pièces qui s’ènviffent les unes dans les autres
, font de mauvais ufage ; la vis & l’écrou s’u-
fent, & l’affemblage ceffe d’être folide. La maniéré
dont on les travaille , foit qu’on les fonde, foit
qu’on les conftruife autrement, n’a rien de particulier.
Il n’y a point d’ouvrier en métal, quel qu’il
foit, & même en bois, qui ne puiffe faire, foit ait
marteau & à la lime, foit au tour, un chandèlier. Les
chandeliers des anciens ne différoient en rien des nôtres
: on ne fait fi nous avons emprunté ceux de nos
églifes dès temples des payens ou des fynagogues
des Juifs ; ce qu’il y a de certain, c’eft qué dans des
tems où le Chriftianifme récent n’auroit pu avoir
fans fcandale le moindre ornement commun avec
le paganifme , quelques perès de l’Eglife rejetterent
l’ufage des chandeliers, par la raifon feule que les
payens s’en fervoient.
• * C handelier d’or à sept branches. (Hifl.
eccllflajt. ) Il eft fait mention de deux chandeliers de
cette efpece dans les livres de l’ancien teftament ;
l’un réel, & l’autre myftérieux : Moyfe ordonna le
premier pour le tabernacle ; il fut battu d’or ; il pe-
loit un talent ; fon pié étoit auffi d’or, & il partoit
de fa tige fept branches circulaires, terminées chacune
par une lampe à bec. Le Saint, l’autel des parfums
, & la table des pains de propofition, n’étoient
éclairés que par ces lampes qu’on allumoit le foir &
qu’on éteignoit le matin. Le chandelier étoit placé
vers le midi : Salomon en fit fondre dix pareils dont