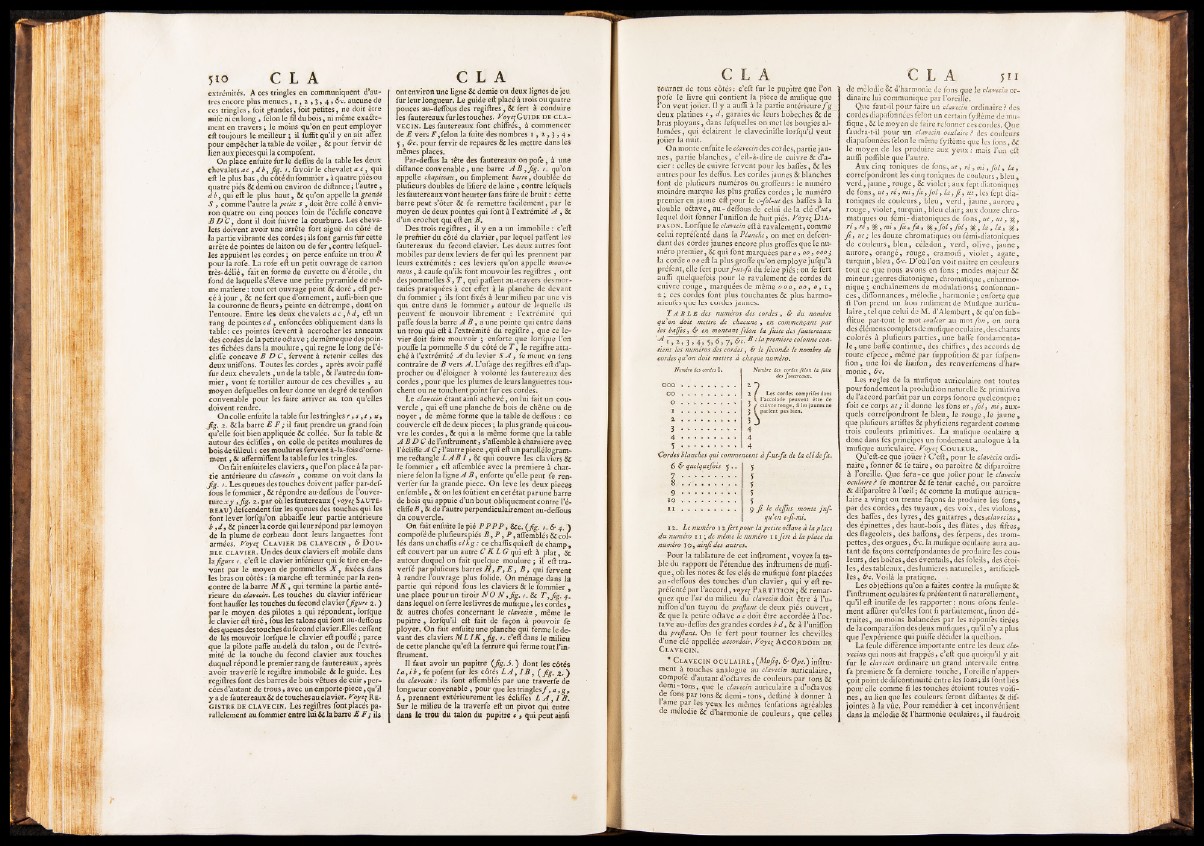
extrémités. A ces tringles en communiquent d’autres
encore plus menues, i , i , 3 , 4 , &c. aucune de
ces tringles, l'oit grandes, foit petites, ne doit être
mile ni en long , félonie fil dubois, ni même exactement
en travers ; le moins xju’on en peut employer
eft toujours le meilleur ; il luffit qu’il y en ait affez
pour empêcher la table de voiler, ôc pour fervir de
lien aux pièces qui la compofent.
On place enfuite fur le deffus de la table les deux
chevalets a c , d b, jig. 1. favoir le chevalet a c , qui
elt le plus ba s , du côtédufommier, à quatre piésou
quatre piés & demi ou environ de diltance ; l’autre ,
d b, qui elt le plus haut, & qu’on appelle la grande
S , comme l’autre la petite s , doit être collé à environ
quatre ou cinq pouces loin de l’édifie concave
B D C , dont il doit fuivre la courbure. Les chevalets
doivent avoir une arrête fort aiguë du côté de
la partie vibrante des cordes ; ils font garnis fur cette
arrête de pointes de laiton ou de fe r , contre lefquel-
les appuient les cordes ; on perce enfuite un trou R
pour la rofe. La rofe eft un petit ouvrage de carton
très-délié, fait en forme de cuvette ou d’étoile, du
fond de laquelle s’élève une petite pyramide de même
matière : tout cet ouvrage peint & doré, elt percé
à jou r , & ne fert que d’ornement, aufli-bien que
la couronne de fleurs, peinte en détrempe, dont on
l’entoure. Entre les deux chevalets ac 9b d 9 elt un
rang de pointes e d , enfoncées obliquement dans la
table : ces pointes fervent à accrocher les anneaux
■ des cordes de la petite oûave ; de même que des pointes
fichées dans la moulure, qui régné le long de l’é-
cliffe concave B D C , fervent à retenir celles des
deux unifions. Toutes les cordes , après avoir palfé
fur deux chevalets , un de la table, & l’autre du fom-
mier, vont fe tortiller autour de ces chevilles , au
moyen defquelles on leur donne un degré de tenfion
convenable pour les foire arriver au ton qu’elles
doivent rendre.
On colle enfuite la table fur les tringles r , s 9t , u ,
Jig. 2. & la barre E F ; il faut prendre un grand foin
qu’elle foit bien appliquée ôc collée. Sur la table ôc
autour des éd ifies , on colle de petites moulures de
bois de tilleul : ces moulures fervent à-la-fois d’ornement
, & affermiffent la table fin les tringles.
On fait enfiiite les claviers, que l’on place à la partie
antérieure du clavecin , comme on voit dans la
jig. /. Les queues des touches doivent paffer par-def-
fous le fommier, ôc répondre au-deflous de l’ouverture
,fig. a. par où les fautereaux (voye% Sautereau)
defeendent fur les queues des touches qui les
font lever lorfqu’on abbaifle leur partie antérieure
b ,</, & pincer la corde qui leur répond par le moyen
de la plume de corbeau dont leurs languettes font
armées. Voye.1 Clavier de clavecin , & Double
clavier. Un des deux claviers eft mobile dans
la figure 1. c’eft le clavier inférieur qui fe tire en-devant
par le moyen de pommelles AT, fixées dans
les bras ou côtés : fa marche eft terminée par la rencontre
de la barre M K , qui termine la partie antérieure
du clavecin. Les touches du clavier inférieur
font haufler les touches du fécond clavier (Jîgure 2. )
pa rle moyen des pilotes 2. qui répondent, lorfque
le clavier eft tiré, fous les talons qui font au-defious
des queues des touches du fécond clavier.Elles ceffent
de les mouvoir lorfque le clavier eft pouffé ; parce
que la pilote paffe au-delà du talon, ou de l’extrémité
de la touche du fécond clavier aux touches
duquel répond le premier rang de fautereaux, après
avoir traverfé le regiftre immobile & le guide. Les
regiftres font des barres de bois vêtues de cuir, percées
d’autant de trous, avec un emporte-piece, qu’il
y a de fautereaux & de touches au clavier. Voye[ Registre
de clavecin. Les regiftres font placés parallèlement
au fommier entre lui & la barre E F ; ils
ont environ une ligne ôc demie ou deux lignes de jeu
fur leur longueur. Le guide eft placé à trois ou quatre
pouces au-defious des regiftres, ôc fert à conduire
les fautereaux fur les touches. FoyeçGuiDE de c l a v
e c in . Les fautereaux font chiffrés, à commencer
de E vers F ,félon la fuite des nombres 1 , 2 , 3 ,4 >
5 , &c. pour fervir de repaires & les mettre dans les
mêmes places.
Par-delfus la tête des fautereaux on pofe, à une
diftance convenable, une barre A B 9fig. 1. cju’on
appelle chapiteau, ou Amplement barre, doublée de
plufieurs doubles de lifiere de laine , contre lefquels
les fautereaux vont heurter fans faire de bruit : cette
barre peut s’ôter ôc fe remettre facilement, par le
moyen de deux pointes qui font à l’extrémité A , &
d’un crochet qui eft en B.
Des trois regiftres, il y en a un immobile : c’eft
le prethier du côté du clavier, par lequel pafient les
fautereaux du fécond clavier. Les deux autres font
mobiles par deux leviers de fer qui les prennent par
leurs extrémités : ces leviers qu’on appelle mouve-
mens, à caufe qu’ils font mouvoir les regiftres , ont
des pommelles S , T , qui pafient au-travers desmor-
taifes pratiquées à cet effet à la planche de devant
du fommier ; ils font fixés à leur milieu par une vis
qui entre dans le fommier , autour de laquelle ils
peuvent' fe mouvoir librement : l’extrémité qui
paffe fous la barre A B , a une pointe qui entre dans
un trou qui eft à l’extrémité du regiftre , que ce levier
doit foire mouvoir ; enforte que lorfque l’on
pouffe la pommelle S du côté de T , le regiftre attaché
à l’extrémité A du levier S A , f e meut en fens
contraire de B vers A. L’ufage des regiftres eft d’approcher
ou d’éloigner à volonté les fautereaux des
cordes, pour que les plumes de leurs languettes touchent
ou ne touchent point fur ces cordes.
Le clavecin étant ainli achevé, on lui fait un couvercle
, qui eft une planche de bois de chêne ou de
noyer , de même forme que la table de deffous : ce
couvercle eft de deux pièces ; la plus grande qui couvre
les cordes, & qui a la même forme que la table
A B D C de l’inftrument, s’affemble à charnière avec
l’éctiffe A C ; l’autre piece, qui eft un parallélogramme
reétangle L A B I , & qui couvre les claviers ôc
le fommier, eft affèmblée avec la première à charnière
félon la ligne A B , enforte qu’elle peut fe ren-
verfer fur la grande piece. On leve les deux pièces
enfemble, & on les foûtient en cet état par une barre
de bois qui appuie d’un bout obliquement contre l’édifie
2? , & de l’autre perpendiculairement au-deffous
dn couvercle.
On fait enfuite le pié P P P P , & c . (Jig. i .& 4. )
compofé de plufieurs piés B , P , P , affemblés ôc collés
dans un chaflis c l kg : ce chaflis qui eft de champ ,
eft couvert par un autre C A Z. G qui eft à plat, ôc
autour duquel on fait quelque moulure ; il eft traverfé
par plufieurs barres H , F , E , B , qui fervent
à rendre l’ouvrage plus folide. On ménage dans la
partie qui répond fous les claviers & le fommier ,
une place pour un tiroir N O N , fig. 1. & T 9fig. 4.
dans lequel on ferre les livres de mufique, les cordes ,
& autres chofes concernant le clavecin, même le
pupitre , lorfqu’il eft fait de façon à pouvoir fe
ployer. On foit enfuite une planche qui ferme le devant
des claviers M L IK 9fig, 1. c’eft dans le milieu
de cette planche qu’eft la ferrure qui ferme tout l’inftrument.
Il faut avoir un pupitre (Jig. 5. ) dont les côtés
l a 9i b , fe pofent fur les côtés L A , I B 9 ( Jig, 2 . )
du clavecin : ils font affemblés par une traverfe de
longueur convenable , pour que les tringles f , a , g 9
h , prennent extérieurement les édifies L A ,1 B.
Sur le milieu de la traverfe eft un pivot qui entre
dans le trou du talon du pupitre e , qui peut ainfi
ïôürner de tous côtés : c’eft fur le pupitre que l’on
pofe le livre qui contient la piece de mufique que
l ’on veut joüer. II y a aufli à la partie antérieure f g
deux platines c , d , garnies de leurs bobèches ôc de
bras ployans, dans lefquelles on met les bougies allumées
, qui éclairent le clavecinifte lorfqu’il veut
joüer la nuit.
On monte enfuite le clavecin des cordes, partie jaunes,
partie blanches, c’eft-à-dire de cuivre & d’acier
: celles de cuivre fervent pour les baffes, ôc les
autres pour les deffus. Les cordes jaunes & blanches
font de plufieurs numéros ou groffeurs : le numéro
moindre marque les plus groffes cordes ; le numéro
premier en jaune eft pour le c-fol-ut des baffes à la
double oétave, au-deffous de celui de la clé d’«r,
lequel doit fonner l’uniffon de huit piés. Voye^ D iapason.
Lorfque le clavecin eft à ravalement, comme
celui repréfènté dans la Planche, on met en defcèn-
dant des cordes jaunes encore plus großes que le numéro
premier, & qui font marquées par o» 00 , 000;
la corde 0 00 eft la plus groffe qu’on employé jufqu’à
préfent, elle fert pour f - ut-fa du feize piés : on fe fert
aufli quelquefois pour le ravalement de cordes de
cuivre rouge, marquées de même 000, 00, o , 1 ,
2 ; ces cordes font plus touchantes ôc plus harmo-
nieufes que les cordes jaunes.
T a b l e des numéros des cordes, & du nombre
qu'on doit mettre de chacune , en commençant par
les baßes, & en montant félon la fuite des fautereaux
■ I , 2, 3 ,4 , 5, 6 , 7 , &c. B : la première colonne confient
les numéros des cordes, & le fécondé le nombre de
■ cordes quon doit mettre d chaque numéro.
Numéro des cordes I . Nombre des cordes félon la fuite
des fautereaux.
OOO
ÖO
O
-n
2
3
4
5
'Cordes blanches qui commencent à f ut-fa de la clé de fa.
6 & quelquefois <.
7
i l . . . . . . . . . 9 f i le dejfus monte jû fqu'en
e-fi-mi.
1 2. Le numéro 12 fert pour la petite octave d la place
du numéro 1 1 ; de même le numéro 11 fert d la place du
numéro \o9ainfides autres.
Pour la. tablature de cet infiniment, voyez la table
du rapport de l’étendue des inftrumens de mufique,
où les nôtes & les clés de mufique font placées
au-deffous des touches d’un clavier, qui y eft re-
préfenté par l’accord, voye^ Pa r t it io n ; ôc remarquez
que Vue du milieu du clavecin doit être à l’uniffon
d’un tuyau de preflant de deux piés ouvert,
& que la petite oétave a c doit être accordée à l’octave
au-deffus des grandes cordes b d , 8>c à l ’uniffon
du preflant. On fe fert pour tourner les chevilles
d’une clé appellée accordoir, Voye{ A cgo rd oir de
C la v e c in .
* C lave cin o culaire , (\Muflq. & Opt.') inftru*-
ment à touches analogue au clavecin auriculaire,
compofé d’autant d’oôaves de couleurs par tons &
demi-tons, que le clavecin auriculaire a d’ottaves
de fons par tons & demi-tons, deftiné à donner à
lame par les yeux les mêmes fenfations agréables
de mélodie & d’harmonie de couleurs, que celles
de mélodie & d’harmonie, de fons que le ‘clavecin ordinaire
lui communique par l’orëille.
Que faut-il pour faire un clavecin ordinaire ? des
cordes diapafonnées félon un certain fyftème de mufique
, & le moyen de faire refonner ces cordes. Que
faudra-t-il pour un clavecin oculaire? des couleurs
diapafonnées félon le même fyftème que les fons, &
le moyen dé lés produire aux yeux : mais l’un eft
aufli pofliblc que l’autre.
Aux cinq toniques de fons, u t, ré, m i, f o l , la ,
correfpondront les cinq toniques de couleurs, bleu ,
v erd , jaune, rouge, &: violet ; aux fept diatoniques
de fons, u t, r é ,m i,fa ,J o l, la, f i , ut, les fept diatoniques
de couleurs, bleu, v erd, jaune, aurore ,
rouge., violet, turquin, bleu clair ; aux douze chromatiques
ou fémi-diatoniques de fons, u t, ut ,% 9
ré, re, ^ 9mi, fà , f a , % f f o l , f o l ,% 9la , la,
f i , ut; les douze chromatiques ou fémi-diatoniques
de couleurs, bleu, céladon, verd, o live , jaune,
aurore, orangé, rouge, cramoifi, vio le t, agate,
turquin, b leu, &c. D ’où l’on voit naître en couleurs
tout ce que nous avons en fons ; modes majeur &
mineur ; genres diatonique, chromatique, enharmonique
; enchaînemens de modulations ; confonnan-
ces, diffonnançes, mélodie, harmonie ; enforte que
fi l’on prend un bon rudiment de Mufique auriculaire
, tel que celui de M. d’Alembert, & qu’on fub-
ftit.ue par-tout le mot couleur au mot fo n , on aura
des élémens complets de mufique oculaire, des chants
colorés à plufieurs parties, une baffe fondamentale
, une baffe continue, des chiffres, des accords de
toute elpéce, même par fuppofition & par fufpen-
fion, une loi de Iiaifon, des renverfemens d’harmonie
, &c.
Les réglés dé la mufique auriculaire ont toutes
pour fondement la produûion naturelle & primitive
de l’accord parfait par un corps fonore quelconque :
foit ce corps u t; il donne les fons u t, fo l, mi, auxquels
correlpondront le bleu, le rouge, le jaune ,
que plufieurs artiftes & phyficiens regardent comme
trois couleurs primitives. La mufique oculaire a
donc dans fes principes un fondement analogue à la
mufique auriculaire. Voyeç C ouleur.
Qu’eft-ce que joüer ? C’eft, pour le clavecin ordinaire
, fonner & fe taire, ou paroître & difparoître
à l’oreille. Que fera-ce que joüer pour le clavecin,
oculaire? fe montrer & fe tenir caché, ou paroître
& difparoître à l’oeil ; & comme la mufique auriculaire
a vingt ou trente façons de produire les fons,
par des cordes, des tuyaux, des vo ix , des violons,
des baffes, des lyres, des guitarres , des +clavceins,
des épinettes, des haut-bois, des flûtes, des fifres,
des flageolets, des baffons, des ferpens, des trompettes,
des orgues, &c. la mufique oculaire aura autant
de façons correfpondantes de produire les couleurs
, des boîtes, des éventails, des foleils, des étoiles
, des tableaux, des lumières naturelles, artificielles
, &c. Voilà la pratique.
Les objections qu’on a faites contre la mufique &
l’inftrument oculaires fe préfentent fi naturellement,
qu’il eft inutile de les rapporter : nous ofons feulement
affûrer qu’elles font fi parfaitement, finon détruites
, au-moins balancées par les réponfes tirées
de la comparaifon des deux mufiques', qu’il n’y a plus
que l’expérience qui puiffe décider la qu eft ion.
La feule différence importante entre les deux cla~
vecins qui nous ait frappés, c’eft que quoiqu’il y ait
fur le clavecin ordinaire un grand intervalle entre
fa première & fa derniere touche, l’oreille n’apper-
çoit point de difeontinuité entre les fons ; ils font liés
pour elle comme fi les touches étoient toutes voifi-
nes, au lieu que les couleurs feront diftantes & dif*
jointes à la vue. Pour remédier à cet inconvénient
dans la mélodie 6c l’harmonie oculaires, il faudroit