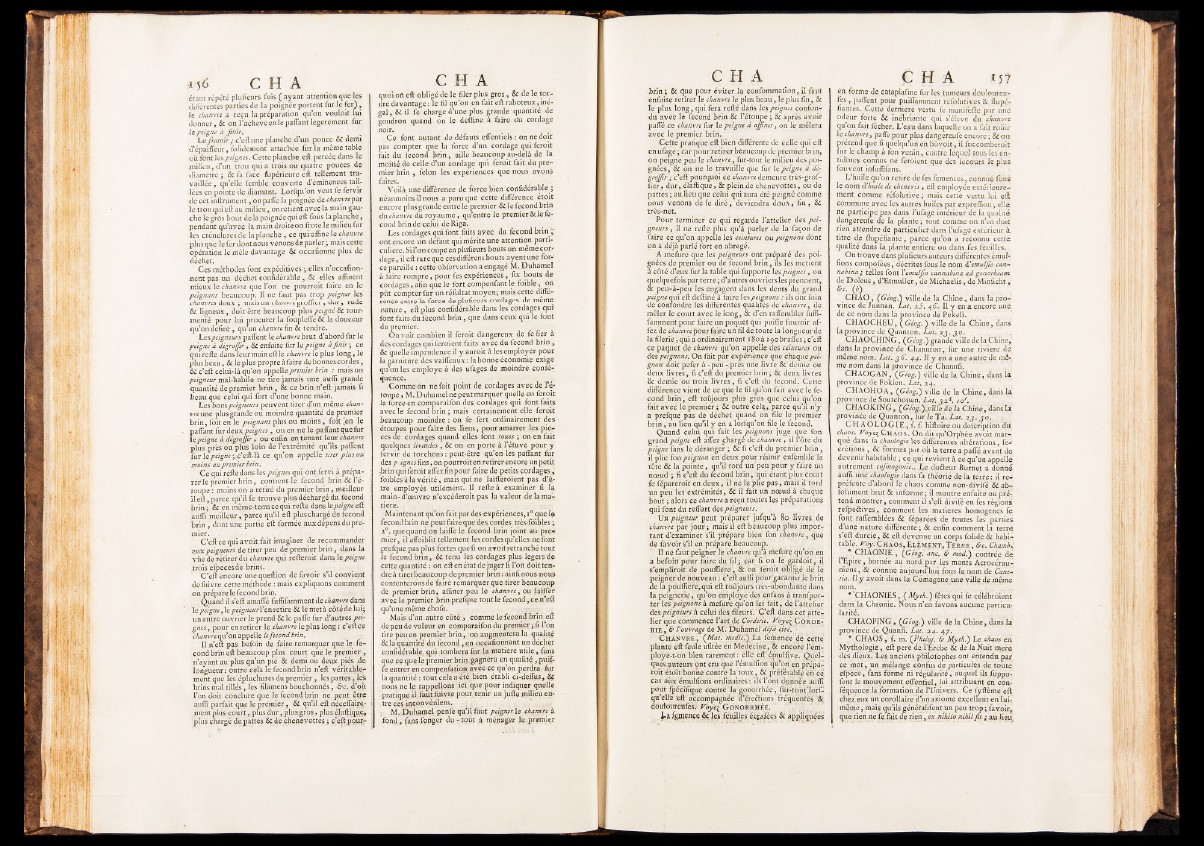
. étant répété, plufieurs fois ( ayant attention que les
différentes parties de la poignée portent fur le f e r ) ,
le chanvre a reçu la préparation qu’on vouloit lui
donner, & on l ’acheveenle paffant legerement fur
le pdgne à finir,
Lefr.otoir ; ç’eflune planche d’un pouce & demi
d’épailfeur, folidement attachée fur la même table
oh font l e s . C e t t e planche eft percée dans le
milieu, d’un trou qui a trois ou quatre pouces de
diamètre ; & fa face fupérieure eft tellement travaillée
, qu’elle femble couverte d’éminences taillées
en pointe de diamant. Lorfqu’on veut fe fervir
de cet infiniment, onpaffe la poignée de chanyre^zt
le trou qui eft au milieu, on retient avec la main gauche
le gros bout de la poignée qui eft fous la planche,
pendant qu’avec la main droite on frote le milieu für
les crénelures de la planche , ce qui affine le chanvre
plus que le fer dont nous venons de parlerj; mais cette
opération le mêle davantage §£ occafionne plus de
déchet.
Ces méthodes font expéditives ; elles n’occafion-
.nent pas un déchet confidérable, & elles affinent
mieux le chanvre que l’on ne pourroit faire en le
peignant beaucoup. Il ne faut pas trop peigner les
chanvres d oux; mais un chanvre groffier, dur, rude
& ligneux, doit être beaucoup plus peigné fit tourmenté
pour lui procurer la foupleffe & la douceur
qu’on defire , qu’un chanvre fin & tendre.
Lespeigneurs paffent le chanvre brut d’abord fur le
peigne à dégrojfir , & enfuité fur le peigne à finir ; ce
quirefte dans leurmaineftle chanvre le plus long, le
plus beau, & le plus propre à faire de bonnes cordes,
& c’eft celui-là qu’on appelle premier brin : mais un
peigneur mal-habile ne tire jamais une auffi grande
quantité de premier brin, & ce brin n’ eft jamais fi
beau que celui qui fort d’une bonne main.
Les bons peigneurs peuvent tirer d’un même chanvre
une plus grande ou moindre quantité de premier
brin, foit en le peignant plus ou moins, foit 'en le
paffant fur deux peignes , ou en ne le paffant que fur
le peigne à dégrojfir , ou enfin en tenant leur chanvre
plus près ou plus loin de l’extrémité qu’ils paffent
fui- le peigne ; c’eft-là ce qu’on appelle tirer plus ou
moins au premier, brin.
Ce qui reftedans les peignes qui ont/ervi à préparer
le premier brin, contientJe fécond brin & l’é toupe
: moins on a retiré du premier brin, meilleur
il eft, parce qu’il fe trouve plus déchargé du fécond
brin; & en même-temseequi refte danslepeigneeû
auffi meilleur, parce qu’il eft plus chargé de fécond
brin , dont une partie eft formée aux dépens du .pré-
mier.
C ’eft ce qui avoit fait imaginer de recommander
aux peigrieurs de tirer peu de premier b rin, dans la
vue de retirer du chanvre qui refteroit dans leptigne
.trois efpecesde brins.
C ’eft encore une queftion de favoir s’il convient
defuivre cette méthode : mais expliquons comment
on prépare le fécond brin.
Quand il s’eft amaffé fuffifamment de chanvre dans
le peigne, le peigneurl’en retire & le metà côté de lui;
un autre ouvrier le prend & le paffe fur-d’autres./>ei-
gnes, pour en retirer le chanvre le plus long : c’eftce
chanvre qu’on appelle le fécond brin.
Il n’eft pas befoin de faire remarquer que le fécond
brin eft beaucoup plus court que le premier ,
n’ayant au plus qu’un pié & demi ou deux pies ,de
longueur: outre cela le fécond brin n’eft véritablçr
mentque les épluchures du premier , les pattes , les
hrins mal tilles, les filamens bouchonnés, &c, d’011
l’on doit conclure que le fécond brin ne peut être
auffi parfait que le premier, & qu’il eft néceffaire-
ment plus court, plus dur, plus gros, plus élaftiqufe
plus chargé de pattes & de chencvottes ; c’eft pourquoi
on eft obligé de le filer plus gros, & de le tordre
davantage : le fil qu’on en fait eft raboteux,inégal
, & il fe charge d’une plus grande quantité de
goudron quand on le deftine à faire du cordage
noir.
Ce font autant de défauts effentiels : on ne doit
pas compter que la force d’un cordage qui feroit
fait du fécond brin, aille beaucoup au-delà de la
moitié de celle d’un cordage qui feroit fait du premier
brin , félon les expériences que nous avons
faites.
Voilà une différence de force bien confidérabley
néanmoins il nous a paru que cette différence étoit
encore plus grande entre le premier & le fécond brin
du chanvre du royaume, qu’entre le premier & le fe-,
cond brin de celui de Riga.
Les cordages qui font faits avec du fécond brin ;
ont encore un défaut qui mérite une attention particulière.
Si l’on coupe en plufieurs bouts un même cordage,
il eft rare que ces différens bouts ayent une for-'
cepareille : cette obfervation a engagé M. Duhamel
.à faire rompre, pour fes expériences, fix bouts de
codages > afin que le fort compenfant le foible, on
pût compter fur un réfultat moyen; mais cette différence
entre la force de plufieurs cordages de meme
nature, eft plus confidérable dans les cordages qui
font faits du fécond brin, que dans ceux qui le font
du premier.
On voit combien il feroit dangereux de fe fier à
des cordages qui feroient faits avec du fécond brin ,
& quelle imprudence il y auroit à les employer pour
la garniture des vaiffeaux : la bonne économie exige
qu’on les employé à des ufages de moindre confé-
quence.
Comme. On ne fait point de cordages avec de l’étoupe
, M. Duhamel ne peut marquer quelle en feroit
la force en comparaifon des cordages qui font faits
avec le fécond brin ; mais certainement elle feroit
beaucoup moindre : on fe fert ordinairement des
étoupes pour faire des liens, pour amarrer les pièces
de. cordages quand elles font roues ; on en fait
quelques livardes , & on en porte à l’étuve pour ÿ
fervir dé torchons : peut-être qu’en les paffant fur
des p ignés fins,on pourroit en retirer encore un petit
•brin qui feroit affez fin pour faire de petits cordages ,
foibles à la vérité, mais qui ne laifferoient pas d’être
employés utilement. Il refte à examiner fi la
.main-d’oeuvre n’excéderoit pas la -valeur de la matière.
Maintenant qii’on fait par des expériences, i° que le
fecondbrin ne peut faire que des cordes très-foibles 5
, 2°. que quand on laiffe le fécond brin joint au premier,
il affoiblit tellement les cordes qu’elles ne font
prefque pas plus fortes que fi on avoit retranché tout
le fecondbrin, fiç ténu les cordages plus légers de
cette quantité : on eftenétat.dejUgerfi l’on doit tendre
à tirer beaucoup de premier brin : ainfi nous nous
contenterons de faire remarquer que tirer beaucoup
de premier brin, affiner peu le chanyre, ou laiffér
avec le premier, brin prefque tout le fécond, ce n’eft
qu’unermême.chofe. _
Mais d’un autre côté , comme le fécond brin eft
de peu-de valeur en comparaifon du premier jft l’on
tire peu en prepiier brin,.ion augmentera la qualité
& la quantité du fécond ,,en oeçafionnant un déchet
confidérable qui tombera fur la matière utile, fans
que ce que le premier brin ;gagnera en qualité » puif-
fe entrer en compenfation avec ce qu’on perdra .-fut
la quantité : tout cela a eté.,bien établi ci-deffus, fiç
nous ne lq rappelions ic irqne.pour indiquer qu.elîe
pratique fii/auj: füivçe pouij tenir .un jufte milieu en-
tre cesipeonvéniens.
M. ,ÎPu^ah>el: Pen^e faut peigPf* le. à
.fond,, fans fonger du -tout à; ménager le premier
brin ; & que pour éviter la confommation, il faut
enfuite retirer le chanvre le plus beau, le plus fin, &
le plus long, qui fera refté dans les peignes confondu
avec le fécond brin & l’étoupe ; & après avoir
paffé.ce chanvre fur le peigne à affiner, on le mêlera
avec le premier brin.
Cette pratique eft bien différente de celle qui eft
en ufage ; Car pour retirer beaucoup de premier brin,
ori peigne peu le chanvre, fur-tout le milieu des poignées,
& on ne le travaille que fur le peigne à dé-
groffir ; c’eft pourquoi ce chanvre demeure très-grof-
fier, dur, élaftique, & pleines chenevottes, où de
pattes ; au lieu que celui qui aura été peigné comme
nous venons de le diré, deviendra doux, fin , &
très-net.
Pour terminer Ce qui regarde l’attelier des peigneurs
, il ne refte plus qu’à parler de la façon dé
faire ce qu’on appelle les ceintures ou peignons dont
On a déjà parlé fort en abrégé i
A mefure que les peigneurs ont préparé des poignées
de premier ou de fécond brin, ils les mettent
à côté d’eux fur la table qui fupporte les peignes , 'où
quelquefois par terre ; d’autres ouvriers les prennent,
& peu-rrà-peu les engagent dans les dents du grand
peigne qui eft deftiné à faire les peignons ; ils ont foin
de confondre les différentes qualités de chanvre , dé
mêler le court avec le long, & d’en raffembler fuffifamment
pour faire un paquet qui puiffe fournir affez
de chanyre pour faire uïi fil de toute la longueur de
la filerie i qui a ordinairement 180 à iqobraffes; c’eft
ce paquet de chanvre qu’on appelle des' ceintures ou
des peignons. On fait par expérience que chaque pei-
gnori doit pefer à - peu- près une livre & dénué ou
deux livres, fi c’eft du premier brin ; & deùx livres
& demie ou trois livres, fi c’eft dit fécond'. Cette
différence vient dé ce que le fil qu’on fait a vec le fécond
brin, eft toûjours plus gros qué celui qu’on
Fait aVec le premier ; & outre celq, parce qu’il n’y
a préfque pas de déchet quand on file le premier
b r in , aù lieu qu’il y en a lorfqu’ori file le fécond.
Quand celui qui fait les peignons jugé que fon
grand peigne eft affez çhârgé de chanvre, il l’ôte du
peigne fans lé déranger ; & fi c’eft du premier brin,
il plie ïottpeignon en deux pour réunir enfemblèTa
tête & la pointe, qu’il tord un' peu polir y faire un
noeud ; fi c’eft du fécond brin, qui étant plus Court
fe féparéroif en deux, il ne le plie p as, ihais il tord
un peu les extrémités, & il fait un noeud à chaque
bout ; alors ce chanvre a reçu toutés les préparations
qui font du reffort des peigneurs.
Un' pèigneur peut préparer' jufqu’à 8.0 livres, de
chanvre par jour ; mais il eft beaucoup plus important
d’éxaminer s’il prépare bien fon chanvre, que
de favoir s’il en préparé beâUCôup.
Il né faut peigner lé chanvre qû’à mefure qù’ôn en
a befoltrpOur faire du fil ;, car fi On lé gardoit ,. il
s’empliroit de pbufliëré', & ôn Jféfôit obligé de le
peigner'de nouveau : c’eft auffipô'ur garantir le brin
de la poifflieré, qui eft toûjours irès-âbohdâhte dans
la peignerie , qu’on émplOyé'dès énfans à tranfpor-
tçr les'peignons à meftire qu’on leé fait, de i’attèlier
des peigneurs à celui dès^fileurs'. C ’èft dans cet atte-
lier que commence Part de Càrderie. fi^oye^ C ord e-'
Rie , & P ouvrage de M." DUnamèl' déjà cite.. ■
C h a n v r e , (Mat. femehçe.ÿé cette
planté eft feule ufitée ërt Mèdeciné, & encore l’ém-
ployè-t-oil' bien rarement : elle èft'émulfive. Qûel-
quesjautéurs ont cru que l’émulfiôn qu’on én. prejiar
roit etoit bonne Contré la toux, & préférablé en ce
cas aux émulfions ordinaires': ils l’ont donnée anffi
pour fpécifique contré'la gonorrhée, Tür-tOut^ioff-
qu’èllé 'eft accompagnée d’ereéïions fréquentes ‘ &
dôirioureufésv Voÿe^ G onorrhée. ‘
(gDiencé ôc les feuilles écrafées & appliquées
en forme de cataplafme fur les tumeurs douloureu-
fes > paffent pour puiffamment réfolutives & ftupc-
fiantes. Gette dernière vertu fe manifefte par uné
odeur forte & inébriante qui s’élève du chanvre
qu’on fait fécher. L’eau dans laquelle on a fait roiiir
le chanvre, paffe pour plus dangereufe encore ; & on
prétend que fi quelqu’un en bûvoit, il fuccomberoit
iur le champ à fon venin, contre lequel tous les antidotes
connus né feroient que des feCours le plus
fouv'ént infuffifansk
L’huile qu’on retire de fes femences, connué fous
le nom d’huile de chenevis, eft employée extérieurement
comme réfolutive; mais cette vertu lui eft
commune avec les autres huiles par expreffion; elle
ne participe pas dans l’ufage intérieur de la qualité
dangereufe de la plante ; tout comme bn n*en doit
rien attendre de particulier dans l’ufage extérieur à
titré dé ftupéfiante, parce qu’on a reconnu cette
qualité dans la plante entière ou dans.fes feuilles.
On trouve dans plufieurs auteurs différentes émul-,
fions compofées, décrites fous le nom d’emuljio can-
nabma; telles font Y emuljio cannabina ad gonorheam
de Doleus , d’Etmuller, de Michaelis, de Minficht,
H MÊË I , H I CHÀO , ( Géog.) ville de la Chine, dans la province
de jurinan. Lat. ^6.- Il y en a encore uné.
de ce nom dans la province de Pekeli.
CH AOCB EU, ( Géog. ) ville de la Chine, dans
la province de Quanton. Lat. 2.3. 2 0.
CHAOCHING, (Géog.') grande ville de la Chine,'
dans la province de Channtoir, fur une riviere de
même'nbm. Lat. $6. 44. ÎI y en a une autre de même
nom dans la province .de Channfi.
CHAOGAN, ([Géog.) Ville de la Chiné, dans ia
province de Fokien. Lot. 24.
CHAOHOA, {Géog.) ville 'de la Chine^ dans la
provincê de Soutchbuen. Lat. j 2 d. 10'. .
CHAOKING, (Géog. f ville ,de la Chine, dans là
provinçe de Quantoft , fur le Ta. Lat. 23 . 30J V
C H A 0 L O G IÈ , f. f. hiftoire ou defeription du
chaos. Voye^ C h a o s . On dit qu’Orphée avoit marque
dans fa çhaologie les différentes altérations, fe-*
cretiOns , & formes par oh la terre a paffé avant de
devériir habitable ; ce qui revient à ce qu’on appelle
autrement cojmogônie,. Le doéteur Burnet a donné
auffi une ckàologie dans fa théorie de la terre : il re-
prefent.e d’abord le chaos comme non-divifé & ab-
lolument brut & informe; il montre enfuite ou pré-*
tend montrer., comment il. s’eft divifé en fes régions
refpeéliyes, .comment les matières homogènes fe
font raffembiées & féparées de toutes les parties
d’Une nature différente ; & enfin comment la terré
s’eft durcie, & eft devenue un corps folide & habitable.
Voyi,C h a o s , Elément,T e r r e , &c, Chambé
CHAQNIË , {Géog. anc. & ,mod.) contrée de
l’EpÛle;, bornée ai^ nord par. les monts Acrocérau-
niëns, connue aujourd’hui fous le nom de Çaneé,
ria. Il y avoit dans la. Comagene une. ville de même
nom.
* CHAQNIES, ( Myth. ) fêtes qui fe céïébrôient
dans, la Chaonie. Nous n’en favons aucune, particularité..
CHAOPING , {Géog.) ville de la Chiné, dans la
province de Quanfi. Lat. 24. 47.
* CHAOS, f. m. (Philof. '& Myth.) Le chaos en
Mythologie , eft pere dè l ’Erebe fie de la Nuit meré.
dés dieux. Les anciens philolophes ont entendu par
ce mot, un mélange cOnfus de particules de.toute
èfpécé, lans forme ni régularité, auquel ils fuppo-
fent le mouvement effentiel, lui attribuant en con-
féquëncé’la formation dé l’Univers. Ce fyftème eft:
chez.eux Un corollaire d’un axiome excellent en lui-
même , mais qu’ils généralifent un peu trop ; favoir,
que rien ne fe fait de rien, ex.nihilo nihilfit ; au liéiL