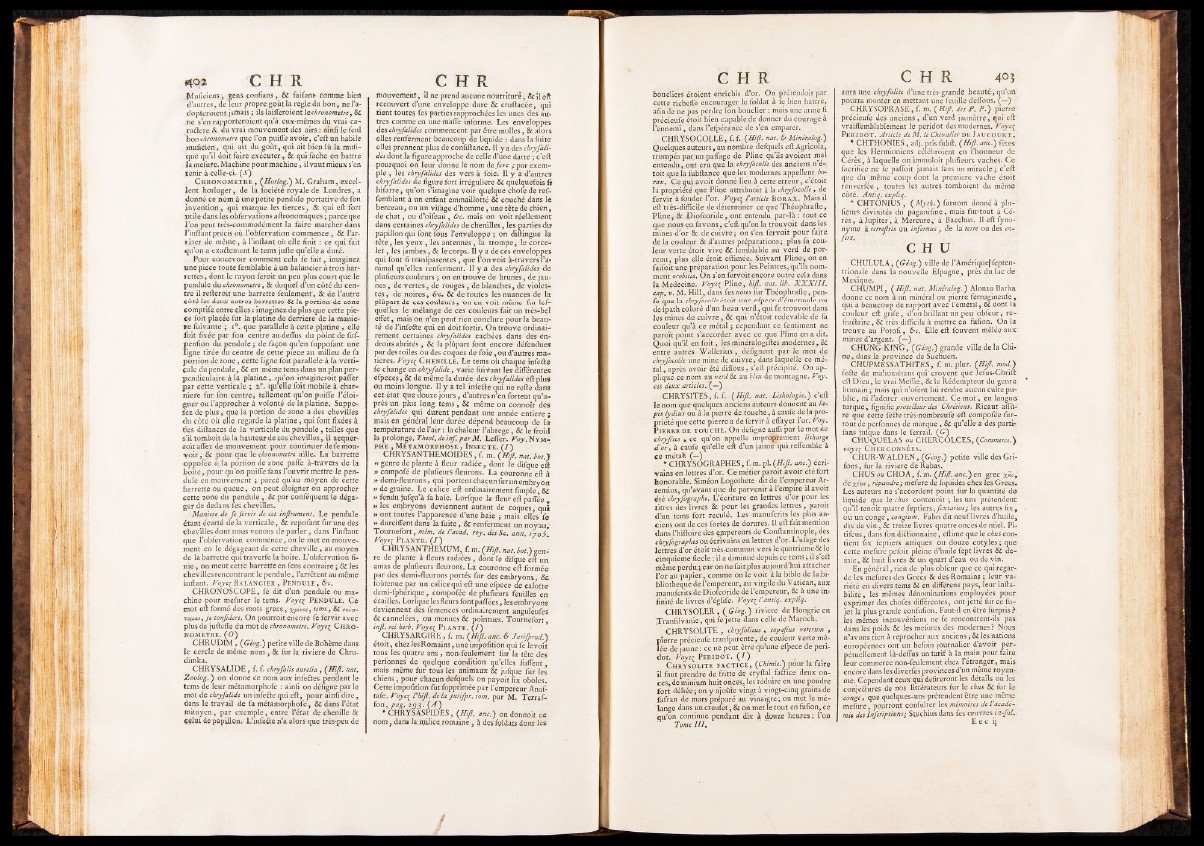
Mu ficiens gens cç>nfîans, & faifant comme bien
d’autres, de leur propre goût la réglé du bon, ne l’a-
dopteroient jamais ; ils laifferoient 1 e chronométré, &
ne s’en rappor£eroient qu’à eux-mêmes du vrai ca-
ra&ere & du vrai mouvement des airs : ainfi le feul
bon chronométré que l’on puiffe avoir, c’eft un habile
mufiçien, qui ait du goût, qui ait bien lû la mufi-
iqué qu’il doit faire exécuter, & qui fâche en battre
la mefure. Machine pour machine , il vaut mieux s’en
tenir à celle-ci. {S)
C hronométré , ( Horlog.) M. Graham, excellent
horloger, de la lociété royale de Londres, a
donné ce nom à une petite pendule portative de fon
invention, qui marque les tierces, & qui eft fort
Utile dans les obfervarions agronomiques ; parce que
l ’on peut très-commodément la faire marcher dans
l ’inftant précis o ù l ’obfervation commence , & l’arrêter
de même, à l’inftant oit elle finit : ce qui fait
qu’on a exactement le tems jufte qu’elle a duré. •
Pour concevoir comment cela fe fa it, imaginez
une piece toute femblable à un balancier à trois barrettes
, dont le rayop feroit Un peu plus court que le
pendule du chronométré, & duquel d’un côté du centre
il refteroit une barrette feulement", & de-l’autre
côté les deux autres barrettes & la portion de zone
comprife entre elles : imaginez de plus que cette pièce
foit placée fur la platine de derrière de la maniéré
fuivante ; i°.,que parallèle à cette platine , elle
foit fixée par fon centre au-deffus du point de fuf-
penfion du pendule ; de façon qu’en fuppofant une
ligne tirée du centre de cette piece au milieu de fa
portion de zone, cette ligne foit parallèle à la verticale
du pendule, & en même tems dans un plan perpendiculaire
à la platine ,,.qu’on imagineroit paffer
par cette verticale ; i° . qu’elle foit mobile à charnière
fur fôn-centre, tellement qu’on puiffe l’éloigner
ou l’approcher à volonté de la platine. Supposez
de plus, que la portion de zone a des chevilles
du côté oit elle regarde la platine, qui font fixées à
des diftances de la verticale du pendule, telles que
s’il tombôit de la hauteur de ces chevilles, il acquer-
■ roit affez de mouvement pour continuer de fe mouv
o ir , & pour que le chronométré aille. La barrette
oppofée ài la portion de zone paffe à-travers de la
boîte, pour qu’on puiffe fans l’ouvrir mettre le pendule
en mouvement ; parce qu’au moyen de cette
barrette ou queue, on peut eloigner ou approcher
cette zone du pendule , & par conféquent le dégager
de dedans fes chevilles.
' Maniéré de fe fervir de cet infiniment. Le pendule
étant écarté de la verticale, & repofant fur une des
chevilles dont nous venons de p arler, dans l’inftant
que l’obfervation commence, on le met en mouvement
en le dégageant de cette cheville , au moyen
de la barrette qui traverfe la boîte. L ’obfervation finie
, on meut cette barrette en fens contraire ; & les
chevilles rencontrant le pendule, l’arrêtent au même
inftant. Voyez Balancier , Pendule, & c.
CHRONOSCOPE, fe dit d’un pendule ou machine
pour mefurer le tems. Voyez Pendule. Ce
mot eft formé des mots grecs, yfivoç, tems, &W77-
Tofxtti, je confidere. On pourroit encore fe fervir avec
plus de jufteffe du mot de chronométré. Voyez C hro nométré.
(O )
CHRUDIM, (Géog.) petite ville de Bohème dans
le cercle de même nom, & fur la riviere de Chru-
dimka.
CHRYSALIDE, f. f. chtyfalis aurelia , (Hifi. nat.
Zoolog. ) on donne ce nom aux infettes pêridant le
tems de leur métamorphofe : ainfi on défigne par le
mot de chryfalide un infette qui eft, pour ainfi dire,
dans le travail de fa métamorphofe, & dans l’état
mitoyen, par exemple, entre l’état de chenille &
celui de papillon. L’infe&e n’a alors que très-peu de
mouvement, il ne prend aucune nourriture, & il eft
recouvert d’une enveloppe dure & cruftacée, qui
tient toutes fes parties rapprochées les unes des autres
comme en une maffe informe. Les enveloppes
des chryfalides commencent par être molles, & alors
elles renferment beaucoup de liquide : dans la fuite
elles prennent plus de confiftance. Il y a des chryfali-
d 'es dont la figure approché de celle d’une datte ; c’eft
pourquoi on leur donne le nom de feve ; par exemple
, les chryfalides des vers à foie. Il y a d’autres
chryfalides de figure fort irrégulière & quelquefois fi
bifarre, qu’on s’imagine voir quelque choie de ref-
femblant à un enfant emmaillotté & couché dans le
berceau , ou un vifage d’homme, une tête de chien ,
de ch at, ou d’oifeau, &c. mais on voit réellement
dans certaines chryfalides de chenilles, les parties du
papillon qui font fous l’enveloppe ; on diftingue la
tête , les y e u x , les antennes, la trompe, le corce-
l e t , les jambes, & le corps. Il y a de ces enveloppes
qui font fi tranfparentes , que l’on voit à-travers l’animal
qu’elles renferment. Il y a des chryfalides de
plufieurs couleurs ; on en trouve de brunes, de jaunes
, de v ertes, de rouges , de blanches, de violettes
, de noires, &c. & de toutes les nuances de la
plûpart de ces couleurs ; on en voit même fur lef-
quelles le mélange de ces couleurs fait un très-bel
effet, mais on n’en peut rien conclure pour la beauté
de l’infefte qui en doit fortir. On trouve ordinairement
certaines chryfalides cachées dans des endroits
abrités , & la plûpart font encore défendues
par des toiles ou des coques de fo ie , ou d’autres matières.
Voyez C henille. Le tems où chaque infe&e
le change en chryfalide, varie fuivant les- différentes
efpeces, & de même la durée des chryfalides eft plus
ou moins longue. Il y a tel infeCte qui ne refte dans
cet état que douze jours, d’autres n’en fortent qu’a-
près un plus long tems , & même on connoît des
chryfalides qui durent pendant une année entière ;
mais en général leur durée dépend beaucoup de la
température de l’air : la chaleur l’abrege, & le froid
la prolonge. Theol. de inf. par M. Leffer. Voy. Nym phe
, Mét am o r ph o se , In se c te . ( / )
CHRYSANTHEMOIDES, f. m. {Hifi. nat. bot.}
« genre de plante à fleur radiée, dont le difque eft
» compofé de plufieurs fleurons. La couronne eft à
» demi-fleurons, qui portent chacun fur un embryon
» de graine. Le calice eft ordinairement Ample, &
» fendu jufqu’à fa bafe. Lorfque la fleur eft paffée
» les enjbryons deviennent autant de coques, qui
» ont toutes l’apparence d’une baie ; mais elles fe
» durciffent dans la fuite, & renferment un noyau.'
ToUrnefort, mém. de l'acad. roy. des S c. ann. ry o i .
Voyez Pl a n t e , (ƒ )
CHRYSANTHEMUM, f. m. {Hifi. nat. bot.) genre
de plante à fleurs radiées, dont le difque eft un
amas de plufieurs fleurons. La couronne eft formée
par des demi-fleurons portés fur des embryons, &
foûtenue par un calice qui eft une efpece de calotte
demi-fphérique, compofée de plufieurs feuilles en
écailles. Lorfque lesfleurs fontpaffées, les embryons
deviennent des femences ordinairement anguleufes
& cannelées, ou menues & pointues. Tournefort,
infi. rei herb. Voyez Plante. ( ! )
CHRYSARGIRE, f. m. {Hifi. anc. & Jurifprud.)
étoit, chez les Romains, une impofition qui fe le voit
tous les quatre ans, non-feulement fur la tête des
perfonnes de quelque condition qu’elles fuffent
mais même fur tous les animaux & jufque fur les
chiens, pour chacun defquels on payoit fix obôles.
Cette impofition fut fupprimée par l’empereur Anaf-
tafe. Voyez rhifi. de la jurifpr. rom, par M. Terraf-
fon, pag. 293. {A )
* CHRYSASPIDES, {Hifi. anc.) ondonnoit ce
nom, dans la milice, romaine, à des foldats dont les
/
boucliers étoient ehrlchis d’or. On prétendoit par
cette richeffe- encourager le fôldat à fç bien battre,
afin de ne pas perdre fon bouclier : mais une armé fi
précieufe çtpit bien capable de donner du courage à
l’ennemi, dans l’efpéràrice de s’en emparer.
CHRYSOCOLLE,: f. f. {Hifi. nat. & Minéralog.)
Quelques auteurs, au nombre defquels eft Agricola,
trompés par un paffage de Pline qu’ils avoient mal
entendu,ipnt cru que, la chryfocolle des anciens n’é-
toit que la fubftance que les modernes appellent borax.
Ce qui avoit dpnné. lieu à cette erreur, c’étpit
la propriété que Pline attribuoit à la chryfocolle , de
ferv;ir à fonder l’or. -Yoyez Varticle Borax. Mais il
eft très-difficile de déterminer ce que Théophrafte,
Pline , & -Diofepride , fpnt entendu par-là : tout ce
que -nous en favons, c’eft qifon la trouvoit dans les
mines d’or & de cuivré; on s’en fervoit pour faire
de la couleur & d’autres préparations.; plus fa couleur
verte étoit vive & femblable au verd de porreau,
plus elle étoit eftimée. Suivant Pline^ on en
faifoit une , préparation pour les Peintres, qu’ils nomment
orobitis. On s’en fervpitëneore outre cela dans
la Medecine. Voyez Pline,, hifi, nat. lib. X X X I I I .
cap. v. M. Hill, dans fes notes fur Théophrafte, pen-
fe que la chryfocolle étoit une efpece d’émeraude ou
de lpath coloré d’un beau verd, qui fe trouvoit dans
les mines de cuivre, & qui n’étoit redevable de fâ
couleur qu’à ce métal ; cependant ce fentiment ne
paroît point s’accorder avec ce que Pline en a dit.
Quoi qu’il en fo i t , les minéralogiftes modernes, &:
entre autrès Wallerius , défignent par le mot de
chryfocolle une mine de cuivre, dans laquelle ce métal
,- après avoir été diffous, s’eft précipité. On applique
ce nom au verd te au bleu de montagne. Voy.
ces deux articles. {—). , ,,
CHRYSITES, f. f. {Hifi. nat. Lithologie f ) , f i &
le nom que quelques anciens auteurs donnent au lapis
lydius ou à la pierre de.touche, à caufe de la propriété
que cette pierre a de fervir à effayer l’or. Voy.
P ierre de to u ch e . On défigne auffi par le mot de
chryfites , ce qu’on appelle improprement litharge
d'or, à caufe qù’elle eft d’un jaune qui reffemble à
ce métak ('—)
* CHRYSOGRAPHES, f. m. pl. {Hifi. anc.) écrivains
en lettres d’or. Ce métier paroît avoir été fort
honorable. Siméon Logothete dit de l’empereur Ar-
temius, qu’avant que de parvenir à l’empire il avoit
été chryfographe. L’écriture en lettres d’or pour les
titres des livres & pour les grandes lettres, paroît
d’un tems fort reculé. Les manuferits les plus anciens
ont de ces fortes de dorures. Il eft fait meiition
dans l’hiftoire des empereurs de Conftantinople, des
chryfograph.es ou écrivains.en lettres d’or. L’ufage des
lettres d’or étoit très-commun vers le quatrième & le
cinquième fiecle : il a diminué depuis ce tems ;.il s’eft
même perdu ; car on iie fait plus aujourd’hui attacher
l’or au papier, comme on le voit à la bible de la b ibliothèque
de l’empereur, au v ig ile du Vatican, aux
.manuferits de Dioicoride de l’empereur, & à une infinité
de livres d’églife. Voyez l'antiq. expliq.
CHRYSOLER , ( Géog. ) riviere de Hongrie en
Tranfilvanie, qui fe jette dans celle de Maroch.
CHRYSOLITE , chryfolitus , topafius veterum ,
pierre précieufe tranfparente, de couleur verte mêlée
de jaune : ce ne peut être qu’une efpece de peri-
dot. Voyez Per id o t . ( / )
C hr y so l it e f a c t ic e , {Chimie.) pour la faire
il faut prendre de fritte de cryftal faftice deux onces,
de minium huit onces, les réduire en une poudre
fort déliée; on y ajoûte vingt à vingt-cinq grains de
fafran de mars préparé au vinaigre ; on met le mélange
dans un creulet, & on met le tout en fufiori, ce
qu’on continue pendant dix à douze heures ; l’on
Tome I I I ,
aura line chryfolite d’une très-grande beauté, qu’on
pourra monter en mettant une feuille deffous. (—)
CHRYSOPRASE, f. m. {Hifi. des P. P .) pierre
précieufe des anciens , ,d’un verd jaunâtre, qui eft
vraiffemblablement le peridot des modernes. Voyez
PERIDOT. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
* CHTHONÎES, adj. pris fubft. {Hifi. anc.) fêtes
que les Hermioniens célébroient en l’honneur de
Cérès, à laquelle on immoloit plufieurs vaches. Ce
facrifice ne fe paffoit jamais fans un miracle ; c’eft
que du' même coup dont la première vache étoit
renverfée , toutes les autres tomboient du même
côté. Antiq. expliq.
* CHTON1US , {Myth.) furnom donné à plufieurs
divinités du paganifme, mais fur-tout à Cérès
, à Jupiter, à Mercure, à Bacchus. Il eft fyno-:
nyme à terrefiris ou infernus , de la terre ou des enfers.
C H U
CHULULA, {Glogé) ville de l’Amérique|fepten-
trionale dans la nouvelle Efpagne, près du lac de
Mexique.
CHUMPI, ( Hifi. nat. Minéralog. ) Alonzo Barba
donne ce nom à un minéral ou pierre ferrugineufe ,
qui a beaucôup de rapport avec l’émeril, & dont la
couleur eft grife ,• d’un brillant un peu obfcur, re-
fraûaire, & très-difficile à mettre en fufion. On la
trouve au Potofi, &c. Elle eft fouvent mêlée aux
mines d’argent. (—) t!'
CHUNG-KING, ( Géog. ) grande ville de la Chine
, dans la province de Suchuen.
CHUPMESSATHITES, f. m. plur. {Hifi. mod.)
fefte de mahométans qui’ croyent que Jeuis-Chrift
eft Dieu, le vrai Meffie, &: le Rédempteur du genre
humain ; 'mais qui n’ofent lui rendre aucun culte public,
ni l’adorer ouvertement. Ce mot, en langue
turque, fignifie protecteur des Chrétiens. Ricaut affû-
re que cette fefte très-nombreüfe eft compofée fur-
tout de perfonnes de marque , & qu’elle a des parti-
fans jufque dans le ferrail. (C )
CHU QUEL AS ou CHERCOLCES, {Commerce.')
voyez CHERCONNÉES.
CHURAVALDEN, {Géog.) petite ville des Gri-
fons, fur la riviere de Rabas.
CHUS ou CH OA, f. m. {Hiß. anc.) en grec
dtÿtuv, répandre; mefure de liquides chez les Grecs.
Les auteurs ne s’accordent point fur la quantité de
liquide que le chus contenoit ; les uns prétendent
qu’il tenoit quatre feptiers,fextarios; les autres f ix ,
ou un conge, congium. Fabri dit neuf livres d’huile,
dix de v in , & treize livres quatre onces de miel. Pi-
tifeus, dans fon dittionnaire, eftime que le chus contient
fix feptiers attiques ou douze cotyles ; que
cette mefure pefoit pleine d’huile fept livres & de-
mie, & huit livres & un quart d’eau ou de vin.
En général, rien de plus obfcur que ce qui regarde
les mefures des Grecs & des Romains ; leur variété
en divers tems & en différens pays, leur infta-
bilité, les mêmes dénominations employées pour
exprimer des chofes différentes, ont jetté fur ce fu-
jet la plus grande confufion. Faut-il en être furpris ?
les mêmes inconvéniens ne fe rencontrent-ils pas
dans les poids & les mefures des modernes? Nous
n’avons rien à reprocher aux anciens ; & les nations
européennes ont un befoin journalier d’avoir per-
! pétuellement là-deffus un tarif à la main pour faire
! leur commerce non-feulement chez l’étranger, mais
encore‘dans les diverfes provinces d’un même royau-
! me. Cependant ceux qui defireront les détails ou les
! conjectures de nos littérateurs fur le chus & fur le
conge, que quelques-uns prétendent être une même
mefure, pourront confulter les mémoires de l'académie
desInfcriptions; Stuchiusdans fes oeuvres in-fal,.