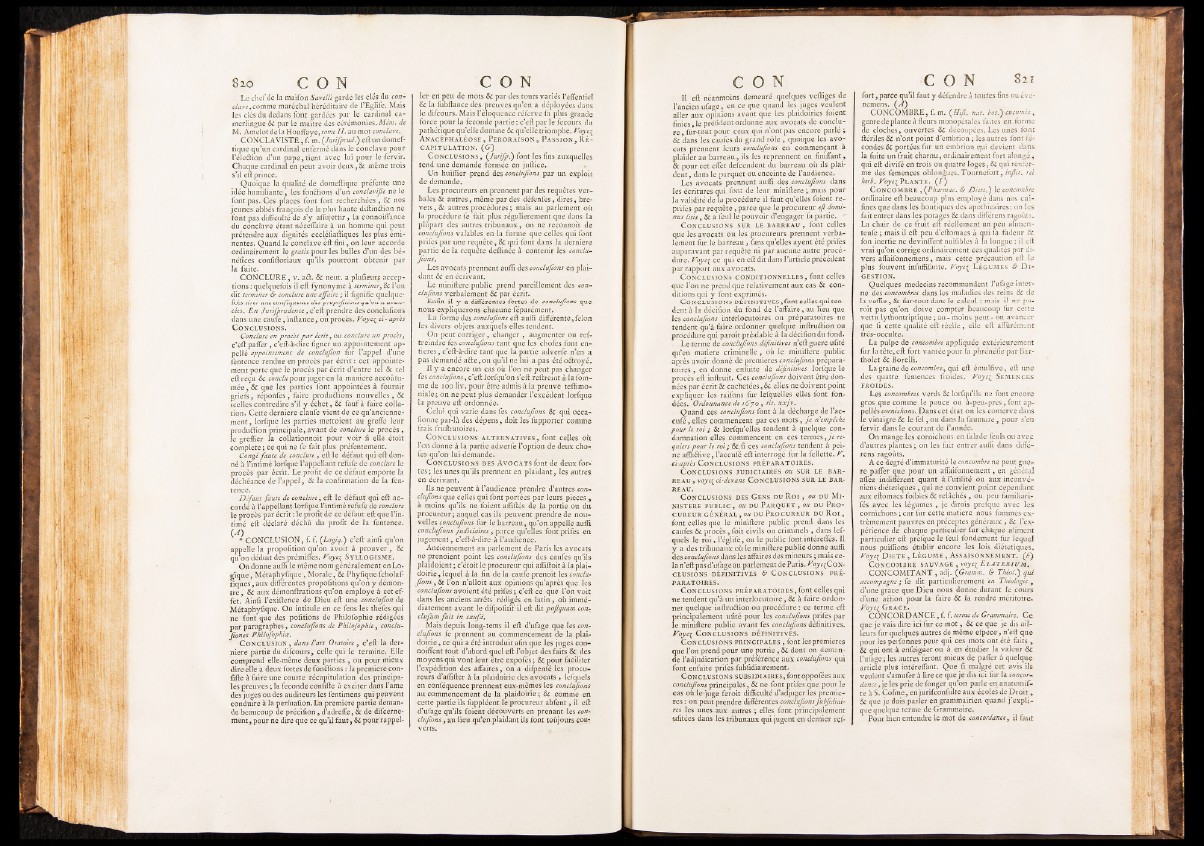
Le chef de la maifon Savelli garde les clés du conclave
, comme maréchal héréditaire de l’Eglife. Mais
les clés du dedans font gardées par le cardinal camerlingue
8c par le maître des cérémonies. Mém. de
M. Amelot delà Houffayc,rorae IL au mot conclave.
CONCLAVISTE, f. m. (Jurifprud.) eft un domef-
tique qu’un cardinal enfermé dans le conclave pour
l’éle&ion d’un pape, tient avec lui pour le fervir.
Chaque cardinal en peut avoir deux, 8c même trois
s’il eft prince.
Quoique la qualité de domeftique préfente une
idée humiliante, les fondions d’un conclaviflt ne le
font pas. Ces places font fort recherchées, Sc nos
jeunes abbés françois de la plus haute diftin&ion ne
font pas difficulté de s’y aflùjettir, la connoiffance
du conclave étant néceffaire à un homme qui peut
prétendre aux dignités eccléfiaftiques les plus éminentes.
Quand le conclave eft fini, on leur accorde
ordinairement le gratis pour les bulles d’un des bénéfices
confiftoriaux qu’ils pourront obtenir par
la fuite.
CONCLURE, v . ad. 8c neut. a plufieurs acceptions
: quelquefois il eft fynonyme à terminer, 8c l ’on
dit terminer & conclure une affaire ; il lignifie quelquefois
tirer une conféquence des propofitions qu'on a avancées.
En Jurifprudence, c’eft prendre des conclulions
dans une caufe, inftance, ou procès. Voyeç ci - après
C onclusio ns.
Conclure en procès par écrit, ou conclure un procès y
c’eft paffer, c’eft-à-dire ligner un appointement ap-
pellé appointement de conclufion fur l’appel d’une
fentence rendue en procès par écrit : cet appointement
porte que le procès par écrit d’entre tel & tel
eft reçu 8c conclu pour juger en la maniéré accoutumée
, 8c que les parties font appointées à fournir
griefs, réponfes , faire produdions nouvelles , 8c
icelles contredire s’il y échet, 8c fauf à faire collation.
Cette derniere claufe vient de ce qu’anciçnne-
ment, lorfque les parties mettoient au greffe leur
produdion principale, avant de conclure le procès ,
le greffier la collationnoit pour voir fi elle étoit
complété ; ce qui ne fe fait plus préfentement.
Congé faute de conclure , eft le défaut qui eft donné
à l’intimé lorfque l’appellant refufe de conclure le
procès par écrit. Le profit de ce défaut emporte la
déchéance de l’appel, & la confirmation de la fentence.
Défaut faute de conclure, eft le défaut qui eft accordé
à l’appellant lorfque l’intimé refufe de conclure
le procès par écrit : le profit de ce défaut eft que l’intimé
eft déclaré déchu du profit de la fentence.
■
* CONCLUSION, f. f. (Logiq.) c’eft ainfi qu’on
appelle la propofition qu’on avoit à prouver , 8c
qu’on déduit des prémiffes. Voye^ Sy l lo g ism e .
On donne auffi le même nom généralement en Logique
, Métaphyfique, Morale, Sc Phyfique fcholaf-
tiques, aux différentes propofitions qu’on y démontre
, 8c aux démonftrations qu’on employé à cet effet.
Ainfi l’exiftence de Dieu eft une conclufion de
Métaphyfique. On intitule en ce fens les thefes cjui
ne font que des polirions de Philofophie rédigées
par paragraphes, conctufions de Philofophie, conclu-
fiones Phiiofophice.
C onclusion , dans l'art Oratoire , c’eft la derniere
partie du difeours, celle qui le termine. Elle
comprend elle-même deux parties , ou pour mieux
dire elle â deux fortes de fonctions : la première con-
fifte à faire une courte récapitulation des principales
preuves ; la fécondé confifte à exciter dans l’ame
des juges ou des auditeurs les fentimens qui peuvent
conduire à la perfuafion. La première partie demande
beaucoup de précifion, d’adreffe,& de difeerne-
ment, pour ne dire que ce qu’il faut, 8c pour rappeller
ert peu de mots ôc par des tours variés l’effentiel
ôc la fubftance des preuves qu’on a déployées dans
le difeours. Mais l’éloquence réferve fa plus grande
force pour la fécondé partie : c’eft par le fecours du
pathétique qu’elle domine 6c qu’elle triomphe. Voyeç
An a c é ph al éo se , Pé r o r a iso n , Pa s s io n ,R é c
a p itu l a t io n . (G)
C onclusions , (Jurifp.) font les fins auxquelles
tend une demande formée en juftice.
Un huiflier prend des conclufions par- un exploit
de demande.
Les procureurs en prennent par des requêtes verbales
6c autres, même par des défenfes, dires, brevets
, 8c autres procédures ; mais au parlement oii
la procédure fe fait plus régulièrement que dans la
plupart des autres tribunaux, on ne reconnoît de
conclufions valables en la forme que celles qui font
prifes par une requête, 6c qui font dans la dernier^
partie de la requête deftinée à contenir les conclu-
fions.
Les avocats prennent auffi des conclufions en plaidant
6c en écrivant.
Le miniftere public prend pareillement des conclufions
verbalement 6c par écrit.
Enfin il y a différentes fortes de conclufions que
nous expliquerons chacune féparément,
La forme des conclufions eft auffi différente,félon
les divers objets auxquels elles tendent.
On peut corriger, changer , augmenter ou ref*
treindre fes conclufions tant que les chofes font entières,
c’eft-à-dire tant que la partie adverfe n’en a
pas demandé ad e ,ou qu’il ne lui a pas étéodroyé.
Il y a encore un cas où l’on ne peut pas changer
fes conclufions, c’eft lorfqu’on s’eft reftreint à la fom-
me de ioo liv. pour être admis à la preuve teftimo-
niale ; on ne peut plus demander l’excédent lorfque
la preuve eft ordonnée.
Celui qui varie dans fes conclufions 6c qui occa-
fionne par-là des dépens, doit les fupporter comme
frais fruftratoires.
C o nclusions alternatives , font celles où
l’on donne à la partie adverfe l’option de deux cho-
fes qu’on lui demande.
C onclusions des Av o c a t s font de deux fortes
; les unes qu’ils prennent en plaidant, les autres
en écrivant.
Ils ne peuvent à l’audience prendre d’autres conclufions
que celles qui font portées par leurs pièces ,
à moins qu’ils ne foient affiftés de la partie ou du
procureur; auquel cas ils peuvent prendre de nouvelles
conclufions fur le barreau, qu’on appelle auffi
conclufions judiciaires , parce qu’elles font prifes en
jugement, c’eft-à-dire à l’audience.
Anciennement au parlement de Paris les avocats
ne prenoient point les conclufions des caufes qu’ils
plaidoient ; c’etoit le procureur qui affiftoit à la plaidoirie
, lequel à la fin de la caufe prenoit les conclufions
, 8c l’on n’alloit aux opinions qu’après que les
conclufions avoient été prifes ; c’eft ce que l’on voit
dans les anciens arrêts rédigés en latin, où immé<-
diatement avant le difpofitif il eft dit pofiquam conclu]
iim fuit in caufâ.
Mais depuis long-tems il eft d’ufage que les conclufions
fe prennent au commencement de la plaidoirie
, ce qui a été introduit afin que les juges- Con-
noiffent tout d’abord quel eft l’objet des faits 6c des
moyens qui vont leur être expofés ; ôc pour faciliter
l’expédition des affaires, on a difpenfé les procureurs
d’affifter à la plaidoirie des avocats , lefquels
en conféquence prennent eux-mêmes les conclufions
au commencement de la plaidoirie ; 8c comme en
cette partie ils fuppléent le procureur abfent, il eft
d’ufage qu’ils foient découverts en prenant les conclufions
, au lieu qu’en plaidant ils font toujours coq-,
verts.
Il eft néanmoins demeuré quelques veftiges de
l’ancien ufage, en ce que quand les juges veulent
aller aux opinions avant que les plaidoiries foient
finies, le préfident ordonne aux avocats de conclur
e , fur-tout pour ceux qui n’ont pas encore parlé ;
& dans les caufes du grand rôle , quoique les avocats
prennent leurs conclufions en commençant à
plaider au barreau, ils les reprennent en finiffant,
8c pour cet effet descendent du barreau où ils plaident,
dans le parquet ou enceinte de l’audience.
Les avocats prennent auffi des conclufions dans
les écritures qui font de leur miniftere ; mais pour
la validité de la procédure il faut qu’elles foient re-
prifes par requête, parce que le procureur efi domi-
nus litis, 8c a feul le pouvoir d’engager fa partie. "
C o nclusions sur le barreau , font celles
que les avocats ou les procureurs prennent verbalement
fur le barreau, fans qu’elles ayent été prifes
auparavant par requête ni par aucune autre procédure.
Voye[ ce qui en eft dit dans l’article précédent
par rapport aux avocats.
C onclusions co ndit ionnelles , font celles
que l’on ne prend que relativement aux cas 8c conditions
qui y font exprimés.
C o nclusions d é f in it iv e s , font celles qui tendent
à la décifion du fond de l’affaire, au lieu que
les conclufions interlocutoires ou préparatoires ne
tendent qu’à faire ordonner quelque inftrudion ou
procédure qui paroît préalable à la décifion du fond.
Le terme de conclufions définitives n’eft guere ufité
qu’en matière criminelle , où le miniftere public
après avoir donné de premières conclufions préparatoires
, en donne enîuite de définitives lorfque le
procès eft inftruit. Ces conclufions doivent être données
par écrit 8c cachetées, ôc elles ne doivent point
expliquer les raifons fur lefquelles elles font fondées.
Ordonnance de 16 jo , tit. xxjv.
Quand ces conclufions font à la décharge de l’ac-
eufé, elles commencent par ces mots, je n'empêche
pour le roi ; 8c lorfqu’elles tendent à quelque condamnation
elles commencent en ces termes, je requiers
pour le roi ; 8c.fi ces conclufions tendent à peine
afllidive, l’accufé eft interrogé fur la fellette. V ,
ci-après CONCLUSIONS PRÉPARATOIRES.
C onclusions judiciaires ou sur le ba rreau
, voye{ ci-devant CONCLUSIONS SUR LE BARREAU.
C onclusions des Gens du Roi , ou du Mi nistère
p u b l ic , ou du Pa rqu et , ou du Procu
reu r GÉNÉRAL , OU DU PROCUREUR DU R o i ,
font celles que le miniftere public prend dans les
caufes 6c procès, foit civils ou criminels , dans lefquels
le ro i, l’églife, ou le public font intéreffés. Il
y a des tribunaux où le miniftere public donne auffi
des conclufions dans les affaires des mineurs ; mais cela
n’eft pas d’ufage au parlement de Paris. V^ {C O N CLUSIONS
DÉFINITIVES & CONCLUSIONS PRÉPARATOIRES.
C onclusions préparatoires , font celles qui
ne tendent qu’à un interlocutoire, 6c à faire ordonner
quelque inftrudion ou procédure : ce terme eft
principalement ufité pour les conclufions prifes par
le miniftere public avant fes conclufions définitives.
Voye{ C onclusions déf in itiv es.
. C onclusions principales , font les premières
que l’on prend pour une partie , 6c dont on demande
l’adjudication par préférence aux conclufions qui
font enfuite prifes fubfidiairement.
C onclusions subsidiaires, font oppofées aux
conclufions principales, 8c ne font prifes que pour le
cas où le-juge feroit difficulté d’adjuger les premières
: on peut prendre différentes conclufions fubfidiai-
res les unes aux autres ; elles font principalement
'ufitées dans les tribunaux qui jugent en dernier reffort,
parce qu’il faut y défendre à toutes fins ou éve-
nemens. (A )
CONCOMBRE, f. m. (Hifi. nat. bot.) cucumis,
genre de plante à fleurs monopétales faites en forme
de cloches, ouvertes 6c découpées. Les unes font
ftériles 8c n’ont point d’embrion ; les autres font fécondes
6c portées fur un embrion qui devient dans
la fuite un fruit charnu, ordinairement fort alongé,
qui eft divifé en trois ou quatre loges, 6c qui renferme
des femences oblongues. Tournefort, infi.it. rei
herb. Voye^ Plan t e . ( / )
C oncombre , (Pharmac. & Dicte.') le concombre
ordinaire eft beaucoup plus employé dans nos cui-
fines que dans les boutiques des apothicaires : on les
fait entrer dans les potages 6c dans diffërens ragoûts.
La chair de ce fruit eft réellement un peu alimen-
teufe ; mais il eft peu d’eftomacs à qui la fadeur 8c
fon inertie ne devinffent nuifibles à la longue : il eft
vrai qu’on corrige ordinairement ces qualités par divers
affaifonnemens, mais cette précaution eft le
plus fouvent infuffifante. Voyei L égumes £ D ig
e st io n .
Quelques médecins recommandent l’ufage interne
des concombres dans les maladies des reins 8c de
la veffie , 8c fur-tout dans le calcul : mais il ne paroît
pas qu’on doive compter beaucoup fur cette
vertu lythontriptique ; au - moins peut - on avancer
que fi cette qualité eft réelle, elle eft affûrément
très-occulte.
La pulpe de concombre appliquée extérieurement
fur la tête, eft fort vantée pour la phrénéfie par Bar-
tholet 6c Borelli.
La graine de concombre, qui eft émulfive, eft une
des . quatre femences froides. Voye^ Semences
froides.
Les concombres verds 8c lorfqu’ils ne font encore
gros que comme le pouce ou à-peu-près, font ap-
pellés cornichons. Dans cet état on les conferve dans
le vinaigre 6c le f e l , ou dans la faumure, pour s’en
fervir dans le courant de l’année.
On mange les cornichons en falade feuls ou avec
d’autres plantes ; on les fait entrer auffi dans diffe—
rens ragoûts.
A ce degré d’immaturité le concombre ne peut guere
paffer que pour un affaifonnement, en général
affez indifférent quant à l’utilité ou aux inconvé-
niens diététiques , qui ne convient point cependant
aux eftomacs foibles 6c relâchés , ou peu familiari-
fés avec les légumes ,. je dirois prefque avec les
cornichons ; car fur cette matière nous fournies extrêmement
pauvres en préceptes généraux , 6c l’exr
périence de chaque particulier fur chaque aliment
particulier eft prefque le feul fondement fur lequel
nous puiffions établir encore les lois diététiques»
Voye^ D iet e , Légume , Assaisonn emen t, (fi)
C oncombre sauvag e , voye{ E l a t e r iu m .
CONCOMITANT, adj. (Gramm. 6* Théol.) qui
accompagne ; fe dit particulièrement en Théologie ,
d’une grâce que Dieu nous donne durant le cours
d’une adion pour la faire 8c la rendre méritoire.
Voye{ Grâce.
CONCORDANCE, f. f. terme de Grammaire. Ce
que je vais dire ici fur ce mot, 6c ce que je dis ailleurs
fur quelques autres de même efpece, n’eft que
pour les perfonnes pour qui ces mots ont été faits ,
6c qui ont à enfeigaer ou à en étudier la valeur ôc
l’ufage ; les autres feront mieux de paffer à quelque
article plus intéreffant. Que fi malgré cet avis ils
veulent s’amufer à lire ce que je dis ici. fur la concordance,
jeles prie de fonger qu’on parle en anatomif-
te à S. Cofme, en jurifconfulte aux écoles de D ro it ,
6c que je dois parler en grammairien quand j’explique
quelque terme de Grammaire.
Pour bien entendre le mot de concordance, il faut